
 |
Rennes-le-Château Juillet 2021
|
 |
Christian Doumergue
|
Alfred
Saunière, le Frère de l’Ombre
 L’histoire
mondialement connue du « Curé aux
milliards » de Rennes-le-Château est cristallisée
autour d’un seul homme :
l’abbé Bérenger Saunière (1852-1917). Peu
après son arrivée, en 1885, dans le
petit village audois, ce jeune curé se lança dans des
travaux de rénovation de
son église, puis de constructions (villa style Renaissance, tour
néo-gothique,
parcs et jardins luxuriants, etc.) hors de ses conditions de fortune.
Ce qui alimenta
vite l’idée qu’il avait trouvé un trésor. Cette
belle histoire, qui en ces
temps de désenchantement a la capacité de nous ouvrir les
portes du rêve, en
cache cependant une autre. En faisant de Bérenger
Saunière le seul héros de ce
qu’il est convenu d’appeler « l’Affaire de
Rennes-le-Château », les
nombreux ouvrages et articles parus sur le sujet ont oublié, ce
faisant, un
acteur tout aussi important pour l’histoire du lieu. Cet
« oublié », c’est Alfred Saunière
(1855-1905), le propre frère de l’abbé, si longtemps
resté dans l’ombre de
celui-ci que, jusqu’en 1994, son portrait (retrouvé dans les
papiers du curé de
Rennes) a été confondu avec celui de
Bérenger ! Ainsi, durant des
décennies, le visage affiché sur les couvertures de
livres et figurant dans
l’iconographie des articles n’était pas celui de Bérenger
mais d’Alfred. Confusion
des plus symboliques, à l’image de cette affaire pleine de faux
semblants et
d’illusions cachant la vérité. Un
pourvoyeur de fonds. L’étude
des archives (longtemps négligées) laissées
par l’abbé Saunière suffit à montrer l’importance
d’Alfred en ce qui concerne
les agissements de son frère à Rennes-le-Château.
Bérenger, on le sait à
présent depuis un certain temps, a pu commencer ses travaux de
restauration de
l’église (tombant littéralement en ruines à son
arrivée) grâce à des donations.
Celles de la comtesse de Chambord puis d’une certaine Marie
Cavailhé, vivant à
Coursan près de Narbonne. Mais cette œuvre ne fut possible dans
son ampleur que
par l’entremise des fonds apportés par son frère Alfred. A
partir de 1909, Bérenger fut inquiété par sa
hiérarchie, qui le pressa de justifier l’origine des fonds
grâce auxquels il put
ériger son fastueux domaine (sur lequel l’évêque de
Carcassonne voulait dès
lors mettre la main). Le curé de Rennes s’efforça alors
de minimiser au maximum
le rôle d’Alfred. Dans
un premier justificatif envoyé à sa
hiérarchie, Bérenger note avoir obtenu la somme de 600
Francs « De diverses
familles par mon frère. » Mais, en mars 1911, contraint
par les questions de sa
hiérarchie, il est obligé d’avouer une somme plus
conséquente. Une lettre qui
lui est adressée en date du 19 mars indique en effet que
Bérenger a désormais
reconnu avoir reçu par l’intermédiaire de son
frère la somme de… 55.000
Francs-or ! Cette somme, est-il précisé, a
été remise pour une part directement
par Alfred (25.000 Fr.), pour une part par des donateurs rentrés
en contact
avec Bérenger par l’intermédiaire de son frère. La
somme est importante. La commission chargée
de clarifier la comptabilité de l’abbé demande donc au
prêtre de se justifier
sur ce point. Le 25 mars, Bérenger répond à cette
question en notant : « Mon
frère étant prédicateur avait de nombreuses
relations : il servit
d’intermédiaire à ces générosités.
» Le
frère de l’ombre Pourquoi
Bérenger s’efforça-t-il de minimiser à
ce point les fonds amenés par son frère ?
Incontestablement, cela est lié à un
leitmotiv des correspondances du prêtre à l’époque
de son procès. Dans
plusieurs lettres en effet, il mentionne l’idée que
l’Evêché de Carcassonne lui
fait payer les fautes d’Alfred. Dans un brouillon de l’année
1909, datant du
tout début des démêlés de l’abbé, il
affirme ainsi avoir été « depuis assez
longtemps » prévenu que « le curé de
Rennes-le-Château devait s’attendre à expier
les fautes de son frère l’abbé mort trop tôt.
» Il
ne dit absolument rien de ces fautes, qui
apparaissent tout aussi discrètement évoquées dans
plusieurs lettres de cette
période. Ainsi, le 22 janvier 1909, l’abbé Rouanet, un
des proches amis de Bérenger,
lui recommande de ne pas s’engager dans un combat dont il ne pourrait
sortir
vainqueur. Comme argument, il utilise la façon dont la
mémoire de son frère a
été salie : « Que n’a-t-on pas dit de ton pauvre
frère, garde ta mémoire
intacte. » Il
est impossible, à ce jour, de se prononcer
sur la nature de ces fautes. Alfred eut un fils, avec une jeune femme
(Emilie
Salière), mais ce fils ne naquit qu’après sa mort.
Officiellement, les archives
épiscopales de Carcassonne ne contiennent rien à son
sujet, ce qui paraît
difficile à croire… Ce mystère-là reste donc
entier. Mais celui du rôle joué
par Alfred auprès de son frère s’est par contre
éclairci au fil de mes
recherches.
L’engagement
d’Alfred. Selon
Bérenger, c’est par ses activités de
prédication qu’Alfred recueillit l’essentiel des fonds
rapatriés à
Rennes-le-Château. Très tôt en effet, Alfred met un
terme à sa carrière de
prêtre. Ordonné en 1878, il est nommé Vicaire
à Alzonne. La paroisse est
importante. En 1876, elle compte quelques 1546 habitants. Alfred n’y
reste
cependant pas. À partir de 1880, il est nommé professeur
au Petit Séminaire de
Narbonne, un poste qu’il va occuper durablement jusqu’en 1892.Vers
1893, soit
deux ans avant qu’il devienne un important pourvoyeur de fonds pour son
frère,
un tournant radical s’opère dans sa carrière. Un rapport
du sous-préfet de
l’Aude daté du 13 octobre 1896, signale en effet qu’Alfred est
alors « prêtre
libre depuis environ 3 ans. » Le titre de « prêtre
libre » est ambigu car il
peut avoir plusieurs sens. Ici, il ne signifie pas qu’Alfred se soit
émancipé
de sa hiérarchie. Les rapports échangés durant
cette période avec le Ministre
des Cultes indiquent au contraire qu’il est encore prêtre.
L’adjectif « libre »
indique simplement qu’il n’est pas affecté à une paroisse
en particulier. Cette
« liberté » va permettre à Alfred d’entamer
une carrière de missionnaire.
Alfred, établi à Narbonne, a dès lors le statut de
« prédicateur. » Or il va,
dans ce rôle, très vite prendre une certaine envergure
politique. En
1896, l’Evêché le choisit pour devenir «
aumônier militaire en cas de mobilisation du 16e corps
d’armée. » Selon la
procédure en vigueur, cette nomination doit recevoir l’aval du
Ministre des
Cultes. Une enquête est donc ouverte. Et c’est le Préfet
de l’Aude qui en a la
charge. Les éléments qui ressortent au fil de cette
enquête ne seront pas
favorables à Alfred. La nomination proposée lui est donc
refusée. La cause de
ce refus : son engagement politique. Les dernières lignes du
rapport du Sous-Préfet
au Préfet indiquent : « M. Saunière est hostile au
Gouvernement et à la
République. » Impossible, dès lors, de lui laisser
la possibilité d’exercer une
quelconque influence sur des militaires. La République est alors
dans la
crainte du coup d’état militaire. Quelques années plus
tard, cette crainte sera
à l’origine du scandale de l’ « Affaire des
fiches ». Cette
enquête est précieuse, essentielle, pour
éclairer la personnalité d’Alfred. Le rapport du
Sous-préfet contient en effet
plusieurs indications précises. Il indique que « pendant
quelques années »,
Alfred a été « le directeur et le rédacteur
principal du journal “ La Croix du
Midi ” qui s’imprimait à Narbonne. » Le
Sous-Préfet commet ici une petite
approximation. Si Alfred a bien dirigé un journal, c’est La
Croix du Sud
et non La Croix du Midi. La confusion s’explique par le fait
suivant :
en avril 1895, lorsque La Croix du Sud, qui s’imprimait
à Narbonne,
cessa sa publication, ses abonnés reçurent en
échange La Croix du Midi,
qui s’imprimait à Toulouse. Mais peu importe cette petite
erreur. Le rapport du
Sous-Préfet de 1896 met en lumière l’engagement politique
d’Alfred ! Au
sujet de celui-ci, des précisions
supplémentaires sont données dans un autre rapport du
Sous-Préfet de Narbonne
au Préfet de l’Aude. Daté du 16 septembre 1902, ce
nouveau rapport a été
réalisé suite à une sollicitation d’Alfred
auprès du Ministère des Cultes,
sollicitation dont on ignore la teneur. Le rapport indique seulement
qu’Alfred
« a sollicité l’intervention de M. Douarche, bouiller
général, auprès de la
Direction Générale des Cultes. » Plus
précis et détaillé que le précédent,
ce
rapport indique : « M. l’abbé Saunière prêtre
intelligent et actif a jusqu’ici
mis au service de la cause anti républicaine les qualités
qu’on se plait à
reconnaître en lui. Placé à la direction du Cercle
catholique de Narbonne où
tous ses efforts tendent à recruter le plus d’adeptes possibles
à la politique
des réactionnaires, il n’est pas de circonstances où son
intervention n’ait été
motivée par le désir de combattre le Gouvernement et de
lui faire échec par
tous les moyens. Il est à peu près établi que la
plupart des articles agressifs
visant le Ministère et parus dans le “Courrier de Narbonne” ont
été inspirés
par cet ecclésiastique s’ils n’ont pas été
écrits de sa propre main, et que
lui-même n’est pas étranger aux manœuvres [et] aux faits
de pression dont
certains électeurs sont l’objet chaque fois qu’une
élection a lieu dans cette
ville. » Le
Cercle Catholique Dans
ce rapport, une information au sujet
d’Alfred attire particulièrement l’attention :
« Placé à la direction
du Cercle catholique de Narbonne ». Le
Cercle Catholique de Narbonne s’inscrit dans
un mouvement plus large de constitution, un peu partout en France, de
Cercles
catholiques ouvriers. Le premier est créé à Paris
en 1873, à l’initiative du
comte de Mun (1841-1914), de François René de la Tour du
Pin Chambly, marquis
de la Charce (1834-1924), Félix de Roquefeuil-Cahuzac et Maurice
Maignen,
désireux de ramener la France dans « les voies
chrétiennes. » En
l’espace de deux ans, 110 cercles du même type sont fondés
un peu partout sur
le territoire et regroupent quelques 12.000 ouvriers. En 1878, ce sont
375
cercles qui ont été constitués. Ils totalisent
37.500 ouvriers et 7600 membres
issus des classes dirigeantes. C’est dans ce contexte qu’est
créé le Cercle
Catholique de Narbonne, le 16 avril 1875, par 23 membres fondateurs
appartenant
à de riches familles du Narbonnais. Officiellement
œuvres de bienfaisance offrant
des avantages à leurs membres issus des classes populaires (bons
de réductions
dans certaines boutiques alimentaires, accès à des salles
de jeux, à des
bibliothèques, etc.), les Cercles Catholiques sont en fait de
formidables
outils de manipulation et de propagande politique, d’abord
destinés à permettre
le retour du comte de Chambord (1820-1883) en France – ensuite à
répandre et
entretenir l’idéalisme catholique et à lutter contre la
République. Ce qui
passe par la constitution d’un tentaculaire réseau d’influence
(à Narbonne, la
Commission Archéologique de la ville sera ainsi mise
« sous
influence ») et l’élaboration de puissants
réseaux de financement occultes
(le Cercle de Narbonne est particulièrement actif en ce
domaine). Les Cercles
sont de vrais instruments de guerre, dans ce climat où
s’opposent encore, et
pour quelques temps, farouchement deux France.  Le
Courrier de Narbonne
et le Cercle
Catholique. Le
rapport du sous-préfet de Narbonne contient,
à côté des informations sur Alfred et le Cercle
Catholique de Narbonne, un
autre détail important dès lors qu’il s’agit de
reconstituer la vie oubliée du
« frère de l’ombre ». C’est le fait que
plusieurs articles du Courrier
de Narbonne furent inspirés ou signés par Alfred (la
difficulté à
déterminer son rôle exact tient au fait que la plupart des
articles parus dans
le quotidien ne sont pas signés…). Le
Courrier de Narbonne
se définit comme un «
journal politique, agricole, commercial, scientifique,
littéraire et
d’annonces. » Dirigé par Louis Fenetau, imprimeur à
Narbonne, il paraissait
tous les jeudis. La ligne du journal n’est pas ouvertement
réactionnaire. La
rédaction se défend d’ailleurs d’une telle ligne. «
Libre de toute attache,
n’appartenant à aucune coterie, nous répudions hautement
cette appellation de
réactionnaire que nous n’avons, d’ailleurs, jamais
mérité. » lit-on dans son
édition du 9 février 1896. Mais, malgré cette
affirmation, le Courrier de
Narbonne n’en reste pas moins un journal qui porte des idées
réactionnaires. Les articles hostiles au Gouvernement sont
légion, et le
journal se fait très clairement la voix du catholicisme
militant. Ainsi, par
exemple, sur la question de la séparation de l’Église
et de l’État,
publie-t-il
plusieurs articles fortement hostiles au principe. Dans son
édition du 21
février 1895, il affirme que « la séparation de l’Église
et de l’État
est impossible ». Dix ans avant que
la loi de Séparation n’advienne, il pose la chose comme ne
pouvant pas arriver
: « Nous sommes encore loin du jour où la Chambre aura
l’audace de se mettre en
opposition avec les traditions séculaires de neuf dixième
des Français. » L’engagement
religieux du journal est donc très
clair et souvent affirmé. « Le sentiment religieux est
chez nous une antique et
chère tradition, et tous les efforts de l’impiété
ne parviendront jamais à
l’étouffer. » peut-on lire, par exemple, le 18 avril 1895.
Ce genre de lignes –
peut-être inspirées par Alfred – laisse deviner la place
que celui-ci a pu
occuper dans l’élaboration du journal. Les
mentions que le Courrier de Narbonne
fait des activités du Cercle Catholique de Narbonne permettent
en outre de
mesurer l’aura que cette structure a pu avoir dans le milieu catholique
conservateur. Placé à sa tête, Alfred a pu, par
cette position, tisser un
important réseau relationnel. Outre
ses réunions « clandestines »
et plus ou moins confidentielles, où se dessinaient
stratégies et lignes
d’attaque, le Cercle Catholique organisait en effet de
régulières
manifestations qui drainaient un public important et choisi. Rendant
compte
d’une « Soirée récréative »
conjointement organisée par le Cercle Catholique et
le Patronage St Joseph (où Alfred a été
nommé aumônier en 1897) le 31 mars
1895, le Courrier de Narbonne (4 avril 1895) consigne : «
L’élite du
clergé et de la population narbonnaise catholique,
répondant à l’invitation qui
lui avait été faite, se pressait dans cette enceinte trop
étroite pour la
circonstance, avide de spectacle, mais désireuse aussi de
témoigner à Monsieur
l’Archiprêtre Cantegril toute sa sympathie pour l’école du
Sanctuaire. » Ce
milieu qualifié d’ « élite » par le
quotidien constitua un vivier de donateurs pour Alfred. Il n’est
d’ailleurs pas
étonnant que l’on retrouve dans les colonnes du Courrier de
Narbonne, le
nom de Louis Cavailhé qualifié d’ « ami » par
la rédaction du journal. Comme je
l’ai signalé en introduction de cet article, Marie
Cavailhé fut la seconde grande
donatrice de Bérenger à Rennes. Il est désormais
établi qu’elle fut amenée à
réaliser cette donation par l’intermédiaire du Cercle
Catholique. L’engagement
public. Incontestablement,
l’engagement d’Alfred à la
tête du Cercle Catholique comme dans la presse locale, lui valut
une envergure
d’homme public. Et ce d’autant plus qu’Alfred est reconnu par les
membres du
Cercle comme un orateur exceptionnel. Le 25 décembre 1900,
à l’occasion des
noces d’argent du Cercle, il fera plusieurs discours remarqués
pour leur
caractère saisissant. Pour Alfred, les Cercles Catholiques sont
un instrument
de lutte contre l’âge de ténèbres que
prépare la République. Il est en guerre
et, pour mener cette guerre, il cherche (conformément à
la stratégie globale
des Cercles Catholiques) à rallier à sa cause les
ouvriers. Au cours d’un
discours édifiant, il entend bien détourner ceux-ci des
sirènes de la
République, en leur rappelant l’aide apportée aux
ouvriers par le
christianisme, qui dès l’Antiquité abolit l’esclavage. Ce
talent oratoire, Alfred va l’utiliser lors
de nombreuses réunions publiques. Un article paru dans L’Echo
de Narbonne
du dimanche 8 octobre 1899, en dit long à ce sujet. Alfred,
simplement appelé
l’abbé Saunière (l’implication des milieux
réactionnaires narbonnais ne laisse
cependant aucun doute sur son identité) est en effet
présenté comme un acteur
de premier plan des forces politiques réactionnaires locales. Intitulé
« La Réunion de Cuxac », l’article
commence en ces termes : « Jeudi soir, M. Félix Liouville,
allié de M. l’abbé
Saunière et de M. de Beauxhostes, candidat malheureux,
chaleureusement soutenu
aux élections du 26 février dernier par toutes les
feuilles réactionnaires et
cléricales, depuis le Messager jusqu’à l’Express
en passant par
le Courrier et l’Éclair, était venu faire
une conférence
politique. » Se
concentrant sur Félix Liouville, la suite de
l’article ne nomme plus explicitement Alfred Saunière. Mais il
est d’un intérêt
essentiel pour comprendre pourquoi certaines familles
réactionnaires alimentèrent
à ce point l’œuvre de Bérenger Saunière. Ce court
article présente en effet
Alfred comme un allié politique de premier rang de M. de
Beauxhostes. Or, les
Beauxhostes figurent parmi les plus importants donateurs de
Bérenger. Bérenger
reconnut avoir reçu de Mme de Beauxhostes la somme de 10.000
Francs-or. Une
somme déjà importante, qu’il faut peut-être majorer
à 25.000 Francs-or, somme
attribuée, sur un autre actif de situation, à une
certaine Mme X que Pierre
Jarnac identifie à Mme de Beauxhostes. J’ai
pu ainsi établir que tous les premiers et
plus importants donateurs de l’abbé Saunière sont, d’une
façon ou d’une autre,
rattachés au Cercle Catholique de Narbonne. La devise de ce
dernier (à l’instar
de tous les Cercles Catholiques de France) était :
« In hoc signo
vinces » (« Par ce signe tu
vaincras ») que l’on retrouve sur le
tympan de l’église de Rennes-le-Château. Comme une
signature des donateurs de
Bérenger Saunière.  Soulever
le voile… L’Histoire
ne retient parfois que l’apparence
des choses. Le mythe du « curé aux
milliards » s’est construit autour
de la figure de Bérenger Saunière. Elle a, ce faisant,
oublié « l’homme
derrière le rideau ». C’est progressivement que l’on
redécouvre Alfred
Saunière. Longtemps ignoré au profit de son frère,
Alfred est resté méconnu à
cause de l’importante carence documentaire à son sujet. Rien, ou
presque, n’a
été conservé le concernant dans les papiers de son
frère. Diverses raisons
expliquent sans doute cela, dont la raison morale n’est sans doute pas
la moindre.
Sans doute chercha-t-on à se débarrasser des papiers
personnels de cet
ecclésiastique dont la vie fut, de notoriété
publique, entachée de « fautes »
aujourd’hui oubliées. Les « archives de l’abbé
Saunière » ne nous apprennent
ainsi rien à son sujet. Il est pourtant un maillon essentiel
pour comprendre
les origines de l’ « Affaire de Rennes ».
Par sa position,
Alfred est celui des frères Saunière qui a le plus de
relations et qui va
mettre son frère Bérenger en contact avec certains
milieux. Dans
les dernières années du XIXe
siècle et les toutes premières du XXe, c’est
lui l’homme qui brille. Difficile
de suivre sa trace cependant. Mais la persévérance
paye. Ainsi, je viens de retrouver ce qui semble être une preuve
de sa
fréquentation régulière des lieux mondains. Les
stations thermales sont alors
très fréquentées. On y vient pour se montrer, pour
briller. Le journal
hebdomadaire Aulus Mondain, organe officiel de la station
thermale
d’Aulus-les-Bains en Ariège, publiait ainsi dans chacune de ses
éditions une
« liste des étrangers » annonçant
tous les nouveaux arrivés dans la
petite ville. Rubrique mondaine par excellence. Or dans son
édition du dimanche
15 août 1897 (n°4886), Aulus Mondain annonce
l’arrivée, parmi les
« étrangers » venant pour la plupart de la
région, mais pour certains
de beaucoup plus loin (de Bordeaux, de Paris, mais aussi d’Italie…) de
« M. l’abbé Saunière, Montozels
[sic] » Étant donné qu’à cette
époque
Bérenger est établi à Rennes-le-Château, et
y officie, il ne fait pas de doute
que l’abbé Saunière en question est Alfred. Ce qui
soulève une question :
dans quel but vint-il séjourner à Aulus-les-Bains ? Alfred
s’impose ainsi, aujourd’hui, comme une
piste de recherche des plus importantes pour continuer à
comprendre ce qui se
cache vraiment derrière l’Énigme
de Rennes. Les
cercles réactionnaires de l’époque sont une
des clés pour comprendre quels réseaux ont pu financer
les travaux de l’abbé
Saunière (ce qui n’exclut pas que ce dernier ait fait des
découvertes
trésoraires, ses recherches en la matière étant
avérées et documentées !).
Alfred est aussi, sans doute, une des clés pour comprendre
certaines
ramifications plus « occultes » de l’affaire. Car
les Cercles
Catholiques paraissent être le point de convergence de plusieurs
milieux.
Ouvertement, ils sont réactionnaires et incarnent un
catholicisme dur (anti
maçonnique et antisémite). Sur ce dernier point, L’Echo
de Narbonne du
11 février 1900 rapporte une anecdote significative. On y voit
Alfred démarcher
chaque commerçant de Narbonne afin qu’ils s’abonnent au Messager,
l’un
des journaux réactionnaires sur lequel il exerce son influence.
En échange de
l’abonnement, Alfred leur promet une publicité gratuite dans le
quotidien, afin
« d’empêcher les consommateurs de s’adresser aux juifs
ou bien à des
maisons du dehors » (non situées à Narbonne). Mais
cette ligne dure s’efface vite lorsque
l’on dépasse ces apparences. La lutte contre la
République a poussé à certaines
alliances et, sur ce sujet, j’ai relevé quelques indices,
probants, voire des preuves,
de liens entre les Cercles Catholiques et une certaine
Franc-Maçonnerie. J’ai
noté, ailleurs (dans mon livre Franc-Maçonnerie et
Histoire de France,
publié aux éditions de l’Opportun) que certains membres
de Cercles Catholiques
entretenaient des relations proches avec Oswald Wirth (1860-1943) qui
mena, au
sein de la Franc-Maçonnerie, un rude combat pour redonner
à l’Ordre sa
dimension spirituelle et contrer les forces matérialistes qui le
dévoraient.
Louis Amiable (1837-1897), Grand Orateur du Grand Collège des
Rites, lors de
violentes attaques contre Wirth, dira à propos de ce
dernier : « Il
est allé faire à Lyon et Clermont-Ferrand des
conférences sur l’occultisme,
ayant pour zélateurs deux jeunes prêtres, meneurs
d’ouvriers, enrôlés dans les
cercles catholiques. » Cela
met en lumière que certains ont cru, à
l’époque, en une nécessaire « union des
forces » spirituelles. D’autres
essaieront par la suite de la porter, en vain. Une telle union a-t-elle
eu lieu
autour du Cercle de Narbonne ? Plusieurs présomptions
existent à ce sujet,
comme le lien passé entre certaines familles fondatrices du
Cercle (en
l’occurrence les Chefdebien) et la Franc-Maçonnerie. Poursuivant
mes recherches
à ce sujet, j’ai récemment découvert un autre
indice de ce lien. Dans son
édition du 22 mai 1898, L’Echo de Narbonne, journal
républicain et
anticlérical, attaque les rapports entre le Cercle Catholique de
Narbonne et Edmond
Bartissol (1841-1916), franc-maçon initié à la
loge Saint-Jean-des-Arts de
Perpignan. L’article de L’Echo est virulent,
dénonçant aussi bien
l’opportunisme de Bartissol que l’hypocrisie des membres du Cercle,
à commencer
par Alfred Saunière. L’auteur de l’article tonne ainsi :
« Franc-Maçon, Bartissol l’est, nous pouvons
l’affirmer à M. de
Beauxhostes et à son lieutenant en chef politique, l’abbé
Saunière, qui du
reste, s’en moque comme de son premier sermon. » Plus loin,
l’auteur de
l’article ironise : « …nous espérons que les
curés qui donnent de la
copie au Messager et les laïcs atteints de cagotisme, nous
feront grâce
après l’adoption de M. Bartissol, de leur indignation
conventionnelle pour la
maçonnerie en général et la libre pensée en
particulier. Nous y gagnerons
toujours cela, et c’est quelque chose. » Cet
article révèle que les lignes de frontière
entre des milieux que tout oppose extérieurement sont parfois
bien plus
incertaines qu’on ne le dit. Edmond Bartissol qui s’engage
auprès des cléricaux
alors qu’il est le propriétaire des murs de la Loge
Saint-Jean-des-Arts et
reste affilié à la Franc-Maçonnerie en est un
exemple. Le Cercle Catholique de
Narbonne en est un autre exemple. Sans doute est-ce en ce milieu encore
mal
connu que réside une des clés majeures de l’Énigme,
dont Alfred fut, peut-être, un des gardiens. 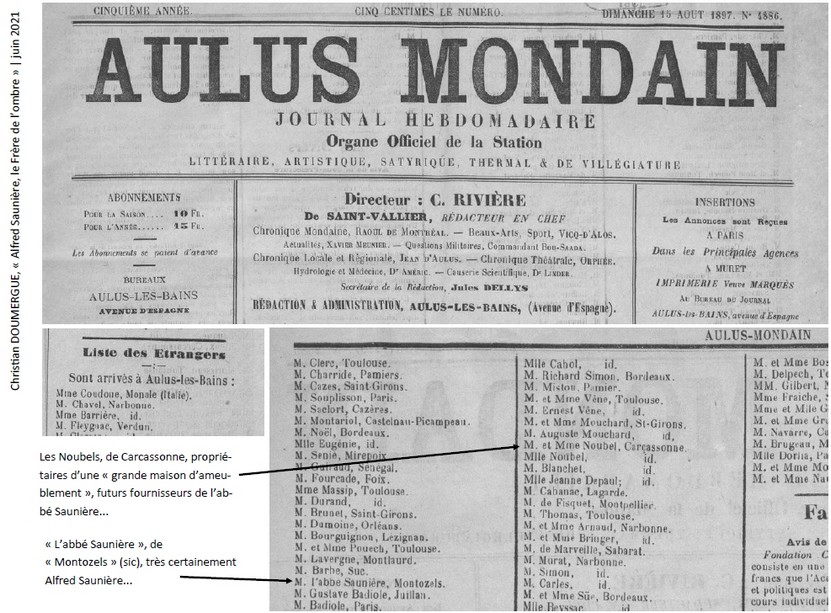 |
|
Christian
DOUMERGUE est l’auteur
de nombreux ouvrages, parmi lesquels « Le Secret
dévoilé. Enquête sur les
mystères de Rennes-le-Château » (éditions de
l’Opportun) et « Le Cercle de
Narbonne » (éditions Arqa), auxquels le
présent article apporte des
éléments supplémentaires qu’il a récemment
découverts. 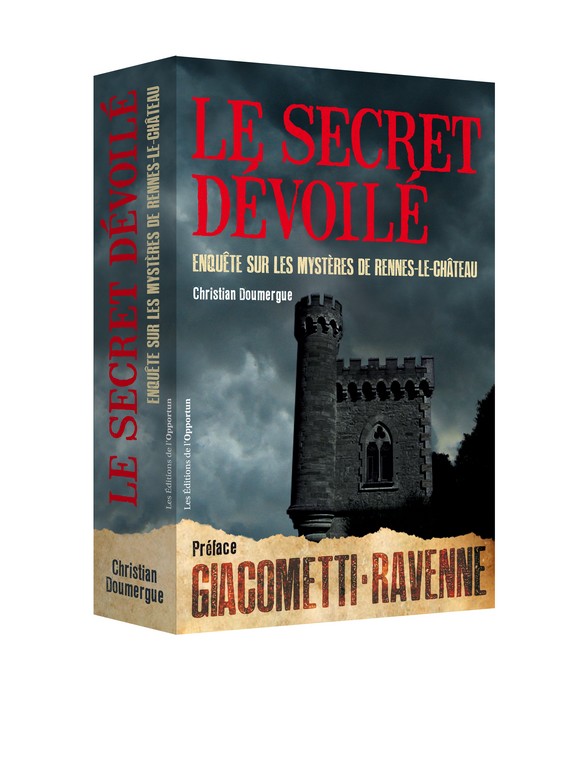 J'ai lu un certain nombre d'ouvrages
touchant de près ou de plus loin l'Affaire de
Rennes-le-Château. Le Secret Dévoilé de Christian
reste sans comparaison aucune le meilleur de ceux-ci. On commence enfin
à comprendre ce Mystère avec des sources et des arguments
clairs. Alfred Saunière, mais pas que, y tient toute sa place.
Je recommande vraiment cet ouvrage à tous. Si vous avez un
intérêt et faites le choix de vous le procurer je vous
invite à prendre contact avec Dorian à La Librairie
Cadence de Lyon (04
78
42 48 21) A
cette même Librairie Cadence est disponible Les
Trésors du Pilat l'ouvrage de Thierry Rollat et Patrick Berlier. Thierry Rollat
|
 |