JUILLET
2022
|
ENTRETIEN-INTERVIEW
|
BERNARD
ETLICHER
|
Bernard
Etlicher est géographe, naturaliste,
Professeur émérite des Universités.
Parallèlement à son activité
professionnelle à l'Université de Saint Etienne, il a
assuré la présidence du
Conseil scientifique du Parc naturel Régional du Pilat de 2005
à l'année
dernière. Il est actuellement vice-Président de cette
structure. Lors des recherches importantes que nous
avons menées dans le secteur de la Pierre des Trois
Evêques, il y a quelques
années, nous avons eu la chance de le rencontrer une
première fois où il a
enrichi nos connaissances grâce à son regard scientifique.
C’est donc
aujourd’hui un honneur pour nous et pour nos internautes de le
recevoir dans nos colonnes. Vous trouverez à la fin de
l'entretien-interview les coordonnées de Bernard Etlicher ceci
si vous souhaitez réagir. |
 |
Bernard
Etlicher : Le titre de professeur émérite
des Universités nous est décerné lorsque,
pour reprendre l'expression consacrée, nous faisons valoir nos
droits à la
retraite. Décerné par l'Université
il
nous permet de continuer à avoir une activité
scientifique, mais nous
n'assurons plus de cours réguliers auprès des
étudiants. En ce qui me concerne,
géographe de
formation, j'ai enseigné à la faculté des Lettres et à la faculté des Sciences au
long d'une
carrière qui m'a mené de 1973 à 2017.
2 :
Les
Regards du Pilat : Vous
êtes très impliqué au Conseil
scientifique du Parc naturel Régional du Pilat. Pouvez-vous nous
définir les
rôles et les attributions de ce Conseil scientifique ?

3 :
Les
Regards du Pilat : Notre
massif montagneux possède
beaucoup d’attraits et génère bien des passions. Occuper
les responsabilités
qui sont les vôtres au sein du Parc, témoigne
manifestement de l’intérêt qui
vous anime pour cette institution. Comment en êtes-vous
arrivé à vous impliquer
au service des Pilatois ? Comment votre formation ou votre
parcours
professionnel vous ont-ils mené au Conseil scientifique du
Parc ?

4 :
Les
Regards du Pilat : En
1974, à sa création, le Parc
Naturel Régional du Pilat avait recensé un certain nombre
de zones naturelles
sensibles, à protéger. Parmi celles-ci se trouvait la
lande couvrant la colline
des Roches de Merlin. Depuis les années 90, à la suite de
l'incendie qui a
ravagé la colline quelques années plus tôt, on
assiste à une prolifération
spontanée de pins noirs d'Autriche, qui menacent le site
d'enrésinement. Si
rien n'est fait, dans quelque temps, les Roches de Merlin seront au
milieu des
bois. Déjà la vue, qui formait l'un des attraits du lieu,
est complètement
bouchée dans plusieurs directions. Certes, le site est un
terrain privé, mais
le Parc ne peut-il pas intervenir pour remédier à ce
problème ?

5 :
Les
Regards du Pilat : Le
Parc Naturel Régional du Pilat
devrait bientôt s'agrandir par l'annexion de communes
périphériques, situées en
Ardèche ou en Haute-Loire. Cet accroissement de son territoire
ne devrait-il
pas lui apporter une plus grande diversité de paysages, mais
aussi des natures
de sols différentes de celles qu'il possédait
déjà : terrains volcaniques pour
la Haute-Loire, peut-être calcaires pour l'Ardèche ?
6 :
Les
Regards du Pilat : Parlons
un peu patrimoine, même si ce
n'est pas la spécialité du conseil scientifique. Il y a
eu quelques initiatives
isolées pour tenter d'en dresser un inventaire. Georges
Pétillon, qui fut le
premier sous-directeur du Parc, avait réalisé une
série de fiches
archéologiques, essentiellement pour les régions nord-est
du Pilat, qui lui
étaient plus familières. Plus récemment,
l'association Visages de notre Pilat
avait publié un inventaire du patrimoine du canton de
Pélussin, et Jacques
Laversanne a fait de même pour le canton de
Saint-Genest-Malifaux. Ne
pensez-vous pas qu'il serait nécessaire d'établir un
inventaire exhaustif du
patrimoine pour l'ensemble du territoire du Parc ?
7 :
Les
Regards du Pilat : Lorsque
l’on évoque le Pilat, le
massif montagneux, on parle d’une montagne vieille. Le Pilat
s’avère en réalité
la pointe nord extrême de la chaine des Cévennes.
Qu’est-ce qu’une montagne
vieille ? Comment est-ce qu’on la différencie d’une
montagne jeune ?
8 :
Les
Regards du Pilat : Dernièrement,
vous avez été interviewé
par Robert Helsop dit Rob Hope, dans l’un de ses films,
consacrés au Pilat.
Vous intervenez principalement à propos des chirats du Pilat. Ce
phénomène propre
au Pilat et presque unique au monde mérite ici vos explications
sur l’arrivée
de ces roches entassées.
Leur
présence est due à la conjonction de deux
facteurs, combinaison que l'on ne
retrouve que très rarement, mais qui, ici, se trouve
réunie sur une assez grande
étendue qui dépasse
largement le domaine du Parc actuel.
Premier
facteur, une roche appelée
leptynite par les géologues, qui est
une roche métamorphique très claire, à cristaux
fins qui se comporte lors du
gel, fort différemment des autres roches
granitiques du Massif Central. Sous l'action des gels
sévères, de
l'ordre de -30°C, elle n'éclate pas en
formant du sable comme ailleurs dans la
région, mais des blocs pouvant atteindre le mètre et une
poudre fine, claire de
la taille des limons (soit entre 20 et 2 micrometres). Ce
caractère est lié à
la nature des cristaux qui la composent
(abondance de quartz), à leur disposition et à
leur taille.
Second
facteur,
le Pilat n'a pas connu, notamment lors de la dernière
période glaciaire,
de glaciers qui sont susceptibles de protéger la roche des
températures
extrêmes régnant lors de ces périodes, parce qu'il
n'est pas suffisamment
élevé. La limite des neiges permanentes au-dessus
de laquelle la montagne est couverte de glace se
situe
lors de la dernière glaciation, à 1450 m dans les
Monts du Forez, 1500 m
dans le massif du Mézenc, et autour de 1700 m dans le Vercors
pour ne citer que les massifs les plus
proches; comme
vous le savez, le Pilat n'atteint que 1430m et encore, sur une surface
très
réduite et il faut donc imaginer un déneigement chaque
été du massif, alors
même que les périodes de gel sont très
fréquentes probablement même en été. Ces
conditions sont à même de fracturer la roche et à
produire des blocs en grande
quantité.
Le
processus de formation du chirat se fait
donc en deux temps : la
fracturation de la roche libère des blocs de toute taille
à partir des
sommets ; ces blocs tombent sur les versants et s'y entassent
permettant,
dans un second temps, la mise en mouvement de cette accumulation. Ils
progressent en masse vers le bas du versant, en une langue qui peut
atteindre
plusieurs centaines de mètres voire le kilomètre dans les
cas les plus
spectaculaires. Lors des étés, la neige font sur la
surface des blocs mais
l'eau de fonte regèle en profondeur entre les blocs, car le sol
est gelé en
permanence, et cette glace de regel cimente les blocs entre eux ce qui
permet à
la masse de blocs de fluer lentement vers le bas.
La
vitesse de déplacement du chirat était du
même ordre que celle d'un glacier et se mesure en dm/ an.
Aujourd'hui, comme la glace intersticielle
a fondu, le
chirat n'est plus mobile. Il est figé. Encore aujourd'hui on
constate que la
température dans le chirat en
été est
bien plus fraiche qu'en surface, les
blocs s'opposant au rayonnement solaire au point que cette
caractéristique a
été utilisée autrefois
pour aménager des
glacières pour la conservation de produits alimentaires (fromage) voire de pains de glaces faits par de neige
tassée,
vendue en ville pendant
l'été.

Photo Patrick
Berlier - Le Chirat du Crêt de La Perdrix
9 :
Les
Regards du Pilat : En
2020 une association, « des
Pierres et des Hommes », a vu le jour dans le Pilat. Elle a
notamment
vocation à recenser le patrimoine lithique du Pilat. Avec votre
recul et votre
expérience, parleriez-vous d’un patrimoine mégalithique,
plutôt riche ou plutôt
pauvre ?
Une
approche scientifique pluridisciplinaire de
la question permettrait de mieux la cerner et d'avancer des
hypothèses
plausibles sans garantie de certitude, mais elle éviterait de
diffuser des
interprétations fantaisistes qui ne résistent pas
à un examen sérieux. Il y a
dans ce domaine un foisonnement de littérature
sujette à caution. En grande partie,
ceci est dû à l'absence de démarche
scientifique dans l'étude ces phénomènes.
Pour analyser de telles
structures ou formes il faut impérativement accepter de croiser
et débattre
entre scientifiques d'horizons et de formations différentes. Ceci est aussi vrai pour les chercheurs
professionnels que les amateurs, même si ce réflexe est
logiquement plus fréquent chez les
premiers que chez les
seconds.
La
première question à se poser est la
suivante : la forme ou la structure peut-elle avoir
été
« construite » par la nature ? De la
réponse à cette question
découle la suite du raisonnement et force est de constater que
beaucoup
d'écrits ne la posent pas. Pour y répondre, les
archéologues amateurs doivent
impérativement faire appel aux
spécialistes concernés, le plus souvent géologues
ou géomorphologues qui,
seuls, seront en mesure de répondre et dire si des formes
analogues sont connues ailleurs dans le
monde et si les
processus naturels connus peuvent
engendrer des formes ou structures
analogues.
En
cas de réponse négative, on peut dès lors
s'autoriser
à imaginer l'activité humaine. Mais assez souvent, il y a
des formes de
convergence entre les formes construites par l'homme et certaines
formes
naturelles. Dans ce cas, la sagesse consiste à ne les
interpréter comme humaines
que s'il y a des preuves archéologiques
d'une
fonction du lieu. Bien souvent d'ailleurs, la forme peut
être naturelle mais utilisée par des
hommes à des fins cultuelles ou autres.
C'est trop souvent parce que cette règle n'a pas
été respectée que des
polémiques se nouent voire souvent s'enveniment.
L'exemple
typique sont les cupules, ces petites
cuvettes que
l'on trouve à la surface des blocs rocheux, plus ou moins
remplies d'eau lors
des saisons humides. Elles existent partout sur certains types de
roches y compris
là où l'homme préhistorique n'a jamais mis les
pieds (iles antarctiques ou
Labrador par exemple). Elles peuvent
donc être naturelles, ce qui n'empêche nullement, qu'en
certains sites, elles
puissent avoir donné lieu à des cérémonies
mystiques voire même avoir été
réaménagées par l'homme. Mais en l'absence de
ces preuves l'explication naturelle se suffit à elle-même. La littérature abonde d'explications
laissant
croire à un creusement de ces cuvettes par des civilisations
protohistoriques
sans aucune preuve archéologique. Et
quand on trouve des traces d'usage cultuel à proximité de
rochers à cupules,
pourquoi se perdre en théories pour imaginer les outils utilisés alors qu'il suffit de chercher
un
peu pour en trouver fabriquées naturellement.
Pour
répondre à la première interrogation, la
pauvreté des sites
d'occupation avérés ne doit pas nous
étonner.
Les géographes antiques et César lui-même
n'évoquent qu'occasionnellement la
Cémène qui est une frontière
dans la
Gaule pendant plusieurs siècles entre la partie
romanisée, la Narbonnaise et les
principautés gauloises
situées le long de la Loire et de l'Allier. Preuve
que cet espace est mal connu, il est mal
situé sur les cartes de
l'époque,
orienté plus Est-Ouest que Nord-Sud. Visiblement, cette
région-frontière entre deux peuples est mal connue et
n'est pas ou peu humanisée. La
faiblesse des
témoignages archéologiques n'a donc rien
d'étonnant.
10 :
Les
Regards du Pilat : Le
Menhir du Flat, sur la commune de
Colombiers, s’impose comme un emblème mégalithique du
Parc naturel Régional du
Pilat. Apparemment, cette grosse roche semble avoir été
érigée naturellement
car reliée par son socle à la masse granitique qui
l’entoure. Que l’Homme ait
pu, en des temps reculés, travailler ce gros bloc et son
environnement ne paraît
pas anodin non plus. Que vous inspire ce site et pourquoi ?

11 :
Les
Regards du Pilat : Le
site des Trois Dents, est-il un chirat
en formation ? Ce sommet aurait été occupé
certainement dès la Préhistoire
par l’Homme. On observe toujours de nos jours une double enceinte.
Qu’avez-vous
à nous dire à propos de ce site notoire qui constitue un
marqueur géographique emblématique
du Parc naturel Régional du Pilat ?
L'existence
d'une structure empierrée plus ou
moins rectiligne est très visible sur
les photographies aériennes. Les observations faites d'une
construction avec
des parements me semblent indiscutables
notamment dans un article scientifique datant d'une petite dizaine
d'années et
une telle structure ne peut être
qu'une
construction humaine.
En
revanche, l'interprétation de cette
structure comme un côté d'un quadrilatère
permettant d'envisager l'existence une enceinte fermée et donc un usage défensif ne m'a pas
totalement
convaincu. Je m'explique mal qu'on
puisse interpréter les
accumulations de
pierres un peu plus haut sur le versant comme
les restes d'une structure parallèle à la
première constituant le
côté opposé du
rectangle comme des constructions
défensives. Ceci d'autant qu'il ne
reste rien
d'observable des deux autres
côtés du
rectangle imaginé dans le sens de la pente. Au
pied du versant rocheux, je
les interpréterais plutôt comme des moraines de
névé pour les raisons
suivantes :
-
Elles ne sont pas exactement dans le
prolongement l'une de l'autre ni parallèles à la
structure évoquée ci-dessus.
-
Elles sont au pied et parallèles à la base du
versant rocheux qui les domine. L'espace qui les sépare (la
porte évoquée
dans les publications) où la moraine disparaît
correspond à un endroit où la crête rocheuse
s'abaisse en une sorte de col ou de passage qui permet
de gagner le versant nord de la dent et
qui est donc ouvert au vent du nord; la disparition de la moraine de
né vé
au droit du col est logique lorsque on connaît
le mode de formation
de ces moraines de névé
situées
toujours en position d'abri au vent dominant..
Ces
formes naturelles sont moins connues que
les moraines glaciaires, et il me semble utile de préciser en
quelques mots
leur morphologie et les mécanismes de leur formation. Ce sont des formes qui se développent encore
actuellement
en haute montagne ; dans les Alpes on en trouve d'actives vers
2400 à 2700
m, mais il est possible d'en repérer plus bas qui ne
fonctionnent plus
aujourd'hui. Ces formes se développent 300 m environ en dessous
de la ligne des
neiges permanentes, là où
des névés
accumulés l'hiver subsistent tardivement et ne fondent qu'en fin
d'été. Le
mécanisme de formation est simple : au printemps, le gel de
la nuit
fracture les rochers, et dans la journée où
l'élévation de température fait
dégeler la roche, surtout en exposition sud, ce qui est le cas
ici. Le
rocher dégèle
et des blocs tombent sur le névé. La surface
de celui -ci est durcie par ces alternances, et le bloc glisse en luge,
il
s'arrête à l'aval du névé. Si le
névé peut certaines années atteindre une
épaisseur importante, plusieurs mètres, il se forme une
accumulation linéaire
des blocs quelques mètres en avant de la paroi rocheuse, comme
le montre la
photo dans le massif du Canigou. Au droit du col, le vent s'engouffre
et la
neige est soufflée, il n'y a pas
d'accumulation de neige et la pente est trop faible pour que des blocs
se détachent
et tombent, le mécanisme ne fonctionne pas, d'où la pseudo porte évoquée dans les
publications.
Mon
analyse est ici qu'il pourrait exister deux
structures d'origine
distincte ;
deux moraines de névé en mauvais état de
conservation à l'amont car
probablement anciennes : l'altitude
est trop faible par rapport à l'enneigement actuel pour qu'elles
soient actives
aujourd'hui et une structure
linéaire plus bas qu'il est
effectivement vraisemblable de considérer
comme construite par l'homme.
L'origine
et la finalité de cet alignement de
blocs inférieurs reste en grande partie mystérieux. Les
sondages récents n'ont
rien trouvé permettant de dater et
de
définir l'usage de cette construction. L'hypothèse d'une
construction défensive
pourrait être retenue s'il s'avère que l'on observe une
structure identique sur
le versant nord, cependant qui n'est pas visible sur
toutes les missions aériennes mais se confond
souvent avec le
chirat qui est sur ce versant. Quand on connaît
la dynamique des blocs
à la surface du chirat, cassures, basculements en surface voire
parfois de
véritables structure d'effondrement, on peut s'interroger sur
l'ancienneté
d'une construction qui traverserait le
chirat en travers sans être démantelée…

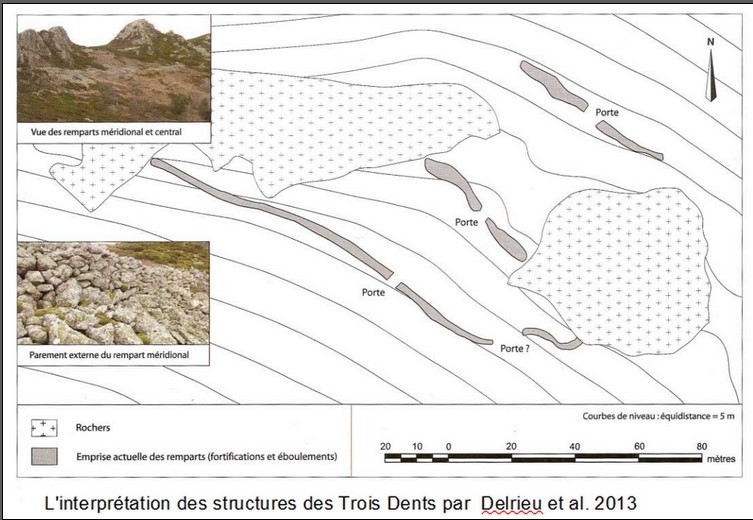
Vue du site
On suit clairement l'alignement de blocs inférieur évoquant
un
cheminement et les deux petites structures de part et d'autre du
passage entre
les deux dents.
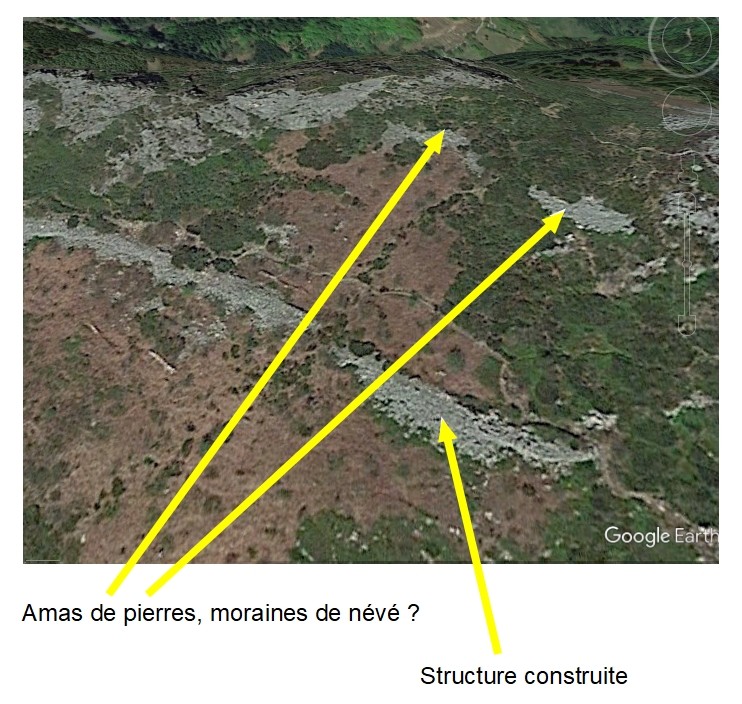

Bernard
Etlicher : L'attrait du site avec son caractère
spectaculaire, le chirat démarrant immédiatement sous la
chapelle est l'un des
plus beaux points de vue du massif.
L'ancienneté
de l'intérêt pour le site,
est souligné par la présence de
la chapelle bien sûr, la
construction
actuelle et celles qui l'ont précédé puisque des
ruines de constructions
antérieures ont été découvertes. Plus
anciennes, certaines constructions, enceintes,
ont été décrites, avec un degré de
vraisemblance probablement plus grand qu'aux
Trois Dents, même si l'âge précis de
ces occupations n'a, à ma connaissance, pas pu être
prouvé à ce jour.
Quant
à la légende de la
présence et même de la
conversion religieuse de Ponce Pilate, il
faut s'en garder…
elle fait fi des
connaissances historiques et géographiques qui sont les
nôtres à ce jour. D'une
part les conversions au catholicisme en Gaule sont
plus tardives, d'autre part il faut savoir
que la même légende existe
en Suisse au
Mont Pilate, près de Lucerne, où
on a aussi
fait monter Ponce
Pilate ! Et on y raconte le même itinéraire, avec la Jasserie, le lac au sommet et
le précipice ! Mieux, la
confusion va
plus loin, parmi les premiers ouvrages
qui décrivent la végétation du Pilat, couramment
cités par les amateurs locaux,
il en existe au moins un qui, en fait, décrit la
végétation du Mont
Pilate ; les espèces qui y sont décrites ne peuvent, pour certaines, avoir été
observées au Mont Pilat à cause de
leurs exigences écologiques, altitude et nature calcaire des roches…
Je ne saurais
trop pour conclure, qu'inciter les
amateurs à être très
prudents dans leurs
analyses de notre patrimoine…

Photo Patrick Berlier - La
Chapelle de Saint-Sabin
Les
Regards du Pilat : Merci beaucoup, Monsieur Etlicher pour l'ensemble de
vos réponses, toutes instructives, à plus d'un titre.
Vos
éventuelles remarques ou autres questions complémentaires
sont les bienvenues.
Vous
pouvez les poser directement à notre invité : etlicher42@gmail.com
ou
encore à : thierry.rollat2@gmail.com
|
|