

|
|
OCTOBRE
2023 |
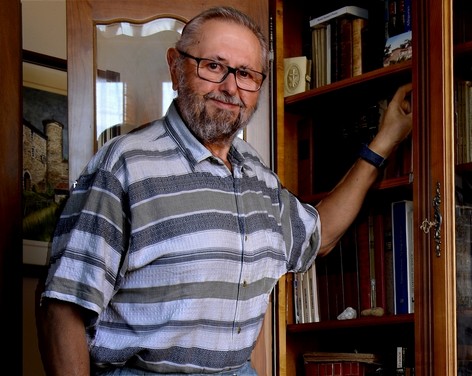
|
Par
Notre Ami
Patrick
BERLIER
|
BALADE
MÉGALITHIQUE AUTOUR D'ÉCHALAS
Cela fait maintenant
quelques années que chaque été nous convions nos amis à une balade découverte.
Pour cette année 2023, c'est le secteur d'Échalas qui a été choisi, et la date
le mardi 8 août. C'est par une belle journée que nous nous sommes retrouvés,
une grosse vingtaine de personnes, devant l'église du village. Cette
sympathique bourgade était autrefois connue pour sa spécialité, les rigottes
d'Échalas, petits fromages cylindriques de vaches, dont la particularité était
leur couleur jaune-orangée. Or à l'époque, dans les années 50 probablement,
l'église avait été peinte, extérieurement, dans la même couleur, pour rappeler
la spécialité locale. Ainsi le village d'Échalas est-il repérable de fort loin
grâce à la couleur de son église.

L'église d'Échalas, aux couleurs des célèbres rigottes
Échalas se trouve
dans la partie du Parc Naturel Régional du Pilat située dans le département du
Rhône. Son nom viendrait soit des échalas, les pieux servant de tuteurs aux
pieds de vigne, en raison du passé viticole de la région, soit du mot échelle,
car Échalas se situe sur un degré intermédiaire entre la vallée du Gier et les
sommets du Pilat. On parle d'ailleurs, en termes de géographie, du
« gradin de Longes » à propos de cette région.

Patrick
Après ces
préliminaires, exposés rapidement et pour l'anecdote aux participants de la
balade, nous voilà partis en direction de l'est. La Croix de Marsicot passée,
la route oblique vers le sud. Nous abandonnons le bitume pour prendre un chemin
à droite, vers l'ouest donc. Après avoir longé la centrale électrique, où
aboutissent de multiples lignes à haute tension, nous voici en vue de la Madone
d'Échalas, humble statue de la Vierge juchée sur un pilier de pierres, datant
de 1899. La pause est la bienvenue, mais nous ne tardons pas à reprendre notre
périple.

Pause aux pieds de Notre-Dame d'Échalas
Nous nous sommes
fixés trois objectifs, trois sites mégalithiques signalés en 1986 par Marcel
Boyer dans sa brochure Échalas - Notes sur quelques pierres gravées. Le
premier objectif est la Pierre du Mézerin. C'est le nom du ruisseau qui coule
au fond de la combe sauvage séparant les communes d'Échalas et Trèves. Il nous
faut d'abord passer à travers champ pour atteindre le pylône servant de repère.
Nos guides savent qu'ensuite nous devrons descendre plein sud à travers la
lande du coteau, sur quelques dizaines de mètres. Plus simple à dire qu'à
faire, parce que la végétation est dense, et que quelques ronces ont poussé au
milieu des bruyères, mais nous parvenons à atteindre la fameuse pierre. C'est
un bloc oblong de micaschiste, d'un peu moins de de 2 m de long, posé sur un
affleurement de rocher et calé avec des pierres sèches. C'est vrai qu'elle
ressemble étrangement à la célèbre Pierre qui Chante des Roches de Marlin. Mais
c'est loin d'être sa sœur jumelle, car elle est plus petite, et ne présente pas
les mêmes bassins. On y voit seulement quelques petites cupules et des croix
gravées, ce qui fait dire qu'il s'agirait plutôt d'une borne, une limite de
propriétés. Néanmoins son aspect mégalithique n'est pas à dédaigner. Éric
explique en quoi elle est liée à l'église d'Échalas, qui a sans doute remplacé
un site païen.

La Pierre du Mézerin
Nous remontons vers
le pylône. Lionel nous invite à une lecture de paysage. Il est vrai que la vue
est dégagée. Face à nous, de l'autre côté de la vallée du Mézerin, s'étalent
les maisons des hameaux de la Basse-Dhuire et de la Haute-Dhuire. Juste au-dessus,
on aperçoit les véhicules roulant sur la D 502, la route qui va de la vallée du
Gier à la vallée du Rhône, en passant par Trèves, le Fautre, le col du Pilon et
Condrieu. C'est à peu de choses près un tronçon de la voie antique qui allait
de Feurs à Vienne, autrement dit de la vallée de la Loire à celle du Rhône.
Elle fut utilisée pour le transport de l'étain, extrait des mines britanniques
et acheminé à travers toute la France jusqu'à la Méditerranée.

Pause lecture de paysage sur le coteau du Mézerin
Lionel évoque la
présence au bord de cette route de la Croix de Saint-Adon, entre Trèves et le
Pilon. Nous n'irons pas la voir mais nous en avons un dessin. C'est une humble
croix de fer forgé, plantée dans un socle maçonné, portant la date 1767. Saint
Adon fut évêque de Vienne au IXe siècle. C'est par ses écrits que
l'on apprend que Ponce Pilate fut exilé en Gaule près de Vienne. Il était sans
doute normal de lui rendre hommage par cette croix sur la route de Vienne.
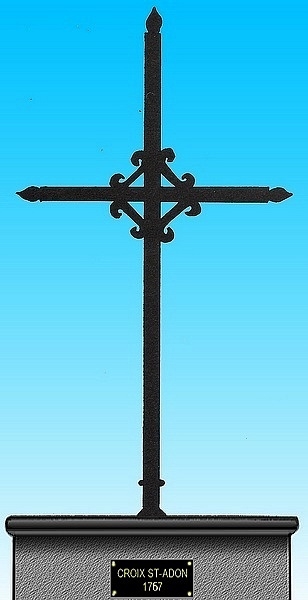
La croix de Saint-Adon (d'après un dessin de Patrick Berlier)
Midi, il est temps de
trouver un lieu accueillant pour le pique-nique. C'est à l'ombre d'un bouquet
d'arbres que nous prenons cette pause. Guy et Pierre-Bernard y vont de leur
chanson, racontant les hilarantes aventures de l'homme de Cro-Magnon. Les meilleures
choses ayant une fin, il nous faut bien nous remettre en route pour atteindre
le deuxième site mégalithique inscrit au programme de la journée. Il n'est qu'à
deux pas, juste le champ à traverser. Alors voici enfin la Pierre du Gonty, du
nom du hameau le plus proche, dite aussi Pierre Blanche ou Pierre Guittard.
Autant de noms pouvant désigner un officiant au temps des druides. Nul doute
que cette pierre dut être un lieu de culte.

La Pierre du Gonty, Pierre Blanche ou Pierre Guittard
À la fin des années
70, les premiers chercheurs qui s'intéressèrent à cette pierre la trouvèrent
facilement, car elle était au milieu d'un pré, bien dégagée et visible de très
loin. Elle offrait d'ailleurs un vaste panorama sur le Pilat d'un côté, et sur
les Monts du Lyonnais de l'autre. En outre, elle était représentée sur la carte
IGN par une sorte de petite étoile, ce qui était le symbole signalant un rocher
isolé. Aujourd'hui ce n'est plus le cas...
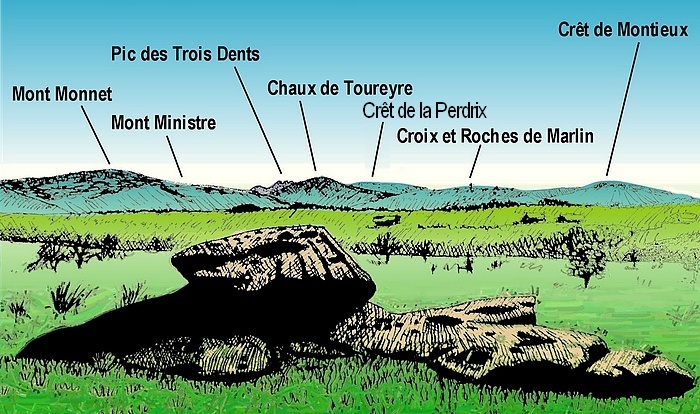
La pierre et son environnement en 1979 (dessin de Patrick
Berlier)
La pierre étant
entourée d'une zone dense de genêts et broussailles, on ne la voit plus de
loin, mais heureusement Lionel est venu en repérage quelques jours plus
tôt.C'est un nouveau rocher de micaschiste, d'environ 6 m de long, qui
visiblement a été taillé, pour dégager un bloc central plus ou moins
circulaire. Le reste du rocher se répartit en trois langues de pierre peu
épaisses, comme si c'était un corps humain, avec les deux jambes d'un côté, le
ventre rebondi au centre, et le reste du corps de l'autre côté. Pour Éric,
c'est une déesse-mère couchée sur le dos. Ce qui frappe au premier abord, ce
sont les cupules et bassins creusés dans les différentes parties de la
pierre. Le plus gros bassin, de 38 cm de
diamètre, se situe sur ce qui pourrait être la cuisse gauche de la déesse.

Le plus gros bassin
Sur sa cuisse droite,
il y a lun joli groupe de 7 cupules, ressemblant trop à une constellation pour
que l'on n'envisage pas l'éventualité d'une carte céleste. Plusieurs
constellations sont formées de 7 étoiles, et celle qui ressemble le plus à ce
groupe de 7 cupules est la constellation du Dauphin.
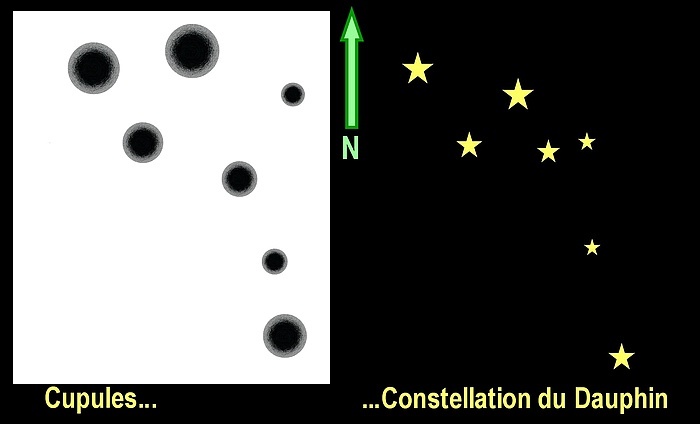
Une carte céleste ?
Nous constatons très
vite que toutes les parties de la pierre sont couvertes de cupules, nous
renonçons à les compter mais il y en a bien au moins 80. Certaines cupules sont
carrées, ou rectangulaires, mais celles-là ne remontent sans doute pas à cette
époque que Jean Combe nommait les Temps perdus, l'époque des mégalithes. Ces
trous-là auraient été creusées par les topographes romains pour servir à caler
leurs instruments de mesure, ancêtres du théodolite.

Le rocher central
À travers champ nous
rejoignons la route, que nous traversons pour prendre en face un chemin
champêtre. Nous nous dirigeons vers le Crêt Guillon, un nom connu par tradition
orale mais qui n'apparaît pas sur les cartes. C'est une colline peu élevée, au
nord-ouest d'Échalas, dont le sommet à la cote 307 m marque la limite entre
Échalas et Saint-Romain-en-Gier. C'est au point culminant que nous attend le
troisième mégalithe, une petite pierre à cupules, constituée d'un affleurement
de micaschiste, de forme triangulaire, d'un peu moins de 2 m de long. Nous
aurions pu y passer à côté sans même la remarquer, mais nos guides qui en
connaissaient l'emplacement avec précision nous y emmènent sans hésitation.
Cette pierre est creusée d'une quinzaine de cupules, certaines groupées par
deux, comme des yeux. On y voit également une croix, et deux gravures en forme
de flèche.

La pierre du Crêt Guillon
Éric explique que la
même distance, exactement 2152 m, sépare la pierre du Mézerin de la pierre du
Crêt Guillon, et ladite pierre du Mézerin du chœur de l'église d'Échalas. Nous
restons songeurs à l'énoncé de ces découvertes. Comment les hommes des Temps
perdus ont-ils fait pour mesurer ces distances ? Autre curiosité, si l'on
trace ces deux axes sur une carte, et si l'on joint par un troisième trait la
pierre du Crêt Guillon à l'église d'Échalas, on obtient un triangle, lequel
ressemble bien singulièrement à celui formé par la pierre du Crêt Guillon.
Hasard, bien sûr, rien ne ressemble plus à un triangle qu'un autre triangle,
surtout tourné dans le même sens, alors c'est seulement une coïncidence. À
moins que...
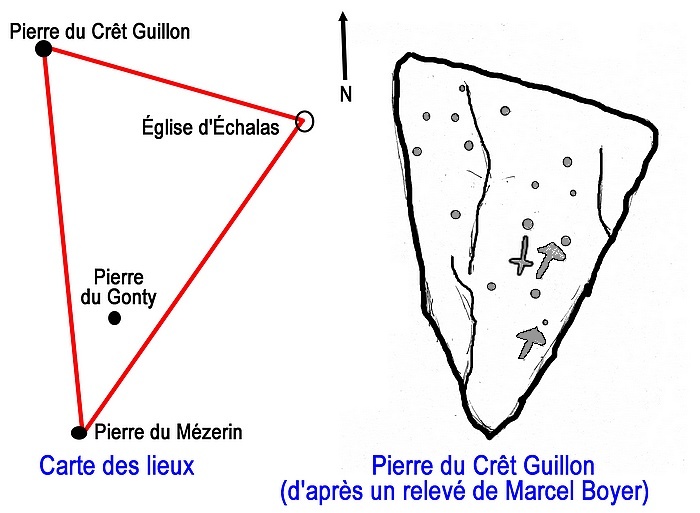
Mystères des Temps perdus
C'est en méditant sur
ces mystères que nous revenons à Échalas. Pour finir la journée, Lionel nous
invite chez lui, dans sa maison du Fay à Trèves, pour boire le verre de
l'amitié. C'est l'occasion de revoir, ou de découvrir pour ceux qui ne le
connaissaient pas, le portail avec l'arc outrepassé, et la fameuse clé de voûte
datée de 1757. Nous garderons tous le souvenir d'une journée exceptionnelle...
| |