HUGUES DE
PAGAN, FONDATEUR DE L'ORDRE DU TEMPLE
QUI
ÉTAIT-IL VRAIMENT ?
Après
que les chrétiens eurent reconquis la Terre
Sainte à la fin du XIe siècle lors des
premières croisades, les
pèlerins commencèrent à y affluer depuis toute
l'Europe. Cependant, si les
croisés tenaient les villes, les routes qui y conduisaient
restaient
dangereuses. Aussi pour assurer leur sécurité, vers 1118
quelques chevaliers se
réunirent pour former la Milice des Pauvres Chevaliers du
Christ. Installée à
l'emplacement du Temple de Salomon, cette confrérie devint
l'Ordre du Temple,
et ses membres furent rapidement surnommés les Templiers.
Tous les
historiens s'accordent sur l'identité du
fondateur et premier grand-maître de l'ordre du Temple. Dans les
actes du
concile de Troyes, qui en 1129 officialisa son existence, ce fondateur
était
désigné sous le nom de « Frère
Hugues » ou « Maître
Hugues ». C'est un peu plus tard que son nom patronymique
fut révélé.
C'était un certain Hugo de Paganis, un nom latin qui s'est
trouvé transposé en
français sous diverses orthographes : Payns, Payens, Payen,
Pagan, etc. À
l'époque, on écrivait les noms comme on les entendait,
aussi plus de cinquante
versions différentes de celui-ci ont-elles été
recensées.

Hugues
de Payns
(Musée
national des châteaux de Versailles et de Trianon)
Si
l'identité du fondateur de l'ordre du Temple
ne fait aucun doute, en revanche ses origines géographiques
restent imprécises.
Était-il Champenois comme on le prétend
généralement, ou Ardéchois, ou encore
Provençal ? J'ai consacré à cette
interrogation un chapitre du tome II de
mon livre La Société Angélique (réédité
en 2015 en un seul volume, Arqa
éditions). Plus récemment, est paru le livre de Pierre
Gaugier : Hugues
Pagan, fondateur provençal de l'ordre du Temple (éditions
Odes, 2021). Tout
serait-il dit sur le sujet ? Pas forcément, car s'il
apporte certaines
réponses, le livre de Pierre Gaugier soulève aussi
plusieurs questions, et
l'opportunité de faire le point une nouvelle fois se justifie
pleinement.
DES ORIGINES
INCERTAINES
Les
historiens du Temple voient en Hugues de
Payns un chevalier champenois, originaire de Payns, une bourgade proche
de
Troyes. En vérité, cette localisation repose sur des
éléments bien fragiles
comme il sera expliqué plus loin. D'autres historiens, souvent
à vocation plus
régionaliste, préférant l'orthographe Hugues de
Pagan, n'hésitent pas à le voir
originaire du Vivarais, autrement dit le département de
l'Ardèche. Si cette
localisation géographique s'avérait exacte, notre homme
serait ainsi né à deux
pas du Pilat. Enfin une autre version le voit originaire de la
région des
gorges du Verdon en Provence.
Pour corser
la difficulté, on trouve le nom Pagan
écrit tantôt avec une particule (Hugues de Pagan) et
tantôt sans (Hugues
Pagan). La particule paraît avoir été
rajoutée pour donner un air plus noble à
cette famille. Pagan semble donc être un surnom
(« paysan,
villageois », ou encore
« païen ») plutôt que l'indication
d'un
lieu d'origine.
En raison de
ces imprécisions, beaucoup de
familles du nom de Payns, Payens, Payan ou Pagan, ont vu dans le
fondateur des
Templiers leur ancêtre le plus illustre. On peut citer par
exemple la branche
des Pagan d'Avignon. Ainsi dans le livre Divers ouvrages de M. le
comte de
Pagan, trouvés dans ses écrits après sa mort
(1669) apparaît ce passage à
propos d'Hugues de Pagan :
« Encore
que
ce héros ait pris sa naissance dans l’Italie ; étant
d’origine Française,
& sorti de la maison de Bretagne : Nous ferons revivre sa
gloire en ce
lieu, & les éloges de ses Vertus se verront parmi celles de
nos fameux
Capitaines. » (Transcription
en français
moderne)
Comme il
était très à la mode à l'époque de
se
doter d'un aïeul célèbre, et de
préférence d'origine italienne, le comte de
Pagan aurait cédé à cet engouement en
s'improvisant généalogiste et en faisant
du fondateur des Templiers l'un de ses ascendants, voyant ses
ancêtres italiens
franchir les Alpes, autour de l'an mille, pour s'installer en Avignon
après
être passés par la Bretagne. C'est au cours d'un combat
épique contre les
Sarrasins qu'ils auraient gagné leur surnom Pagan variante de
païen, pour
signifier qu'ils avaient écrasé ces païens lors de
la bataille.
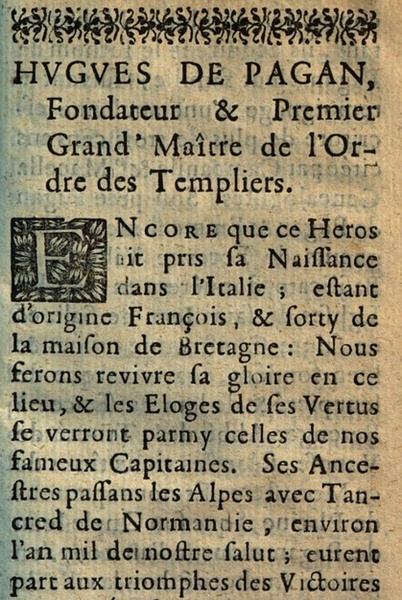
Page
du livre du comte de Pagan évoquant son prétendu
ancêtre
La plus
ancienne mention du nom d'Hugo de Paganis,
sans indication de son origine, se trouve dans l'Histoire des
croisades
de Guillaume de Tyr, cardinal et chroniqueur, qui vécut au XIIe
siècle. Voici ce qu'il écrivait dans le livre XII,
chapitre VII de son ouvrage,
rédigé en latin :
« Eodem
anno, quidam nobiles
viri de equestri ordine, Deo devoti, religiosi et timentes Deum, in
manu domini
patriarchae, Christi servitio se mancipantes, more canonicorum
Regularium, in
castitate, et obedientia, et sine proprio velle perpetuo vivere
professi sunt.
Inter quos primi et praecipui fuerunt, viri venerabiles, Hugo de
Paganis et
Gaufredus de
Sancto Aldemaro. »
Soit en français :
« Dans
le cours de la même année, quelques nobles chevaliers,
hommes dévoués à Dieu et
animés de sentiments religieux, se consacrèrent au
service du Christ, et firent
profession entre les mains du patriarche de vivre à jamais,
ainsi que les
chanoines réguliers, dans la chasteté,
l'obéissance et la pauvreté. Les
premiers et les plus distingués d'entre eux furent deux hommes
vénérables, Hugues
de Payns et Geoffroi de Saint-Aldemar. »
Cette traduction
est celle qui fut publiée en 1824 par M. Guizot.
Mais bien longtemps avant, vers 1170, Héraclius ou
Éraclès d'Auvergne,
patriarche de Jérusalem, avait proposé une
première traduction de ce livre, en
français de l'époque. Concernant les noms des deux
premiers Templiers, voici ce
qu'il écrivait :
« Luns
ot non Hues de Paiens delez troies, li autres
Geufroiz de Saint Omer. »
Soit en
français moderne :
« L'un
avait nom Hugues de Payns à côté de Troyes, l'autre
Geoffroy de Saint-Omer. »
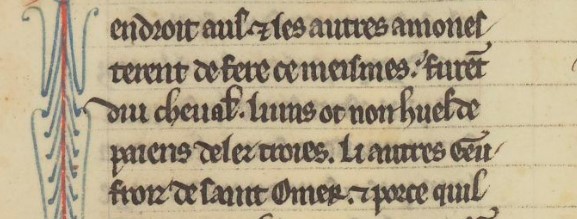
Passage de la
traduction d'Héraclius
d'Auvergne
situant l'origine d'Hugues de Payns près de Troyes
Héraclius
d'Auvergne transforme Saint-Aldemar en Saint-Omer, ce
qui correspond à la dérive courante d'Aldemar en Audemar
puis Omer. C'est ainsi
qu'a évolué le toponyme Saint-Omer, nom d'une
localité dans le Pas-de-Calais.
Mais ce qui est plus gênant, c'est qu'Héraclius se permet
d'ajouter au texte de
Guillaume de Tyr la mention « à côté de
Troyes », donnant par là à
Hugues de Payns une origine géographique proche de Troyes en
Champagne, ce qui
correspond bien à la ville de Payns. Il est ainsi le premier
à prétendre pour
le fondateur de l'ordre du Temple une origine champenoise.
Héraclius
possédait-il des informations que n'avait pas Guillaume de
Tyr ? Il ne
faut pas perdre de vue que les deux hommes étaient des ennemis
irréductibles,
et qu'ils n'hésitaient pas à se déstabiliser l'un
l'autre quand l'occasion se
présentait. C'était peut-être bien à cet
objectif que répondait l'ajout
d'Héraclius. Néanmoins, forts de cette affirmation, les
Champenois ont proclamé
Hugues de Payns enfant de leur pays.
Guillaume de Tyr
eut un continuateur dans la personne de Jacques
de Vitry (1160-1240), évêque d'Acre et historien. Dans son
ouvrage Historia
orientalis seu Hierosolymitana il cite les deux fondateurs de
l'ordre du
Temple : « Hugues de Pains et Geoffroi de
Saint-Aldemar ». Mais
il ne reprend pas l'ajout d'Héraclius sur l'origine champenoise
du premier. En
fait, parmi tous les chroniqueurs de cette époque,
Héraclius est le seul à
donner cette indication.
Quatre
siècles plus tard, c'est l'humaniste italien Carlo Sigonio,
dit Sigonius, qui évoqua à nouveau Hugues de Pagan dans
son livre Historiarum
de regno Italiæ, publié en 1591. C'est un ouvrage
rédigé en latin, et voici
l'extrait :
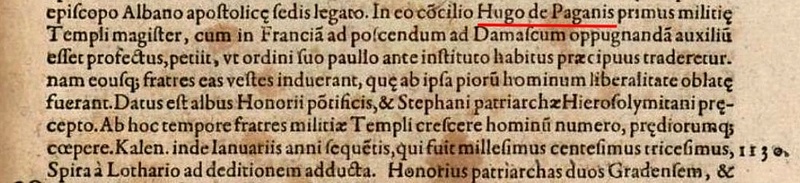
Passage du livre
de Sigonius évoquant
Hugues de Pagan
Ce texte
évoquait dans un paragraphe précédent le concile
de
Troyes. Le passage où il est question d'Hugues de Pagan peut se
traduire
ainsi :
« Dans
ce concile Hugues de Pagan premier maître de la
milice du Temple, puisqu'il partit en France pour obtenir de l'aide, en
vue du
siège de Damas, a demandé qu'elle
puisse être remise
à son ordre peu avant son institution principale. Car
au point que les frères avaient mis ces vêtements, qui
avaient été offerts par la libéralité
même des hommes pieux. Accordé par le
pape Honorius, et sur la recommandation
d’Étienne
le patriarche de Jérusalem. À partir de ce moment, les
frères de la milice du
Temple ont augmenté en nombre, et
les domaines ont
commencé à apparaître. Aux
calendes de Janvier de
l'année suivante, c'était en mille cent
trente. »
Notons que
Sigonius situe les événements en 1130. Il ne reprend
nullement l'affirmation d'Héraclius concernant l'origine
champenoise d'Hugues
de Pagan. Quelques décennies plus tard, d'autres auteurs vont
commencer à
évoquer un lieu de naissance bien différent.
UNE ORIGINE
ARDÉCHOISE ?
Avant d'en
venir à ces écrits des siècles passés,
commençons par l'époque moderne. Le premier auteur
contemporain à soutenir une
origine ardéchoise fut Gérard de Sède dans son
livre Les Templiers sont
parmi nous (Julliard, 1962). L'auteur, qui n'était pas
historien mais
journaliste, avait su trouver un style vif et agréable à
lire. Même si
aujourd'hui on reproche à Gérard de Sède d'avoir
fait de la pseudo-histoire,
son ouvrage connut à l'époque un succès certain,
et fut réédité en livre de
poche dans la collection L'aventure mystérieuse
(éditions J'ai Lu,
1969). Voici en quels termes l'auteur affirme l'origine
ardéchoise d'Hugues de
Payen :
« L'obscurité
qui a longtemps
entouré aux yeux des historiens la personnalité d'Hugues
de Payen, fondateur du
Temple, ne s'est pas entièrement dissipée à la
découverte de son acte de
naissance. »
Et cette
phrase sibylline est éclairée par une
note de bas de page :
« Contrairement
à la thèse de
plusieurs historiens qui l'ont cru originaire de Payns en Champagne,
Hugues de
Payen (ou Pagan) naquit le 9 février 1070 au château de
Mahun, commune de
Saint-Symphorien-de-Mahun, Ardèche. L'acte a été
retrouvé en 1897 (cf. Esquieu,
« Les Templiers de Cahors », in Bulletin de
la Société littéraire,
scientifique et artistique du Lot, 1898.) Son père
était surnommé « le
Maure de la Gardille » et était originaire de
Langogne, aux sources de
l'Allier (Al-liès). »

Ruines
du château de Mahun
Gérard
de Sède n'en disait pas plus. Il se
fondait uniquement sur ce bulletin d'une société savante,
cité en référence. Il
ignorait, apparemment, le travail de deux historiens régionaux.
Le premier est
l’abbé Jean-François Filhol, auteur d’une histoire
d’Annonay publiée en 1882,
ouvrage monumental en quatre volumes, dans lequel il défendait
la théorie d'une
origine ardéchoise du fondateur de l'ordre du Temple. Le second
est un
historien du Vivarais, Charles-Albin Mazon, qui mena une enquête
très serrée
après l'annonce en 1897 de la découverte de l'acte de
naissance d'Hugues de
Pagan. Il établit que cette nouvelle avait été
envoyée depuis Annonay au
journal Le petit Marseillais, et qu'elle s’était ensuite
répandue dans
toute la France. Mais jamais le père Jésuite, qui aurait
découvert le fameux
acte dans les archives du monastère de Veyrines, voisin de
Saint-Symphorien-de-Mahun, n’a été retrouvé, pas
plus que l'acte en question.
Charles-Albin
Mazon interrogea à ce sujet les
Jésuites d’Ay et de La Louvesc, ceux-ci lui avouèrent
« tout ignorer de
cette merveilleuse découverte ». Évidemment,
on sait ce que valent les
réponses toujours ambiguës des Jésuites, qui
possèdent une solide réputation à
ce sujet. L’un des leurs, Odo de Gissey, n’écrivait-il pas, dans
ses Discours
historiques de Notre-Dame du Puy (1644), à propos des deux
premiers
chevaliers à l’origine du Temple :
« L’un
de ces deux Gentilshommes était Hugues des
Payans, natif du Vivarais, d’un château proche de Vérines,
Prieuré dépendant de
celui de Macheville, annexé à notre
Collège » (Transcription
en français moderne)
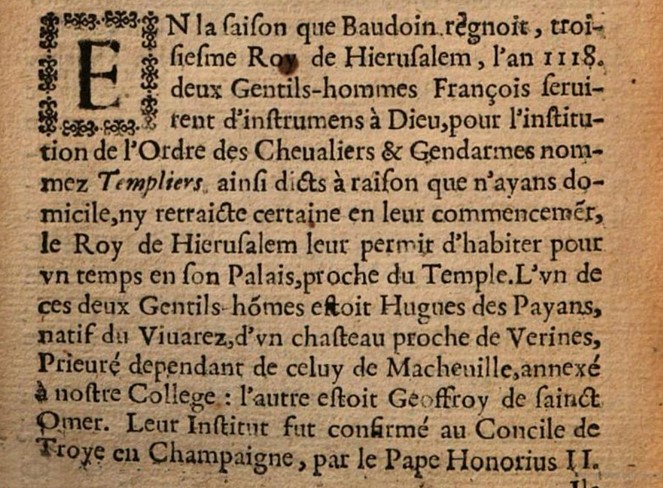
Passage
du livre d'Odo de Gissey évoquant Hugues des Payans
LE MANUSCRIT
DE CARPENTRAS
Il faudra
attendre 1972 et la publication du
livre de Laurent Dailliez Les Templiers ces inconnus (Librairie
académique Perrin) pour en apprendre un peu plus. Aux sources de
la théorie
d'une origine du Vivarais, se trouve ce manuscrit conservé par
la célèbre
Bibliothèque-musée Inguimbertine de Carpentras. Voici en
quels termes en parle
Laurent Dailliez :
« La
bibliothèque municipale de
Carpentras conserve un manuscrit rapportant un don du 29 janvier 1130,
de
Laugier, évêque d'Avignon. À cette occasion, Hugues
de Payens est signalé comme
originaire de Viviers, dans l'Ardèche. On ne voit pas la raison
de cette
mention. »
Il est bien
regrettable que l'auteur ne donne pas
la référence de ce manuscrit, ni sa source
bibliographique. La façon dont est
présentée cette information laisse à penser que ce
document est bien l'acte de
donation lui-même rédigé par l'évêque
Laugier, et il est vrai qu'un personnage
ainsi nommé fut bien évêque d'Avignon de 1124 (ou
1126) à 1142. Laurent
Dailliez, qui tient à l'origine champenoise d'Hugues de Payens,
croit devoir
ajouter « on ne voit pas la raison de cette
mention », pour
manifester son scepticisme quant à une éventuelle origine
ardéchoise. L'auteur
explique qu'à l'automne 1127 Hugues de Payens revint en France
pour recruter et
obtenir des subsides afin de financer son ordre. Il reçut en
effet de
nombreuses donations. Deux ans plus tard en 1129 le concile de Troyes
officialisera l'ordre du Temple et lui donnera sa règle. Dans le
courant de
l'année 1130 Hugues de Payens retournera en Terre Sainte,
où il mourra en 1136.
Presque
cinquante ans après Laurent Dailliez,
Pierre Gaugier écrit dans son livre :
« En
Provence, c'est Hugues
Pagan qui reçut une donation de l'évêque Laugier, Liaugeris,
de l'église
de Saint-Jean-le-Baptiste, sous la plus ancienne mention connue d'Hugo
de
Paganis. Cette charte du 29 janvier 1130, provenait des archives de la
maison
du Temple d'Avignon.
La
charte mentionne :
Hugoni
de Paganis
Vivariensis, primo militiæ Templi magistro.
Traduit
par :
''Hugues
de Pagan du Vivarais,
premier Maître militaire du Temple.'' »
Et en note de
bas de page :
« Charte
conservée à la
Bibliothèque Inguimbertine de Carpentras – manuscrit du prieur
chartreux Don
Polycarpe de la Rivière (1586-1639) – Folio : Annales
christianissimae
Ecclesiae et coronae Francorum (MS 515). »
Nous
pardonnerons à Pierre Gaugier les quelques
petites erreurs qui se sont glissées dans son texte, à
commencer par la
traduction proposée. Militiæ ne signifie pas
« militaire », ce
n'est pas un adjectif mais un nom, que l'on peut traduire par
« armée,
milice ». Militiæ Templi veut donc
dire « milice du
Temple ». C'est d'ailleurs une expression fréquemment
employée par
différents auteurs, au cours des siècles, comme Sigonius
ou Laurent Dailliez.
Nous saurons
gré en revanche à Pierre Gaugier de
révéler le nom de l'auteur du manuscrit, un personnage
qui est loin d'être un
inconnu pour nous, puisqu'il s'agit du Chartreux Dom Polycarpe de la
Rivière.
Sa biographie constitue la première partie du tome I de mon
livre La Société
Angélique et je lui ai consacré un dossier sur
Regards du Pilat, auquel se
réfère Wikipédia pour sa page consacrée
à ce Chartreux célèbre.
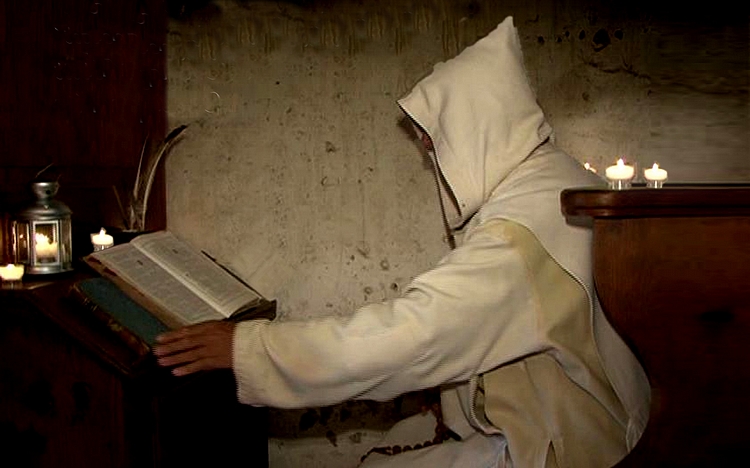
Dom
Polycarpe de la Rivière
(Photo extraite du film « Le Druide du Pilat »)
C'est en 1631
qu'il fut nommé prieur de la
chartreuse de Bonpas, près d'Avignon, où il resta
jusqu'en 1638. Dom Polycarpe
avait déjà publié plusieurs livres de
dévotion, mais arrivé en Provence il
entreprit de faire œuvre d'historien. Ses Annales auraient
dû raconter,
en langue latine et en 17 volumes, toute l'histoire des
évêchés, églises et
monastères de France, projet ambitieux pour lequel il avait
amassé, au fil des
années, des quantités de notes. Pris par ses charges de
prieur de Bonpas et de
visiteur de la Provence, et commençant à souffrir de
rhumatismes, il n'eut pas
le temps de venir à bout de son œuvre, qui resta
inachevée. La rédaction de
quelques volumes seulement était terminée, n'attendant
plus que leur
impression, deux d'entre eux étant consacrés au
diocèse d'Avignon.
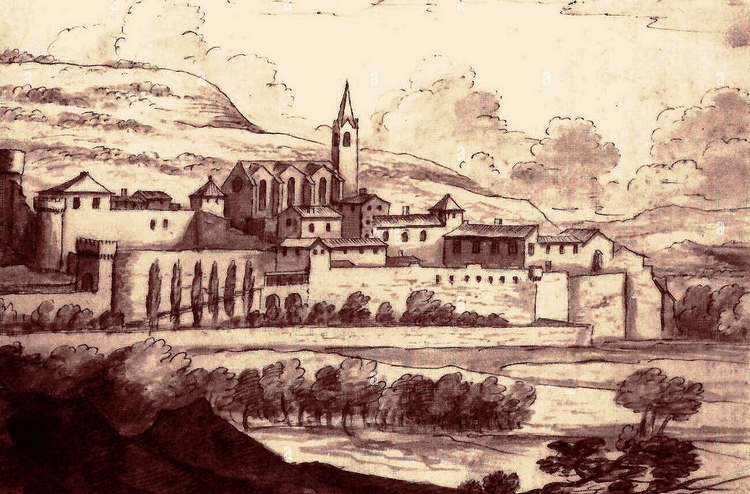
La
chartreuse de Bonpas au temps des Chartreux
(gravure ancienne)
En 1638, ses
douleurs ayant empiré, Dom Polycarpe
obtint d'être relevé de ses fonctions, et c'est en simple
religieux qu'il prit
la route de l'Auvergne pour aller suivre une cure au Mont-Dore. Il ne
laissa
pas ses manuscrits à Bonpas, mais avant son départ il les
confia à son ami
maître Raybaud, avocat à Arles. On sait que Dom Polycarpe
n'arriva jamais à
destination, et sa disparition reste inexpliquée. Au cours des
décennies qui
suivirent, ses manuscrits changèrent de mains, et finirent par
être légués à la
bibliothèque Inguimbertine, qui les conserve toujours.
Cependant le
texte de Pierre Gaugier est ambigu.
Il affirme que la charte de Laugier est conservée à la
bibliothèque
Inguimbertine, tout en signalant que l'auteur du manuscrit est Dom
Polycarpe de
la Rivière. J'ai voulu en avoir le cœur net. On trouve
facilement sur Internet
la version numérisée du Catalogue descriptif et
raisonné des manuscrits de
la bibliothèque de Carpentras, par C.-G.-A. Lambert (1862).
Or si cet
ouvrage recense bien le manuscrit de Dom Polycarpe, on n'y trouve
aucune
mention d'une « charte Laugier ».
Pour tirer
l'affaire au clair, j'ai envoyé un
mail à la bibliothèque Inguimbertine, dont un responsable
m'a répondu
rapidement, en me signalant qu'aucune « charte
Laugier » n'était
conservée par la bibliothèque, la donation de
l'évêque d'Avignon à l'ordre du
Temple étant seulement mentionnée par le manuscrit de Dom
Polycarpe de la
Rivière.
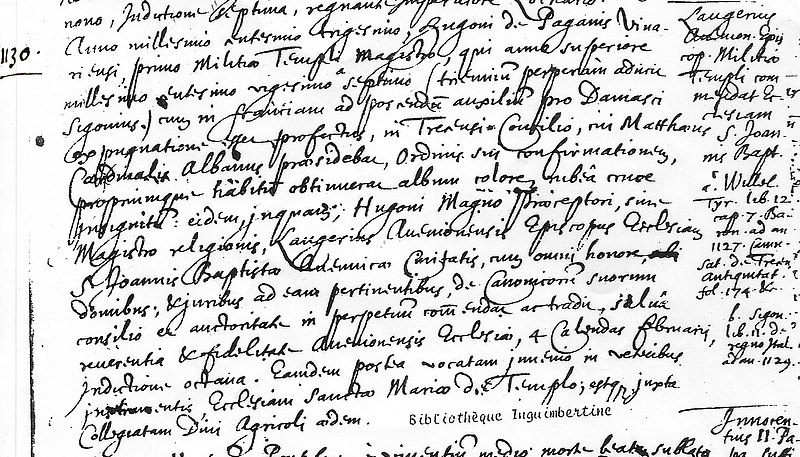
Passage
du manuscrit de Dom Polycarpe de la Rivière
évoquant Hugues de Pagan (Bibliothèque de Carpentras, Ms
515, page 679)
Cette
précision capitale étant apportée, il est
temps de nous pencher attentivement sur ledit manuscrit,
rédigé en latin. C'est
à la page 679 que nous trouvons le paragraphe en question. Dans la marge de gauche Dom Polycarpe a
noté le repère
chronologique : 1130. Dans la marge de droite, il a
rédigé un court résumé
du paragraphe, en quelques mots, le plus souvent
abrégés :
« Laugerius
Avenion.
Episcop. Militiæ Templi commendat Ecclesiam S. Joanis Bapt. »
Ce qui
signifie :
« Laugier
évêque d'Avignon
confie à la milice du Temple l'église
Saint-Jean-Baptiste. »
Suivent deux
renvois bibliographiques :
a. le
chapitre 7 du livre 12 de Guillaume de Tyr.
b.
le livre II de l'ouvrage De
regno Italiæ par Sigonius.
Ce
sont précisément les deux livres
dont il a été question précédemment, ceux
qui révélaient l'identité du
fondateur de l'ordre du Temple. Il est à noter que Dom Polycarpe
n'a pas retenu
la traduction d'Héraclius d'Auvergne.
Quant
au paragraphe proprement dit,
en voici la transcription :
« Anno
millesimo centesimo
trigesimo, Hugoni de Paganis vivariensis, primo Militiæ Templi
Magistro, qui
anno superiore millesimo
centisimo vigesimo septimus (triennium perperam advicit Sigonius) cum
in
Franciam ad possendum auxilium pro Damassi expugnatione esser profertus
in
Troiensi consilio, cui Mattheus cardinalis Albanus præsidebat,
ordinis sui
confirmationem, proprienque habitum obtinerat album colore, rubea cruce
insignitum ; eidem, inquam, Hugoni magno praeceptori, sive
magistro
religionis, Laugerius Avenionensis episcopus ecclesiam S. Joanis
Baptistæ
Avenion civitatis, domibus et juribus ad eam pertinentibus, de
canonicorum
suorum consilio et autoritate, in perpetuum commendat ac tradit, salva
reverentia at fidelitate Avenionensis ecclesiæ, 4 calendas
februarii,
indictione octava. Eamdem postea vocatam invenio in veteribus
instrumentis,
ecclesiam Sanctæ Mariæ de Templo : estque juxta
collegiatam divi Agricoli
aedem. »
Ce qui peut
se traduire ainsi :
« En
l'année mille cent
trente, à Hugues de Pagan, du Vivarais, premier Maître de
la Milice du Temple, qui
en l'année antérieure 1127 (Sigonius avançait
faussement trois ans d'écart) est
venu en France se faire aider pour prendre d'assaut Damas, a
été prononcée, au concile
de Troyes, que Matthieu le cardinal d'Albano présidait, la
confirmation de
l'ordre, en particulier sa tenue de couleur blanche, marquée
d'une croix rouge.
Au même, dis-je, Hugues le grand commandeur, ou maître de
religion, Laugier
évêque d'Avignon, sur le conseil et l'autorité des
chanoines, confie et
transmets pour toujours l'église Saint-Jean-Baptiste de la ville
d'Avignon,
avec tous ses revenus, les maisons et les droits qui s'y rapportent,
salut
respect et fidélité à l'Église d'Avignon.
Le 4 des calendes de février,
huitième indiction. De même ensuite je trouve la
nommée par les anciennes
ressources. En l'église Sainte-Marie du Temple qui est à
côté de la collégiale
de saint Agricol. »
Hormis la
phrase entre parenthèses, par laquelle
Dom Polycarpe signale l'erreur commise, selon lui, par Sigonius – qui
situait
l'arrivée d'Hugues de Pagan en France en 1130 et non en 1127,
d'où l'écart de
trois ans – le texte reprend, sans doute textuellement, l'acte de
donation de
Laugier. C'est donc sans doute ce document qui qualifiait Hugues de
Pagan de Vivariensis.
À ce propos, on peut remarquer que Laurent Dailliez
n'écrivait pas « du
Vivarais » mais « originaire de
Viviers », ce qui n'est pas tout
à fait la même chose, sans être vraiment une erreur,
le pagus vivariensis,
nom donné par les Romains au pays de Viviers, étant
à l'origine du nom
Vivarais.
On apprend
ensuite que l'évêque Laugier confie à
la milice du Temple l'église Saint-Jean-Baptiste d'Avignon, avec
tous les
revenus qui s'y attachent. Cette église, ou plutôt cette
chapelle, se situait
sur le rocher des Doms. Elle a disparu aujourd'hui. Cet acte est
rédigé en
l'église Sainte-Marie du Temple, dont la commanderie jouxtait
effectivement la
collégiale Saint-Agricol, et il est daté, selon la mode
romaine encore en usage
à l'époque, du 4 des calendes de février, soit le
29 janvier. En effet, selon
cette habitude on ne déterminait pas la date en comptant le
nombre de jours
écoulés depuis le début du mois, comme nous le
faisons aujourd'hui, mais le
nombre de jours précédant le début de la
période suivante : le 4 des
calendes de février est le quatrième jour en partant du 1er
février,
soit le 29 janvier.
LES SOURCES
DE POLYCARPE
La question
qui se pose maintenant est
celle-ci : si les ouvrages de Guillaume de Tyr et de Sigonius,
cités en
référence, devaient se trouver facilement dans toutes les
bonnes bibliothèques
– à commencer par celle de la chartreuse de Bonpas – en quel
endroit Dom
Polycarpe de la Rivière a-t-il trouvé l'acte de donation
de Laugier ? Pierre
Gaugier, qui dit que ce document provenait des archives de la maison du
Temple
d'Avignon, avance une explication :
« Avant
l'arrestation des
Templiers, Jacques de Malval, commandeur du Temple d'Avignon de 1306
à 1308,
avait pris soin de cacher les archives du Temple chez les frères
Pontifes de
Bonpas […] Au XVIIe siècle, ces archives
templières avignonnaises
furent retrouvées par l'abbé Polycarpe de la
Rivière. »
Et en note de
bas de page :
« La
chartreuse de Bompas
toujours active dans le Vaucluse au bord de la Durance abrita au temps
des
templiers la confrérie des bâtisseurs de pont (Pont
Bénézet, Pont
Saint-Esprit). Ils furent affiliés aux templiers. »
Malheureusement,
il faut modérer un peu ces
affirmations. D'abord la chartreuse de Bonpas n'est plus
« active »,
dans le sens où ses moines en sont partis depuis la
Révolution. Ce qu'il reste
des bâtiments est aujourd'hui une propriété
privée, qui se visite cependant.
Ensuite, s'il est vrai qu'une communauté de Frères
Pontifes, les constructeurs
de ponts, existait à Bonpas, ils ne furent jamais
affiliés aux Templiers, même
si c'était leur désir.

Entrée
de l'ancienne chartreuse de Bonpas
L'historien
provençal Albert Gros, dans son livre La chartreuse de
Bonpas (éditions Aubanel, 1995)
nous apprend qu'en 1277
les Frères Pontifes firent cette demande au pape Nicolas III,
mais comme
celui-ci se méfiait déjà des Templiers, il leur
refusa cette affiliation. En
1278 les Frères Pontifes furent finalement affiliés aux
Hospitaliers. En 1317,
ceux-ci donnèrent la maison de Bonpas au pape Jean XXII, lequel
l'attribua en
1318 aux Chartreux. En conséquence, en 1307 lors de
l'arrestation des
Templiers, Bonpas appartenait aux Hospitaliers. Il est quand même
peu probable
que le commandeur du Temple ait confié ses archives à un
ordre qui fut toujours
le rival de celui des Templiers.
Une
idée reçue tenace veut que la chartreuse de
Bonpas ait précédemment appartenu aux Templiers. Rien
n'est plus faux, et le
premier à l'affirmer fut sans doute Dom Polycarpe de la
Rivière. Dans une
lettre adressée le 15 octobre 1631 au savant provençal
Nicolas Claude Fabri de
Peiresc, avec qui il correspondait régulièrement, notre
prieur écrit à propos
de Bonpas :
« Mais
je ne puis céans trouver des yeux de lynx pour percer les
murailles et voir au-dedans
ces Templiers aux croix rouges qui n’y furent jamais au dehors. Il est
vrai que
les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem ont
possédé quelque peu d’années
Bonpas, mais jamais les Templiers, où l’on ne saurait
reconnaître nul vestige
ni des uns, ni des autres, l’ancienne église se trouvant
bâtie longtemps
auparavant l’institution desdits ordres ; c’est ce que je puis
vous
assurer en toute vérité. »
On comprend
que Peiresc avait dû le questionner à
ce sujet. Les lettres de Dom Polycarpe de la Rivière à
Peiresc sont conservées,
pour la plupart, par la bibliothèques Méjanes
d'Aix-en-Provence, qui les a
numérisées et mises en ligne sur son site Internet.
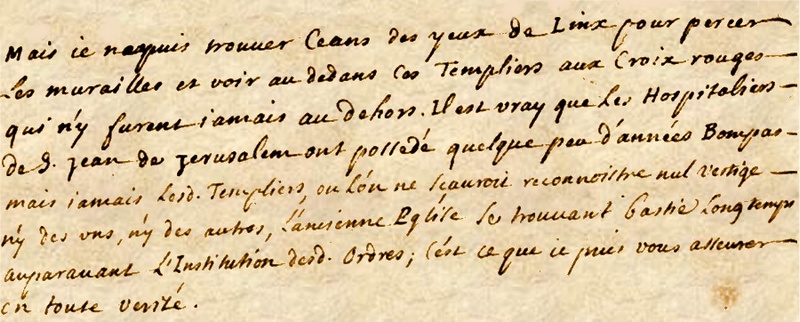
Passage
de la lettre de Dom Polycarpe de la Rivière à
Peiresc évoquant l'absence des Templiers à Bonpas
(Bibliothèque Méjanes)
Ce n'est
peut-être pas à Bonpas que Polycarpe
trouva l'acte de donation de Laugier. Mais cet acte avait certainement
été
rédigé en deux exemplaires au moins, l'un destiné
au Temple, l'autre destiné à
l'Église d'Avignon.
Si Polycarpe n'a pas trouvé le premier à Bonpas, il a pu
dénicher le second
dans les archives du diocèse, où il avait certainement
ses entrées. Il est
intéressant de citer ce que disait de notre prieur son ami le
savant Honoré
Bouche, dans sa Chorographie ou description de la Provence :
« Polycarpe
de la Rivière
Chartreux, personnage, qui, à l'éloquence, à
l'érudition & à la piété qu'il
a fait paraître en beaucoup de petits Traités de
dévotion, qu'il a composés,
avait ajouté une grande recherche pour l'antiquité […] Il
avait eu autrefois
l’entrée des meilleures Bibliothèques de France, & la
rencontre des plus
curieux manuscrits qui s’y pouvaient trouver » (Transcription
en français moderne)
Et à
propos de sa fin et de celle de son œuvre,
ces mots bien étranges :
« Mais par de
certains secrets, à fort peu de gens connus, l'Auteur a disparu,
& son
ouvrage a été condamné aux
ténèbres. » (Transcription en
français
moderne)
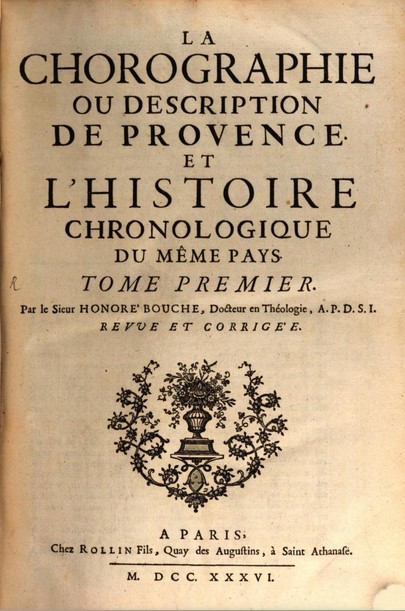
Frontispice
de l'ouvrage d'Honoré Bouche (édition de 1736)
Le lieu
où fut découvert l'acte de donation de
Laugier restera sans doute une énigme. Une de plus parmi toutes
celles qui
entourent la vie de Dom Polycarpe de la Rivière. D'aucuns, qui
n'ont surtout
pas voulu prendre la peine de vérifier ses sources, l'ont
considéré comme un
« joyeux faussaire », opinion toujours soutenue
aujourd'hui ici ou
là. Mais revenons à Hugues de Pagan.
LES PAGAN
SEIGNEURS D'ARGENTAL
DANS LE PILAT
La famille
Pagan, qui avait pour fief le château
de Mahun en Vivarais, se subdivisait en plusieurs branches, dont une
qui
posséda pendant plus d'un siècle le château
d’Argental dans le Pilat.
L'histoire de ce château commence en l'an 844 quand Archimbault
le comte de
Vienne vend ou donne cette terre à un certain Arestagne ou
Rostaing. Au milieu
du XIe siècle sa descendante Fie épouse Artaud
de Malleval en lui
apportant une dot considérable : les seigneuries
d'Argental, de Vocance,
de la Faye, ainsi que les terres de Burdignes, Saint-Sauveur, Riotord,
Vanosc,
Saint-Genest-Malifaux. La famille prend alors le nom d'Argental, et
pour
armoiries d'or au lion d'azur lampassé et couronné de
gueules, termes
héraldiques qui signifient que le lion est bleu avec une langue
et une couronne
rouge.
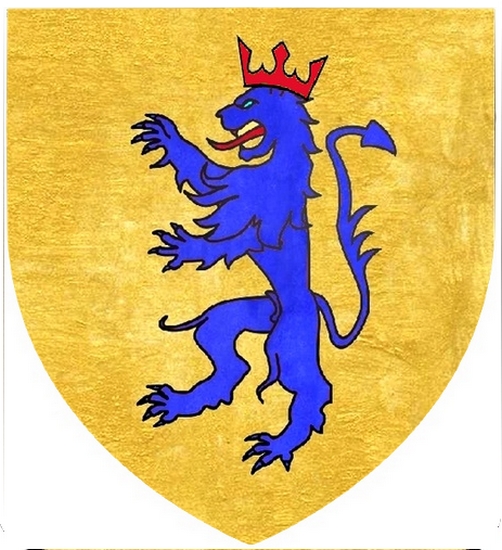
Blason
d'Argental
Succèdent
à Artaud son fils Adhémar, puis le fils
de celui-ci, Artaud II, qui décède en 1152 en laissant
une fille, Béatrix, sans
doute encore très jeune. Béatrix hérite d'Argental
et épouse, avant 1168, Aymon
II Pagan, fils de Guigues Ier et petit-fils d'Aymon Ier
Pagan de Mahun. Cet Aymon II devient le premier Pagan à
régner sur Argental.
Cette lignée semble alors abandonner le blason à une
fleur de lys des Pagan de
Mahun, pour adopter les armes de la famille d'Argental, le lion d'azur
sur
champ d'or. Les Pagan d’Argental seront les maîtres de la toute
proche baronnie
de La Faye, dont le vaste territoire correspond à une
région de la Loire située
aux confins de la Haute-Loire et de l’Ardèche, soit les
actuelles communes de
Saint-Sauveur-en-Rue, Saint-Régis-du-Coin, Marlhes et
Saint-Genest-Malifaux. La
lignée se poursuivra jusqu'à ce que Béatrix Pagan
d'Argental, dernière
héritière, épouse en 1292 Jacques de Jarez,
seigneur de Virieu. Elle décédera
en 1351 sans postérité, et avec elle s'éteindra la
lignée des Pagan d'Argental.
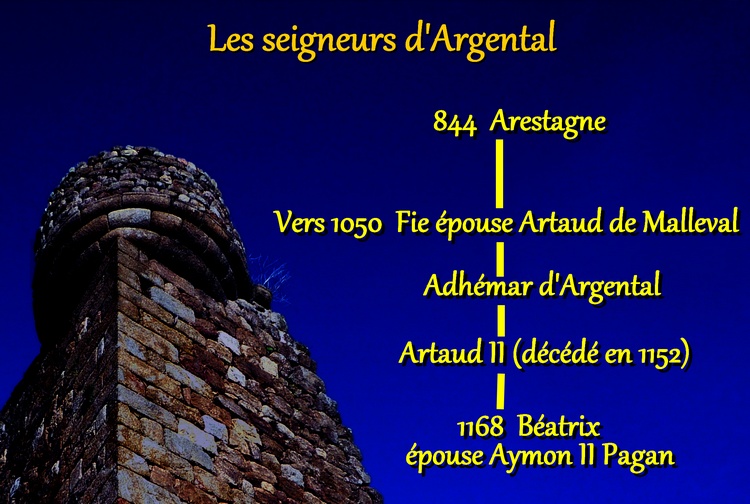
Généalogie
des premiers seigneurs d'Argental
Ces faits
historiques sont aujourd'hui
parfaitement établis, mais par le passé de nombreux
auteurs ont allégrement
confondu les noms et les familles, en proposant des versions parfois
très
fantaisistes concernant les premiers Pagan seigneurs d'Argental.
Se fondant
sans doute sur leurs écrits, Pierre
Gaugier soutient que ce fut Aymon III Pagan (1060-1130) qui à la
fin du XIe
siècle devint par mariage seigneur d'Argental. Lui auraient
succédé son fils
Guigues Ier, et son cousin Arthaud, le fils de son oncle
Wilhème.
Cet Arthaud, qui selon Pierre Gaugier aurait épousé
Béatrix d'Argental. était
le frère aîné d'Hugues Pagan.
On ne peut
pas jeter la pierre à l'auteur, car
certains historiens plus anciens, qui confondaient Artaud II d'Argental
avec
Arthaud Pagan, ont affirmé que c'était bien le
frère d'Hugues de Pagan qui fut
le premier à régner sur Argental et construisit
probablement le château.
Les
ressemblances entre les noms (de multiples
Aymon et Guigues dans la famille Pagan, plusieurs
Artaud dans les familles d'Argental et Pagan,
plusieurs
Béatrix dans la famille d'Argental – chacun de ces noms
présentant des
variantes orthographiques) ne simplifient pas la tâche. Il
paraît évident qu'il
y a eu au moins deux lignées de Pagan à porter le
prénom héréditaire Aymon.
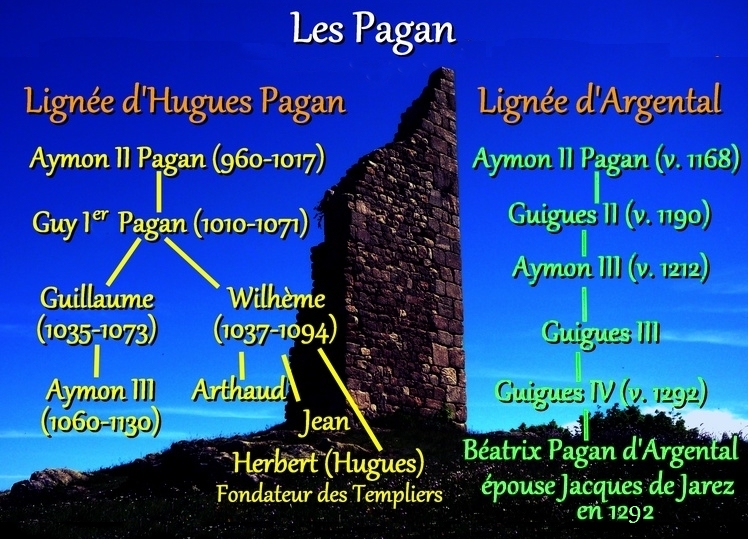
Généalogie
des Pagan
Il y a donc
eu, à presque deux siècles d'écart,
deux Aymon II Pagan, l'un qui vécut de 960 à 1017, et
l'autre qui avant 1168
épousa Béatrix d'Argental. Le premier est à
l'origine de la lignée d'Hugues de
Pagan, le second est à l'origine de la lignée des Pagan
d'Argental. Et de même
il y a eu deux Artaud. L'un, Artaud II d'Argental, seigneur de ce lieu,
et
l'autre, Arthaud Pagan, fils aîné de Wilhème et
frère d'Hugues le fondateur de
l'ordre du Temple. Mais cet Arthaud Pagan n'a jamais
possédé le château
d'Argental, ceux qui l'ont affirmé ont non seulement confondu
les deux Artaud,
ils ont en plus, semble-t-il, mélangé Arthaud et Aymon
Pagan.
Bien rares
sans doute sont les auteurs – surtout
ceux des décennies ou siècles passés – qui ont su
éviter les confusions. Ainsi
par exemple dans une même brochure, Bourg-Argental porte du
Forez (1968),
on trouve deux versions différentes à trois pages
d'écart : page 18 il est
écrit que le premier Pagan connu à Argental est Artaud,
vivant au XIIe
siècle, et page 21 il s'agit d'Aymon II qui avant 1168
épouse Béatrix
d'Argental. Seule la seconde affirmation est exacte, pour la
première il y a
encore une fois confusion entre Artaud II d'Argental et Arthaud Pagan.

Ruines
du château d'Argental
HUGUES DE
PAGAN DU VIVARAIS
Selon les
chroniqueurs, au moment de la création
de l'ordre du Temple son fondateur et premier grand-maître devait
avoir dans
les cinquante ans, et il mourut en 1136. Toutes ces
caractéristiques coïncident
avec un Hugues de Pagan, né à Mahun en 1070,
décédé en 1136. Pour Pierre
Gaugier il se prénommait Herbert et Hugues était son nom
monastique, il est
vrai que la pratique était courante.
Le
château de Mahun, ou plutôt les quelques pans
de murs qui en restent, est situé aujourd'hui sur la commune de
Saint-Symphorien-de-Mahun, près d’Annonay (Ardèche),
c’est-à-dire tout près du
Pilat. Tous les historiens régionaux sans exception se sont fait
l’écho d'une
origine ardéchoise d'Hugues de Pagan — même si tous
n’adhéraient pas à cette
idée.
Parmi les
auteurs ayant adopté le fondateur des
Templiers comme un enfant de leur pays, on peut citer par exemple
Félix
Thiollier (Le Forez pittoresque et monumental, 1889) qui
le
classait parmi les « Forésiens dignes de
mémoire » :
« PAGAN
(Hugues de) : fils de Willelme, seigneur de Miribel, Meys et
Cuzieu,
premier Grand Maître des Templiers 1118 ; mort en 1136. »
Miribel, Meys et Cuzieu sont trois localités du Forez où
les Pagan avaient en effet quelques possessions. Concernant Meys, il
convient
de préciser que cette localité est aujourd'hui située en
Lyonnais.
Jean Combe,
auteur dans les années soixante de
plusieurs ouvrages sur le Pilat, écrit dans son Histoire du
Mont Pilat des
Temps Perdus au XVIIe siècle (éditions
Dumas, 1964), à propos du
château d'Argental :
« Le
nom d'Artaud de Pagan
évoque sans doute un petit château dans les montagnes du
Pilat, mais celui de
son frère appartient à la grande histoire, puisque Hugues
de Pagan fut le
premier grand maître du célèbre ordre des Templiers
dont il avait été l'un des
fondateurs. »
Malheureusement,
l'auteur semble avoir confondu
lui aussi Artaud II d'Argental et Arthaud de Pagan. Jean-Antoine de la
Tour-Varan, bibliothécaire de la Ville de Saint-Étienne
au XIXe
siècle, fut en son temps l’un des défenseurs de la
théorie voyant en Hugues de
Pagan le frère du seigneur d'Argental. Il nous a laissé
une monumentale Chronique
des châteaux et abbayes en deux tomes (1854-1857), mais dans
celle-ci il
n'y a du château d'Argental qu'un dessin et rien d'autre.
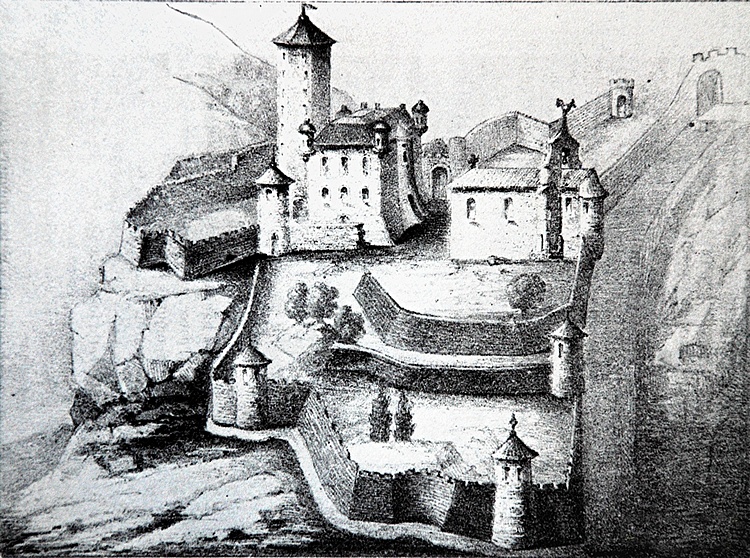
Le
château d'Argental
(dessin de l'abbé Seytre inséré dans l'ouvrage de
J.-A. De la Tour-Varan)
L'ouvrage en
effet ne contient pas ses Recherches
historiques sur le château d’Argental et ses seigneurs, texte
manuscrit que
l'on peut consulter à la Bibliothèque Joseph
Déchelette de Roanne (Fonds
Chaverondier, Ms n° 207). J'ai publié ce texte
intitulé Seigneurs d’Argental
du nom de Pagan dans le chapitre dédié à ce
sujet dans le tome II de La
Société Angélique, mais il n'est sans doute
pas inutile d'en reprendre ici
les passages essentiels.
« Le
Forez a depuis longtemps enregistré Hugues Pagan, fondateur
de l’Ordre du Temple comme étant le frère d’Aymon Pagan,
premier seigneur
d’Argental de cette maison, vers l’an 1152 [...]
La
maison forézienne de Pagan se trouvait déjà
divisée en quatre
branches robustes vers le milieu du XIIème
siècle [...] notre
véritable tâche est de parler de celle d’Argental qui
était l’aînée et qui nous
intéresse. De cette première branche, que l’on tient
à juste titre pour avoir
été le tronc principal de cette rude race des seigneurs
d’Argental, était
Hugues Pagan, premier Grand Maître et instituteur des chevaliers
du Temple. La
conformité des armes est si manifeste qu’elle ne laisse aucun
doute à cet
égard. Cette maison portait : d’or
semé de croisettes de gueules, au lion de même brochant
sur le tout.
[...] Ces
mêmes armes, au rapport du chroniqueur de Bourg-Argental, se
voyaient encore de
son temps (1743) sur la grande porte qui conduisait de cette ville au
faubourg
supérieur.
L’église
du Temple à Paris possédait un ostensoir sur le pied
duquel
étaient gravées ces mêmes armes ; qui pouvait
avoir fait un semblable
présent, si ce n’est Hugues de Pagan, ou un chevalier sorti de
sa maison ?
Ce n’est pas tout ; l’église de Sainte-Marie, de
Bourg-Argental, déjà
connue au IXème siècle, conservait dans son
trésor un riche et
précieux reliquaire d’or dans lequel était enfermé
un morceau de l’éponge qui
avait servi à la Passion de Notre-Seigneur, et sur le pied
duquel se trouve un
écusson aux mêmes armes que celles de l’ostensoir et de la
grande porte de la
ville de Bourg-Argental [...]
Cette
coïncidence frappante d’armoiries de la même famille, dans
une
maison qui fut la première de l’ordre des Templiers, à
Bourg-Argental dans une
église qui dépendait du domaine des Pagan, ne
suffiraient-elles pas pour
établir jusqu’à l’évidence que Hugues de Pagan
était de la même maison que les
seigneurs d’Argental ? »
Ce texte
appelle quelques commentaires. On sait
que le premier seigneur d’Argental de la branche des Pagan, Aymon II, a
acquis
ce titre par mariage, vers 1152 affirme ce texte, avant 1168 disent
d’autres
chroniqueurs. 1152 est en fait la date du décès d'Artaud
II, père de Béatrix
qui épouse Aymon II avant 1168. Même si Hugues de Pagan
était issu des Pagan du
Vivarais, cet Aymon II seigneur d'Argental ne pouvait pas être
son frère, qui
d'ailleurs se prénommait Arthaud. En outre, le fondateur de
l’ordre du Temple
aurait eu 82 ans en 1152, et son frère aîné
quelques années de plus encore.
L’auteur a confondu Artaud II d'Argental avec Arthaud Pagan, et les
deux Aymon
II Pagan.
Le blason des
Pagan, d’or semé de croisettes
de gueules, au lion de même brochant sur le tout,
évoqué par J.-A. de la
Tour-Varan est dûment répertorié par l’Armorial
général du Forez (1874).
On retrouve cet emblème héraldique, le lion sur champ
semé de croisettes,
sculpté sur une pierre dans l'église de Bourg-Argental,
au-dessus du
baptistère. L'autre partie de ce blason porte les armes des
Montchenu
Beaussemblant, de gueules à une bande engrêlée
d'argent chargée d'un aigle
d'azur. Ce blason paraît être une évolution
ultérieure des armes
primitives, une brisure adoptée par un fils cadet pour se
démarquer de ses
aînés, ce qui semble avoir été une pratique
courante dans la famille Pagan. Ces
armes-là n'ont certainement jamais été celles
d'Hugues de Pagan.

Blason
sculpté dans l'église de Bourg-Argental
À droite le lion emblème des Pagan d'Argental
Pour Pierre
Gaugier le blason d'Hugues de Pagan
était d'or au lion d'azur, soit les armoiries
d'Argental. Pourtant il
paraît bien établi que les Pagan ne possédaient pas
encore ce château du vivant
du fondateur de l'ordre du Temple, alors comment aurait-il pu en porter
le
blason ? De plus sa lignée et celle des Pagan d'Argental
sont différentes,
même si elles ont sans doute un lointain ancêtre commun.
D'ailleurs si le
fondateur de l'Ordre du Temple était bien issu des Pagan du
Vivarais, alors il
arborait vraisemblablement le blason de sa lignée
paternelle : d’or à
trois têtes de maures de sable. Son père
Wilhème était le fils cadet de Guy
Ier Pagan, selon l'habitude familiale il a donc
vraisemblablement
abandonné le blason des Pagan de Mahun à une fleur de
lys, pour prendre ces
armes plus parlantes. Il faut rappeler qu'on le surnommait
« le Maure de
la Gardille ».
Ce blason
à trois têtes de Maures est mentionné
par Gérard de Sède dans Les Templiers sont parmi nous,
où il illustre le
paragraphe évoquant une origine ardéchoise d'Hugues de
Payens. Mais l'auteur
n'a fait que reprendre ce que signalait déjà en son temps
l'historien régional
Antoine Vachez, et ce blason de l'une des lignées de la famille
Pagan figure
également dans l'Armorial général du Forez,
cette branche ayant eu des
possessions dans ce comté.
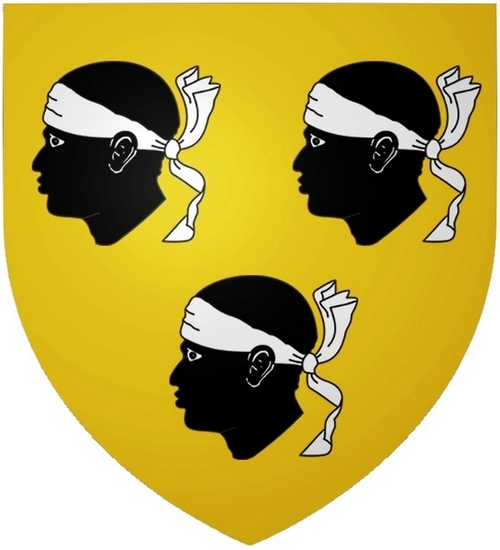
Blason
des Pagan : d'or à trois têtes de maures de
sable
On a vu
Hugues de Pagan marié avec une Catherine,
qui elle serait originaire de Champagne. Pour Pierre Gaugier il
s'agissait de
Catherine de Saint-Clair, ce qui relierait le fondateur de l'ordre du
Temple à
la prestigieuse famille des Saint-Clair, que l'on présente comme
les gardiens
du Graal, et dont la branche anglaise des Sinclair construisit la
Rosslyn
chapel, rendue célèbre par le Da Vinci code. Le
Prieuré de Sion n'est
pas loin !
Gérard
de Sède affirme que le père d'Hugues de
Pagan, celui que l'on surnommait « le Maure de la
Gardille », était
natif de la région de Langogne près des sources de
l’Allier. L'auteur ajoute,
entre parenthèses : Al-liès, comme pour attirer
l'attention du lecteur.
Cet Al-liès incongru n'est en réalité pas autre
chose que l'anagramme
phonétique de : « allez-y ! ».
C'est une injonction
subtile que l'auteur donne à son lecteur. Suivons-là et
allons voir où sont les
sources de l'Allier. Cet affluent de la Loire prend naissance sur le
versant
sud d’une montagne, culminant à 1500 m, que les anciens
nommaient le Maure de
la Gardille, toponyme attesté par plusieurs manuels de
géographie du XIXe
siècle. Le surnom du père d'Hugues de Pagan était
tout simplement le nom de sa
montagne natale. Aujourd'hui le nom a évolué, les cartes
actuelles utilisent
l'orthographe Moure de la Gardille, à tort d'ailleurs, car si ce
mot existe en
occitan comme en provençal, désignant un museau ou de
groin, et donc un sommet
ayant cette forme, il s'écrit mourre, avec deux R
(exemple : le
Mourre Nègre dans le Luberon).
DE PAGANIS
À BAGARRIS, DU
VIVARAIS AU VERDON
Parmi les
hypothèses proposées pour l'origine
géographique d'Hugues de Pagan, il y en a une qui voit en lui un
gentilhomme
provençal de la région du Verdon, dans l'actuel
département du Var. C'est le
formidable succès du livre d'Alfred Weysen L'île des
Veilleurs (Arcadie
éditions, 1972), qui accessoirement relança l'idée
d'un Hugues de Pagan
originaire du Verdon, par un simple et très court paragraphe.
Pour l'auteur, le
fondateur de l'ordre du Temple était en
réalité :
« Hugues
de Bagarri ou de
Paganis, moine de Saint-Victor, seigneur de Bagarri (Var), gardien du
Graal,
abbé de propriétés victorines en Sardaigne et en
Sicile. »
Le livre
étant consacré à la recherche d'un
fabuleux trésor des Templiers dans cette région du
Verdon, Alfred Weysen ne
pouvait pas passer sous silence cette hypothèse d'un Hugues
seigneur de
Bagarri. Si aujourd'hui on ne trouve aucun lieu ainsi nommé en
Provence, ce ne
fut pas toujours le cas. Bagarri ou Bagarris est le nom sous lequel fut
connu,
jusqu'en 1540, le village du Bourguet, situé près de
Castellane, à quelques
kilomètres à l'est des célèbres gorges du
Verdon.
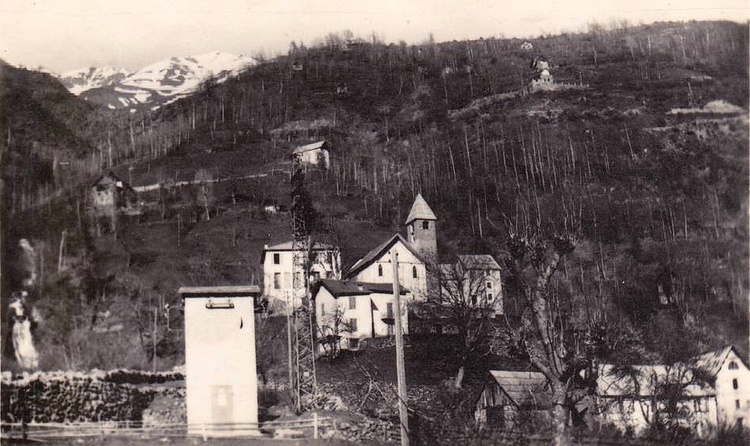
Le
Bourguet, vue générale (carte postale ancienne)
Quelles
étaient les sources d'Alfred
Weysen ? Il cite en bibliographie un ouvrage du XVIIIe
siècle, Histoire
de Castellane par Prieur Laurensi, publié à
Draguignan en 1767. Dans ce
livre on trouve en effet plusieurs paragraphes où il est
question de cet Hugues
de Bagarris :
« L'histoire
nous désigne plus distinctement le principal
fondateur de l'Ordre des Templiers. Elle nous apprend qu'il
était de Provence,
issu d'une famille qui avait la seigneurie de Bagarris, ancien village
voisin
et dépendant de Castellane. Quelques-uns l'appellent Hugues de
Paganis et
d'autres Hugues de Bagarris ; il peut se faire qu'il portât ces
deux noms à la
fois et qu'il fût nommé Hugues de Paganis, seigneur de
Bagarris. Je crois
plutôt que cette diversité d'opinions est venue de la
façon de lire les
anciennes pièces où il était fait mention du
fondateur des Templiers. »
Et
cet autre passage :
« L'on
m'a objecté, pendant que
mon histoire était sous presse, que je mettais sans aucun
fondement, au nombre
de nos illustres citoyens, le premier grand maître des Templiers,
et que son
nom véritable était Hugues de Paganis ou des Payens, et
non pas Hugues de
Bagarris comme je le prétends.
« Il
est juste de satisfaire
ici ceux qui m'ont fait l'honneur de me proposer cette
difficulté. Je conviens
d'abord que certains auteurs nomment Hugues de Paganis le fondateur des
chevaliers du Temple ; mais on ne me niera pas sans doute, que
plusieurs
historiens du pays lui donnent le nom d'Hugues de Bagarris : qu'on lise
Bouche,
tome 2, p. 109 [...]
« 1°
II est certain que le
fondateur des Templiers était seigneur d'un village de la
province : or point
de village en Provence du nom de Paganis, au lieu qu'il se trouve un
Bagarris
auprès de Castellane, dont le nom a pu aisément se
confondre avec celui de
Paganis, comme le reconnaissent fort bien ceux qui s'appliquent
à déchiffrer
les anciens titres.
« 2°
L'histoire nous parle d'un
certain Pierre, vicomte de Castellane, qui se distingua dans la guerre
sainte
contre les Musulmans en 1098, à la tête de nos braves et
de plusieurs
gentilshommes de notre contrée ; et nous voyons, peu
d'années après, un de ces
gentilshommes Provençaux, placé à la tète
de la milice du temple, et appelé
Hugues de Bagarris par certains historiens dignes de foi : n'est-il pas
évident
que c'est ici le seigneur de Bagarris, village auprès de
Castellane ? Tout de
même voyons-nous en 1252, Boniface de Castellane
accompagné dans une action
d'éclat d'un Boniface de Bagarris son vassal.
« 3°
Nos anciens actes nous découvrent parmi nos citoyens
une famille de Bagarris, dont nous voyons, pendant plus de deux
siècles, les
différentes générations se succéder l'une
à l'autre dans le sein de notre
ville. Il est donc très probable, pour ne pas, dire quelque
chose de plus, que
le premier grand maître des Templiers était originaire de
Castellane, et qu'il
s'appelait véritablement Hugues de Bagarris, et non pas de
Paganis ou des
Payens, comme le veulent certains auteurs, qui n'ont pas approfondi ces
différents motifs. »
Prieur
Laurensi se réfère à des auteurs qui l'ont
précédé, et il en cite un en
particulier ; Honoré Bouche, tome 2, page 109. L'auteur de
la Chorographie
ou description de la Provence semble bien, en effet, être le
premier à
avoir fait le rapprochement entre Hugo de Paganis et Hugues de
Bagarris.
Parlant des deux ordres de chevalerie créés lors des
croisades, les
Hospitaliers et les Templiers, voici ce qu'il écrivait à
propos du
second :
« Le
deuxième l'an 1118, par neuf gentilshommes français,
qui étaient allé visiter le Saint-Sépulcre, entre
lesquels il y en avait deux
de Provence, à savoir Hugo de Paganis, d'autres disent de
Bagarris, nom ancien
d'un village à présent nommé le Bourguet,
près de Castellane, & Geoffroy
Adhemar, dont le nom est assez connu en Dauphiné, à
Orange & en
Provence. » (Transcription en
français moderne)

Ruines
de la ferme de Bagarris près du Bourguet
(photo merveilles-du-var.net)
Honoré
Bouche a non seulement fait d'Hugues de Pagan un gentilhomme
provençal, mais il
a même annexé Geoffroy de Saint-Audemar, l'amalgamant avec
les célèbres Adhémar
qui régnèrent en particulier sur la Drôme
provençale (Grignan, la
Garde-Adhémar).
Alors,
Hugues de Pagan était-il originaire du Vivarais ou de la
Provence ? Pour
Pierre Gaugier, il n'y a pas de mystère : une branche des
Pagan s'était
implantée dans le Verdon, et si Hugues de Pagan est bien
né à Mahun en
Vivarais, ayant hérité des biens des Pagan de Bagarris,
il alla s'installer
dans le Verdon. Une aubaine pour lui, qui n'était que le fils
cadet de Wilhème
Pagan et ne pouvait donc prétendre à hériter du
domaine paternel, réservé au
fils aîné Arthaud. Il était donc bien cet Hugo de
Paganis seigneur de Bagarris
évoqué par Prieur Laurensi. Après le
décès de son épouse, il partit pour la
Terre Sainte, où il fonda l'ordre du Temple, dont il devint le
premier
grand-maître.
DEUX HUGUES
DE PAGAN ?
Pierre
Gaugier avance une autre théorie
intéressante. Selon lui – mais il n'est pas le seul à
l'affirmer – Hugues de
Pagan l'Ardéchois aurait quitté l'ordre du Temple peu
avant le concile de
Troyes (1129), et aurait été remplacé par Hugues
de Payns le Champenois.
L'auteur – qui dit tenir l'information d'Alfred Weysen –
affirme qu'Hugues de Pagan serait alors entré
chez les Bénédictins, et serait devenu le constructeur
d'églises connu sous le
nom d'Ugo. Ce mystérieux bâtisseur, ou plutôt
tailleur de pierres, a laissé sa
signature sur plusieurs édifices en Provence ou en Drôme
provençale. Il serait
ensuite devenu abbé de Saint-Victor à Marseille, et
serait mort en 1145.
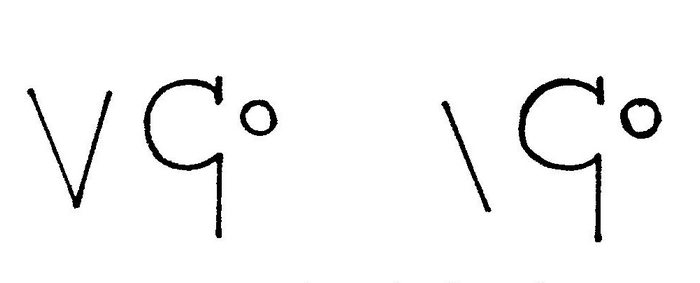
Deux
variantes de la signature Ugo
L'idée
est séduisante, et cela expliquerait que
certains voient naître ce grand-maître des Templiers en
Champagne, et d'autres
en Vivarais. Cependant elle pêche par un détail. Si Hugues
de Pagan du Vivarais
a quitté l'ordre du Temple dans les premiers jours de 1129 (le
concile de
Troyes commençant le 13 janvier), comment peut-il un an plus
tard, le 29
janvier 1130, recevoir à Avignon la donation de
l'évêque Laugier ?
Il est vrai
que l'auteur Pierre Gaugier traduit
par 1103 la date donnée par le manuscrit de Dom Polycarpe (Anno
millesimo
centesimo trigesimo). Non, trigesimo ne signifie pas
« trois » mais « trente ».
Mais ce n'est sans doute qu'une
étourderie.
EN CONCLUSION
De tout ce
qui précède, il ressort que seul
Héraclius d'Auvergne a vu Hugues de Payns naître à
côté de Troyes en Champagne.
Comme il existait en effet une localité du nom de Payns, et
comme le concile
officialisant l'ordre du Temple s'est tenu à Troyes, beaucoup
d'historiens ont
conclu à cette origine.
Hormis M.
Lembron de Ligneu qui en 1855 le voyait
natif de la Touraine, des quantités d'auteurs ont
présenté des origines très
diverses pour le fondateur de l'ordre du Temple : Viviers, Mahun,
Avignon,
le Bourguet, etc. On peut remarquer que tous ces lieux sont
situés dans le
sud-est de la France. Toutes ces convergences vers une même
grande région sont
quand même à relever. C'est sans doute ce qu'il faut
retenir : Hugues de
Pagan, fondateur de l'ordre du Temple, pourrait bien être
né dans le sud-est de
la France. Et vraisemblablement en Vivarais.
|
