
 |
Rubrique Les Papes
Janvier
2025
|

|
Antoine Herrgott
|
Le
Pape Innocent V
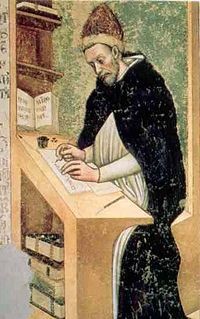 (1276/1276) |
|
Pape du Pilat Né à la source du Furan Pierre de Tarentaise,
Innocent V
Pourquoi ce troisième ouvrage sur notre Pape du
PILAT ? Nommé responsable de l’Association d’histoire
de mon village natal, nous entreprenions les recherches sur l’historique de
Marlhes situé dans le PILAT sud. Cette ambiance de recherches dans les archives
régionales : Archives du Rhône sur la colline de Saint-Paul à Lyon, Archives
départementales au Puy-en-Velay, Archives départementales de La Loire à
Saint-Etienne, nous a permis de retrouver l’existence de ce village depuis l’an
850. Mes attaches familiales sur ce terroir me
donnaient la belle occasion de me rapprocher de l’histoire de la grande ferme «
Courbon-La-Faye. » Famille de grands producteurs de lait « Le Babeurre
»1880-1963, fort d’un cheptel de 160 vaches, d’où l’acquisition de terres sur
la commune voisine de Tarentaise. Origines Cette contrée devient un haut lieu de
recherches par des contacts d’habitants. Tout d’abord la découverte d’une maison forte «
Prarouet » dépendance des Chartreux de Sainte-Croix-en-Jarez proche de
Rive-de-Gier, Chateauneuf. Par un précieux hasard, je rencontrais une habitante
d’un hameau férue d’histoire locale. Cette personne me situait le lieu de
naissance de Pierre de Tarentaise, futur Pape Innocent V, dans un des19 moulins
voisin au bord du Furan, sur sa commune. Le dernier curé de la paroisse était
aussi membre du conseil municipal avec un accès aux archives de la commune. Il
avait découvert un document actant la naissance de Pierre Aleysson au moulin du
lieu-dit « Le Redoux » au bord du Furan. Cette nouvelle ne devait intéresser
que quelques initiés de ce petit village. Les travaux de rénovation de la
mairie ont donné lieu à la destruction des archives, au désespoir de certains
habitants. La famille Aleysson résidente de Montbrison, bourgade, future
préfecture du département de La Loire. Leurs parents propriétaires de ce moulin
du Furens, celui-ci sera le lieu de naissance de leur fils Pierre. Très proche
de Valbenoite où il descend faire ses premières classes, il se retrouve au
séminaire de Verrières en Forez puis il intègre la communauté des dominicains à
Lyon proche de la place Bellecour, et devient prêtre sous le patronyme de
Pierre de Tarentaise. Ces premières investigations m’ont poussé vers des
recherches plus approfondies, et bien au-delà de notre territoire et de la
France. L’Histoire pour devenir soi-même La sélection encouragée par les traductions des
parchemins manuscrits du XIIIe siècle, a favorisé la mise en avant des
personnages classés importants de notre histoire au détriment de ceux, en
action, laissés dans l’ombre par volonté du moment. Le personnage Pierre de
Tarentaise, à la vie très accomplie, fait partie de ceux-là, alors même que
condisciple et proche de Saint Thomas d’Aquin et de Saint Bonaventure, il
aurait fortement mérité d’être plus reconnu, car il fut le premier Dominicain à
monter sur le Siège épiscopal de Saint-Pierre de Rome. Si nous affectons une
grande tristesse de la disparition des textes, il est certain que nous n’avons
pas encore utilisé plus du quart de ceux qui sont conservés dans nos dépôts
d’archives. La mise en place d’un procès de béatification, bien avant 1898,
autour de la vie de Pierre de Tarentaise, a été déterminante dans le travail du
Révérend Père Hyacinthe LAURENT lorsqu’il ouvrit les documents réunis et
collationnés aux archives du Vatican. C’est au cours de la dernière guerre
mondiale qu’il a été affecté, dans la cinquième Armée, basée à Rome, où il
devait se pencher dans la préparation de son livre sorti en 1947. Très peu
d’écrits sont restés dans nos archives régionales et plus particulièrement à
Lyon. La vie de Pierre de Tarentaise se situe, dans
la période plus reculée du Haut Moyen-Âge, entre 1226 et 1276, à l’approche de
la fin du XIIIe siècle. Très riche dans l’avancée universitaire, comme ces
collèges, qu’on voit fleurir grâce aux mécènes souvent princiers qui les
créent, ne sont que des logements pour écoliers pauvres, même s’il arrive,
comme pour celui de Robert de SORBON à Paris, qu’on en vienne à y enseigner ;
et au même moment dans les proches capitales des pays qui nous entourent. Les
écoliers qui ne sont pas parvenus à obtenir une bourse familiale ou un “
bénéfice “ d’église, telle la « chapellerie » d’un riche bourgeois, battent le
pavé, et à grand bruit. Comment raconter la réalité d’une existence hors du
commun aux hommes d’aujourd’hui ? Il y a justement là une force dont nous avons
besoin pour réaliser du mieux possible la vie de Pierre de Tarentaise.
Actuellement les moyens d’investigations, mis à disposition dans les recherches
historiques, sont tels que nous apportons des précisions plus fouillées vers
les faits et scènes réels en d’autres cieux ; la légende de plus de sept
siècles rentre avec bonheur dans l’Histoire. Je me sens infiniment redevable aux historiens
écrivains qui m’ont informé et éclairé tout au long de mes lectures et mes
recherches sur le Moyen-Âge. Je leur en exprime ici toute ma reconnaissance et
ma joie d’accomplir, très modestement, ce reçu. Ecrire c’est faire trace. La Papauté itinérante Les Papes du Moyen-Âge se sont montrés
d’infatigables voyageurs, pour des motifs propres à leur dignité et à leur
mission. Il est vrai qu’en ces périodes troubles, les déplacements étaient
rendus obligatoires, pour des contraintes inéluctables de diplomatie. Dans
notre région nous retrouvons aux alentours de l’an 900 le voyage pontifical par
le 1er pape, Jean VIII, qui passa à Lyon. Dans la période qui nous intéresse,
nous allons retrouver de nombreux voyages entre Rome l’État Pontifical et notre
région plus particulièrement Lyon et Vienne. Lyon et notre région du Forez se
sont retrouvées dans la zone médiane séparant la future “France” de la
Germanie. Après sa division, cette zone fut unifiée, au milieu du Xe siècle,
sous la forme d’un royaume de Bourgogne qui, en 1032, passa aux rois de Germanie,
s’intégrant ainsi au « Saint Empire ». Les rapports de Lyon avec la papauté
datent des origines de la chrétienté Lyonnaise puisque Saint Irénée, originaire
d’Asie Mineure, avait, d’après les historiens, fait un séjour à Rome avant de
venir seconder Saint Pothin, premier évêque de Lyon. L’Église de Lyon, « baptistère des Gaules »,
resta toujours fidèle à la foi catholique, aussi bien dans les périodes
d’expansion paisible, que dans les heures tragiques de persécution. Elle
demeura cependant un centre chrétien rayonnant. Clotilde y naquit, et, par
elle, Dieu amena Clovis au baptême. Et c’est ainsi que, tant par l’importance
de ses institutions ecclésiastiques que par sa situation à la limite du Royaume
de France et de l’Empire, la ville de Lyon fut amenée, au Moyen-Âge, à
accueillir une dizaine de Papes et deux conciles oecuméniques, comme nous le
verrons. Cet amour des Lyonnais pour le Pape, on l’a vu
encore dernièrement dans la joie des 2000 jeunes du diocèse de Lyon qui ont
participé aux JMJ de Cologne ; c’est avec simplicité et dans la foi qu’ils ont
écouté et applaudi Benoit XVI, le nouveau et actuel Pasteur donné à l’Église
catholique. Lyon reste plus que jamais fidèle à sa vocation de ville rayonnante
et de carrefour spirituel. En fait, c’est du côté français que pencha de plus
en plus la balance : son successeur, Renaud de Forez, prélat « féodal », comprit
l’intérêt qu’il y avait à concentrer l’autorité temporelle sur le Lyonnais et
ses abords immédiats ; ses propres successeurs l’imitèrent, si bien qu’à l’Est,
sur la partie du diocèse sise en terre d’Empire, le pouvoir temporel passa de
plus en plus à des seigneurs laïcs, les Dauphins de Viennois et comtes de
Savoie en tête. C’est donc au chef d’une principauté ecclésiastique
indépendante et forte que les papes du XIIIe siècle pouvaient demander asile. Infatigables voyageurs, les souverains, les
empereurs, et les rois de France étaient confrontés aux combats et à la plus
grande diplomatie de terrain. Ils avaient aussi le souci de consommer sur place
les produits de leurs domaines ou d’exploiter le droit du gîte qui leur était
dû. Il semble démontré que le déplacement était devenu quasi continu par
l’ensemble des services et du personnel de la Curie. Les rouages mêmes de
l’Église s’en trouvaient grippés et Rome apparaissait de moins en moins la
capitale administrative au profit, à la moitié du temps, de Lyon carrefour très
important avec Vienne qui avait en charge principalement l’hébergement des
souverains. On le voit, Rome n’était plus Rome, et Lyon devenait le lieu
incontournable.Il n’est pas faux d’annoncer que Lyon était devenue la ville de
la Chrétienté et la cité qui eut le plus longtemps cet honneur par huit ans de
séjours et la présence de pas moins de onze souverains pontifes. Dès le début
du XIIIe siècle apparaissent les tarifs de péage pour les marchandises entrant
et sortant « tant per terra comme per aigui » (eau), la voie fluviale était
très utilisée et bien sûr les papes ne furent pas les derniers à l’emprunter.
Depuis l’Italie, après le passage des Alpes par le Cenis, deux directions
s’offraient aux voyageurs, l’une vers la Champagne et l’autre vers Lyon, par la
voie romaine rive droite de la Saône qui très vite devait s’appeler le “chemin
de France”. Grâce à la vigilance éclairée de l’Archevêque
Humbert, Lyon possédait enfin un pont de pierre sur la Saône et devait assurer
une occupation de plus en plus dense de la « presqu’île ». Toutefois il fallut
attendre vers l’année 1183 pour le lancement du premier pont sur le Rhône. Cet
ouvrage semble avoir été très largement inspiré par la récente réussite du pont
d’Avignon et réalisé par une équipe qui y avait travaillé. Cette oeuvre
coûteuse, car techniquement dure dans sa réalisation devenait le passage névralgique
pour la traversée de la ville et, très vite, la rue marchande Mercière relia un
pont à l’autre et la France au Dauphiné et à l’Italie. Une arche devait
s’écrouler dès 1190, preuve de la complexité d’ériger ce lourd monument à
travers ce fleuve en furie permanente. Désormais Lyon devient la capitale des échanges
de toutes marchandises et des métiers de l’art. Il est bon de mentionner, en
1180, le passage fort remarqué des croisés conduits par Philippe Auguste et
Richard Coeur de Lion.Ce grand carrefour devait attirer la présence de nombreux
Souverains pontifes et réunir par deux fois le Concile autour de la Curie
Romaine rassemblée. Lyon rendue plus attractive et plus facile d’accès devenait
d’autant mieux placée comme position de repli pour les pontifes soucieux de s’arracher
au guêpier italien. La Péninsule était toute proche, bien que séparée d’elle
par le bastion protecteur des Alpes et leurs cols, grâce à la voie maritime
prolongée par la voie fluviale, les relations de Lyon avec l’Outre-monts
n’avaient jamais été interrompues. Nos historiens nous rapportent avec beaucoup
d’attention des interférences artistiques perceptibles dès l’époque romane ;
ressemblances entre les chapiteaux de Saint-Martin d’Ainay et ceux du cloître
d’Aoste, ou de la tour lanterne de Saint-Paul et celle de San Michele de Pavis.
Il reste de ce siècle de très nombreuses influences réciproques colportées par
les clercs, des pèlerins « romieux », des marchands isolés. Elles devaient
s’amplifier avec les croisades, auxquelles, dès les premiers appels d’Urbain
II, et jusqu’au temps de Saint-Louis, notre région fournit un apport continu. La prospérité de la ville frappa beaucoup
Innocent IV, dès ce début du XIIIe siècle, lui ce Génois, entouré dans sa cité
de fortunes “à l’Italienne”. Il devait devant cette situation favorable se
faire accueillir par Lyon pour l’organisation du concile I qui eut lieu en 1244
et 1245. Malheureusement dès les années 1268-69 cette capitale retrouve les
revendications politiques, et les violences recommencèrent. Cette situation ne
devait pas décourager le pape Grégoire X de choisir, comme son prédécesseur, Lyon
pour y réunir son concile. L’atmosphère de guerre civile qui y régna fut
peut-être une raison de ce choix et, en tout cas, l’incita à prolonger son
séjour pour apaiser les esprits ; grâce aussi à un arbitrage conjoint de
Saint-Louis et du légat pontifical en France qui, en 1270, imposa une trêve
bien utile. Grégoire X trouvait que Lyon constituait un atout majeur car
celle-ci présentait l’avantage de la proximité du royaume capétien, porte
ouverte pour un refuge en cas de nécessité, d’autant que la moitié de
l’archidiocèse en faisait partie par ses quatre évêchés suffrageants -Autun,
Chalon, Mâcon, et Langres. Cette situation devait offrir un avantage précieux
sur les rapports constants entre l’archevêque et le roi. A la fin du XIIe siècle, les ordres religieux
militaires s’implantaient ; les Hospitaliers en 1187, les Templiers en 1200, et
peu de temps ensuite ce fut le tour « des Frères » que Saint Dominique
dépêchait à Lyon, dès 1218, imité deux ans plus tard par Saint François. De
même en Forez, Beaujolais et Dombes, ce siècle vit éclore et prospérer de
nombreuses maisons grâce aux libéralités des princes ou des empereurs, et au
rayonnement des hauts lieux monastiques de Cluny, de Citeaux, de la Chaise Dieu
et de la Chartreuse. Dans les trente dernières années du XIIe
siècle, le seul comté du Forez ne se couvrit-il pas de vingt-cinq
établissements religieux ? A la même époque, le Temple et l’Hôpital
commençaient à y tisser un réseau de maisons souvent postées près des principales
voies de circulation et propres à héberger et à nourrir les pèlerins, les
passants et encore tout le personnel accompagnant les papes ou les Pères
conciliaires. La ville de Vienne, liée à l’Église de Lyon par le sang -les
martyrs de l’an 177- favorisée par l’existence d’un antique pont sur le Rhône,
devait accueillir huit de nos papes, l’un d’eux, Clément V, y célébra un
concile général. Enfin citons la ville du Puy, lieu de
pèlerinage marial que l’on gagnait par une route difficile, à partir de la
vallée du Rhône, qui attirait, tout autant les plus humbles fidèles, les papes
et les rois - six pontifes y vinrent faire leurs dévotions. Il est utile de
rajouter et d’insister sur cette période du milieu du XIIIe siècle, où la ville
de Lyon très largement tournée sur les grands courants d’échanges, enrichie, de
plus en plus peuplée, de mieux en mieux pourvue en maisons religieuses, comme
d’ailleurs en auberges, a acquis ses lettres de noblesse. Deux papes la
choisissent pour y demeurer, avec leur Curie de plus en plus étoffée, c’est le
temps des séjours. La communauté patriarcale en déplacement pouvait représenter
plus de 200 personnes au service du pape. Afin de faire face à la nécessité
administrative croissante au cours de cette période du XIIIe siècle, période
centrale, l’itinéraire s’avérait être un grave problème. Le besoin de contacts
directs, du pape avec ses évêques au cours des hébergements et avec les fidèles
et les accompagnateurs de la Curie romaine, occasionnait un tracé proche du
casse- tête. Le Pilat, haut lieu de jouvence Ce rappel historique accompli, il faut
maintenant situer notre « héros », Pierre de Tarentaise, dans son pays natal,
et pour cela décrire le Pilat et Tarentaise. Ce Mont des Cévennes, culminant à 1430 mètres
entre l’Auvergne et la chaîne des Alpes a archivé ses légendes et ses
intrigues, toutes liées à la fascination des hommes, devant la beauté de ses
paysages aux lumières pleines de feux, de calmes et de tendresses, toujours
rassurantes, allant de périodes paisibles aux heures tragiques de combats et de
persécutions ; territoire fascinant, il devient lieu de passage, de refuge et
de médita. Le fleuve Rhône, barrière à l’est, accueille la route fluviale
fougueuse, dangereuse aux échanges incessants entre les hommes par et pour les
marchandises. Personne n’est resté insensible à ses paysages, aux couleurs intenses et vives d’automne, au blanc pur et silencieux de la neige, aux reflets arc-en-ciel de la glace, à l’éclat féérique du lever et du coucher de soleil. Les nombreux écrits sur ce territoire nous permettent d’imaginer une importante emprise de feuillus, parsemée de clairières, de prés, assortis des cultures à proximité de constructions en bois pour majorité. Les espaces de roches, les crêtes et les pics ont vu la construction de bâtisses en pierres à la fois signe de richesse et lieu de protection, de défense et d’observations. Sans manquer l’utilité de s’installer à l’abri de fayes ou de combes bien orientées et aux bords des cours d’eau, rus et ruisseaux ; car l’eau ce bien précieux, a toujours été un symbole de vie.
La source de Furan dans les fougères du Grand Bois
Le Grand Bois protège et abrite la source du
Furan, sa trace se retrouve en amont du village de Tarentaise et en creux tout
au long de son parcours, laissant couler cet or blanc, distribué durant des
siècles aux hommes, leur apportant la richesse de vie, en fonction des besoins
et des évolutions techniques très inventives. Pour certains, avec les Naïdes du
Pilat classées par les historiens romanciers, la nature y cache ses aspects les
plus austères et les plus sauvages. Le village de Tarentaise situé sur un
plateau de 1093m comptait en 1905, 415 habitants. Les pentes de ces hautes
collines, aujourd’hui dénudées du côté de Planfoy, étaient jadis couvertes de
forêts, dont les druides recherchaient les ombres épaisses. Tarentaise vient de Darantasia, est un
hydronyme ayant une origine pré celtique et que l’on pourrait traduire par «
cours d’eau », avec une nuance nous renvoyant « aux eaux vives ». En langage
celtique Tarentaise vient de TAR - AN dieu de la foudre. Il est nécessaire
d’approfondir ces données en sachant que le nom de Tarentaise n’apparaît, pour
ce village dépendant de Rochetaillée, qu’en 1705 et qu’auparavant le vocable
était celui de Prarvé, Praroué: “ le pré du Roy “. Nos anciens du XIIIe siècle
ont souhaité rappeler le lieu de naissance de Pierre Aleysson, nommé Pierre de
Tarentaise à sa rentrée, dès l’âge de seize ans, chez les Dominicains de Lyon
où nous le savons il fit des études brillantes. Cette famille Aleysson est une
grande famille de la bourgeoisie Montbrisonnaise, dont la lignée s’est perdue
en 1405. L’Inventaire des biens de feu Pierre Aleysson,
père du futur dominicain, bourgeois de Montbrison, présenté en 1288 par Thomas
Gayti, tuteur de Pierre de Tarentaise, fournirait un nouvel indice de son
origine forézienne. Nous n’avons pas trouvé le nom du religieux qui devait
l’avoir pris sous sa protection, dès son jeune âge. Il reconnaît sans doute sa
grande capacité intellectuelle, permettant à Pierre son entrée dans l’ordre des
Prêcheurs de Lyon. La tradition a conservé le nom de Champ Blanc,
au lieu où ils tenaient leurs assemblées, et celui de la Grotte de la Faye ou
du Trou des Sarrazines, à la cavité dans laquelle se retiraient les druidesses.
Au moyen-âge le premier village rencontré, après le Pré du Roy, sera celui de
Valbenoite avec son abbaye, plusieurs fois envahie par les eaux tumultueuses du
Furens. Cette montagne, aussi célèbre dans les Gaules que l’Olympe l’était chez
les grecs ; verdoyante et gracieuse aux retours des zéphyrs, fleurie et
parfumée durant l’été ; se montrant décolorée aux approches de l’hiver, prise
par les brouillards, les vents et les pluies. Pilat du latin pileatus, couvert
d’un chapeau. Pi = montagne ; ate, aite = endroit ou région ; mais aussi de
Ponce Pilate originaire de Vienne sur le Rhône, grande personnalité de son
époque qui, en l’an quarante, de retour de Judée après un long séjour se serait
donné la mort. L’Histoire rapporte que cet homme acteur puissant a endossé des
responsabilités très importantes et porté sur ses épaules nombre d’engagements
qui pour certains le disqualifient à tort. En langue Celtique « Pyla » signifie « porte »
; à traduire très certainement comme un point de passage entre la plaine de
Forez et la vallée du Rhône. De tout temps classé, montagne sacrée, Le Pilat
reste un culte, de longues réflexions que ce soit : sur la flore et la faune ;
le langage des Pierres gravées en reflets des cieux, et celles appelées roches
à cupules. Les très nombreuses cérémonies et rassemblements religieux sont là
pour témoigner l’attractivité de cette barre rocheuse du Massif Central protectrice
du fleuve Rhône. La légende de l’époque sur la naissance de
Pierre de Tarentaise, notre futur pape, n’a-t-elle pas inconsciemment inspiré
notre Saint Marcellin Champagnat, lors de ses parcours à pied entre sa famille
du Rosey à Marlhes et sa fondation des Frères Maristes à La Valla en Gier. Les
historiens rapportent qu’une nuit de forte tempête de neige, St. Marcellin
aurait été sauvé grâce à la vue d’une petite lumière au hameau « Les Palais »,
et grâce à l’accueil très chaleureux de cette famille, il devait poursuivre son
chemin dès le lendemain matin. L’anonymat d’un heureux événement Heureux événement en effet que la naissance de Pierre Aleysson, devenu frère Pierre de Tarentaise. C’est au cours du Moyen Âge Central -classé beau Moyen Âge par certains historiens- et dans l’année 1226 qu’il faut situer la naissance de Pierre Aleysson, qui le fait appartenir à notre région du Bas-Forez. Cette région relevait de l’ancien royaume de Bourgogne, d’où la qualification de «Bourguignon» dont maints auteurs ont fait suivre son nom : Pierre de Tarentaise, Bourguignon, Forézien.
Prarouet
Il est né sur les premiers contreforts du
Massif du Mont-Pilat, non loin des gorges du Furens naissant, proche du
lieu-dit “Prarouet”-Tarentaise et de sa petite église succursale du château de
Rochetaillée, lui-même rattaché au diocèse de Lyon. En aval nous trouvons le
bourg de Valbenoite et son Abbaye puis à environ une lieue, Furania le village,
devenu Saint- Étienne. Dans cette belle contrée, pour ceux qui vivent le
silence, nous entrons dans le domaine vaporeux de la légende et de la mystique.
Tout est dissimulé aux yeux de celui qui cherche des gages, il faut y pénétrer
dans le souffle léger du crédo et de la crédibilité. Deux lieux nous inspirent pour la naissance de
Pierre : proche du lieu-dit « les Palais », nom de lieu donné par une grande
famille et Prarouet, maison forte où l’histoire débute dès le XII° siècle,
habité par les Chartreux de Sainte-Croix-en-Jarez de 1690 à la révolution, et
le moulin « Le Redoux ». Aujourd’hui Tarentaise est un petit village, devenu
commune en 1710 et fait partie entre le Bessat et le Col de La République, du
Parc Naturel Régional du Pilat - Le Haut Pilat. Pierre est décrit comme un homme de bonne
figure et tout en nuances, il devient souverain pontife « Bienheureux Innocent
V ». Devenu frère prêcheur dans la Province dominicaine de France et une des
gloires de l’Université de Paris, il sera nommé Archevêque de Lyon, Primat des
Gaules par Grégoire X qui le créa cardinal-évêque d’Ostie. Pierre devait
succéder à son maître sur la chaire de Saint-Pierre de Rome. L’an 1226, année de la naissance de Pierre, en
pleine période de l’inquisition, sous Louis VIII qui meurt prématurément
laissant le trône de France à Louis IX, sous la régence de sa mère Blanche de
Castille, jusqu’en 1236. A Lyon, mort de l’Archevêque Renaud de Forez qui a
fait du Lyonnais un quasi État sous la souveraineté nominale de l’empereur
allemand et réglé les différends principaux entre la partie occidentale et
orientale de l’archidiocèse. Les dominicains s’installent sur un terrain loué à
l’abbaye d’Ainay près de la chapelle Notre Dame de Confort : les Jacobins.
Pierre de Tarentaise, aurait pu être le frère du futur roi de France Louis IX,
tant ils furent proches sous cette régence de Blanche de Castille la mère de ce
dernier qui régna jusqu’en 1270 date à laquelle il devait mourir à Tunis, lors
de cette dernière croisade voulue par le pape Grégoire X. Louis IX, le plus
connu de nos souverains, fut rejoint par le chevalier Joinville de haute
noblesse, devenu son conseiller. Louis IX est canonisé en 1297 et devient
Saint-Louis. Nous verrons aussi les relations très étroites avec un autre frère
de Louis IX, Charles V d’Anjou devenu roi de Sicile.Ce que de nos jours on
connait le moins de la haute figure d’Innocent V, c’est sa valeur
intellectuelle et l’importance de son oeuvre théologique. On admire le Saint ;
on ignore le docteur. Le Père GILLET dans la préface du livre du R.P. H.
Laurent a voulu expliquer à quel point il y a eu une forte injustice et, dans
la mesure du possible, la réparer, tant elle est criante et insupportable. Si à
la fin du XVe siècle, où son autorité doctrinale était encore incontestée, son
oeuvre avait pu être imprimée, comme celles de tant d’autres théologiens qui ne
le valaient pas, personne aujourd’hui n’ignorerait que, de son vivant et au
cours des siècles qui suivirent, Pierre de Tarentaise jouit, dans son Ordre et dans
l’Église, d’une réputation doctrinale de premier ordre, presque à l’égal de
celles de Saint Thomas d’Aquin et de Saint Bonaventure, ses contemporains et
condisciples, bien que son génie n’égalât pas le leur. Nous empruntons les détails qui vont suivre à
un article, d’ailleurs fort remarqué, du R.P. Simonin, sur « Les écrits de
Pierre de Tarentaise, leur diffusion et leur influence », qui Viennent
heureusement compléter les travaux du T.R.P. Gillon. Notons tout d’abord que la
diffusion des écrits d’un auteur médiéval manifeste, de façon certaine, le
degré de crédit qui leur était accordé dans l’estime des contemporains : le
prix élevé des manuscrits empêchant la multiplication d’ouvrages dont la valeur
aurait été contestée. Étant donné le grand nombre d’anciennes
bibliothèques détruites ou dispersées sans laisser de traces, la diffusion des
écrits de Pierre de Tarentaise apparaît tout à fait remarquable. Elle s’est
étendue de la fin du XIIIe au début du XVIe siècle, dans toutes les contrées
qui reconnaissaient alors l’autorité de l’Église romaine. Dans les pays les
plus divers, réguliers et séculiers, moines noirs et moines blancs, chanoines
et religieux mendiants, ont eu ces oeuvres entre leurs mains. Ils les ont
considérées, jusqu’à l’avènement de l’imprimerie, comme les instruments
indispensables du savoir théologique. Avec les ouvrages similaires de S.
Bonaventure et de S.Thomas d’ Aquin, au côté desquels ils figurent dans les
bibliothèques, les commentaires de Pierre de Tarentaise sur les Épîtres de S.
Paul et les Sentences du Lombard ont fait partie du patrimoine commun de
l’Europe chrétienne. Le chapitre de la province dominicaine de
Toulouse, célébré à Orthez le 24 Juin 1316, enjoint aux lecteurs de conformer
leur enseignement à celui des «vénérables frères Thomas et Albert, et du
seigneur Pierre de Tarentaise, nommé « doctor excellentissimus » et « doctor
clarissimus » au concile de Bâle. Pour Jean de Palomar, archidiacre de
Barcelone, Pierre de Tarentaise, devenu pape sous le nom d’Innocent V, lui
paraît comme le dernier des grands papes qui ont, dans l’histoire, honoré la
tiare de l’éclat de leur science et de leur vertu. Il est infiniment probable
qu’au XVe siècle, si, non moins favorisés que ceux d’autres scolastiques, les
écrits de Pierre de Tarentaise avaient été imprimés, ils continueraient
aujourd’hui encore d’être consultés, non seulement par les historiens de la
Scolastique mais aussi par les théologiens. Ce qui devait inspirer le pape
Grégoire X qui convoqua Le Concile II de Lyon au cours duquel il promulgua les
croisades et rechercha vainement, l’union avec l’Église Grecque. Très jeune vers l’excellence dans sa formation Pierre de Tarentaise a dû quitter sa famille et
sa petite bourgade vers l’âge de sept ans, afin d’entreprendre ses premières
études dans une paroisse rurale, tout d’abord vers l’Abbaye de Valbenoîte
proche et ensuite très rapidement à Lyon. Nous pouvons imaginer que Pierre de
Tarentaise a eu l’accès aux connaissances primaires sous l’influence des moines
en l’Abbaye de Valbenoîte. paroisse rurale du bas Forez, fondée en 1184,
traversée par le ruisseau du Furens et située à quelques lieux seulement en aval
de Tarentaise. A cette époque ce vallon délicieux et désert, ombragé de chênes
séculaires et tapissé de buis ; vallée qui a en tout temps inspiré l’esprit
religieux des hommes. C’était la propriété d’une famille noble Forézienne les
De La Valette, et sous l’allégeance de Renaud II de Forez, fils du Comte Guy II
et le frère de Guy III. Très jeune Pierre est rentré chez les Prêcheurs
à Lyon, au monastère de Saint Martin d’Ainay, âgé d’environ seize ans. Les
frères Dominicains y professaient depuis 1218. A cette époque le couvent de
Lyon, lieu d’accueil de l’ordre des Prêcheurs, sortait heureusement du
provisoire où il avait végété durant de longues années. Grâce à une suite de
négociations, Humbert de Romans avait obtenu, comme prieur, en 1235-1236, de
pouvoir transférer le couvent dans un domaine situé derrière la maison des
Templiers et sous la mouvance de l’abbaye de Saint Martin d’Ainay. Il est fort probable que l’ordination
sacerdotale lui fut conférée au sortir de son adolescence, c’est à dire vers
vingt cinq ans, fut ordonné à Lyon où le siège primatial des Gaules était
occupé depuis quatre ans environ par Philippe de Savoie, qui -on le sait- ne
reçut jamais les ordres sacrés. Il faut de même exclure que fr. Pierre ait été
ordonné par Hugues de Saint-Cher durant le séjour que ce cardinal fit à Lyon de
janvier 1245 à avril 1251: le premier cardinal dominicain n’ayant jamais reçu
l’onction épiscopale. Aucun souvenir concernant le premier
enseignement du futur Innocent V n’est parvenu jusqu’à nous, mais on peut
affirmer qu’il fut d’assez courte durée, car dans un acte du 28 mai 1254 tiré
du Grand cartulaire de l’abbaye d’Ainay, son nom est suivi de ces deux mots :
«quondam lectorem» Le document de 1254, auquel on vient de faire allusion, est
-nous croyons- la première pièce d’archives, qui nous ait été conservée, où
figure le nom de Pierre de Tarentaise On peut donc admettre que l’âge de seize ans,
donné par les Annales comme étant celui où Pierre entra dans l’ordre des
Prêcheurs, est chronologiquement exact. Les données fournies par Étienne de
Salagnac et par le dominicain anonyme de Constance ; nous apprennent en effet
que Pierre se fit dominicain étant “ invenis “. Or il semble certain que ce
terme exclut que le futur Innocent V ait été encore “ puer “, quand il revêtit
l’habit dominicain : il avait même atteint, sinon dépassé depuis quelque temps
déjà, sa majorité roturière. Ce qui convient de fixer sa prise d’habit vers
1240. A l’époque où Pierre de Tarentaise sollicita
son admission dans l’ordre des Prêcheurs, le couvent de Lyon sortait
heureusement du provisoire où il avait végété durant de longues années. Grâce à
une suite de négociations, Humbert de Romans avait obtenu, comme prieur, en
1235-1236, de pouvoir transférer le couvent dans un domaine situé derrière la
maison des Templiers et sous la mouvance de l’abbaye de Saint Martin d’Ainay.
Fr. Pierre venait d’autre part prendre place dans une communauté fervente, dont
les membres faisaient hautement honneur à l’Ordre de l’Église. Au cours de ses
premières années de vie religieuse, fr. Pierre entendit plus d’une fois, en
communauté, le récit émouvant de divers événements, qui agirent profondément
sur l’âme populaire et dont Étienne de Bourbon a recueilli les échos dans son
fascicule d’exemple ; à propos de la catastrophe du Mont - Granier qui le 24
nov.1248 coûta la vie à 5000 personnes. La réforme de l’abbaye d’Ainay est le seul souvenir qui nous soit parvenu de l’activité de Pierre de Tarentaise durant les dernières années de son séjour sur les rives du Rhône en tant que professeur en théologie. En 1272 il reviendra à Lyon couronné de gloire « Évêque de Lyon – Primat des Gaules » avant d’assurer le secrétariat général du Concile II de Lyon en 1274. Dès l’été de 1255, fr. Pierre fut désigné pour conquérir ses grades en théologie, il enseignait à cette époque comme bachelier biblique dans l’une des chaires que l’ordre de S. Dominique possédait à l’université de Paris. C’est là désormais qu’il faudra le suivre. Il obtiendra son titre de Maître en Théologie, très rare durant le XIIIe siècle, à l’égal de Thomas d’Aquin et de Hugues de Metz.
Valbenoite (église)
Pierre de Tarentaise fut le 17ème promu ; le
titre de maître n’était reconnu dans l’ordre qu’aux religieux qui avaient pris
leur grade à Paris. L’année 1255 -1256- celle même où Pierre prit contact avec
le milieu intellectuel Parisien fut pour les Dominicains une des plus graves
luttes que le « studium generali » de Paris ait eu à traverser au cours du
XIIIe siècle. Décembre 1255 et Janvier 1256 marquent le point culminant de ces
violences. Pour se protéger et se défendre, les Prêcheurs avaient à nouveau recouru
au pape et avaient réclamé la protection du pouvoir civil, et grâce aussi à la
protection du pouvoir royal le couvent de Saint-Jacques, échappa aux menaces
des séculiers. Pierre de Tarentaise est né une dizaine
d’années après la mort d’Innocent III, pape de 1198 à 1216 qui a repris le nom
d’Innocent III l’antipape de 1179 à 1180 ; Innocent IV de 1243 à 1257 devait
laisser beaucoup d’inspirations au fr. Pierre qui devint Innocent V : d’une
part le Concile I de Lyon, et d’autre part l’appel à la croisade. Trois
croisades en Terre Sainte ont été menées alors que fr. Pierre était attaché à
connaître et faire connaitre la théologie à l’université de Paris. Au même
moment, en 1267, le roi Louis IX «Saint-Louis» part pour la seconde fois en
croisade, depuis Aigues-Mortes là où il avait déjà embarqué pour sa première
croisade en 1245. Sur le retour, il meurt à Tunis le 1er Juillet 1270. Les deux provinces dominicaines, entre
lesquelles se divisait alors le territoire qui forme la France actuelle
-Province de France et Province de Provence -, se sont toujours refusées,
durant tout le cours du XIIIe siècle, à ouvrir des écoles, où des religieux
auraient donné l’enseignement à ceux qui se destinaient dans un avenir plus ou
moins lointain à revêtir l’habit dominicain. Il se peut toutefois que Pierre
ait connu l’ordre naissant de Saint- Dominique par l’intermédiaire d’un de ces
frères, qui se plaisaient à prêcher aux jeunes écoliers, sous le titre de « De
modo docendi pueros », un manuel pour la prédication aux enfants. Car si, au
XIIIe siècle, les Dominicains français ne consentirent jamais à devenir
eux-mêmes des instituteurs, s’ils eurent le souci constant de ne point sortir
de la sphère qui leur était propre, à l’enseignement des sciences élémentaires
donné par d’autres, ils voulurent ajouter l’enseignement élémentaire de la
science des sciences et vivifier ainsi l’intelligence des enfants par la
formation et la direction de leurs jeunes âmes. On peut donc se demander quel fut le religieux
qui, ayant recueilli les premières ouvertures de Pierre de Tarentaise,
l’orienta vers le couvent que les frères Prêcheurs possédaient depuis une
vingtaine d’années dans la ville de Lyon. Une tradition dans l’ordre des
Prêcheurs voulait que les études se poursuivent à Saint Jacques de Paris. Car
pour un dominicain qui devait acquérir un certain renom dans le monde
théologique médiéval, avait dû fréquenter, dès sa jeunesse, le « studium
generale » Parisien. Le cas de Thomas d’Aquin n’a pas été étranger à une telle
conception, mais l’on a oublié que le cas du Docteur Commun était une exception
dictée par des circonstances particulières. Admettre que Pierre de Tarentaise
ait étudié aux côtés du dominicain napolitain, c’est vouloir ignorer la
discipline en usage chez les Prêcheurs à une époque où, pour atteindre un
niveau intellectuel toujours plus élevé, les prieurs provinciaux étaient
fréquemment invités à se montrer difficiles dans le choix des étudiants, qui devaient
être envoyés auprès de la célèbre université. Tout nous porte à croire qu’il en
fut pour Pierre de Tarentaise comme pour les autres profès Dominicains. C’est
probablement après avoir suivi durant un certain nombre d’années les cours au
studium conventuel de Lyon et y avoir entendu commenter pour la première fois
le texte de Pierre Lombard, qu’il fut assigné à Saint Jacques pour y parfaire
ses connaissances théologiques. Vers 1250, Pierre de Tarentaise était prêtre
depuis quelque temps déjà, car tout en tenant compte d’exemptions toujours
possibles, il est probable que l’ordination sacerdotale lui fut conférée au
sortir de son adolescence, c’est à dire vers vingt cinq ans. Qui fut le prélat
consécrateur de Pierre de Tarentaise, ordonné à Lyon ? En 1250, le siège
primatial des Gaules était occupé depuis quatre ans environ par Philippe de
Savoie, qui -on le sait - ne reçut jamais les ordres sacrés. Aucun souvenir
concernant le premier enseignement du futur Innocent V n’est parvenu jusqu’à
nous, mais on peut affirmer qu’il fut d’assez courte durée, car dans un acte
délivré en 1254, - Grand cartulaire de l’abbaye d’Ainay de Charpin –
Feugerolles et M.Guigue -, son nom est suivi de ces deux mots: “quondam
lectorem “. Ce document cité est - croyons nous - la première pièce d’archives,
qui nous ait été conservée, où figure le nom de Pierre de Tarentaise. La
réforme de l’abbaye d’Ainay, très importante et mise en cause durant plus de
quatre années est le seul souvenir qui nous soit parvenu de l’activité de Pierre
de Tarentaise durant les dernières années de son séjour sur les rives du Rhône.
On ne saurait l’identifier avec un autre religieux du couvent de Lyon: frère
Pierre dit Roschelin de Tarentaise. Confirmé par deux grands auteurs - J.
Chevalier et Beyssac - le nom de ce dominicain, qui très probablement était
d’origine savoyarde, figure dans une suite d’actes concernant soit la tenue des
chapitres généraux en Chartreuse en 1255, soit la réforme des chanoines de la
cathédrale de Moûtiers, sur inventaire. Ces divers documents appartiennent aux
années 1255 et 1256. Or à cette date le futur Innocent V avait quitté Lyon
depuis quelques mois déjà. Désigné pour conquérir ses grades en théologie, il
enseignait à cette époque comme bachelier biblique dans l’une des chaires que
l’ordre de S. Dominique possédait à l’université de Paris. C’est là désormais
qu’il nous faudra le suivre. L’Histoire a basculé, pour un nom gratté Très attiré par mes lectures et mes découvertes
sur un grand Homme, je tiens absolument à vous faire partager mon exaltation
dans la reprise de l’Histoire, assurée il faut le dire par les moyens
grandissants d’exploration des manuscrits très anciens. C’est ainsi que l’on
peut découvrir le lieu de naissance de Pierre de Tarentaise dans notre Forez
par les recherches très importantes à la bibliothèque et aux archives du
Vatican au cours de cette dernière guerre. Les recherches sérieuses, longues et
approfondies du Révérend Père H. Laurent, aux archives du Vatican, nous en
apportent le témoignage d’Étienne de Salagnac ce religieux qui a pu être
personnellement en rapport avec Pierre de Tarentaise soit à Paris en 1264, soit
à Lyon en 1274. Étienne de Salagnac, son contemporain, nous a fourni au sujet
de cette naissance, des renseignements majeurs dont la précision géographique
exclut toute possibilité de doute. Ses précisions revêtaient beaucoup
d’importance ; « Fr. Petrus de Tarantasia, dyocesis Lugdunen, doctor gratiosus,
abbreviator Thome compendiosus, scripts super sentences … » compilait « Il
ressort que le mot Lugdunen a été corrigé, par une main du XV° Siècle. » A l’époque de Pierre, le village de Moûtiers
est appelé indifféremment “ Monasterium et Tarantasia “ dans les documents
savoyards ; aussi bien que dans les documents et lettres pontificales. Nous
trouvons aussi un écrit de Bernard Gui, « Priores provinciales » où la parole “
Viennnensis “ a été grattée et remplacée postérieurement par le mot “ eiusdem “
; et c’est sous cette forme que ce texte a été édité par M.D. Chapotin dans “
Histoire des Dominicains de la province de France “.Les témoignages d’Étienne de
Salagnac et de Bernard GUI, que vient confirmer la chronique du monastère de
Sainte Catherine à Rouen, revêtent une certaine importance. Ils mettent
définitivement un terme à la discussion, qui s’éleva au cours du 19° siècle,
entre les historiens de la Savoie et ceux du Val d’Aoste. Or Pierre n’était ni savoyard ni valdôtain ; il appartenait par sa naissance au Bas-Forez. Cette région relevait, on le sait, de l’ancien royaume de Bourgogne, d’où la qualification de « Bourguignon » dont maints auteurs, à l’exemple de Martin de Troppeau, ont fait suivre le nom de notre Bienheureux. Autre figure, autre confusion : dans la légende de Saint Pierre de Tarentaise (Anvers 1680) Geoffroy de Hautecombe se contente de dire que le Saint vit le jour dans un village du diocèse de Vienne, auquel Pierre aurait, dans la suite, donné le nom de Saint-Maurice. La vérité de l’Histoire s’affine par recoupement et par une mise en condition de l’époque qui nous fait découvrir devant les influences, la puissance de la famille de Savoie au XIIIe siècle dans ce diocèse déjà reconnu et fort d’une volonté d’appropriation d’identité ; au point de rendre aveugles les historiens qui jusqu’au vingtième siècle en acceptaient la version.
Le Furan
Épilogue Ces oeuvres, chacune entreprise à des périodes
et des temps différents, me permettent, maintenant, de lever le rideau de
l’Histoire. Le travail de la mémoire n’a de sens que si elle est fidèle à
l’Histoire. La civilisation scientifique et technique de nos jours rattrape le
temps perdu et rapproche Dieu et la Science. Il y a sept siècles, la présence du Pape
Grégoire X, ouvrant le Concile II de Lyon ; confirme que Lyon a été, en dehors
de l’Italie, la ville la plus visitée par les papes du Moyen-Âge. Il est ici
intéressant d’indiquer que entre 1220 - 1250, la Région Lyonnaise faisait,
alors, partie de l’Empire Germanique, au même titre que : La Bourgogne, La
Lorraine, Le Forez, Le Massif Central, La Savoie, Le Diocèse de Valence, Le
Roussillon. Le rôle de métropole de la chrétienté avait fait de Lyon, selon le
mot du biographe d’Innocent IV, Nicolas de Curbio, une “ seconde Rome “ et par
la suite des rives du Tibre, devait, au siècle suivant, l’amener durablement
sur les bords du Rhône. La fusion de l’ensemble des recherches donne tout son
sens à l’écriture. Elle éclaire la vie des hommes et de leur terroir tout au
long des siècles, en nous apportant ainsi, avec forte expression, l’histoire
pour notre liberté. L’Histoire est ce que le présent veut retenir du passé.
Ecrire s’est faire trace. Je voulais absolument tenir et détenir et vous
faire découvrir la vérité « de l’Histoire » quelque peu usurpée par la
puissante famille de Savoie particulièrement au XIIIe siècle rendant aveugles
les historiens de l’époque et ce jusqu’à la première moitié du XXe siècle. Les
archives pontificales du Saint Siège, étudiées lors de la dernière guerre, ont
permis de faire ressortir beaucoup de manuscrits non publiés et dernièrement
traduits. La bibliothèque du Vatican vient de rouvrir ses portes après plusieurs
années de travaux ; voilà une magnifique et bonne raison d’assurer une visite,
profitable à la précision et l’approfondissement de l’Histoire à retenir. 1342,
date à laquelle le trésor fut, sur l’ordre de Clément VI, transporté en
Avignon.Au côté de ces documents, il faut mentionner plus spécialement les
mandements qui émanent de la chancellerie de Charles d’Anjou. Aucun d’entre eux
ne concerne directement Pierre de Tarentaise avant son pontificat. Mais après
que le cardinal d’Ostie eut été appelé à succéder à Grégoire X, les actes du
roi de Sicile nous permettent de suivre de plus près l’action pacificatrice
d’Innocent V tant en Ligurie qu’en Toscane. Signalons aussi un groupe de
documents conservés de nos jours dans les archives de Florence, de Pise et de
Prato : ils ont trait à la paix signée en juin 1276, grâce à l’intervention
d’Innocent V, entre Oise et la Ligue guelfe de Toscane, ainsi que les actes
malheureusement trop rares qui nous permettent de suivre l’activité de Pierre
de Tarentaise, soit durant son provincialat, soit comme archevêque comte de
Lyon. Peut-être sera-t-on amené à se demander si l’héraldique et la
sphragistique ne seraient pas à même de fournir, elles aussi, quelques
indications utiles. D’aucuns l’ont pensé, mais dans le cas présent les données
de ces sciences auxiliaires de l’Histoire demeurent trop vagues, trop
incertaines, pour qu’il soit possible d’en utiliser les renseignements. Appendice Extraits du catalogue des actes imprimés
concernant Innocent V - 1254 - 28 Mai (Assise). _ prieur des frères
Prêcheurs de Lyon et frère Pierre de Tarentaise sont chargés par Hugues de
Saint-Cher, cardinal du titre de Sainte Sabine, de veiller à l’exécution des
décisions prises par le cardinal pour la REFORME de l’abbaye d’Ainay et de
prendre, de concert avec l’abbé du dit monastère, les décisions qui seraient
nécessaires à telle fin. (Document inséré dans une bulle d’Alexandre IV du 5
décembre 1258). - 1265 - juillet à septembre (Pérouse). Clément
IV ordonne au provincial de la province dominicaine de France (Pierre de
Tarentaise) et aux ministres provinciaux des fr. Mineurs du royaume de France
de faire prêcher la croisade contre les Mamelûks. - 1272 - Juin (Rome, près S. Pierre). Grégoire
X fait savoir à Pierre de Tarentaise, provincial de la province de France,
qu’il l’a choisi comme archevêque de Lyon. - 1274 - 7 Mai (Lyon). _ Grégoire X nomme, à la
place de Pierre de Tarentaise, comme archevêque de Lyon, Aymar de Rossillon,
prieur de Cluny. Le 20 Mai, le chapitre général des frères. Prêcheurs, réuni à
Lyon, ordonne à chaque religieux prêtre de célébrer une messe pour Pierre de
Tarentaise, cardinal-évêque d’Ostie. - 1275 - Avant le 20 Février (Lyon). Grégoire
X, ayant repoussé la demande que lui avait faite Philippe III le Hardi, roi de
France, de dispenser son fils aîné, Louis de France, de l’empêchement du
troisième degré de consanguinité, en vue de son mariage avec Jeanne, fille du
défunt Henri III, roi de Navarre, consent à accorder ladite dispense à un autre
fils de Philippe. Le pape ayant manifesté ses intentions au roi par
l’intermédiaire de Pierre de Tarentaise et de fère. Boniface Fieschi de
Lavagna, Philippe III désigne son second fils Philippe le Bel: Grégoire X
accorde à ce dernier la dite dispense. - 1276 - Janvier (vers le 15). Rodolphe Ier,
ayant appris la mort de Grégoire X, écrit aux cardinaux réunis à Arezzo pour
leur demander de placer sur le siège de Pierre un digne pontife. - 1276 - 15 Janvier (Rome). _ Charles Ier, roi
de Sicile, écrit à Gauthier de Sommereuse, justicier de la Terre de Labour, de
lui adresser la plus forte somme possible d’argent. Le roi doit demeurer
longtemps à Rome et supporter de lourdes dépenses en raison de la création du
nouveau pontife. - 1276 - 25 Février (Rome, Latran). _ Innocent
V notifie aux patriarches, archevêques, évêques et abbés et princes du monde
catholique son élévation au souverain pontificat. -1276 - 2 Mars (Rome, Latran). _ Innocent V
confirme Charles 1er, roi de Sicile, dans ses charges de sénateur de Rome et de
vicaire impérial en Toscane - 1276 - les 30 et 31 Mars (Rome, Latran).
Innocent v confirme à deux reprises les privilèges, immunités et exemptions,
accordés par ses prédécesseurs aux religieux de l’Ordre du Temple. - 1276 - 30 Avril (Rome, Latran). Innocent V confirme les pouvoirs concédés par Grégoire X à Gérard de Grandson, évêque de Verdun, afin que ce dernier choisisse des personnes (sous-collecteurs), aptes à lever en Angleterre et en Irlande la dîme ; imposée par le II° concile de Lyon en faveur de la croisade.- en 1898- Innocent V sera béatifié par le Pape Léon XIII.
|
 |