
Projection de la
Sainte Lance sur le Pilat druidique et templier Première partie : des origines de la Sainte Lance aux
Templiers |
Présenté
par
Michel Barbot |

|
Mai
2025 |
La Sainte
Lance ou Lance du Destin, relique de la Passion, est l’arme avec laquelle le
centurion Longinus, le Porteur de la lance, perça le flanc droit de Jésus lors
de sa Crucifixion. La tradition chrétienne l’a identifiée à la Lance de Phinée
ou Pinhas, fis d'Éléazar et petit-fils d'Aaron frère de Moïse. Il dut sa
renommée à ce terrible épisode biblique connu comme « l’acte de
Pinhas » (Livre des Nombres 25-verset 7 et suivants), acte
fondateur de la Sainte Lance. Bien que son nom soit apparenté à l’égyptien Pe-Nehasi
ou Pa-Nahsi, «le noir (le Nubien) », il reste associé aux
termes hébreux néhosha: « la « bouche de cuivre » et pé
nahash : la « bouche de serpent ».. Le mot nahash,
« serpent, serpent volant », signifie aussi « pratiquer la
divination ». Dans ce nom reconnu du premier Porteur de la Lance se révèle
toute sa maîtrise dans l'exercice de pratiques secrètes. La référence serpent /
cuivre se retrouve dans l'expression nahash néhoshet
: « serpent de cuivre » (Livre
des Nombres 21 – 8 et 9). Les Israélites mordus par le serpent brûlant du
désert devaient regarder le serpent de cuivre dressé par Moïse sur un poteau et
ils étaient guéris. Dans l’Évangile de
Jean 3-14, Jésus annonce que le Fils de l’homme sera élevé comme fut élevé
par Moïse, le serpent dans le désert. L’historien israélien Shmuel Ahituv de
l'université Ben Gourion du Néguev, évoque dans son Encyclopédie biblique (Jérusalem, 1972) le grand prêtre égyptien
Pa-Nahsi originaire de Nubie (Soudan) qui offica à l'époque du pharaon
Akhenaton. Pinhas ainsi que son père Éléazar reposent suivant la tradition en
Samarie sur la colline de Pinhas.
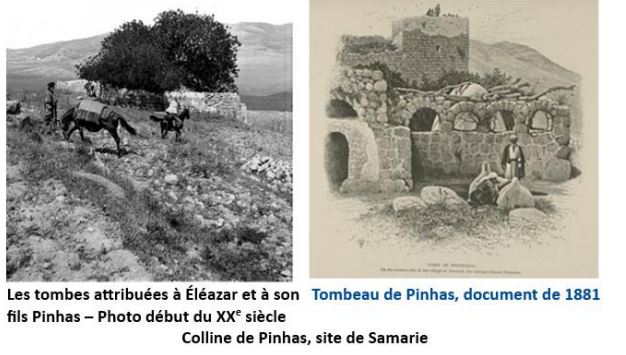
Tombes d'Eleazar et de Pinhas
htts://he-m-wikipediaorg.translate.goog/wiki/%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%AA_%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%97%D7
%A1?_x_tr_sl=iw&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc
Gaius
Cassius, tel était le nom du futur Longinus, était handicapé par une cataracte.
Lorsqu’il perça le flanc droit de Jésus, il fut miraculeusement guéri par l’eau
et le sang qui sortirent de la plaie. Sa guérison au pied de la croix rappelait
celle des Israélites face au serpent de cuivre durant l’Exode.

Scène classique de la Crucifixion : le centurion Longinus perce
de sa lance le flanc droit de Jésus, et il en sort du sang et de l'eau, comme
le signalent les mots latins SANGUiS ET AQUA gravés au-dessus de la croix
(basilique de Fourvière, Lyon)
Après la
Passion, Gaius Cassius à présent connu sous le nom de Longinus, le Porteur de
la Lance, s’en retourna dans sa patrie et adopta la vie monacale. Les vieux
auteurs le disaient originaire de Cappadoce, voire même des Abruzzes ou
d’Espagne. Les descendants de Longinus auraient gardé la Sainte Lance jusqu’en
287, année où elle fut dérobée par l'empereur Maximien, puis dit-on déposée à
Constantiople… Denis Chevignard dans son livre La Terre Sainte et la France (Éditins VIA ROMANA), écrit :
« Cette présence de nos ancêtres en Terre Sainte est également attestée
par Flavius Josèphe, qui précise que la garde personnelle d’Hérode était
composée de Gaulois, de Germains et de Thraces, ce qui montre la confiance que
les puissants ne manquaient pas de leur accorder. » (Antiquités Judaïques, XVII, 8, 3 ; Guerres des Juifs, I, 33, 9) Cet auteur poursuit : « Ajoutons,
pour souligner les prévenances et les préordinations divines, que la tradition
rapporte que le centurion du Calvaire était originaire d’Autun, diocèse choisi
par notre Seigneur pour demander à sainte Marguerite-Marie la dévotion
réparatrice à Son Sacré-Cœur, en 1675. » Ce choix divin se réfère bien sûr à Paray-le-Monial, ville où eut lieu
cette apparition.
La cité
d’Autun, ville natale supposée de Longinus, fut aussi historiquement marquée
par la présence de l’empereur Constantin le Grand, autre détenteur de la Sainte
Lance. En 310 cet empereur affronta à Marseille l’usurpateur Maxence, puis
remonta le Rhône en s’arrêtant dans des temples du dieu Apollon (gaulois
Bélénos). Le Druidisme à l’époque était encore la religion de l’empereur. Il
s’en retourna à Trèves en Germanie où il avait établi sa capitale, mais
conseillé semble-t-il par les Druides, prêtres d’Apollon, il bifurqua
possiblement depuis Lyon, dans un premier temps, vers la cité d’Autun où se
trouvait un temple apollinien. L’historienne Anne Lombard-Jourdan dans Montjoie et saint Denis Le centre de la
Gaule aux origines de Paris et de Saint-Denis (Presses du CNRS), affirme
qu’il poursuivit ensuite sa route jusqu’au Lendit, lieu de la décollation de
saint Denis. En ce lieu se trouvait suivant cette historienne, le plus grand
temple d’Apollon. Les Druides auraient remis à Constantin la Sainte Lance. L’hypothèse
avancée par cette historienne ne fait pas l’unanimité pami ses confrères,
d’autant plus qu’elle prolonge son hypothèse en affirmant que le lieu de
rassemblement annuel des Gaulois affirmé par César dans La Guerre des Gaules, ne se trouvait pas à Chartres mais au Lendit.
Elle développe en fait une hypothèse déjà avancée au XIVe siècle par
Raoul de Presles. Mais n’oublions pas, ainsi que l’évoque Noël Gardon dans son
livre Mon Pilat Etymologies Rêves, Légendes… et Réalités, que « C’est à
Pilat, au ‘’Crêt de l’Airelier’’ que se tenait, autrefois cette assemblée
annuelle gauloise. Puis après la transformation en province romaine du
territoire des Allobroges et de la Narbonnaise, il n’était plus concevable, ni
logique de maintenir en ce lieu ces réunions où les principaux chefs guerriers
et religieux se trouvaient rassemblés. » Suivant cet auteur les
rassemblements sur le Crêt de l’Aralez ou Airelier eurent lieu quelques 120 ans
avant notre ère avant que le lieu de rassemblement des tribus celtes ne fût transféré
à Chartres… Il convient d’évoquer cette autre tradition plutôt intéressante
dans sa symbolique, associant la commune
de Longes adossée au contrefort du Pilat, dans le département du Rhône, au
centurion Romain Longinus.

Longes, vue générale
Présence du nombre 30 dans la géographie sacrée
Les lieux
marqués par le nombre 30 conservent une auréole druidique et souvent templière.
Des romanciers comme M. Gouazé de Foix (Le
dernier Druide), puis Maurice Leblanc (L’île
aux Trente Cercueils) ont centré leur intrigue insulaire autour de la magie entourant ce nombre. J’ai pu
évoquer dans mon article LE VIEUX SECRET,
consacré à l’énigme de Trèves, les anciens sites templiers de Rezé, cité
faisant face, sur la rive gauche de la Loire, à la ville de Nantes. Il y avait l’ancien Trivium avec la chapelle Notre-Dame de
la Blanche et sa commanderie templière et le non moins mystérieux triplet
d’îles dont l’une avait nom Trentemoult.
http://regardsdupilat.free.fr/soutrevesb.html Élément d’importance, la commune de Trèves (le Trivium) dans le
Rhône fut anciennement une annexe de Longes… Les travaux de l’historienne Anne
Lombard-Jourdan donnent à penser que ces différents toponymes révèlent ce que
l’on peut considérer comme une géographie sacrée apollinienne. L’historienne
reprenant le récit du Panégyriste de 310,
indique : « C’est à Trèves, à la fin de juillet 310, que le panégyriste,
très vraisemblablement le Gaulois Eumène, professeur aux écoles d’Autun, évoqua
à mots couverts la consultation de l’oracle, qui datait du mois précédent. […]
l'empereur « a vu Apollon accompagné de la Victoire et lui offrant des
couronnes de laurier’’, qui portaient chacune un signe cruciforme assimilable
au chiffre romain X et répété trois fois. Il semble bien que
Constantin ait voulu, à l’exemple d’Alexandre, se faire garantir une origine
divine. La visite que celui-ci rendit, pendant l’hiver 332-331 avant notre ère,
à l’oracle d’Amon dans l’oasis égyptienne de Siwa, Constantin l’accomplit au
sanctuaire celtique ‘’le plus beau du monde’’ au printemps 310. » Les trois X
(XXX) seront interprétés par le panégyriste gaulois dans « un sens conforme aux
usages romains – les 30 années de règne, expression des vota publica courante à Rome – » Le nombre trente dans son aspect
géographique se reconnaît au Moyen Âge sous le nom Tricena, soit l'oracle
Tricine mentionné par Raoul de Presles. Anne Lombard-Jourdan commente : «
L’emploi insolite du distributif latin : ‘’chaque fois trente’’, comme
toponyme, autorise le rapprochement avec le tricennum
omen annorum que portaient […] les couronnes offertes par Apollon à
Constantin. » Elle rappelle ensuite que le faubourg de Trion à Lyon doit son
nom au lieu-dit Triguncius (932) « qui postule un type primitif latinisé
Tricontis ou Tricontim, du gaulois Tricontis ou Tricontin ; ce dernier mot a
été considéré comme l’ordinal : ‘’trentième’’, tiré du cardinal tricont, qui se
retrouve dans le breton tregont. » Près du Trion lyonnais vers le Gourguillon
se trouvait un quartier Saint-Georges où
se trouvait le bain d’Apollon et une
fontaine dite plus tard, « des Trois cornets ».

Fontaine rue de Trion à Lyon. Bien qu'inspirée de l'art
gallo-romain, elle date en réalité du XIXe siècle
Le Trion
ne fait pas l’unanimité pour son étymologie : nombre 30 pour les uns et nombre
3 pour les autres… L’énigme du Trente apollinien se prolonge dans le héros
solaire du conte breton : Tregont à Baris
ou « Trente de Paris », personnage solaire tout droit venu du
Finistère breton. La route suivie par Constantin était marquée par les temples
consacrés au dieu Apollon. Nous nous arrêterons sur l’hypothèse avancée par
l’éditeur et érudit allemand Christoph Cellarius (né en 1638 à Schmalkalden et
mort en 1707 à Halle), principalement connu pour ses travaux en histoire et en
géographie et dont l’œuvre principale fut son Historia Universalis qui divise l'histoire en trois périodes :
l'Antiquité, le Moyen Âge et les Temps modernes, une division toujours utilisée
de nos jours. Son hypothèse rapportée par Lietzmann qui l’étend quant à lui
jusqu’au lac de Genève, voire le Rhin supérieur (Silzungsber. der preuss.
Ak. der Wiss., 1937, p. 264), s‘énonce ainsi : « Lugdunum forsan
aut Viennam aut aliam eiusdem tractus », soit : « Lyon, peut-être, ou
Vienne, ou une autre de la même région. » fie:///C:/Users/miche/Downloads/rea_0035
004_1950_num_52_3_3433%20(2).pdf
Pour cette hypothèse formulée par Cellarius nous resterons
dans la partie du tractus délimité par les cités de Lyon et de Vienne et plus
précisément dans la section bordant le Mont Pilat. Un temple d’Apollon,
fut-t-il satellite du temple du Lendit pourrait-il, être envisagé en ces lieux
? La région où se localise le Lendit, ainsi que celle du Pilat, partagent le privilège
d’avoir été reconnues possiblement, pour deux époques différentes, comme le
Centre des Gaules évoqué par César. Une recherche dans l’index du tome I des
livrets Le guide du Pilat et du
Jarez (Action graphique éditeur) de Patrick Berlier, me permit de découvrir
qu’il existait dans le mystérieux massif, un Col de Trente Sous. Ce col situé
dans la commune de Saint Paul-en-Jarez, par son nombre trente se placerait
d’emblée dans cette géographie sacrée apollinienne. Patrick dans la brochure n°
XI évoque ainsi ce col : « De la Barollière partait une deuxième voie ; elle
montait le long de la ‘’Côte Bayolle’’ jusqu’au ‘’Col de Trente Sous’’, nom qui
est une déformation de ‘’Trente Sauts’’. » Suite à cette découverte je me
rapprochais de Patrick qui m’écrivit : « Le col de Trente Sous est en réalité à
2 km au sud de Saint-Paul-en-Jarez, plus près donc de la Terrasse-sur-Dorlay.
Pour moi le ‘’vrai’’ col n'est pas à l'endroit où il est indiqué sur la carte,
mais à 1 km plus au sud. Tout cela je l'expliquais dans un sujet pour Regards
du Pilat : htt://regardsdupilat.free.fr/barolliere.html

Le col de Trente Sous
Si le
toponyme Trente se veut révélateur d’une géographie sacrée liée au culte
d’Apollon, se pourrait-il que dans le Pilat, nous ayons d’autres indices
permettant de l’affirmer ? Intrigué par cette hypothèse, Patrick me présenta
une intéressante piste postulant pour une approche géographique apollinienne
dans le Pilat : « Dans sa partie la plus méridionale se trouve le village de
Saint-Appolinard, curieusement écrit avec deux P et un seul L, contrairement à
Apollon.

Saint-Appolinard, l''église
Si les
manuels d'hagiographie connaissent saint Apollinaire, martyre à Ravenne au Ier
siècle, seuls des ouvrages locaux signalent un saint Appolinard évêque de
Valence mort en 520. Cet incongru Appolinard pourrait bien être aussi une
christianisation d'Apollon déguisée sous une orthographe fantaisiste. »
S’appuyant sur les Fiches archéologiques de Georges Pétilon, Patrick
ajoutait : « Une voie romaine importante venait de la vallée du Rhône et se
dirigeait sur le Velay, permettant ainsi de passer de la vallée du Rhône à
celle de la Loire, et cette route passait par le lieu qui deviendra Saint-Apollinard. Avant
d'arriver à la Loire, la voie passait donc par Polignac, autre lieu dédié à
Apollon, dont subsiste le masque, la statue grossière qui délivrait des
oracles, exposée dans les soubassements du donjon du château médiéval. »
Il apparaît que le village de Saint-Appolinard puisse être retenu comme un
probable jalon permettant de voyager, notamment, vers Polignac, lieu marquant
de la géographie sacrée apollinienne.

Le masque d'Appolon qui servait à délivrer des oracles
(château de Polignac, Haute-Loire)
Projection géographique de la croix décussée dans le Pilat
Je
découvris en parallèle que, suivant la tradition, Longin devenu saint, transmit
la Sainte Lance à saint Georges le Cavalier « solaire » mort en Asie Mineure
vers 305… Ici, seule la symbolique compte…htts://actu.fr/occitanie/lascabanes_46158/saint-georges-de-lascabanes-protecteur-despelerins_4142837.html
Or, il
apparaît que ce saint pourfendeur de dragons, fut vénéré dans deux sites
importants du Pilat. L’un de ces deux sites fut assurément la chapelle
Saint-Georges de Virieu à Pélussin et le
second, la chapelle Saint Georges d’Argental.

Les deux chapelles Saint Georges : Virieu et Argental
L’abbé J.
Batia dans son livre Recherches
historiques sur le Forez Viennois nous apporte de précieuses réflexions
centrées autour de ces deux édifies : « Tous les documents sont d’accord pour
faire remonter à l’an 1300 l’érection de la chapelle de Virieu. Jacques de
Jarez, seigneur de Saint-Chamond, marié à Béatrix, fille de Pagan, seigneur
d’Argental, était alors seigneur de Virieu et Chavanay. Se souvenant sans doute
que la chapelle d’Argental, fondée au XIIe siècle, était dédiée à Saint-Georges, il voulut, peut-être pour
être agréable à son épouse Béatrix et pour qu’elle pût retrouver à Virieu le
souvenir de sa chapelle d’Argental, placer la chapelle de Virieu sous le
vocable de Saint-Georges. »
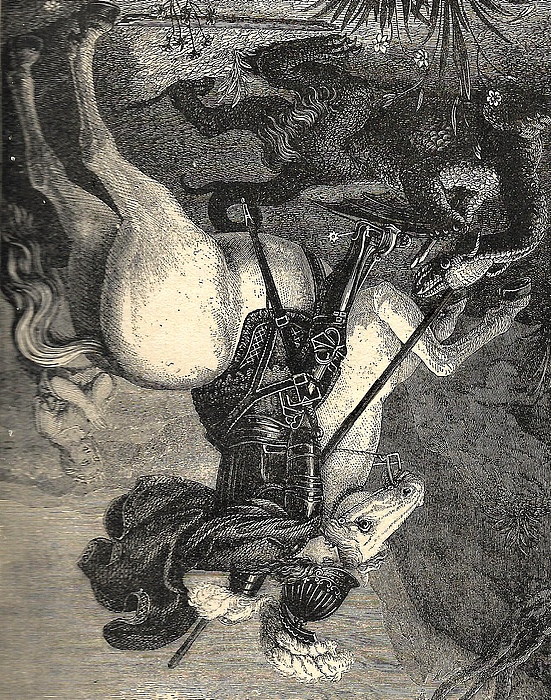
Saint Georges, armé de la Lance, pourfend le dragon
(gravure ancienne)
En
reliant ainsi les deux chapelles, l’abbé Batia nous permet de tracer une ligne,
image de la Sainte Lance arborée par saint Georges. Derrière le culte médiéval
de ce saint plane l’ombre des Chevaliers de l’Ordre du Temple auxquels les
Pagan étaient possiblement liés. Dans le département de la Loire nous pouvons
découvrir, à tire d’exemple, la commune de Saint-Georges-Haute-Ville sur un
ancien Chemin de Compostelle. Dans un reportage de TL7 (Télévision Loire 7), la
chroniqueuse Justine Ouillon met en avant la vénération de saint Georges par
les Templiers. Au retour de croisades, ils ont reçu « la mission de protéger
les routes de notre pays et plus particulièrement les chemins de Compostelle.
Voilà donc l’explication la plus probable sur l’origine du nom de
Saint-Georges-Haute-Ville. »
htts://www.dailymotin.com/video/x80ie5x
Cette
lecture templière Saint-Georgienne dans
son aspect axial généré par les chapelles d’Argental et de Virieu, apparaît
soudain bien étrange si l’on trace également un second axe entre le Col de
Trente Sous et la commune de Saint-Appolinard. Ces deux axes en se croisant
face à l’épine dorsale du Mont Pilat vont matérialiser la croix décussée
apollinienne ou croix de saint André (apôtre important dans la redécouverte de la Sainte Lance) qui
nous mène au talisman de Phinée. Patrick Berlier informé de ma découverte, reproduisit sur la carte
l’hypothétique croix :
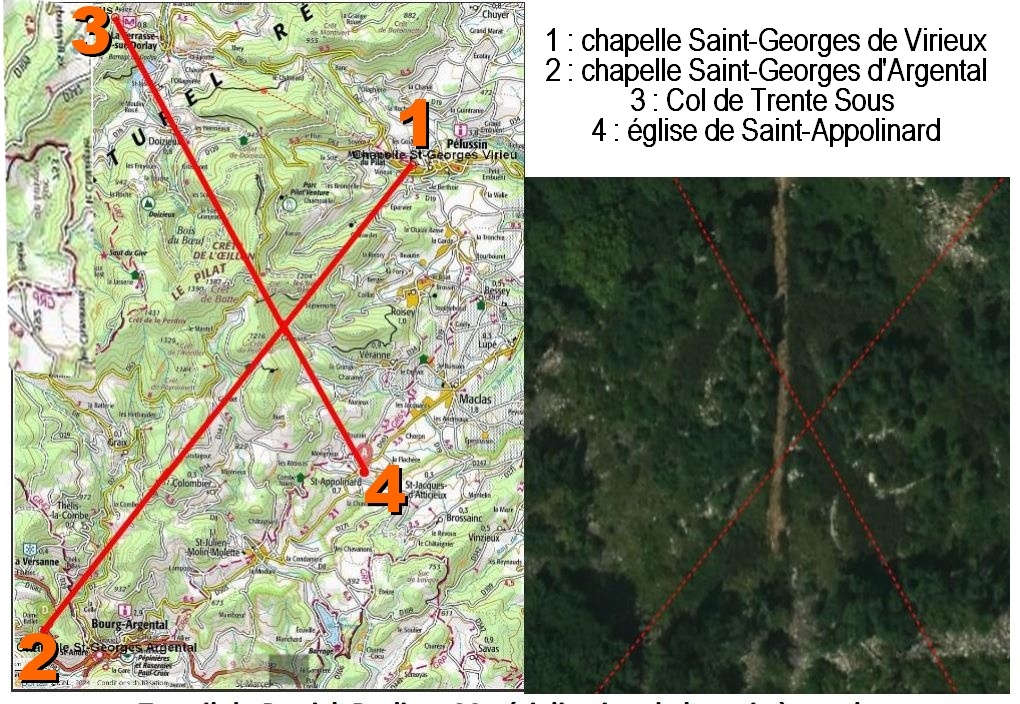
Travail de Patrick Berlier :
Matérialisation de la croix sur la carte à gauche. Et vue aérienne du centre de la croix à
droite
(images © IGN)
L’une des
branches de la croix prend naissance dans la commune de Saint-Paul-en-Jarez, ce
qui permet à notre ami d’avancer le commentaire suivant : « elle est donc
constituée de ce que l'on pourrait nommer la lance de saint Georges et l'épée
de saint Paul, entrecroisées, entre les deux chapelles Saint-Georges, Argental
et Virieu, le Col de Trente Sous et l'église de Saint-Appolinard constituant le
4e
point. Le centre de la croix se situe sur la commune de Véranne, non loin du
hameau de Cubusson. À cet endroit il n'y a rien... encore que l'image satellite
montre des traces claires, comme des ruines, mais comme il ne doit pas être
facile d'y aller nous ne sommes pas prêts d'avoir le fin mot. »
Le Saut vers la Lumière
Le FIN
MOT ? Non, il ne se trouve pas au centre de la croix dans l’ancien « Locus de Cublusone, (B 1057, f° 159
v°)».
htts://www.amisdesparcs.fr/IMG/pdf/lieux_dits_canton_de_pelussin_maj_2016-.pdf
La croix
de saint André fut arborée dès le Moyen Âge par la Maison de Bourgogne et par
le Royaume d’Écosse, d’où sa présence dans l’Ordre de la Toison d’Or et dans
l’Ordre de Saint-André-du-Chardon. Le drapeau d’Écosse pérennise la présence de
Templiers autour du futur Roi d’Ecosse, Robert the Bruce, lors de la bataille
de Bannockburn (1314) qui libéra le pays du joug des Anglais. Ce drapeau, croix
d’argent de saint André sur champ d’azur, est appelé Saltire (sautoir) en anglais. Cette croix fut aussi une signature…
X… le NOM, le MOT dans la Maçonnerie. Jean- Claude Marol dans son livre BLASON langue vivante (Éditins Dangles)
écrit : « Trouvons notre nom dans cette vie, il nous aidera à trouver
notre place d’instant en instant : ici et maintenant, dans la multiplicité. »
Car oui « le signe est le même pour indiquer un point précis et pour
multiplier. En se situant précisément, on se relie au Tout. Mon nom se découvre
et s’écrit à la confluence de la lumière
et de la résistance que je lui offre. Cette résistance sera bientôt
disponibilité. » Le sautoir héraldique correspond à l’étrier qui
permettait au cavalier ou cabalier de
sauter sur sa monture, la cavale ou cabale. En latin, le saut c’est la danse.
Cette danse solaire se reconnaît-elle dans le nom du Col des Trente Sous ou
Sauts ? Trente sauts tels les 30 jours du mois solaire ? Mais ce nombre 30 est
aussi le nombre de saint André qui suivant la tradition accéda à la Lumière
paradisiaque un 30 novembre. Le point de la croix géographique de saint André
marqué par la chapelle Saint-Georges d’Argental, est aujourd’hui localisé dans
la commune de Bourg-Argental dont l’église paroissiale est placée sous la
dédicace de saint André. Faut-il y voir plus qu’un hasard ? Le nom d’Argental
serait bien mystérieux si l’on en croit cette étymologie avancée : « mot
d’origine gauloise ‘’are-canto-avo’’ qui signifie “domaine près de la
frontière”. » Ceci en référence à la proche Pierre des Trois Évêques… htts://www.bourgargental.fr/ma-ville/bienvenue-bourg-argental/
Pascal
Gambirasio d’Asseux (La voie du blason –
Éditins Télètes) rapproche le sautoir héraldique du « cheval de
frise » : « qui, d’obstacle immédiat devient l’occasion d’un saut, d’un
bond vers le haut ». Ce saut du cavalier effectué dans la lumière, est
précisément celui que Constantin dans l’imagerie médiévale a effectué. Dans la
cathédrale Saint-Lazare d’Autun le chapiteau représentant le Cavalier de la Victoire attire de
nombreux visiteurs.
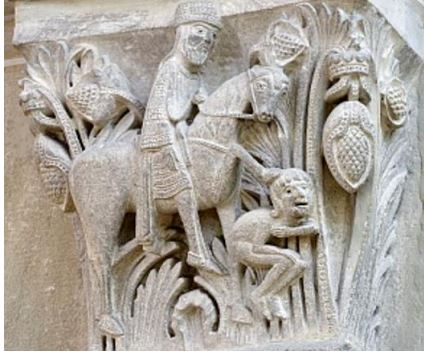
Chapiteau de la cathédrale d’Autun :
Constantin le Grand
Denis
Grivot, Maître de Chapelle de la Cathédrale d’Autun et Conservateur des
Antiquités et Objets d’Art de Saône-et-Loire est l’auteur d’un très intéressant
livre : La sculpture du XIIe
siècle de la cathédrale d’Autun (Éditions S.A.E.P.). Il le rappelle : «
Dans l’Ouest de la France, on trouve fréquemment ce sujet d’un cavalier
couronné écrasant un ennemi sous le sabot de son cheval : il a été prouvé que
ce sujet représentait l’empereur Constantin. Constantin, c’était celui qui
avait autorisé le christianisme ». Ainsi que l’indique le Conservateur, le
cheval « ne repose sur rien, ce qui est assez rare à Autun ». Il rappelle aussi
que dans la cité d’Autun se trouvait un temple d’Apollon que Constantin visita.
Puis il poursuit : « le cheval a une étrange parenté avec l’âne de la
Fuite en Egypte, et avec l’âne de Balaam ». Le Cavalier de la Victoire
très présent dans l’Angoumois, est présenté par Fulcanelli (Demeures
Philosophales) comme le Cavalier de l’Apocalypse : « le chevalier
mystique dont parle le visionnaire de Pathmos, qui doit venir dans la plénitude
de la lumière et surgir du feu, à la manière d'un pur esprit. » Le célèbre hermétiste insiste sur l’aspect
solaire du cavalier : « à cause de son orientation, au rayonnement
solaire. » Bien que la cité indiquée par Fulcanelli où se trouve le
cavalier, soit la bonne, l’église ne le serait point. http://www.archerjulienchampagne.com/article-2050527.html
Un Saut
de Lumière dans les pas des Chevaliers du Temple
Cette
projection de la croix décussée ou croix de saint André sur le sol du Pilat,
porte, pouvons-nous le penser, le sceau de l’Ordre du Temple. Patrick Berlier
dans l le livret déjà cité rappelle que le château d’Argental au XIIe
siècle « passa aux mains d’Artaud de Pagan. Le château resta la propriété
de la famille de Pagan jusqu’en 1352 […] mort de Guigues de Pagan. »
Artaud ainsi que l’indique Patrick (sur la foi de ce qu'affirmait Jean Combe)
était frère d’Hugues de Pagan (ou de Payns), fondateur de l’Ordre des
Chevaliers du Temple… En réalité ce n'est pas aussi simple, car les membres de
cette famille portaient des prénoms héréditaires qui souvent les ont fait
confondre par les historiens :
Si le
point sud de l’axe « Sainte Lance » de la croix est marqué par la présence des
Pagan, importante famille quant à la création de l’Ordre du Temple, le point
nord est quant à lui localisé à Virieu dans la commune de Pélussin où plane
aujourd’hui encore l’ombre de cet ordre monacal et chevaleresque. Notre ami
Thierry Rollat dans son article « Les Châteaux de Pélussin », à l’appui du
livre de l’abbé Batia et de la tradition orale, évoque une présence templière à
Pélussin. L’Histoire conserve le souvenir de ces chevaliers implantés dans la
commune à La Valette sous le nom de Chevaliers de Pélucin. http://regardsdupilat.free.fr/chateauxdepelussin.html
Patrick Berlier dans son livre Avec les pèlerins de Compostelle (Actes graphiques éditeur), évoque
le site de La Valette où se dressait une maison forte « à l’emplacement
d’une grange dont on ne sait rien, hormis le nom :
‘’Grange-lez-Pélussin’’. » Puis il ajoute : « Les croyances
populaires y ont vu un lieu de rassemblement secret des Templiers… «
Patrick évoque à proximité une bien étrange inscription, qui fleure bon
l’époque où ces mystérieux Chevaliers de Pélucin occupaient les lieux. Il y a
aussi, toujours à proximité de La Valette, dans la montée goudronnée qui
conduit au vieux château disparu, une curieuse croix. Thierry Rollat reprenant
les paroles de Michel Lhortolat (livre du patrimoine publié par l’association
Visages de notre Pilat en 2004) reconnaît qu’il s’agit de la plus étrange croix
de la région. Patrick dans le tome 18 Le
Pilat au fil du Rhône De Vérin à Chavannay (actes graphiques édition)
présente une belle photo de « L’étrange croix de La Valette »… « spécimen
magnifique et méconnu » : « Au-dessus d’un fût carré, un cœur quadrangulaire et
entouré de trois branches trilobés, ‘’comme des petits-beurre’’. Ce cœur s’orne
d’un motif dans lequel le profane ne verra que cinq ‘’bosses’’ en relief…
L’initié, lui, saura y voir une croix pattée inscrite dans un cercle (et bien
d’autres choses encore…) selon le même principe que pour la clé de voûte visible
à Chavanay. »

La croix de la Valette, dans les années 80 et aujourd'hui
Page 16
de ce même tome, Patrick évoque cette « belle clé de voûte ornée d’un motif
alliant rouelles, rose, et croix pattée ». Avant d’ajouter : « On parle bien
sûr de trésor et de mystérieux souterrains… » Sous la représentation de cette
œuvre d’art notre ami Stéphanois note en légende : « Clé de voûte, rue de
Serves : en inclinant la tête à 45°, on y voit apparaître une croix
pattée. » Cette inscription et cette croix de La Valette sur lesquelles
nous ne pouvons nous étendre, semblent confirmer une présence templière.

Clé de voûte de Chavanay – à droite matérialisation en rouge de
la croix pattée ou croix de de Malte quand on tourne le dessin à 45°
Les
Chevaliers de Pélucin disparaissent en 1307, une année clé. Les domaines
templiers après la fin de l’ordre, furent généralement attribués à l’Ordre
Hospitalier de Saint- Jean, futur Ordre de Malte mais il arrivait qu’ils
devenaient l’apanage d’une noble famille de la région. Tel sera le cas de La
Valette. Ainsi vont apparaître au gré des mariages les Rochefort de La Valette.
Dans la première moitié du XVIIe siècle, Marguerite de Rochefort de
la Valette, épouse de Claude du Treuil, greffier de Virieu en 1624, vécut dans
une mystérieuse maison du Pilat rhodanien « en un lieu que l’on ne va pas
déterminer plus précisément afin de préserver une tranquillité bien légitime
aux occupants de la vieille bâtisse que nous allons évoquer. » Telle était
le souhait légitime de Thierry Rollat en février 2019. http://regardsdupilat.free.fr/dessignesvenusd%27ailleurs.html
Thierry dans son article Des signes venus d’ailleurs, reconnaît que cet édifice
« semble indéniablement templier puisqu’à deux cents mètres de notre énigmatique
maison se trouve une ancienne maison forte remarquable des Templiers du Pilat
rhodanien, magnifiquement rénovée. » Bien que post médiévale, cette maison
n’en demeure pas moins baignée d’une aura templière. Un homme dont nous ne
pouvons donner que le nom et le prénom, Joseph Blaché, contacta Thierry et lui
permit d’accéder aux « Signes » d’un autre temps visibles sur la cheminée :

Photo des signes sur la cheminée
(extraite de l'article de Thierry Rollat)
Thierry
dans son article, nous présente une reconstitution en couleur de ces signes. Il
nous apparaît que ces signes bien que présentés ainsi sur la cheminée, peuvent
se lire également dans l’autre sens :
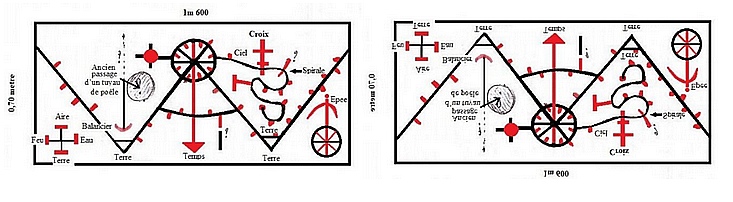
Relevé des Signes
venus d’ailleurs – article de Thierry Rollat.
À droite le même relevé mais inversé
Une fois
inversés, leur schéma générateur paraît se retrouver dans ces hiéroglyphes
égyptiens
:htts://en.wikipedia.org/wiki/Gardiner%27s_sign_list#Reading_list
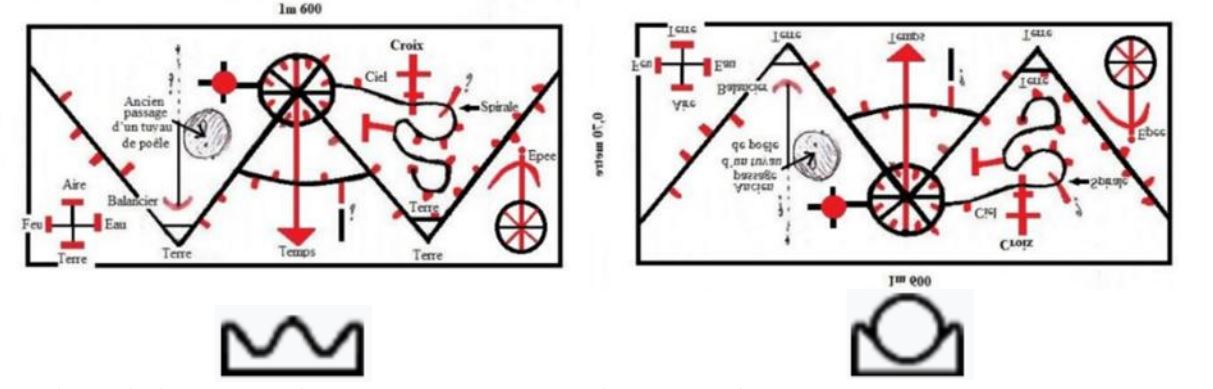
Les signes
inversés et leur équivalence hiéroglyphique
La
représentation de gauche visible sur la cheminée, paraît s’inspirer du
hiéroglyphe égyptien représentant des collines et signifiant « pays des
collines, terre étrangère ». La représentation de droite, après
retournement, paraît s’inspirer du hiéroglyphe égyptien représentant l’horizon
: lever de soleil entre deux montagnes. Cet idéogramme nommé Akhet, l’Horizon,
apparaît dans le nom de la cité d’Akhenaton: « l'horizon d'Aton », la
ville fondée par le pharaon Akhénaton, mais aussi – c’est important – dans le
nom égyptien de la Grande Pyramide de Gizeh : Akhet Khufu, l’Horizon de Khéops !
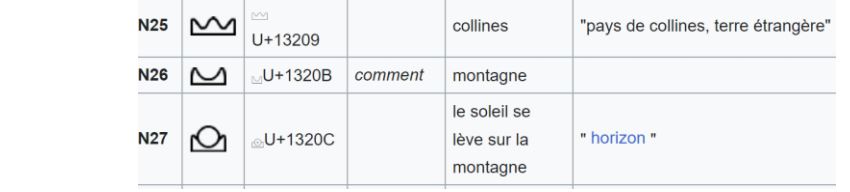
Les hiéroglyphes égyptiens
Cette
représentation des « Signes venus d’ailleurs » dans le sens
« Akhet-Horizon », met en relief deux pyramides égyptiennes. On
reconnaît à son sommet le pyramidion (la pierre angulaire) ou Benben, symbole
du rayonnement solaire sur lequel se tient symboliquement le Phénix ou
Benou. L'égyptologue Américain Mark
Lehner, expert du Sphinx affirme que les Égyptiens auraient pris le solstice
d’été en considération en construisant les pyramides. Ses observations
démontrent que lorsqu’une personne se tient près du Sphinx lors du solstice
d’été, le soleil semble se coucher exactement entre les pyramides de Khéphren
et de Kéhops. « Ceci est remarquablement similaire à un hiéroglyphe,
Akhet, qui signifie approximativement ‘’horizon’’ »
https://www.aime-jeanclaude-free.com/blog/akhet-khufu/
Les deux pyramides représentées sur la cheminée, mais
après retournement du haut vers le bas, correspondraient-elles à Khephren et à
Khéops ? Le Phénix évoqué ci-dessus est quelque fois, dans l’explication du
pyramidion, remplacé par le Sphinx. Nous retrouvons ici le voyage effectué depuis l’Égypte jusque dans
le Pilat ; voyage relaté dans mon article De
Péluse à Pélussin. Il apparaît que Patrick Berlier c’est intéressé à la
projection de la Grande Pyramide dans le Pilat. Dans son conte de Noël LE SECRET DE LA GRANDE PYRAMIDE - UN CONTE
D’UN AUTRE MONDE, il n’a pas hésité à projeter le Saint des Saints de la
pyramide en un lieu qui ne peut être que Sainte-Croix-en-Jarez, ou ses environs
immédiats… Inspiration plutôt judicieuse si l’on tient compte des observations
faites par notre ami Éric Charpentier (Sainte-Croix-en-Jarez
Un symbole de Perfections…) : « Le Magister de Sainte-Croix, s’il se
positionnait au centre du Triangle de la Chartreuse, centre du lieu sacré, ne
pouvait qu’observer les levers réels et non les lieux théoriques qui ont
pourtant toute leur importance comme nous venons de le voir. « Il se trouve que
par un heureux (?) hasard de Dame Nature, le soleil se lève à
Sainte-Croix-en-Jarez le jour du solstice d’été à l’endroit où le relief est le
plus bas et précisément au creux de de la ‘’cuvette’’ formée par les pentes des
collines de Rochassieux et de Chantaloup. Éric reconnaît « que ce
phénomène très étrange, entièrement lié à la topographie du lieu » fut
« manifestement »… « pris en considération dans un premier temps
par les bâtisseurs du néolithique mais aussi dans un second temps par les
bâtisseurs du Moyen-Âge. » Avant d’ajouter : « Ce phénomène est certainement
le même qui a donné naissance à l’un des plus vieux symboles des observations
astrales, le hiéroglyphe égyptien ‘’akhet’’, symbole de l’horizon, figurant un
lever de soleil au creux d’une cuvette. » Dans mon article De Péluse à Pélussin, j’ai pu évoquer
l’influence du Royaume juif de Septimanie sur l’Histoire secrète du Pilat. Créé
sous Pépin le Bref en 759, ce royaume exista durant 140 ans puis se pérennisa
avec le titre de ''roi juif'' qui se transmit de manière héréditaire plusieurs
siècles durant au sein de la dynastie makhirite des Nessiim de Narbonne venue
de Bagdad, jusqu’en 1306, année où le roi Philippe le Bel, expulse tous les
Juifs de son royaume et se proclame détenteur de leurs biens.
htt://regardsdupilat.free.fr/bonneanneetrois.html
Les plus
grands Kabbalistes vont séjourner un temps dans ce territoire. L’un d’entre
eux, fut Abraham ibn Ezra dit Raba’a (1092-1167) célèbre linguiste, astrologue,
commentateur biblique et philosophe. Ce grand voyageur (Terre Sainte, Italie,
Angleterre, Égypte, Afrique) natif de Tudela en Navarre, étudia la Kabbale dans
la cité de Safed, la « ville des Kabbalistes » en Israël. Au retour
il séjourna à Babylone et en Perse, où le calife de Bagdad avait permis aux
Juifs d’avoir leur propre prince… les fameux Makir David dont un rameau
s’installa dans le Forez. Raba’a séjourna un temps en Italie et en Provence,
avant de rentrer dans l’ancien royaume de Septimanie à Narbonne. Il rencontrera
les Kabbalistes de Lunel, et étudia trois ans à Béziers. Il rédigea un
intrigant commentaire sur les mystères évoqués ci-dessus. Voici après
traduction ce commentaire :
« Et
il y avait des hommes, combien peu, qui croyaient en un homme qui avait le Nom
de Dieu. Et quand Rome crut aux jours de Constantin qui renouvela toute la
religion et mit sur son étendard une forme soutenue par un prêtre Édomite, il
n’y avait personne au monde qui garderait la nouvelle Torah, hormis quelques
Édomites ; c’est pourquoi Rome fut appelée ‘’le Royaume d’Édom’’. »
Cet homme
qui avait le Nom de Dieu ou Éloah, c’est bien sûr Jésus. C’est bien l’empereur
Constantin qui instaura la religion des chrétiens en tant que religion d’état.
Son étendard est le fameux labarum, sur lequel fut apposé le Chrisme
(symbole christique, initiale X…) avec la fameuse inscription : In hoc signo
vinces, soit en français : « Par ce signe tu vaincras ». Il était
brandi par un prêtre Édomite. Edomi signifie « rouge » d’où une
possible traduction en « prêtre Rouge » et l’on pense aux Druides Rouges
qui dans les combats maniaient l’épée ou la lance… Étrangement le commentaire
de Raba’a s’applique à deux versets bibliques. L’un se trouve dans le Livre des
Juges (5-4) et l’autre dans le Livre du Deutéronome (33-2) dont voici
l’intéressante traduction présentée dans la Bible du Semeur : « Il dit :
L’Éternel est venu du Sinaï, il s’est levé pour eux ; aux confins de Séir tel
le soleil à l’horizon, et il a resplendi de la montagne de Parân. Et les saints
anges par myriades étaient autour de lui. » Cette traduction s’éloigne du
mot-à-mot. En effet, dans le texte hébreu (partie du verset où est évoquée
Séir), seul le mot Zara’h ou Zariha : « se lever » ou « briller »,
caractéristique du soleil, apparaît :
(il) a brillé sur le Séir pour eux ! » Les mots soleil et horizon,
n’apparaissent en fait que dans l’exégèse hébraïque. Le commentateur juif
Malbim (XIXe siècle) explique que le mot Zariha, « fait
référence au début de l'apparition de la
lumière et non à sa persistance. » Le mot est donc synonyme de l’égyptien
Akhet. Les quatre lieux indiqués dans le verset, suivant le Sifre Deutéronome, commentaire juif du
IIIe siècle accepté depuis par tous les grands exégètes Juifs ainsi
que par saint Jérôme, doivent être ainsi compris : Il est venu du Sinaï - lorsque le Tout-Puissant a révélé qu'il
devait donner la Torah à Israël, non pas dans une seule langue, mais en quatre
langues […] : Il est venu du Sinaï -
c'est la langue hébraïque. Et il s’est
levé sur le Séir, pour eux ! : c'est une langue romaine (Romi). Apparue du mont Paran - c'est une
langue arabe. Et a quitté les saintes
myriades (les anges) – c'est une langue araméenne ». Le Séir désigne
le Mont Séir, la montagne biblique d’Édom qui dans l’exégèse juive, notamment
dans les Manuscrits de la Mer Morte, correspond à Rome et à l’Empire Romain
dont la langue est le Romi (latin). Saint Jérôme au siècle suivant, à l’appui
de ce commentaire traduira : Et de Seir ortus est nobis » soit en français :
« Et il s’est levé pour nous de
Séir » ! alors que le texte hébreu dit « pour eux » ! Jérôme par sa compréhension du commentaire juif
ose cette traduction audacieuse. Suivant le commentaire juif, cette phrase
tirée du Deutéronome, doit être associée à un verset du Livre des Juges 5-4
(Bible du Semeur) : « Ô Eternel, lorsque tu sortis de Séir, lorsque tu
t’avanças depuis les champs d’Edom, la terre se mit à trembler et le ciel se
fondit en eau : les nuées déversèrent une pluie abondante. » Mais ce
commentaire du Sifré Deutéronome reconnu
par tous les Kabbalistes à commencer par Raba’a qui établit une correspondance
entre le Mont Séir d’Édom (territoire des fils d’Ésaü ou Édom) et la région où
Constantin a été acclamé empereur, se prolonge ainsi : « Tout d’abord,
Dieu s’approche des fils d’Ésaü et leur demande s’ils sont prêts à recevoir la
Torah. Ils s'enquièrent de son contenu mais, après avoir appris qu'il inclut
une interdiction du meurtre, ils expliquent que l'effusion de sang est
l'essence de leur patriarche, qui accomplit la bénédiction d'Isaac : ‘’Par ton
épée tu vivras » (Genèse 27 - 40).’’
» D’où il appert que : « Le meurtre est donc un aspect intrinsèque du
caractère et du patrimoine de Rome « Cette épée d’Ésaü par laquelle vivent
les Édomites est présentée comme leur « héritage ». Rashi de Troyes, le Rabbi
Champenois qui commentait le texte hébreu au mot-à-mot, expliquait qu’Édom/Ésaü
vivra non « par », mais « sur » son épée… Ce qui semble
indiquer que cette épée peut s’entendre tout à la fois comme l’arme de guerre
qu’elle est mais aussi comme un lieu. N’oublions pas que Rashi vivait dans le
royaume de France. Dans les « Signes venus d’ailleurs » nous découvrons une
épée. Était-elle à l’origine, aussi rouge qu’elle apparaît sur la
reconstitution ? L’épée d’Édom après traduction apparaît comme l’épée Rouge…
Cette épée semble bloquée dans une roue. En avril 2020 l’hermétiste Renard
Gambline inspiré par les « Signes venus d’ailleurs », nous présentait dans les
Regards du Pilat, une pertinente étude des signes. htt://regardsdupilat.free.fr/renard.html Il décrypte de belle façon la présence dans ces signes de
l’hermétique S, le Serpent, « hiéroglyphe du Principe alchimique
primordial » et « signe graphique du soleil , père de la lumière
c'est la notation de mouvement, du devenir et du déplacement sur la roue avec
ses rayons, nécessaire à la coction de la matière ». Nous retrouvons la
roue à proximité du S : « Pour la roue surmontée d’une épée ; elle
représente la roue de la fortune dans l'art du Moyen Age avec un sens plus
étroit auxquels sont attachés des hommes ou des figures allégoriques puisque
l’ensemble symbolise les changements de fortune, la roue est liée à la
symbolique du cercle, à laquelle s’ajoute la notion de mouvement, du devenir et
du déplacement. » Cette roue, symbolique du soleil apparaît surmontée de l’épée,
rayon lumineux solaire dont Renard Gambline nous rappelle qu’elle est l’hiéroglyphe du feu des
Philosophes. Posée sur la lame de l’épée, la roue apparaît comme un cercle
partagé en deux partis égales chargées d’une croix en X ou croix de saint André
: la Lumière. L’épée est placée à l’extérieur de la pyramide. Elle veille telle
le Sphinx sur la pyramide.

Détail de la roue et l'épée
Dans
l’article De Péluse à Pélusin, citant le Rav Roiter j’indiquais que le mot
Sphinx était étymologiquement apparenté à l’hébreu Tsaphon qui désigne ce qui
est « caché », un « mystère », le « Nord » d’où vient
la lumière (Livre de Job) et le dieu
du Nord, Baal Tsephon. Ce que je ne savais pas lorsque je rédigeai cet article,
c’est que cette étymologie du mot Sphinx était déjà ancienne. En effet,
Frédéric Portal (Les symboles des
Égyptiens comparés à ceux des Hébreux suivi du texte intégral en français du Hieroglyphica
d’Horapollon – 1840 – réédité avec commentaires par Georges Lahy) évoquait
déjà pour le mot Sphinx « l’hébreu […] TŠAFAN signifie cacher et garder, et […] TŠAFON ou […] TŠEFOUN, un
mystère, un arcane et la région des ténèbres, le nord. »… « Le sphinx
possédait encore la signification de maître
ou seigneur ». Le mot Sphinx dans
le sens de « Seigneur » apparaît ainsi comme un synonyme de Séir (nom de la
montage d’Édom) dont l’une des étymologies est précisément « Seigneur » en
akkadien. Le baron Frédéric de Portal terminait ainsi son exégèse du mot Sphinx
: « Pharaon délègue sa puissance à Joseph, et le nomme interprète des sphinx, […], ou interprète
des choses cachées. Le premier ministre était le gardien et l’interprète des ordres cachés du souverain et des lois
secrètes de l’empire. » Ceci est d’autant plus intéressant, car ainsi que je
l’ai évoqué dans mon article, Joseph suivant les commentateurs juifs, avait transformé le blé en or. Cet Or que les
Hébreux quittant l’Égypte au temps de Moïse auraient retirés des pyramides… (De Péluse à Pélussin… ). Les Hieroglyphica d’Horapollon ont été
traduits et même adaptés par Nostradamus. Le Mage de Salon affirmait avoir
traduit l’Orus Apollo non pas
l’édition vénitienne de 1505 d’Alde Manuce mais « SCELON UN TRES ANCIEN
EXEMPLAIRE GREC DES DRUIDES ». Patrice Guinard (Nostradamus traducteur Horapollon et Galien – BoD Édition) a révélé
dans la traduction de Nostradamus la présence d’un véritable codage. Il émet
l’hypothèse suivant laquelle l’exemplaire druidique
que Nostradamus aurait possédé, pourrait provenir de la station
gallo-romaine de Glanum où se trouve cette curieuse inscription : « L. HO.
SCRI. » ainsi commentée par P. Guinard : « Une allusion à des livres d’Horus ?
Ceux d’Horapollon ? Transmis par un copiste ? » Peut-être « L : Liber : Livre(s) », « HO : Horus et « SCRI : SCRIBO, Scribe » Nostradamus n’a pas omis de traduire
en un huitain la section désignée par cet incipit : « [A75] Comment ilz signifient la bouche » dont voici les premiers
vers :
Et quant ilz veulent bien descrire la
bouche
A paingdre au vif ung serpent ont s’esforce
Car par la gueulle nous nuict quant il nous touche
Au travers des trois premiers vers de ce huitain nous retrouvons en termes hiéroglyphiques, le nom du premier porteur de la Sainte Lance (pé nahash : la « bouche de serpent ») tel que suivant l’Orus Apollo les Égyptiens décrivaient la bouche. Le cryptage de l’ouvrage tel que le conçut Nostradamus, serait peut-être à prendre en compte pour la compréhension des mystères pilatois évoqués ci-dessus. Ce traité aurait été écrit en langue copte et traduit en grec par un certain Philippos dont le nom qui est aussi celui d’un apôtre de Jésus, signifierait suivant la Légende Dorée : « Bouche de lampe »… Les « Signes venus d’ailleurs » donnent à penser qu’il faille associer l’épée à la croix de Lorraine, placée sous la vigilance du Serpent, l’S ou la Grosse S (le Gros Airain nostradamique).
Cette
croix se retrouve dans le Pilat. Patrick Berlier nous en parle dans le tome 18
du Guide du Pilat et du Jarez : Le
Pilat au fil du Rhône De Vérin à Chavannay… Avant de s’arrêter longuement à
La Valette, Patrick s’arrête à la Morcellarie où l’on accède après avoir fait
une halte à la Pierraborna marquée par son socle rocheux. Sur la paroi rocheuse
est gravée une croix de Lorraine « à l’intérieur d’un V » croix qui, Patrick
nous le rappelle, « se nommait ‘’croix d’Anjou’’, en raison d’une relique, un
fragment de la Sainte-Croix taillé en croix à double traverse, ramené de Terre
Sainte en Anjou par les Croisés. Parmi eux était un certain Gordin de Roucout,
templier de la commanderie de Marlhes. Le bon roi René en fit son emblème, et
la rebaptisa ‘’croix de Lorraine’’ après avoir vaincu Charles le Téméraire à
Nancy en 1477. ». Patrick rappelle ensuite que : « Si la province d’Anjou est
bien loin du Pilat, la ville d’Anjou en est au contraire très proche, de
l’autre côté du Rhône. Elle fut le fief de l’une des branches de la famille de
Roussillon. »
Une croix
de Lorraine dans un V se retrouve à Montreuil-sur-Mer. Philippe Valcq,
historien de la cité, la présente comme le « Signe de ralliement des Ligueurs »
(L’énigme de la ville secrète des
Templiers Montreuil-sur-Mer – Éditions Ramuel). La croix d’Anjou fut
utilisée par les Templiers, il est donc possible que les Ligueurs au XVIe siècle aient utilisé ce symbole en
toute connaissance de ses origines. Les « Signes venus d’ailleurs » ne semblent
pas étrangers aux graffitis de Chinon, le Testament des Templiers : Nous
reconnaissons sur cette partie des graffitis de Chinon, la Sainte Lance.
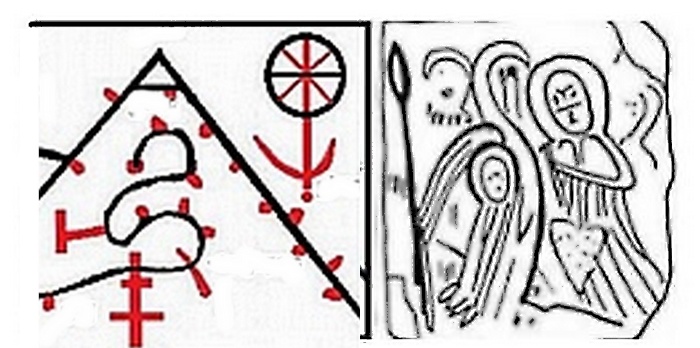
Comparaison des
« signes venus d'ailleurs » et des graffitis de Chinon :
la grosse S forme leur point commun
Albert
Heron de la Chesnay (Les graffiti de la
tour du Coudray à Chinon – revue Atlantis n° 268), Président-fondateur à
Chinon du C.A.N.O. (Compagnons d’archéologie et d’iconographie pour nantir les
œuvres) qui œuvra dans cette cité avec Louis Charbonneau-Lassay, s’interroge
sur la découverte de la Sainte Lance : « Est-elle pour eux un signe, un présage
? Les Chevalier du Temple sont-ils la ‘’lance de Dieu’’, comme Jeanne d’Arc
faisant prendre à sainte Catherine l’épée de Fierbois qui devint ‘’l’épée de
Dieu’’ ? » Ente la Sainte Lance et le Templier auréolé à genou, apparaît « un
ange dont il est séparé par un signe S (qui ressemble à un col de cygne) dans
lequel est placée une main. » A. Heron de la Chesnay reconnaît dans cette
représentation une Annonciation… une Grosse S (grossesse) à venir ?
Le
fondateur du C.A.N.O. nous entretient de la théorie avancée par certains
chercheurs suivant laquelle ces graffiti seraient une carte géographique de
type trésoraire. Le Templier militaire qui « défend les Lieux saints symbolisés
par les deux calvaires » et portant « le bouclier du Temple marqué de l’ennéade
», localiserait « la Commanderie de Payns, ‘’fief d’Hugues de Pays, fondateur
du Temple’’. L’auteur de cet article poursuit : « En bas à droite du graffiti,
nous considérons avoir saint Bernard comme en bas à droite de la carte, nous
avons sa fondation : l’abbaye de Clairvaux ». La carte ici mentionnée est celle
présentée par Louis Charpentier dans son livre Les mystères Templiers. « L’énigme… serait donc dans la forêt, dans
la partie dite du Grand Orient… ? » L’hypothèse forêt d’Orient, zone
marécageuse créée par les Templiers, demeure très intéressante. Il serait
peut-être envisageable de proposer une lecture similaire avec les « Signes
venus d’ailleurs ». Les lieux s’il faut en retenir apparaissent peut-être dans
cet article. S’il fallait retenir une abbaye cistercienne nous la découvririons
assurément dans les propos suivants : Saint Bernard qui donna à l’Ordre du
Temple ses statuts, s’en vint « sur les confins de la Bourgogne, du Forez
et du Lyonnais, dans la vallée de la Tessone* […] visitant ces lieux, avec
quelques-uns de ses frères, arrivé à l'endroit où s'éleva depuis le couvent de
la Bénisson-Dieu, s'écria dans un transport d'enthousiasme et d'inspiration :
‘’Hic, fratres, benedicamus Domino’’. Ici,
mes frères, bénissons Dieu. Solitude, silence, vallée humide et profonde,
c'était l'image de la vallée d'Absinthe (premier nom de Clairvaux). Une émotion
bien naturelle tira de l'âme du saint cette exclamation prophétique qui
détermina le nom et le séjour de la XXXème fille de Clairvaux. » *La vallée de la Tessone formait une
enclave du territoire Lyonnais entre le Forez et la Bourgogne.
htts://archive.wikiwix.com/cache/index2.php?url=htt%3A%2F%2Fabbaye.benisson.dieu.free.fr%2FHistoire.htm%23_Toc65030696#federatin=archive.wikiwix.com&tab=url
Nous
pouvons découvrir ces informations sur le site de l'abbaye de la Bénisson-Dieu
[en mode archive] dans l’article Abbaye
Royale de la Bénisson-Dieu. Cette abbaye cistercienne se trouve dans la
commune La Bénisson-Dieu (département de la Loire). Ces faits ont été notamment
rapportés par le chanoine Jean-Marie de La Mure, dans son Histoire du Forez.
À suivre... Prochainement vous découvrirez la seconde
partie de cette recherche passionnante : De la maison aux « Signes venus
d’ailleurs » aux divinités OSIRIS et ISIS