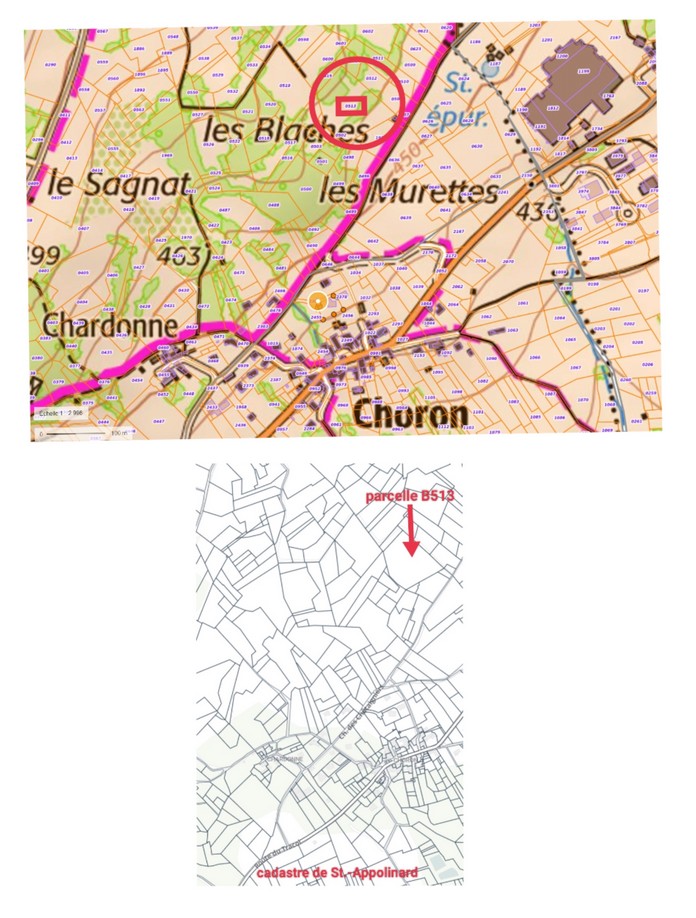Le Moulin à Vent Tout ce
qu’il faut savoir sur le Moulin à Vent. Plaidoyer par son inventeur pour un site menacé.
|
Présenté
par
Dominique Bonnaud- Dantil |
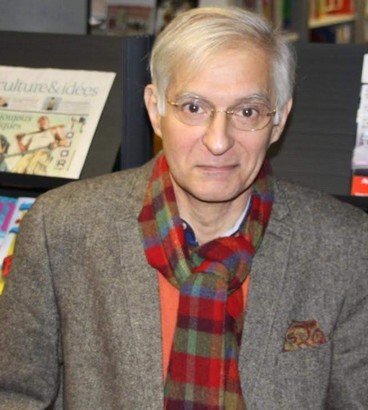 |
Février
2025 |
Dans mon Entretien d’octobre dernier, le Moulin
à Vent occupait une place particulière, insuffisante
cependant en considération de son importance. Par ailleurs,
depuis cet Entretien, j’ai retrouvé d’autres informations. La présentation ci-dessous,
complétée, corrigée et précisée, vient ainsi combler ces lacunes. Mon propos se
veut aussi un appel aux responsables locaux ou de l’archéologie professionnelle
pour qu’ils portent toute leur attention avant qu’il ne soit trop tard à ce gisement
archéologique d’un grand intérêt. Le Moulin à Vent, c’est un peu le Vieux
Pélussin ou le Pélussin d’avant Pélussin, comme on dit en Grèce Palaiokastro
(le Vieux Château, la Vieille Forteresse) pour désigner un
habitat préhistorique fortifié ayant précédé en un lieu un peu décalé l’habitat
moderne.
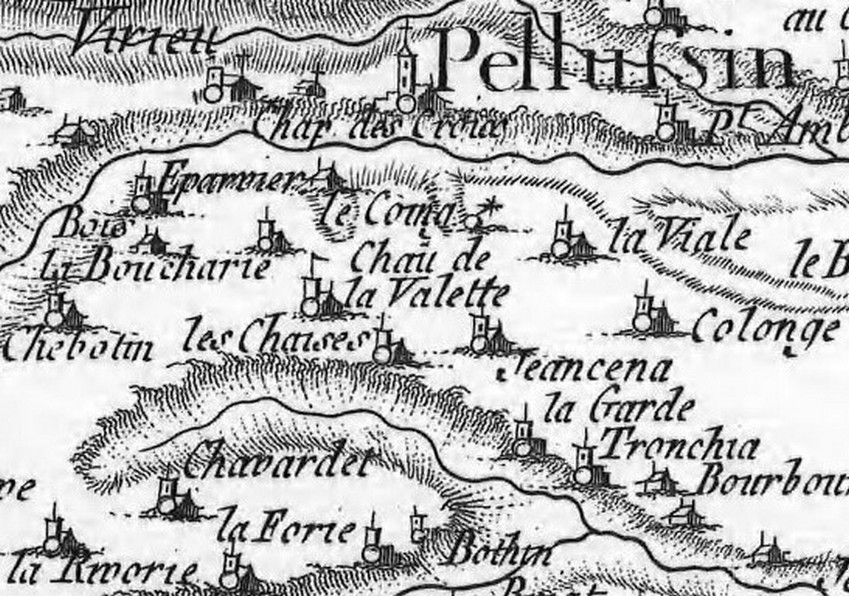
Récit d’une découverte
Au début des années 1970, j’explorais l’étrange
petit cirque où se déploie le bois de la Valette face au versant ouest du
Moulin à Vent. Je découvrais entre autres au sommet du bois la Pierre Juton et,
suite à des échanges avec les personnes résidant autour du château de la
Valette, j’entrais en contact à la Chaize Basse avec une veuve Michel Fond, née Angèle Dervieux, âgée d’un peu plus de 80 ans, seule héritière
de l’ex auberge-hôtel Dervieux à l’angle des routes de Maclas et de la Ribaudy,
cette dernière conduisant tout droit au Moulin à Vent, lieu-dit très proche de
La Chaize. Cette dame m’avait montré une belle lame en silex en deux morceaux.
Il y avait bien longtemps que son père Jean Dervieux, né en 1859, cultivateur
propriétaire, fils de maçon et lui-même ancien tailleur de pierres, les avait
recueillis dans une terre ou un bois lui appartenant ou qui lui était familier,
au Moulin à Vent, tout près de ses propriétés de la Chaize. Récemment, une
recherche approfondie qui a exigé, outre une intense mobilisation de ma mémoire
pour des faits remontant à plus d’un demi-siècle et le recours aux ressources
cadastrales et d’état-civil, m’a permis contre toute attente de retrouver la
trace de cette lame auprès de sa petite-fille, Mme Noëlle Degrange, professeure
de piano actuellement retraitée à St.-Donat-sur-l’Herbasse (Drôme), à qui elle
l’avait léguée. J’ai pu en obtenir des photos et, lors de l’Assemblée générale
de Visages de Notre Pilat au printemps 2024, celle-ci a transmis à Philippe
Monteil ce bel objet, qui faisait ainsi retour dans le canton de Pélussin qu’il
n’aurait jamais dû quitter, avec vocation à intégrer à terme une collection
publique (Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la
création, à l’architecture et au patrimoine, Titre Ier, chap. II, art. 70-71).
Les dimensions de ces deux morceaux recollés de lame sont : 12 x 3,5 cm. Elles correspondent à un
fragment distal de poignard sur grande lame mi débitée par percussion indirecte
et retouches unifaciales, et mi polie. La comparaison avec des lames complètes
de sites bien étudiés permet de déduire que ces deux morceaux correspondent aux
deux tiers, voire la moitié de la lame d’origine, d’une longueur comprise entre
18 et 24 cm., un ou deux autres fragments étant perdus ou restés enfouis. Quant
au manche il devait être composé de matières périssables : soit l’extrémité de
la lame en tenait lieu avec des lanières en tendons animaliers, enroulées et
fixées à la lame et entre elles grâce à une colle animale ou végétale ; soit le
bout de la lame était inséré dans un bois fendu et fixé à lui par des liens en
fibres végétales. La tracéologie limitée à un diagnostic visuel montre que
cette arme de poing a peu ou pas du tout servi. Il s’agit vraisemblablement
d’un objet de prestige, un marqueur social davantage qu’un outil ou une arme. Fragilisées
par leurs dimensions, ces lames avaient une fonctionnalité limitée. D’autres
exemples sont connus, dont le poignard à retouches bifaciales et de moindre
qualité d’Ötzi qui vivait à la fin du 4ème millénaire avant notre ère. Ce
poignard, répandu dans les sociétés alpines, y figurait souvent comme arme
d’apparat. Les armes et outils proprement dits d’Ötzi étaient son arc et sa
hache en cuivre fixée au bout d’un long manche. Quant au silex Dervieux,
couleur brun-mélasse, du Turonien supérieur et de qualité exceptionnelle, il
provient du gisement du Grand-Pressigny (Indre-et-Loire). Au Néolithique final,
cette qualité et celle du travail ont fait le succès de ces lames accompagné
d’un accroissement de leur production et de l’expansion de leur diffusion sous
la forme de produits finis réalisés souvent en série, et non d’une matière
première brute.

De la lame au site, dont je devinais
l’importance, il n’y avait que quelques pas vite franchis. Et, dès 1974, je le signalais
pour la première fois dans un inventaire sommaire, mais guère dépassé depuis, de
toutes mes découvertes sur le versant rhodanien du Pilat, présenté dans ma contribution pour le canton
de Pélussin, dont l’occasion m’avait été offerte, à un guide touristique :
Fenêtre ouverte sur le Haut-Vivarais, du rivage à la montagne, de la vallée
du Rhône aux Boutières et au Mont-Pilat : guide officiel de l’Union
Touristique (Annonay, Betinas, p. 104 et 106). Entre-temps, en 1973, alors
que le PNR du Pilat n’en était qu’au stade de sa préfiguration, j’avais fait
découvrir le Moulin à Vent, parmi bien d’autres sites, à Georges Pétillon qui, tout
juste nommé directeur adjoint, était entré en contact avec moi pour s’informer.
Si bien que la première mention du site date de cette année dans un rapport
rédigé à la suite d’une autorisation de sondage du 9 juillet. Il s’ouvrait sur
cette reconnaissance : « Ce site a été découvert par Dominique Bonnaud de
Pélussin ». Il tenait le même propos dans un article de 1985 (« Le site du Moulin à Vent », Dan l’tan,
n° 6, 1985, p. 28). Dans ses Fiches archéologiques dactylographiées restées
longtemps confidentielles, il me cite aussi à plusieurs reprises sans toutefois
toujours préciser qui a découvert quoi. Pourtant, il me doit la connaissance de
la plupart des sites dont il fait état, comme le prouve ce que j’ai publié en
1974, même si cette publication est restée peu connue. Quoi qu’il en soit, nous
partagions globalement les mêmes idées sur l’archéologie et la préhistoire du
Pilat et il a parfois développé dans ces fiches de fines observations, par
exemple sur les ateliers médiévaux et modernes à ciel ouvert de taille de
meules que je lui avais montrés, dont il précise l’extension et l’importance
des veines notamment dans le quartier situé entre le Pont du Mas, la Roche, le
Moulin, la Guintranie et Chez Judy.
En 1994, dans son mémoire de maîtrise, c’est
Georges Pétillon que Nathalie Corompt crédite de la découverte du Moulin à
Vent et d’un certain nombre d’autres
informations qui me sont également dues, ne donnant d’autre référence que
Patrick Berlier. C’est d’autant plus curieux qu’elle connaissait parfaitement
l’article de 1985, cité dans sa bibliographie avec les « Documents personnels »
de G. Pétillon, qui correspondent manifestement à ses Fiches archéologiques où
elle a puisé un grand nombre de ses informations comme il est aisé de le
vérifier. Elle cite aussi son rapport de 1973, et elle lui accorde une mention
particulière dans ses remerciements (L’occupation du sol de l’Âge des métaux
à la période gallo-romaine à l’extrémité sud-est du département de la Loire,
mémoire de maîtrise d’archéologie Lyon II, 1994). Après mon départ de Pélussin,
on ne peut pas dire que l’on ait fait preuve de beaucoup de probité à mon
égard. C’est du passé, mais s’il fallait faire une thèse sur les pillages dans
les mémoires et travaux universitaires, ce n’est pas la matière qui manquerait.
Elle rapporte aussi en deux passages de son mémoire que ce qui était en ma
possession n’était plus visible à l’époque de son travail. Je dois lui apporter
un démenti catégorique : en quittant Pélussin, je n’ai emporté avec moi
que les trois haches en jadéitite en ma possession avec une fusaïole en terre de cuisson oxydante sans doute gallo-romaine. Or, rien ne l’empêchait de parler de ces haches si elle
l’avait voulu, puisque tout était publié depuis 1977. Tout le reste n’a pas
quitté Pélussin, notamment les fameuses sigillées qui lui ont manqué, dit-elle,
pour des datations. Autant que je m’en souvienne, il n’y en avait guère et fort
peu caractérisées et exploitables. Enfin, il semble, selon les échanges que
j’ai pu avoir avec Philippe Monteil, que
G. Pétillon a récupéré tout ce matériel. Je ne suis donc en rien responsable si
elle n’a pu y avoir accès. Je renvoie aussi plus loin aux silex Pétillon qui
n’ont pas eu besoin de moi pour également se volatiliser.
Comme je serai conduit à évoquer plusieurs fois
le mémoire de Mme Achard-Corompt dans les lignes qui suivent, je crois utile
d’en parler ici un peu plus en détail. Il déborde en fait le cadre qu’il s’est
fixé, cadre spatial (9 des 14 communes du canton de Pélussin. Sont exclues
Vérin, St.-Michel-sur-Rhône, La Chapelle-Villars, Chuyer et St.-Appolinard), et
cadre temporel (âge des métaux et période gallo-romaine). Elle adopte une
approche comparative, notamment à propos du dépôt de Bronze de Chézenas. Elle en
fait une analyse complète (p. 30-43), même si ces « dépôts » métalliques font
aujourd’hui l’objet de nouvelles interprétations : on ne croit plus qu’ils
correspondent à des « cachettes de
fondeurs » destinées à un recyclage par temps de pénurie. On y voit au
contraire des pratiques rituelles complexes, qui échappent à nos logiques
actuelles, dans le cadre d’une relative abondance et prospérité. Mais je
partage pleinement son approche comparative que je m’efforce de mettre
également en pratique. Un gisement archéologique n’est pas un isolat, il
s’inscrit dans un contexte et dans un ensemble. De surcroît, ce dépôt illustre
ce qu’elle et moi constatons et déplorons, à savoir un certain et persistant
désintérêt des chercheurs pour cette enclave sud de la Loire correspondant au
Pilat, au piedmont rhodanien et à quelques annexes en Haut-Vivarais, en gros le
Forez-Viennois historique ou Viennois de la rive droite. Force est de constater
que la publicité des informations relatives à l’archéologie de cette région est
indigente. Elles sont mal diffusées et méconnues. Je cite ici N. Corompt :
« Cette partie du département de la Loire semble ne susciter chez les
chercheurs qu’un intérêt restreint. Les cartes répertoriant l’ensemble des
sites archéologiques du département nous présentent trop souvent ce territoire
comme un espace vide de toute occupation humaine. Bien sûr, il n’en est rien.
Ce constat attristant est le résultat du manque d’intérêt et de recherches
insuffisantes… Des traces d’occupation de toutes les périodes historiques ont
été repérées, mais ne sont connues que de peu de personnes ou seulement à un
échelon local. » (p. 8). Dans sa conclusion, elle en donne une explication
crédible, à savoir que le versant sud du
Pilat est trop atypique et marginal par rapport au reste du département (p.
93). C’est ainsi que l’on chercherait en vain une mention de ce dépôt de bronze
dans une grande synthèse en anglais mais faisant autorité sur cette
période : The Bronze Age in Europe : An introduction to the
Prehistory of Europe c.2000–700 BC, édité en 1979 (Londres, Methuen) par
John Coles et Anthony Harding, repris et très enrichi en 2013, entre autres par
ce dernier, dans le Manuel d’Oxford sur l’âge du Bronze européen. L’ouvrage
cite pourtant – il suffit de parcourir l’index pour s’en aviser – un nombre
considérable de sites français, notamment dans des tableaux récapitulatifs à la
fin de chaque chapitre. Pour le Br. Ancien, l’abri sous-roche de La Baume
Loire, et pour le Br. Récent l’habitat de Champs-Vieux, tous deux à Solignac
(Hte.-Loire) sont les sites mentionnés les plus proches (p. 203 et 454). Il est
vrai que ces tableaux ne mentionnent que les gisements pouvant répondre d’au
moins une datation radiocarbone et que la bibliographie se limite aux
publications récentes avec de rares exceptions antérieures à 1950. Et, si l’on
y trouve Montelius, alors que Déchelette est ignoré, c’est parce qu’il est plus
familier aux Scandinaves et aux Anglo-Saxons. En corollaire, c’est ce
désintérêt qui a favorisé la prolifération des théories les plus fantaisistes
sur le Pilat, et Mme Achard-Corompt déplore aussi – ce qui ne peut que susciter
mon adhésion – l’« ésotérisme forcené… ces élucubrateurs qui refont l’histoire
et parfois le monde à l’aide d’hypothétiques menhirs et de lignes imaginaires
censés représenter notre système stellaire », ces solstices d’été ou d’hiver
mis à toutes les sauces, comme si les rapports de nos ancêtres à la voûte
céleste se réduisaient à cela. Sans compter, comme elle le dit, qu’il est
impératif de raisonner sur d’authentiques mégalithes. Elle semble toutefois
ignorer le travail de 1986 de Myriam Philibert sur le mégalithisme de la Loire.
Il est vrai que cette dernière, proche d’Henri Delporte, a fait aussi un peu
dans l’ésotérisme, mais elle a toujours maintenu une stricte séparation entre
ses publications universitaires et celles destinées au grand public. Mme
Achard-Corompt pourfend encore et à juste titre le druidisme et la celtomania
ou encore des guides d’une qualité archéologique et historique douteuse dont
l’auteur n’a pas à être cité ici (p. 15-16). Elle reconnaît que « les
hypothétiques monuments celtiques du Pilat » sont « dans la majeure partie des
cas des affabulations » (p. 43). En revanche, peut-être parce que leur
découverte à la fin des années 1970
appartient à G. Pétillon sur les indications d’un chasseur, elle admet le
caractère anthropique et l’attribution au Paléolithique inférieur, plus
particulièrement à l’Acheuléen, d’une douzaine de galets ovoïdes paraissant
aménagés, qualifiés de choppers par leur inventeur, ramassés en surface près de
Gencenas, à l’est de la carrière de
meules de l’Alouette (Bessey) dans les parcelles d’un léger vallon,
profondément labourées pour y planter de la vigne ou des arbres fruitiers (p.
8). La quartzite dont ils sont constitués, inhabituelle en ce lieu, provient,
selon un repérage précis de G. Pétillon, d’une terrasse du Rhône distante de 3
km à vol d’oiseau. Par la suite, ils ont été confiés à Gabriel Chapotat, conservateur des musées de
Vienne, qui les a lui-même remis à la direction régionale des Antiquités
préhistoriques. À l’heure actuelle, on ignore où ils sont déposés (G. Pétillon,
Il était une fois… le Pilat…, 1980, brochure présentant le dessin de
l’un des galets ; fiche archéologique n° 2 de Bessey où, plus évasif, il
se contente de les décrire et d’exposer les circonstances de leur découverte).
Quant à leur caractère anthropique et leur datation, ils ne font pas
l’unanimité parmi les professionnels, mais leur jugement est fondé semble-t-il à
partir d’un autre exemplaire pas tout à fait identique de Philippe Monteil qui, en 2021, a repris la prospection des
parcelles identifiées par Pétillon, et trouvé en bordure d’une d’entre elles,
récemment labourée, un autre de ces galets portant des enlèvements
périphériques et deux encoches symétriques censées assurer une meilleure
préhension, et il a constaté une différence entre les cassures de ce galet et
ceux identiques d’une terrasse alluviale de la carte géologique au-dessus de
Salaise-Sur-Sanne (38), celles des derniers lui paraissant naturelles. Tout
ceci me semble bien subjectif et je ne peux me résoudre à retenir cet exemplaire qui me paraît un peu
trop lisse, dépourvu de toute tracéologie, avec des cassures un peu trop
fraîches. Pour autant, je suspends mon avis sur les exemplaires Pétillon, faute
de les avoir vus, regrettant une fois de plus la difficulté d’accès aux dépôts
régionaux, et je me range au moins provisoirement plutôt du côté des
sceptiques, les conditions climatiques du Paléolithique inférieur ne permettant
pas d’envisager une occupation permanente dans le Pilat, y compris son piedmont
soumis à de fortes intempéries en l’absence de tout abri de type cavité
naturelle. On pourrait admettre un objet perdu lors d’un simple passage, mais
une douzaine de galets est un nombre incompatible avec l’hypothèse d’une
présence aléatoire. Toutefois, d’autres possibilités existent : par
exemple, on sait que les terrasses alluviales du Rhône ont fait l’objet de
prélèvements pour l’empierrement des routes et chemins, et il ne serait pas
surprenant d’en retrouver des traces en bordure ou dans les champs voisins de
ces voies. Mme Achard-Corompt n’a pas vraiment apporté d’éléments nouveaux sur
ce que l’on connaissait déjà du Pilat, mais ses interventions de ramassage sur
quelques groupes de parcelles n’avaient pas la prétention d’être autre chose
que des sondages. Elle mentionne sa découverte dans un contexte gallo-romain
aux Collonges d’une herminette (p. 10) ou celle de deux autres haches polies
par Pétillon (p. 8). Elle ne décrit pas l’herminette en question, et c’est avec
beaucoup d’imprécision que Vincent Georges répertorie ces pièces dans son
corpus (Le Forez du 6ème au 1er millénaire av. J.-C.
Territoires, identités et stratégies des sociétés humaines du Massif central
dans le bassin amont de la Loire (France), thèse Université de Bourgogne,
2007, vol. 2-Corpus, Item 359. Pélussin, Les Collonges, p. 146-147 ; Item
104. Bessey, La Tronchiat, p. 44 et Item 485. Roisey, Tronchiat, p. 199. Ces
deux derniers sont des doublons dus sans doute au fait que la Tronchiat est un
lieu-dit commun à deux communes, mais
c’est dire l’imprécision des informations d’origine et le caractère fantomatique
de ces haches). Le principal mérite de Mme Achard-Corompt est d’avoir procédé
pour l’époque gallo-romaine à une synthèse qui faisait défaut, regroupant entre
autres les mentions anciennes de trouvailles monétaires qui souvent ont
disparu. Elle a mis en évidence des corrélations et des continuités entre les
vestiges de la période gallo-romaine et les emplacements castellaires de la
période suivante. Cette synthèse a permis de mieux comprendre la logique propre
à cette époque de l’occupation du territoire, coteaux et piedmont, dans la
région de Pélussin. Pour y parvenir elle a dû se servir à bon escient
d’excellentes fouilles en marge de son champ d’étude, comme celles à Limony
(lieu-dit Brèze) de notre ami le docteur vétérinaire Michel Guigal, disparu
trop tôt. Il avait des compétences archéologiques certaines et participait
chaque été en famille à des fouilles à Chypre. Il est dommage qu’elle n’ait pas
assez insisté pareillement sur les sites de St.-Appolinard, où abondent des
vestiges gallo-romains de type « industriel ». Par exemple, elle évoque les
Blaches, mais ignore les estampilles importantes qui y ont été trouvées,
pourtant bien connues de Pétillon, et qui font tout l’intérêt d’un des nombreux
gisements qui jalonnent une voie, sinon romaine au sens strict, importante à
l’époque gallo-romaine et médiévale. La méconnaissance de l’estampille Clariana
trouvée sur ce site, qui a contribué à
biaiser les conclusions d’une étude de 1999 d’Alain Bouet sur cette officine de
tuilerie-briquetterie, est un autre
exemple du désintérêt des archéologues pour le Pilat. Elle était pourtant
répertoriée dès 1997 dans le fascicule de la Loire de la Carte archéologique
de la Gaule (v. Annexe). Enfin, je réserve pour un autre chapitre ce
qu’elle dit sur les enceintes du Pilat.
Des murs imposants…
Le site du Moulin à Vent occupe une
superficie significative d’un peu plus
de deux hectares, et s’il était resté libre de toute construction, il
approcherait les cinq hectares. À titre de comparaison, la surface du « château
» préhistorique du Lébous (St.-Mathieu-de-Tréviers, Hérault) est d’à peine un
demi hectare. Dès ma première visite, j’avais constaté un enchevêtrement de
murailles, dont certaines sur le versant sud atteignent parfois une épaisseur
peu commune de près de 10 m pour 3 m de hauteur, sans que l’on puisse établir
si c’est l’état d’origine ou le résultat de l’épierrement des champs
environnants. La technique du double parement avec un blocage intérieur
tendrait à privilégier la première éventualité, mais les deux possibilités ne
sont pas incompatibles. À l’ouest du site se trouvent des murs d’un genre
différent, composés de gros blocs à rapprocher du non moins étonnant « mur païen » du mont Ste.-Odile dans les
Vosges (Bas-Rhin), ce qui n’est pas forcément une preuve d’ancienneté puisque
une section de ce dernier est maintenant datée par la dendrochronologie avec
une grande précision, du dernier quart du VIIe siècle de notre ère, grâce à des
échantillons anciennement prélevés des tenons en bois mortaisés utilisés lors
de la construction ou d’une réfection pour lier les blocs. Il ne serait pas
exclusivement de L’âge du Bronze ou de l’époque gauloise comme on l’a longtemps
pensé, même si la montagne d’Altitona passe pour avoir été un lieu de
culte à cette époque : un exemple parmi d’autres des calamiteuses théories
des celtisants du XIXe siècle, qui trouvent encore malheureusement des échos
aujourd’hui. La complexité du Moulin à
Vent est le fruit de nombreux remaniements à travers le temps. Ces murs ne
relèvent sans doute pas tous d’un habitat préhistorique ou/et protohistorique,
plus ou moins défensif ou protégé, mais la présence de guérites, bastions et
tours d’angle sur certains d’entre eux (ainsi le soubassement de la « tour »
sud-ouest sur la limite des parcelles B 40-41) autorisait une comparaison avec
le site du Lébous que je viens de citer,
et je ne m’en étais pas privé à l’époque où j’en faisais la découverte. Sa
fouille par un préhistorien amateur qualifié, le Dr Arnal, avait fait l’objet
d’une certaine publicité. Il appartient au groupe néolithique
final-chalcolithique de Fontbouisse, dont l’apogée se situe au milieu du
troisième millénaire avant notre ère, composé de villages ou hameaux, ouverts
ou fortifiés, d’une superficie d’un hectare maximum. Depuis, d’autres «
habitats ceinturés » de la même culture ont été exhumés : Boussargues
(Argelliers, Hérault) remparé en pierres sèches, ou Mudaison (Hérault), protégé
par une profonde tranchée surmontée d’un puissant rempart palissadé (terre et
bois) doté de plusieurs bastions, et abritant des habitations aujourd’hui
disparues, à proximité d’un cours d’eau et au sein d’un terroir fertile où la
communauté paysanne pratiquait la culture de l’orge et du blé et l’élevage des
bovins et des caprinés. Le petit village éponyme de Fontbouisse (Villevieille,
Gard) présente comme le Moulin à Vent des murs en pierres sèches à double
parement et blocage intérieur d’une épaisseur atteignant parfois les deux
mètres, largement dépassés par certains murs du site pélussinois. Comparaison
n’est pas raison, mais l’influence de cette culture via le couloir rhodanien
n’est pas exclue. Elle s’étendait dans l’actuelle garrigue languedocienne jusqu’au Rhône, sur la partie
orientale de l’Hérault, le Gard et le sud de l’Ardèche, qui n’est pas si
éloigné du Moulin à Vent, où le matériel
retrouvé révèle des contacts à longue et même très longue distance. Mais, si le
site n’a livré à ce jour que des vestiges néolithiques, ces murailles peuvent
être tout autant contemporaines que plus récentes, en tout ou en partie. D’une
part des céramiques exhumées par G. Pétillon en fournissent des indices.
D’autre part, on peut également faire un rapprochement avec Jastres Nord
(Lussas, Ardèche), sur la rive gauche de l’Ardèche en face d’Aubenas, un
oppidum du second Âge du Fer, et son rempart également large à parement double
et agrémenté de tours et de bastions (Claude Lefebvre, « Jastres et les oppida
méditerranéens », Revue du Vivarais, t. XCI, janvier-mars 1987 (689), p.
9-20). Ce qui est sûr, c’est que le site ne devait pas se présenter à l’origine
tel qu’on le voit aujourd’hui. Les lieux ont subi à travers les âges de
multiples aménagements et modifications, ne serait-ce que par l’installation
d’un moulin à vent, qui a laissé son nom au site et dont on voit encore les
ruines côté est.
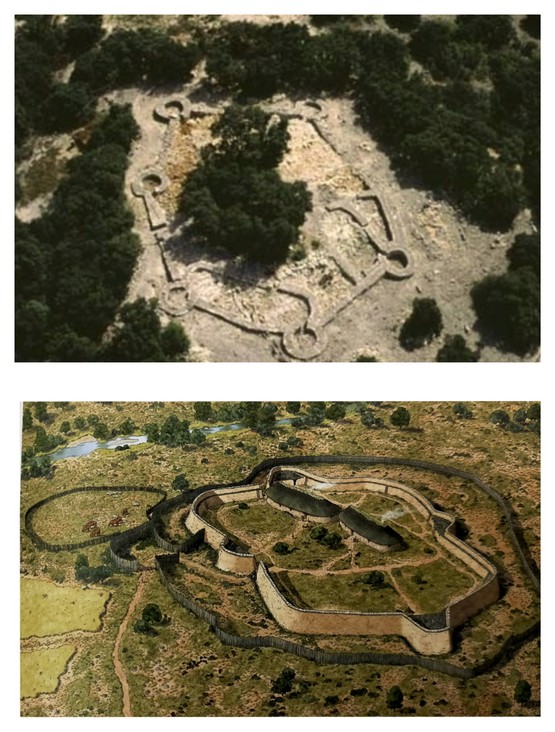
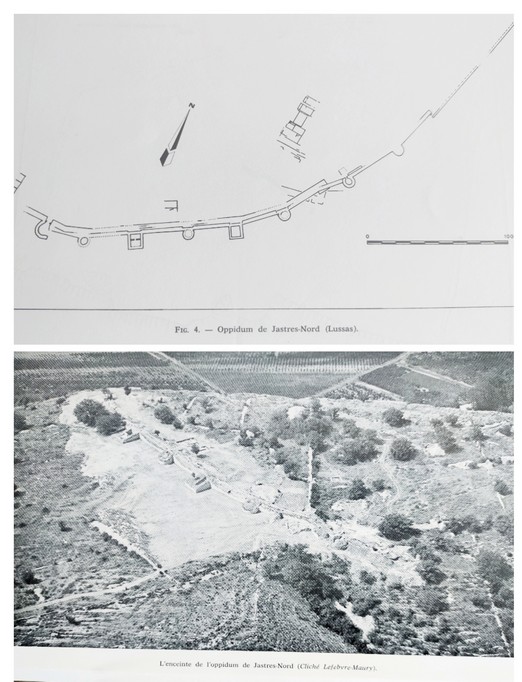
… associés à un grand tumulus ?
Alors que la pente du versant nord, côté Régrillon
face à Pélussin, est très abrupte, celle du versant sud, le plus remparé, est
douce et se termine au creux d’un léger vallon. Dans l’Entretien, j’expliquais
que le toponyme Le Coma, figurant sur la carte de Cassini au
XVIIIe siècle, d’après la langue gauloise, pourrait signifier précisément La
Combe ou Le Vallon. La présence dans ce vallon de puits et de
sources a certainement favorisé l’occupation pérenne des lieux. Tout au fond, au
bord de la route de La Ribaudy, j’avais remarqué un imposant monticule de forme
oblongue contourné par les labours, et correspondant à deux petites parcelles
cadastrales de même forme. G. Pétillon y voyait « peut-être une motte
féodale. » (fiche n° 7 de Pélussin, Murailles du Moulin à Vent).
Dans son article de 1985, il dit du monticule qu’il « rappelle une motte
féodale ou un tumulus, mais rien ne prouve que ce ne soit pas un accident de
terrain naturel. » (Dan l’tan, n° 6, p. 31). Concernant une butte
isolée en bordure de champ, c’est peu probable. Quant à la motte féodale, je persiste
à penser qu’elle aurait été installée en position proéminente à l’intérieur de
l’enceinte comme le moulin à vent. J’y voyais donc plutôt un tumulus, plus
probable que de nombreux pierriers du Pilat souvent considérés à tort comme des
tumuli. L’apparente mais légère dégradation du flanc ouest de ce monticule,
semble t-il lors des activités agricoles et par des engins mécaniques, montre
qu’il n’est peut-être pas si naturel, mais composé d’éléments entassés plus
fragiles. Si les murailles nous ont rappelé le Chalcolithique d’influence
fontbuxienne ou la période de la Tène, l’association d’un imposant tumulus au
pied d’un oppidum fortifié évoque une autre hypothèse, à vérifier comme les
deux autres, celle des « principautés » hallstattiennes bien connues en France,
en Suisse, en Allemagne et en Autriche : Vix-mont Lassois, Lavau, Bourges,
Châtillon-sur-Glane, la Heuneburg, Hochdorf, Glauberg ou Strettweg, dont les
tumuli ont généralement livré char d’apparat, mobilier de prestige et service à
boire du genre symposium d’origine méditerranéenne. Le site du Moulin à Vent
était à même de contrôler le trafic du couloir rhodanien qui transitait tout
autant sur le piedmont que le long du fleuve. Si dans ses fiches
dactylographiées, G. Pétillon qualifie l’enceinte d’« architecture militaire
celto-ligure… » - ce qui ne veut pas dire grand-chose – il ajoute : «
…commandant la route de piedmont » - ce qui a plus de sens (fiche n° 7 de
Pélussin).
… sur un important chemin antique de piedmont
G. Pétillon ne cite pas ses sources mais, dans plusieurs fiches et dans son article de 1985, il met le site en relation avec la voie de piedmont nord-sud de grande communication qui, dans l’Antiquité préromaine, depuis St.-Romain-en-Gal se dirigeait en direction de Nîmes. Nous complétons ici sa description. Elle rejoignait le Pilon, puis passait vers Métrieux (Chuyer). Le combat qui s’est ici déroulé le 10 décembre 1587 sous les guerres de Religion, une escarmouche de cavalerie dite aussi « bataille de Virecul » tend à montrer que cette voie était encore empruntée à l’époque moderne : lors de la capitulation de ses auxiliaires allemands, depuis le camp de Marcigny en Saône-et-Loire, François de Châtillon-Coligny, à la tête d’un petit détachement protestant, s’était replié sur le Vivarais. Après avoir traversé le Gier entre Tartaras et Trèves, il avait emprunté cette voie et, en ce lieu, avait échappé de peu aux catholiques de François de Mandelot, gouverneur de Lyon, accourus lui barrer la route (La Huguerie, un des chefs des troupes suisses au service des réformés, Journal du voyage des reitres en France, en 1587, publié par d’Aubais. Pièces fugitives pour servir à l’histoire de France, t. II, Mélanges, p. 23 ; Mémoires de Jacques Page seigneur de Saint-Auban, un des lieutenants de François de Châtillon, Documents pour servir à l’histoire de France, collection Petitot, 1re série, t. 43 ; Comptes et Chroniques de la ville de Condrieu, XVIe-XVIIe siècles ; Claude de Rubys, Histoire véritable de la ville de Lyon, 1604 ; A. Péricaud, Notice sur François de Mandelot, gouverneur et lieutenant-général du Lyonnais, Forez et Beaujolais, sous Charles IX et Henri III, Lyon, J. M. Barret, 1828 ; surtout A. Vachez, « La bataille de Métrieux », Revue du Lyonnais, 2e série, t. 31, août 1865, complété et corrigé dans Études historiques sur l’Ancien pays de Jarez, Lyon, A. Brun, 1885, p. 28-42 ; Abbé J. Batia, Recherches historiques sur le Forez-Viennois, St.-Étienne, 1924, p. 71-72). Sur la commune de Pélussin, elle suivait un raidillon pavé de gros blocs reliant La Guintranie au Moulin, où le pavage disparaît sous les alluvions de la Valencize, puis d’autres portions ont été recouvertes par le goudron. Elle passait ensuite entre l’église Notre-Dame et la mairie, descendait en pente raide vers le Régrillon le long du Rocher du Diable (une pierre à bassins), et remontait l’autre versant en diagonale avant de longer le flanc est du Moulin à Vent, une partie très embroussaillée montrant néanmoins et à nouveau un pavage bien visible. Elle gagnait ensuite la Morcellerie et les Collonges, un toponyme gallo-romain et médiéval, puis Malleval où elle croisait l’importante voie du Velay par le Tracol, suivant ou longeant l’actuelle D503, probablement préromaine elle aussi, mais avec nombre de caractéristiques qui en ont fait par la suite une quasi voie romaine même en l’absence de bornes milliaires, car elle est entre autres jalonnée de vestiges de cette époque. Elle gagnait ensuite Chézenas connu pour son dépôt de bronze, avant d’entrer en Haut-Vivarais, où elle rejoignait vraisemblablement Félines, un toponyme en relation avec les productions en terre cuite, céramique ou autre. En latin, figlina c’est l’art ou l’atelier du potier, ou encore la carrière d’argile. Dès 1839, Charles-Athanase 1er baron Walckenaer (Histoire-Géographie : Atlas de la Géographie ancienne, historique et comparée des Gaules Cisalpine et Transalpine, Paris, Dufaut), suivi en 1914 par René Cagnat (Cours d’épigraphie latine, réimpr. 1964, p. 342, note I), avait du reste rapproché le nom du village haut-vivarois de Figlinis, figurant dans le réseau du cursus publicus en Gaule sur la Table de Peutinger, comme la première station à 17 milles/25 km au sud de Vienne, suivie de Tain-l’Hermitage/Tigna à 16 milles/23,5 km, puis Valence/Valentia à 13 milles/19 km (J. Dupraz, Ch. Fraisse, Carte archéologique de la Gaule, L’Ardèche, 07, Paris, 2001, p. 249, n° 089). Cette identification est aujourd’hui abandonnée au profit de Roussillon en Isère, où sont attestés d’importants gisements de glaise en lien évident avec le toponyme, et dans les environs duquel des tuileries ont été repérées, voire encore, mais à seulement quinze kilomètres au sud de Vienne, au profit de St.-Clair-du-Rhône, au lieu-dit et site de Clarasson. Depuis l’hypothèse avancée en 1968 par Marcel Leglay, alors directeur de la circonscription Rhône-Alpes des Antiquités historiques, en raison du cumul de la concordance toponymique et de la présence d’abondantes carrières de glaise, on y a du moins situé après plusieurs tâtonnements la fameuse officine de tuilerie-briquetterie CLARIANA (v. Annexe). Si l’on admet que le réseau antique, au moins partiellement, n’a pas cessé d’être fréquenté à l’époque romaine, médiévale et même moderne, le réseau routier romain ayant dans le meilleur des cas repris ou réaménagé une partie du réseau ancien existant, ce qui est probable, comme on l’a vu, pour la voie du Velay, l’étape suivante pourrait être Annonay, qui tirerait son nom en tant que dépôt de l’Annone, le Service de l’approvisionnement dans l’empire romain. Mais cette voie passait plus vraisemblablement à l’est de la cité. En effet, Georges de Manteyer mentionne un vieux chemin servant de limites à Champagne, entre Peaugres et Bogy au nord, Colombier, St.-Désirat et une portion de Champagne au sud (Les origines de la Maison de Savoie en Bourgogne 910-1060, t. 3, La paix en Viennois, Grenoble, 1904, 153 [67], n. 2). Ces précisions visent à souligner l’importance de ce vieux chemin, dont nous n’avons pas cherché à établir le tracé exact, sauf à Pélussin et autour du Moulin à Vent, et la description de la suite de son trajet, à supposer même qu’il soit parfaitement bien identifié, n’est plus vraiment utile à notre propos.
On l’a vu, certains tronçons de ce vieux chemin
sont pavés. Or, ceux qui ont parlé de tous les chemins pavés anciens du Pilat
les ont souvent qualifiés abusivement de romains. G. Pétillon lui-même, à
propos du pavage à hauteur du Moulin à Vent, ne peut s’empêcher de préciser
qu’il est « à la mode romaine » et, à
propos du tronçon de la Guintranie, il déclare qu’une largeur de 6 pieds
(environ 1,75 m) était la norme de croisement des convois de mulets bâtés de
tous les chemins de ce type dans le Pilat. Une mise au point s’impose donc.
Stricto sensu, une voie romaine, conçue avant tout pour faciliter le
déplacement des légions en armes, comme les autobahnen ont été
multipliées en Allemagne dans les années 1930 pour la mobilité des troupes
mécanisées, est une voie large de 6 à 12 m., de tracé autant que possible
rectiligne et évitant les reliefs trop prononcés. La via Agrippa de Lyon à
Arles, approximativement notre RN7 sur la rive gauche du Rhône, ou celle de la
Narbonnaise, notre RN ou D86 sur la rive droite, sont les exemples les plus
proches et significatifs de ces voies rapides avant la lettre, et le chemin
dont nous parlons ne possède aucune de ces caractéristiques (Raymond
Chevallier, Les Voies romaines, A. Colin, 1972). Quant au pavage, ce
n’est pas une exclusivité des voies romaines. Hors contexte urbain et italique,
il se pourrait même qu’elles aient été moins pavées que des chemins de tout
autres époques. Les pavages de voies anciennes sont difficilement datables,
sauf cas particulier historiquement documenté, ou démontage des dalles pour
retrouver d’éventuels marqueurs chronologiques. Ils peuvent être plus récents
que la voie qu’ils recouvrent, et leur raison d’être est souvent
utilitaire : ainsi, la côte de la Guintranie, sans pavé, serait un
bourbier, et il aurait été difficile d’y faire passer les convois de mules
transportant les meules taillées dans les
ateliers de plein air environnants à partir de notre Moyen Âge. C’est vrai
également de la voie pavée de Taillis Vert le long du Ternay entre
St.-Julien-Molin-Molette et Colombier. Moyennant quoi, une solution de
continuité caractérise le pavage de ces vieux chemins, quelle que soit leur
époque, et il est vain de vouloir
trouver des pavés sur toute leur longueur. On évalue à moins de 1% les tronçons
pavés des voies romaines en Gaule, la surface de la plupart se contentant de
terre et de sable, ou de graviers parfois bétonnés. Et, à en juger par la
fréquence des chemins pavés dans le Pilat, il est fort possible que les voies
préromaines et médiévales aient été plus
souvent pavées que les voies romaines.
Pour n’être pas une voie romaine, ce chemin de piedmont nous semble n’avoir que
plus d’intérêt du fait de son ancienneté. Pour N. Corompt, semblent pourtant
médiévales ces pavées ou pavies du Pilat, notamment cette voie du Pilon passant
par le quartier N-D de Pélussin, qu’elle ne met toutefois pas en relation avec
le Moulin à Vent (p. 87 de son mémoire). Effectivement, la plupart de ces
pavées sont médiévales mais, probablement faute de faire cette relation, elle
oublie que certains de ces chemins ont pu traverser plusieurs époques. La
colonisation de la Gaule romaine n’a pas interrompu du jour au lendemain le
trafic sur de vieux chemins sous prétexte qu’ils ne répondaient pas aux normes
de la romanité. Concernant la voie gallo-romaine du Tracol, elle critique le
tracé qu’en donne Jean Patissier qui a voulu faire la liaison entre divers
sites d’époque différente (p. 63-65). Concernant la méthodologie, elle a en
partie raison. Si, pour notre part, nous avons mis la voie de piedmont en
relation avec des étapes gallo-romaines plus récentes, ce n’est pas en
considération de son tracé, mais seulement pour souligner qu’elle a pu
continuer à être empruntée après l’antiquité pré romaine et plus récemment
encore.
Au demeurant, ne serait-ce qu’en raison des
caprices du Rhône, il n’est pas certain que l’itinéraire romain ait toujours
emprunté la vallée. Si la via Agrippa sur la rive gauche était un peu mieux
avantagée pour échapper à ces désagréments, ce n’était pas le cas de la
Narbonnaise sur la rive droite, et la voie du piedmont a pu jouer pour elle un
rôle de voie subsidiaire lors du petit optimum de réchauffement climatique
romain, approximativement des deux derniers
siècles de l’indépendance gauloise au milieu du IIIe siècle de notre ère, dont on sait qu’il
s’est traduit sur le pourtour méditerranéen par une forte pluviosité propice
aux débordements saisonniers des cours d’eau, à l’inverse des latitudes élevées
en Asie où une sécheresse prononcée et tenace serait considérée par certains
à l’origine des mouvements ethniques
exogènes fatals à l’empire romain. La Table de Peutinger étant une compilation
de données de plusieurs époques, André
Pelletier reporte au IIe siècle la création de la voie Narbonnaise. Il en
fait une conséquence tardive du développement de la cité d’Alba en Helvie
(Ardèche) et des échanges induits de cette cité avec Lyon. N. Corompt ne
partage pas cet avis en raison du rôle stratégique du Rhône et de sa vallée
depuis la plus haute antiquité (p. 65-66 et 72). Il est difficile de se
prononcer catégoriquement, même si la prise en compte des conditions
climatiques milite plutôt en faveur du point de vue de l’historien de la Vienne
gallo-romaine. Au Moyen-Âge encore, c’est le piedmont et non la vallée qui
était emprunté, notamment par saint Louis et les contingents de croisés qui se
rendaient à Aigues-Mortes y embarquer pour la Terre Sainte. Sauf en 1248, où il
utilise la voie fluviale, il a plutôt
suivi la voie Régordane qui partait du Puy. Je l’ai personnellement parcourue
jusqu’à St-Gilles-du-Gard. Certes, la raison principale était tout autre :
la vallée, la rive gauche du moins, était terre d’empire, et seule l’ancienne
Narbonnaise rive droite était en principe à disposition des gens du royaume,
mais précisément les caprices du Rhône, qui se portaient particulièrement sur
cette rive resserrée entre le fleuve et le flanc est des Cévennes, ont aussi pu
jouer un rôle.

Vallon et rempart sud vus depuis la route de la Ribaudy
Plan du site
Dans son article de 1985, G. Pétillon indiquait :
« Nous en avons fait un relevé partiel en 1973. » (Dan l’tan,
n° 6, p. 28) et, dans sa fiche n° 7 de Pélussin (Murailles du Moulin à Vent),
il précisait : « J’ai fait avec Dominique Bonnaud un relevé de la
partie la mieux conservée, qui est celle bordant les vignes », donc côté sud.
Effectivement, le relevé ne pouvait être que partiel en raison de la présence
d’une exploitation agricole et d’une habitation qui font obstacle totalement ou
presque à toute expertise du site au nord et à l’est, où l’installation d’un
camping, dont mon père est à l’origine, n’a pas non plus contribué à améliorer
la compréhension du site. Mais c’est un relevé de tous les murs que nous avons
fait, par triangulation, approximative en raison de la présence d’un important
couvert végétal, et sans autre distinction que leur épaisseur traduite sur le
papier par des nuances de trait. Il existe toutefois des détails
suggestifs : par exemple l’appendice très étroit en forme de goulot
d’arrosoir à main de la parcelle longiforme B33 du cadastre, le réservoir de
l’arrosoir dépourvu d’anse. Étranglé entre les parcelles B25 et B26, cet
appendice occupe la place que nous avions identifiée à une rampe d’accès au
sud-ouest du site. La forme curieuse de cette parcelle ne s’invente pas, et la
rampe semble correspondre à une entrée en chicane, dispositif défensif bien
connu. L’autre rampe au nord pourrait être plus récente et correspondre au
chemin d’accès à l’ancien moulin.
Récemment, en consultant cette section B du
cadastre, j’ai fait le constat suivant : un grand nombre de parcelles se
suivent selon un tracé formant une figure de trois quarts ou d’un demi cercle.
Il pourrait bien circonscrire le site originel, enceinte ou/et habitat. En
utilisant une échelle à peu près identique, j’ai pu y caler schématiquement
notre plan de 1973. Sans surprise, une grande partie des murs alors identifiés
se confondent avec des limites de parcelles.
Si cette corrélation montre la relative fiabilité de notre relevé, elle ne
prouve rien d’autre que la construction du parcellaire à travers le temps par
réaménagement et réemploi de l’existant, modifiant et bouleversant à de
multiples reprises la configuration primitive. Il a été récemment déclaré que
le Lidar doublé d’un drone, acquis en 2022 par l’association Des Pierres et
des Hommes, « est approprié au Moulin à Vent ». L’expérience mérite d’être
tentée : vraisemblablement, le Lidar repérera les murs de notre relevé de
1973, et confirmera la fiabilité de ce dernier, comme la superposition du plan
sur le cadastre à laquelle j’ai procédé. Il pourra y ajouter quelques
structures qui nous auraient échappées, mais il ne fera pas mieux le tri entre
ce qui est ancien correspondant à une enceinte primitive, et ce qui a été créé
de toutes pièces plus récemment, sauf à
repérer quelques tours d’angle, ce que nous avions fait. Il existe aussi
au Moulin à Vent un atelier médiéval de meules sur plusieurs affleurements
rocheux, dont l’un est surmonté de deux bassins d’une trentaine de centimètres
de diamètre. Mais, contrairement au vieux moulin, cette meulière se situe hors
enceinte, à l’ouest, sur une parcelle à proximité d’un petit chemin conduisant
de la route de la Vialle à la tranchée de l’ancienne « galoche » ou « tacot »
au débouché sud des viaducs.
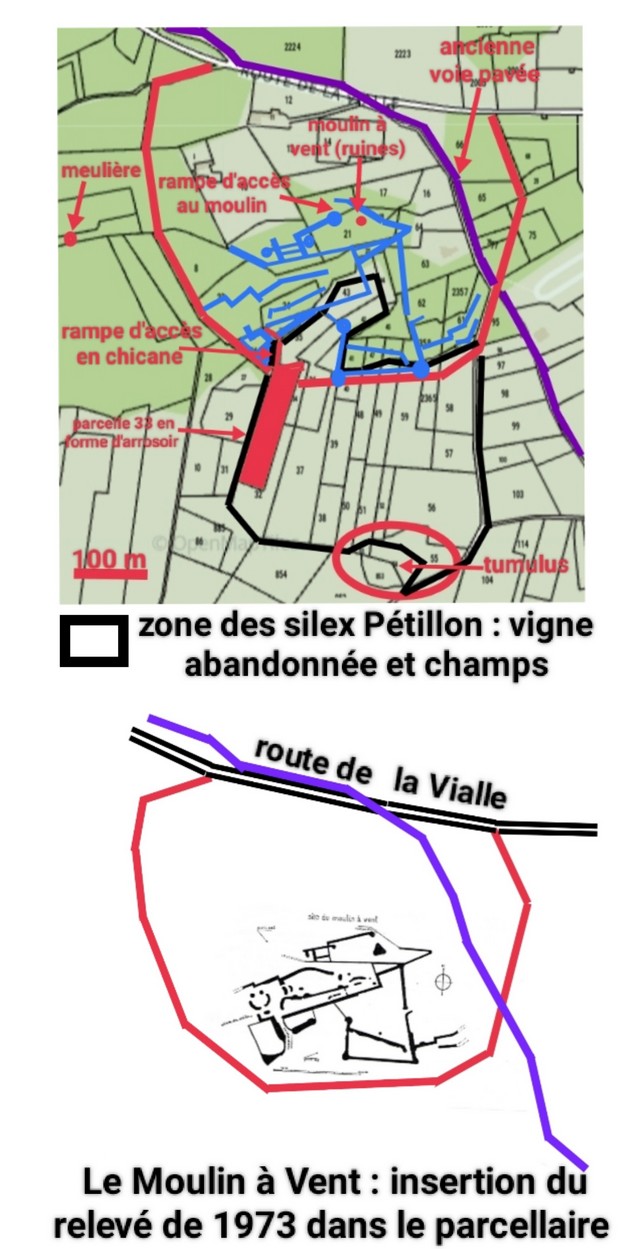
Une enceinte parmi d’autres du Pilat et du
Haut-Vivarais ?
Ignoré jusqu’à maintenant en tant qu’enceinte
du Pilat, le Moulin à Vent mérite d’être comparé à tout ce qui y était
auparavant identifié comme tel. En 1994, N. Corompt avait abordé le thème des
sites de hauteur dans son mémoire de maîtrise. L’année suivante, son mémoire de
DEA traitait exclusivement de ce sujet sur trois départements (N. Corompt, Entre
Gaule du Nord et Gaule méditerranéenne : les habitats fortifiés de hauteur
dans les départements de l’Ardèche, de la Loire et du Rhône, mémoire de
DEA, Université de Lyon II, Lyon, 1995, p. 57-58). Mais ce qui nous intéresse
ici n’y occupe que quelques pages. C’est pourquoi dans les lignes qui suivent,
c’est à son mémoire de maîtrise que je ferais plutôt référence, étant de
surcroît précisé que sur ce sujet, comme en d’autres, elle a puisé la
quasi-totalité de son information dans les fiches Pétillon. En 2013, Fabien
Delrieu et Pierre Dutreuil, dans le cadre d’un programme de recherche sur
l’habitat fortifié à l’âge du Bronze et
au 1er âge du Fer sur le versant oriental du Massif central, ont
repris à leur tour plus
particulièrement la documentation sur
les quatre sites connus de ce secteur, dans un article de synthèse bien documenté
pour l’essentiel, même s’ils n’ont manifestement pas eu accès à toutes les
informations, et qui donne les plans de trois des sites présentés avec leurs
courbes de niveau, mais ils ne présentent de ces enceintes qu’une seule
interprétation réductrice en termes de système défensif. On ne peut que le
regretter (F. Delrieu, P. Dutreuil, Les fortifications d’altitude en pierres
sèches dans le Haut-Vivarais et le Pilat : architecture et chronologie,
Ardèche Archéologie n° 30, 2013, p. 65-71, 7 pages seulement mais deux colonnes
par page. Je suis redevable à Mr. Philippe Richagneux, secrétaire du GRAL, de
m’avoir communiqué cet article). De plus, il est intéressant et curieux de
constater qu’eux et N. Corompt n’envisagent ici de fortifications que sur des
sites de hauteur. Or, le Moulin à Vent ne rentre pas dans cette typologie.
À propos de St.-Sabin (Véranne), Delrieu et
Dutreuil soulignent l’indigence des résultats de plusieurs sondages : le
premier vers 1935 par des Viennois, M. Delaroche et Gabriel Chapotat, au sud de
la chapelle sur un amas de blocs considéré par eux sans preuve comme un tumulus
néolithique. Ils y ont recueilli des fragments de poterie, disparus, attribués
pareillement au Néolithique. Avant les grands travaux de sa période viennoise,
Chapotat ne se démarquait guère des poncifs en faveur dans les milieux de l’archéologie
de l’entre deux guerres. Il a même laissé un article d’une grande banalité sur
les pierres à bassins à propos de l’une
d’entre elles sur les hauteurs de Ste.-Colombe. Quant à l’enceinte, bien
présente sur le versant ouest le moins abrupt, édifiée avec les pierres de
l’imposant chirat à travers lequel a aussi été aménagé le chemin d’accès au
lieu de pèlerinage à partir des auberges, N. Corompt (p. 51-52) l’attribue au
Chalcolithique/Bronze. C’est un emprunt évident à Pétillon qui lui décerne « une
très grande ancienneté : bronze voire même néolithique » sur le seul
critère que son parement est des plus fruste, ce qui est plus que discutable (Pétillon
G., sd, fiche n° 2 de Véranne, St.-Sabin). Pour les sondages de Jean
Patissier en 1976, je sais à quoi m’en tenir à leur propos puisque j’ai
participé à ceux de Château Bélize. Ses compétences en archéologie classique,
comme le montrent ses rapports sur le gallo-romain à St.-Appolinard, sont certaines.
Elles sont moins assurées pour la préhistoire : il n’a rien trouvé à l’arrière du parement interne du rempart,
mais sur l’arête sommitale nord-sud, le long du chemin qui descend en direction
de Buet, il a sondé deux fonds de cabanes, dont l’une à l’angle sud-est du
rempart, non sur Véranne mais sur
Colombier (parcelle B15), à la limite des communes, et il y a trouvé en
profondeur quelques poteries grises qu’il pense protohistoriques et…
médiévales. À juste titre, et en dépit de son enceinte « néolithique »,
Pétillon, auquel N. Corompt emboîte le pas, ne retient que le second
qualificatif pour ces tessons manifestement liés sans surprise aux activités
pérégrines. Sur le flanc ouest et dans la même parcelle B15 de Colombier, qui
s’étale sur pas moins de 29 ha, Pétillon fait état de nombreux fonds de cabanes,
mais elles sont hors enceinte. À l’intérieur, sur l’arête sommitale, il y a à
quelques mètres de la chapelle actuelle des vestiges au sol, mais ils correspondent à la chapelle
antérieure à celle d’aujourd’hui datée de 1683, due aux soyeux de Pélussin dont
les Benay. L’un des deux modestes fonds de cabanes, les seuls de la même arête,
sondés par Patissier et qualifiés pompeusement de « bâtiments », n’offre même pas à un homme la place
suffisante pour s’y étendre jambes allongées, ce que N. Corompt semble avoir en
partie compris. Ceci ne peut correspondre qu’à un abri temporaire de chasseur
ou de berger, sachant que la transhumance estivale était pratiquée dans le
Pilat au Moyen Âge comme nous l’apprend le Cartulaire de St.-Sauveur-en-Rue
pour les hauteurs de Taillard, mais d’autres secteurs du massif ont
probablement aussi été concernés. L’enceinte n’a donc rien de défensif et n’a
jamais abrité un habitat permanent. Pétillon lui dénie également toute fonction
militaire en raison de l’altitude, de la prise aux vents et de la présence au
nord d’une seule modeste source. Il lui reconnaît seulement une finalité
religieuse, toujours d’actualité. On se demande bien d’ailleurs ce qu’il y
aurait ici à défendre. Tout au plus peut-on imaginer un excellent poste d’observation
des déplacements de troupes, notamment lors de la guerre des Gaules. L’enceinte
correspondrait plutôt à un enclos pour le bétail, étroitement lié au culte ici
pratiqué. Ce n’est pas le seul exemple de vénération d’un saint assez obscur
(Savi en patois) servant d’alibi à un culte païen agraire christianisé, décrit
entre autres par l’abbé Batia (Recherches historiques sur le Forez-Viennois,
St.-Étienne, Dumas, 1924, p. 251-252). Il est censé protéger de la foudre et,
pour le cheptel et, à partir du XVIIe siècle à l’initiative entre autres des
Benay de Pélussin, pour le ver à soie, des épizooties. Il est aussi associé à
la pratique des rebouteux. Lors des pèlerinages, principalement le lundi de
Pentecôte, est effectuée la cueillette et la bénédiction de l’alchimille des
Alpes, encore appelée pied de lion, herbe de St.-Sabin ou herbe aux sorciers,
laquelle figure dans la pharmacopée des alchimistes, et dont une poignée est
ensuite attachée au-dessus de l’entrée des étables pour la protection des troupeaux.
Il y a là ce que l’on appelle un faisceau d’indices favorables à cette
interprétation pastorale et cultuelle, laquelle ne fait pas obstacle à ce que
cette transhumance et ce culte aient une origine antérieure à l’ère chrétienne.
Si l’attribution à la protohistoire,
voire plus haut dans le temps, des céramiques Patissier et Chapotat n’est pas
prouvée, rien ne s’oppose donc à ce que l’on trouve ici un jour de tels
artefacts, mais le Moyen-Âge reste le premier concerné parce que, des trois
petits épisodes d’optimum climatique les plus récents de notre histoire,
indépendamment du nôtre, au sein de fluctuations de plus grande ampleur,
l’optimum de l’âge du bronze (1500-1000 av. J.-C.), celui de l’époque romaine
(ca 200 av.-250/300 apr. J -C.) et l’optimum médiéval (ca 900-1300 apr. J.-C.)
qui précède le petit âge glaciaire de l’époque moderne, c’est le dernier qui
est le plus marqué, les deux autres se caractérisant par un écart peu
significatif d’un demi-degré de plus que durant les périodes froides qui les encadrent.
L’exclusivité médiévale des débris de poterie, soulignée par Pétillon et N.
Corompt, va dans le même sens.
À l’est des cols de l’Œillon et du Gratteau,
aux Trois-Dents (Véranne), dont les pendages accentués sont occupés, tant au
nord qu’au sud, par d’imposants chirats, on ne peut nier la présence sur le
versant méridional, juste au pied des falaises ou pics qui ont donné leur nom
au site, d’une structure empierrée rectiligne bien visible à distance,
notamment depuis St.-Sabin. Sur place, dans la parcelle AE13 de Véranne de 5 ha
½ environ, on remarque dans le cirque d’éboulis une muraille à double parement
édifiée de main d’homme, et elle-même très éboulée, qui s’étale de la Roche
Anglaise à l’ouest, le premier des trois
pics, ou le second si l’on veut en voir quatre, jusqu’au suivant. Plus haut,
dans l’espace formant col entre ces deux pics, on distingue encore, parallèles
ou presque, deux autres alignements pierreux moins allongés. La surface de
l’ensemble est ainsi compartimentée en deux. Delrieu et Dutreuil voient aussi
sur ces alignements supérieurs des parements, mais « agencés… de manière
relativement fruste ». Pourtant, il existe une autre expertise scientifique,
celle de Bernard Etlicher, géographe,
naturaliste, enseignant à l’Université de St.-Étienne de 1973 à 2017, président
du Conseil scientifique du PNR du Pilat de 2005 à 2021, puis son
vice-président. Ses compétences géologiques sont certaines et il voit dans les
alignements en surplomb du principal rempart des fronts de moraines de névé,
toujours situées en position d’abri au vent dominant, qu’il compare à celles du Canigou (Pyrénées-orientales). Faute
d’alignements perpendiculaires pour former un quadrilatère, il remet en partie
en cause la lecture du site comme enceinte pré ou protohistorique de type
défensif. En fait, le problème ne se
pose pas vraiment puisque les alignements s’appuient contre les enrochements
latéraux. En 1994, N. Corompt aurait observé à l’intérieur des remparts des
structures du type « fonds de cabanes », qui lui feraient presque accepter un
habitat humain improbable (p. 52-53). On peut se demander si elle les a
vraiment vus, car une fois de plus elle semble s’aligner sur Pétillon qui
mentionne effectivement des fonds de cabanes entre l’enceinte et la falaise (Pétillon
G., sd, fiche n° 1 de Véranne, Enceinte du Pic des Trois Dents). Ni moi,
lors de plusieurs visites, ni Delrieu et Dutreuil en 2012, n’avons rien
remarqué de tel. Pour autant, leur témoignage n’est pas à rejeter, mais ce
qu’ils ont vu doit être aussi peu convaincant que les « bâtiments » de
St.-Sabin. Pétillon rappelle la présence intéressante et originale contre la
falaise d’une large brèche à ciel
ouvert, pour autant appelée grotte des fées ou du feu, et d’un petit trou
circulaire qui semble taillé de main d’homme, le tout surplombant une cavité,
le puit des fées, qui retient de l’eau et où de l’eau coulerait, paraît il,
depuis le trou circulaire. Comme à
St.-Sabin, l’ensemble de murs n’a rien de défensif. C’est aussi
l’opinion de M. Etlicher avec un argument qui lui est propre mais qui, on l’a
vu, n’est pas recevable, et une fois de plus Pétillon n’attribue au site qu’une
signification religieuse, dont il n’y a toutefois aucune trace et, de façon
plus crédible, aucune valeur militaire avec cet autre argument qu’il est dominé
par la falaise des Trois Dents. De fait, qu’y a-t-il à défendre, sinon des tas
de cailloux, en ces lieux ingrats en prise à des vents violents et aux
intempéries ? Sans compter le problème du ravitaillement : vivres, aucune structure crédible de stockage
ne pouvant être décelée, et eau, nonobstant le semblant de source repéré par
Pétillon. Quoiqu’il en soit, il y aurait ici un mix de naturel et d’anthropique
peu banal qu’il faut comprendre. L’anthropique se distingue encore dans les
ouvertures aménagées au centre de chacun des murs, toutes alignées sur un même axe, ce qui ne s’invente pas. Quant au
mobilier, c’est le néant absolu. Ni Patissier en 1974, ni N. Corompt et tous
les doctorants préhistoriens autorisés à fouiller n’ont jamais rien trouvé. En
définitive, le site est indatable et, comme à St.-Sabin, il semble raisonnable
de voir dans ce système de murs un enclos compartimenté pour le bétail utilisé
en périodes d’estive. Pour le confectionner, les pasteurs auraient utilisé ce
que leur offrait la nature en l’aménageant et en le complétant.
Château Bélize (Pélussin, parcelles E1230-1235,
mais aussi en grande partie sur Pavezin) est situé sur le versant nord du crêt
de Baronnette ou de Bourchany mais très près de la ligne de crête et, à l’inverse des deux sites précédents, à
l’altitude raisonnable de 873 m. On y
accède depuis le col de Pavezin par le sentier du Parc n° 8, à l’ouest à
partir de Grange Rouet par une courte montée, ou à l’est par une montée longue
et abrupte à travers une hêtraie. On y distingue une petite enceinte ovale
d’une modeste superficie (un tiers d’hectare),
dominant une falaise très éboulée propice aux abris sous roche, et au
pied de laquelle Raymond Grau aurait trouvé une tête humaine en granit d’une
quinzaine de cm taillée en boule, les yeux et la bouche marqués d’un trait
creux, semblable à une autre tête surmontant un long buste dépourvu d’épaules,
et encastrée dans un mur de grange d’un hameau au-dessous de Montant (Chuyer).
Du rempart à double parement large de 2,5 m en moyenne, il ne reste que
quelques pans. Une entrée longe d’abord la muraille avant de traverser la
falaise. De nombreuses prospections sans grands résultats ont contribué à
accentuer le cahot des lieux et à brouiller les couches archéologiques. Aux
fouilles de Louis Dugas en 1927, ont succédé les fouilles Patissier-Ughetti en
1973. J’étais le plus jeune des participants. Était aussi présente l’intuitive
Denise Peillon, dont le nom reste attaché aux silex de la Font-Ria
(St.-Genest-Malifaux). N. Corompt (p. 17 et 45) considère ces fouilles comme
les seules soi-disant pratiquées selon la méthode stratigraphique dans le Pilat. Il faut relativiser :
Delrieu et Dutreuil eux-mêmes constatent d’après le rapport Patissier «
l’absence de contexte stratigraphique ». Et, de fait, une fouille
stratigraphique, ça ne consiste pas seulement à aligner un semblant de cordeau,
sans compter que ce n’est pas forcément la bonne méthode sur un tel site. Vu
d’un côté la difficulté de l’accès aux lieux et celle des lieux mêmes (important couvert végétal et faible
épaisseur du substrat terreux sur un site pentu et très chaotique), de l’autre le petit nombre des « fouilleurs »,
la moyenne d’âge et les motivations pas toutes désintéressées des principaux
acteurs, je peux certifier que ces prospections ont été assez superficielles. Toutefois,
contrairement aux enceintes précédentes, nous sommes ici en terrain plus sûr
avec un peu plus de mobilier. Dans l’entrée à l’intérieur de la muraille, J.
Patissier a trouvé plusieurs tessons de céramique surtout grise, c’est-à-dire
majoritairement médiévale. Conservés par lui, on ne sait ce qu’ils sont
devenus. Sollicité, Robert Périchon
(1928-1999) de Roanne a fait une expertise « prudente » de l’ensemble : il
identifie un fragment semblable aux sigillées jaunes de Roanne au Bronze final
ou au 1er âge du Fer. Delrieu et Dutreuil pensent toutefois que le
dessin présent dans le rapport Patissier ne permet raisonnablement pas de lever
cette imprécision et que sa relation avec le rempart n’est pas assurée. Mais il
y a aussi des tessons laténiens, gallo-romains et médiévaux, ce qui n’est déjà
pas rien et laisse envisager une longue occupation jusqu’à la guerre de Cent
ans. Quant à la qualification du site dans sa phase la plus ancienne,
l’enceinte est trop petite pour être considérée comme défensive et sa fonction
serait plutôt cultuelle (Bélize/Belisama ?). Pétillon a émis en ce
sens une hypothèse intéressante : au nord des ruines d’une construction
voisine munie de deux tours d’angle quadrangulaires qui font penser à un
château médiéval dont le lieu aurait pris le nom, se trouvait un grand bassin bêtement
détruit par la municipalité de Ste.-Croix-en-Jarez au cours d’une recherche de
source sur les conseils d’un sourcier quelque peu dérangé. L’eau, captée sur le
plateau situé au nord, y était conduite par un drain en pierres. La réputation
néfaste de cette source, censée procurer la colique, et chargée de légendes, le
seigneur du coin y faisant boire toute sa chevalerie sans l’épuiser, laisse
présumer d’un culte païen des sources anathémisé par le christianisme (Pétillon
G., sd, fiche n° 1 de Pélussin, Château de Bélize).
Le Chirat Blanc (St.-Symphorien-de-Mahun,
Ardèche) ou Suc de Barry, qui doit son premier nom aux éboulis de blocs de
quartz sur son flanc oriental, est situé sur l’un des sommets d’une de ces
dorsales sud-ouest nord-est par
lesquelles se termine le massif des Cévennes à l’est, la plus au nord étant
celle du Pilat. Le site au fort pendage
est ceint d’un rempart ellipsoïdal très allongé, à double parement assez fruste et très
détérioré, formé de deux sections
appuyées au nord sur un chaos rocheux. Albin Mazon, le premier, en 1901, puis
en 1906, à avoir mentionné le site qu’il met au rang des oppida d’origine
romaine ou gauloise, avec le sens des réalités et la perspicacité intuitive dont
il fait souvent preuve, envisage dans sa composition non seulement des pierres
sèches mais aussi des branchages (A. Mazon, Le Préhistorique dans l’Ardèche,
Privas, 1906, p. 56). Cette enceinte est
la seule de celles que nous venons de présenter à abriter un véritable habitat
composé de 83 « habitations » de format assez homogène, recensées lors des prospections de 2012.
Leurs soubassements sont en pierre sèche et leur surface varie de 12 à 26 m².
Les concentrations et alignements sont plus importants à proximité de l’entrée
du site au sud-est, le long des voies de
circulation intérieures, notamment celle qui dessert le site depuis l’entrée,
ou le long de la ligne sommitale qui constitue
le seul replat. Qu’est-ce qui a rendu ici possible une telle occupation à une
altitude d’un peu plus de 1000 m, alors que nous avons constaté sa quasi
impossibilité à St.-Sabin et surtout aux Trois-Dents, situés également à plus
de 1000 m. Vingt centièmes de latitude sud supplémentaires ne sont pas
significatifs. En fait, la dorsale du Suc de Barry est protégée des influences
septentrionales par les autres dorsales cévenoles qui la précédent vers le
nord. Pour autant, diverses fouilles (Georges Goury, 1916 ; Henri Muller,
1921 ; C.-A. Poinard, 1963-1966 ; Éric Durand, 1993 ; N.
Corompt, 1995) ont donné de piètres résultats : un modeste tesson de «
poterie mal cuite » vaguement estimé de facture protohistorique trouvé dans un
des bâtiments lors des fouilles Goury de 1916. Sans élément de datation
véritable, toutefois, des similitudes architecturales avec le site de La Farre
(St.-Andéol-de-Fourcades) à 30 km au sud, sondé en 1977 par l’abbé Teyssier, et
occupé au Ve siècle avant notre ère, autorise les chercheurs à adopter à titre d’hypothèse une datation similaire.
Quant à la qualification du site, seule une structure hémicirculaire adossée au
parement externe à l’est du rempart justifierait timidement une fonction
défensive. Mazon rapporte et semble accepter aussi, avec moins de bonheur, que
« d’après bien des gens du pays, il s’agirait simplement d’une enceinte où l’on
aurait parqué les bestiaux en temps de peste, ce qui, d’ailleurs, n’aurait rien
de contradictoire avec la version de très vieille histoire ou de préhistoire
généralement admise à ce sujet. »
Ces quatre « fortifications » sont donc non
seulement très différentes de celle du
Moulin à Vent (altitude, absence de tours et de bastions), mais aussi entre
elles. Tout au plus peut-on repérer entre l’une ou l’autre quelques affinités.
Dans leur conclusion, Delrieu et Dutreuil les rattachent à la fin de la période
protohistorique. Même si les preuves manquent pour certaines et même si la période médiévale est, semble
t-il, aussi très présente sur ces sites, ceci me semble plausible et je n’y
fais aucune objection. En revanche, comme tout mon propos l’a montré, je suis
très réservé sur leur interprétation exagérément univoque : sous leur
plume, l’expression « système défensif » revient trop souvent, pour ne pas dire
constamment, et ils l’appliquent à chacun des quatre sites présentés, comme si
le temps de l’archéologie avait suspendu son vol une fois pour toutes au début
du XXe siècle, après les publications pionnières de Louis-Pierre Gras et Louis
Dugas, qui ont aussi abusé de l’attribution celtique, celle retenue en dernier lieu par Delrieu et
Dutreuil (L.-P. Gras, Essai de classification des monuments préhistoriques
du Forez, Montbrison, 1872 ; L. Dugas, Étude sur quelques monuments
celtiques du Mont Pilat, Vienne, Remilly, 1927). Les recherches ont beaucoup évolué depuis et il existe bien
d’autres possibilités que la seule enceinte défensive, qui plus est de la Tène
finale. Je ne suis pas le seul à considérer comme totalement non défensives les
enceintes de St.-Sabin et des Trois Dents, Georges Pétillon leur déniant aussi
toute fonction militaire. Lui et, dans son sillage, Nathalie Corompt, me
paraissent donc plus nuancés que Delrieu et Dutreuil. De surcroît, la première
partie du titre du DEA de Mme Corompt-Achard, « Entre Gaule du Nord et Gaule
méditerranéenne », convient assez bien au cas particulier du Moulin à Vent, où
je suppose des affinités fontbuxiennes. Je dois reconnaître que moi-même en
1974, je n’étais guère critique à l’égard de toutes ces enceintes du Pilat que
je me contentais de citer, alors même que, sur d’autres sujets, j’exprimais
quelques réserves notamment sur le mégalithisme (le Flat) et déjà, mais
timidement, de sérieux doutes sur les interprétations classiques des pierres à
bassins, ce que j’ai depuis développé plus amplement. Delrieu et Dutreuil en
appellent aussi à « des investigations
de terrain plus poussées ». C’est un propos assez récurrent depuis un siècle,
mais jusque là on ne l’a guère vu déboucher sur des initiatives autres que les
petites opérations de sondages que nous avons évoquées avec les résultats que
l’on sait. Si dans les temps à venir cet appel devait se concrétiser, encore
faut-il comprendre les conditions particulières des fouilles au moins en partie
sur certains de ces sites. Aux Trois-Dents, le long du « rempart » de St.-Sabin
et dans une moindre mesure au Suc de Barry, la présence de chirats rend toute
recherche pratiquement impossible et inutile, les éventuels artefacts que l’on
aurait pu y trouver auront glissé entre les éboulis sous lesquels il est vain d’espérer
pouvoir les récupérer. Ainsi s’expliquent sans doute les résultats négatifs des
sondages en ces endroits précis. De plus, en période de réduction drastique des
budgets, pour des opérations nécessitant des moyens importants, il faudra faire
des choix. Dans ces conditions, St.-Sabin et surtout les Trois-Dents ne me
paraissent pas des priorités. Il serait à mon avis préférable de privilégier
Château Bélize et le Chirat Blanc, et je ne saurais trop inviter également les
chercheurs à s’intéresser au Moulin à Vent, un site probablement plus
prometteur que les précédents. Il ne peut pas véritablement leur être comparé
tant il en diffère, et il contribue à renouveler notablement les données disponibles
sur la préhistoire du Pilat.
Je termine ce copieux chapitre par l’évocation
d’un autre site potentiellement remparé et protohistorique du Pilat, sur une
modeste hauteur de 627 m, située à 50 m environ au-dessus de Berger-Caillat
(Roisey), et occupée par le bois
Blachemard (composé de blache, du gaulois blaca, chêne blanc,
désignant un bois, un taillis, et
souvent une terre gagnée sur un taillis, et de mard correspondant
probablement au vieux français mare, maire, maior, plus
grand, ce toponyme signifierait donc quelque chose comme Grandbois). En
contrebas de cette éminence, dans des parcelles mentionnées dans sa fiche n° 3
de Roisey par Georges Pétillon, qui y subodore un possible « habitat en
cabanes », j’avais trouvé au début des années 1970 une bola ou
balle de fronde en granit, parfaitement ronde et grosse comme une balle de
tennis. Elle gisait plus précisément au pied d’un challier, aujourd’hui
délaissé et envahi par les taillis, soutenu par un mur très épais et composé de
gros blocs en pierre sèche, correspondant sans doute à l’extension des cultures
en hauteur lors d’une période d’optimum démographique, tel celui qui a précédé
la guerre de 1914-1918. À l’époque, moi
et Pétillon n’avions pas poussé nos investigations au-delà de ces parcelles au
nord et à proximité de la route qui dessert les hameaux de Berger et de
Caillat. Or, récemment, la consultation du cadastre m’a permis de remarquer, un
peu comme au Moulin à Vent, une distribution circulaire et en éventail des
parcelles autour de cette petite hauteur. La bola pouvant relever tout
autant de la fin de la protohistoire que de la période médiévale, il en va de
même pour cette hauteur et les structures qu’elle est susceptible d’héberger.
Début novembre 2024, Philippe Monteil, habitant Roisey, s’y est rendu à ma demande
et y a procédé à quelques rapides
observations : sur la légère pente sud proche du sommet, une parcelle
grossièrement rectangulaire est occupée par un champ peut-être exploité
récemment. C’est la seule partie non boisée de cette crête, où l’on trouve
beaucoup d’aménagements murés et, sur la partie la plus haute, un soutirage
fait penser à l’intérieur d’une construction effondrée.
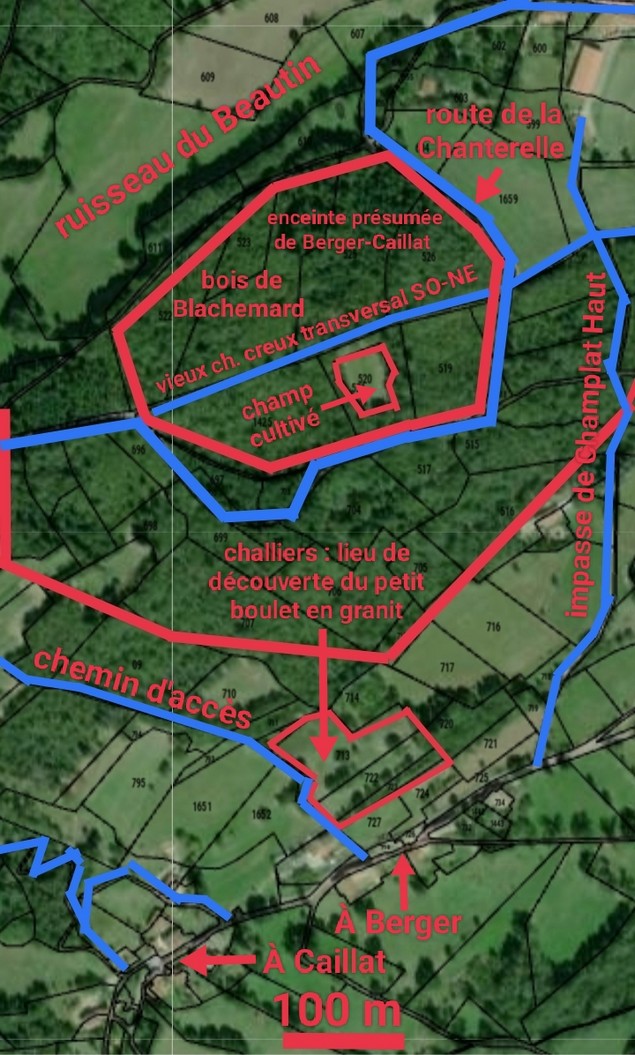
Les silex Pétillon
En 1977, Jean Combier, directeur de la
circonscription d’Archéologie Préhistorique Rhône-Alpes, dans un rapport décennal
publié dans Gallia Préhistoire, évoquant, d’après des informations
recueillies manifestement auprès de G. Pétillon, les prospections effectuées de
1971 à 1973 entre autres dans la commune de Pélussin, déclarait : « …au
sud de l’éperon du Moulin à Vent, M. D. Bonnaud a recueilli dans des
terres cultivées une industrie de silex laminaire qui comprend une quarantaine
de pièces, probablement du Paléolithique final ou de l’Épipaléolithique » («
Informations archéologiques de la circonscription Rhône-Alpes : Dix ans de
recherches préhistoriques dans la région Rhône-Alpes (1965-1975) », Gallia
Préhistoire, t. 20, fasc. 2, 1977, article Pélussin, p. 644). C’est
assurément flatteur, mais ce n’est pas exact. Il ne faut pas s’en
étonner : ces rapports, rédigés en différé et souvent dans l’urgence, ne
sont pas exempts, sinon d’importantes erreurs, d’informations très
approximatives. En réalité, si je suis bien l’inventeur du site du Moulin à
Vent, l’auteur de la découverte de ces
silex est G. Pétillon lui-même. Il suffit pour s’en assurer de consulter son
rapport de 1973, sa fiche n° 8 de Pélussin (Silex taillés du Moulin à
Vent), et son article de 1985 : « Dans les terrains cultivés, au
Sud des murailles, j’ai trouvé une assez grande quantité de silex taillés. […] On
peut les dater du Mésolithique au Chalcolithique, c’est-à-dire de la fin de
l’époque glaciaire à la découverte des métaux. Au pied des murailles, j’ai
également trouvé des fragments de céramiques qui attestent une occupation à
l’âge du Fer. C’est donc un site qui fut occupé pendant plusieurs
millénaires » (Dan l’tan, n° 6, p. 28). À cette époque, je suivais à Lyon
II les cours d’Archéologie préhistorique de Denise Philibert, décédée en 2022,
spécialiste du Mésolithique. Je lui avais donc tout naturellement soumis pour
expertise les trois planches dressées par G. Pétillon dans son rapport de 1973 pour représenter 37 des 43
silex qu’il avait recueillis. Le microlithisme de ces pièces avait
particulièrement attiré son attention, et elle y voyait une industrie
mésolithique. Toutes les bonnes expertises convergent et c’est à tort que
certains vieillissent ces outils, notamment Mme Achard-Corompt (p. 10) qui les
rattache non seulement au néolithique mais aussi au magdalénien, voire même au
moustérien. En l’attente de plus grandes précisions, la périodisation très large
adoptée par G. Pétillon dans son article de 1985 paraît recevable ; elle
recouvre toute la gamme des artefacts actuellement recueillis sur les lieux.
Je me suis toujours interrogé sur les silex
Pétillon. Je veux bien admettre que celui-ci avait la main « archéologique »
comme on dit de quelqu’un : « Il a la main verte ». Il rapporte également
que d’autres sont passés avant lui et ont fait d’amples « récoltes » à une
époque où le site n’était pourtant pas très connu et, à preuve du contraire, celles-ci n’ont guère
laissé de traces. Surtout, je m’explique
mal l’absence d’autres découvertes après lui dans les mêmes terres à la suite
des labours. Moi-même, je n’avais rien trouvé, mais peut-être n’avais-je pas
exploré la zone précise des silex Pétillon, à savoir les parcelles B 32-44,
48-53, 55-59 et 2365, toutes situées hors rempart, dans une vigne aujourd’hui
en friche (parcelles 42-44) insérée dans un rentrant de ce dernier, et dans les
champs qui s’étalent sur la légère pente du vallon jusqu’à 100-150 m environ au
sud du rempart. Des indices militent en faveur d’une taille partielle sur
place, sans que l’on puisse pour autant parler d’un atelier comme à la Font-Ria
(Saint-Genest-Malifaux), qui ne peut pas être un gisement paléolithique en
raison des conditions climatiques et de l’absence de couvert végétal à
l’époque. Comme l’établit Vincent Georges, « des phases érosives majeures
auraient envoyé bien au-delà de la dénivellation la plus abrupte les éventuels
vestiges paléolithiques du gisement dont la situation est celle d’une pente
abrupte immédiatement sous un replat » (Vincent Georges, Le Forez du 6ème
au 1er millénaire av. J.-C. Territoires, identités et stratégies des
sociétés humaines du Massif central dans le bassin amont de la Loire (France),
Thèse Université de Bourgogne, 2007, vol. 2-Corpus, Item 554.
Saint-Genest-Malifaux, Bois Farost La Font Ria, p. 224).
Les silex Pétillon, conjointement avec le
matériel archéologique des Blaches à St.-Appolinard, sont actuellement égarés
et les tentatives pour les retrouver ont toutes échouées. C’est d’ailleurs dans
ce but que Philippe Monteil et Thierry Rollat de Regards du Pilat ont
enquêté, et que Thierry, il y aura bientôt quatre ans, a retrouvé ma trace. Dans
une lettre de 2021 adressée à l’une de mes nièces, le motif principal de sa demande portait clairement sur cette quête des silex taillés. Je n’ai pu lui
donner satisfaction, mais Philippe Monteil,
seul ou récemment en ma compagnie, muni des trois planches de dessins
laissées par G. Pétillon, a exploré sans succès diverses pistes. Le plus
curieux dans cette affaire est que, même des personnes ayant travaillé pour le
Parc, qui devraient être mieux informées, n’ont aucune idée de ce que ces silex
sont devenus. J’ai bien connu G. Pétillon, avec lequel j’entretenais les
meilleurs rapports. C’était quelqu’un de rigoureux et de méthodique. Il n’a pu
laisser ces silex sans une signalétique précise. Reste la possibilité de leur
versement par le PNR du Pilat, en définitive seul responsable de leur devenir, au SRA, dont le
dépôt de Villeurbanne est actuellement fermé pour travaux. Mais la difficulté
d’obtenir des informations, tant du Parc que du SRA, constituent des
aberrations administratives.
Dans son rapport de 1973, G. Pétillon a procédé
à l’identification des 43 silex qu’il a récoltés et dessiné 37 d’entre eux :
• 5 petits disques très retouchés 1-5
• 1 biface cassé récemment 6
• 3 pointes moyennes présentant des cassures
anciennes 7-9, le 18 serait peut-être à ranger dans la même catégorie
• 4 petites pointes 10-13, le 19 à cassure
ancienne était sans doute de même facture
• 3 petits grattoirs très retouchés 14-16
• 1 petit rabot caréné 17
• 17 lames tronquées la moitié avec retouches
abruptes 20-36
• 1 grattoir plus épais, avec cassure récente
et cortex sur la droite 37
• 1 petit nucleus 38
• 5 éclats non retouchés 39-43
Ajoutons pour mémoire : 7 tessons de
céramique grise fine aux formes non identifiables, 6 tessons de céramique jaune
ou rouge, 1 morceau de galet de serpentine ( ? en fait roche verte) percé,
peut-être une fusaïole, 1 rectangle de plomb (3,5x5x0,5 cm) très oxydé, percé
au centre et strié sur les deux faces.
Mais ce descriptif mérite d’être un peu
révisé : l’industrie est essentiellement laminaire ; les petits
disques très retouchés 1-5 seraient plutôt des grattoirs (pièce 1, grattoir à
encoches, et 3-4) à ajouter aux pièces 14-16, un outil peut-être mixte,
grattoir et perçoir (pièce 2) et un racloir ? (pièce 5) ; je ne me
prononce pas pour les pièces 6, 9 et 19 trop amputées, de même pour 37 en
laquelle j’ai du mal à voir un grattoir ; les pièces 7 (du genre bec),
10-13 et 18, sont effectivement des pointes ou perçoirs, auxquelles il faut
sans doute ajouter la pièce 33 ; 8 est plutôt une armature foliacée
amygdaloïde à base convexe ; je ne sais pas si la pièce 17 carénée est un « rabot ».
En résumé :
• lames tronquées : 16 pièces (20-32 et
34-36) dont un certain nombre sont peut-être des grattoirs ou racloirs,
43% ? (pourcentage hors nucleus et éclats).
• pointes ou perçoirs : 8 dont une pièce
mixte (pièce 2, les autres étant 7, 10-13, 18 et 33), 22%.
• grattoirs liés au traitement des peaux :
6 (pièces 1, 3-4, 14-16), 16% ?.
• racloirs ? : 1 (pièce 5).
• armatures foliacées : 1 (pièce 8).
• pièces carénées : 1 (pièce 17).
• indéterminés : 4 (6, 9, 19 et 37).
• nucleus : 1 (pièce 38).
• rebuts de taille, éclats : 5 (pièces 39-43).
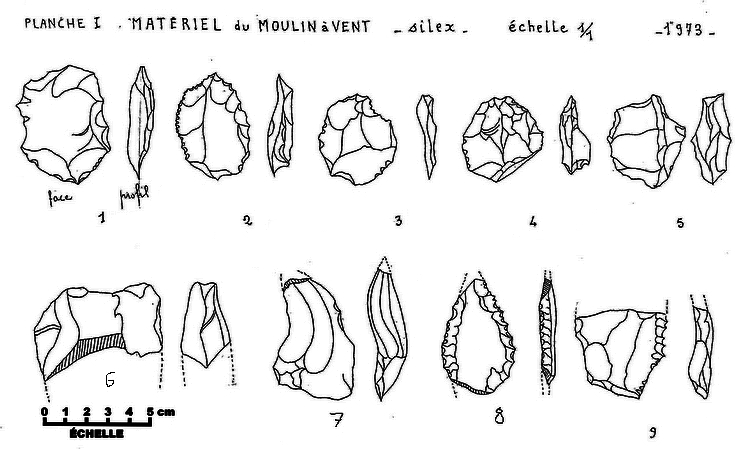
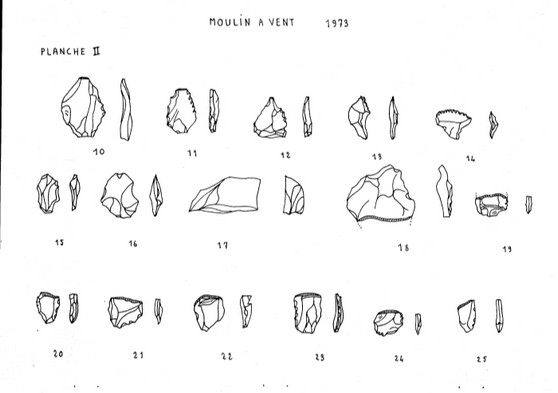
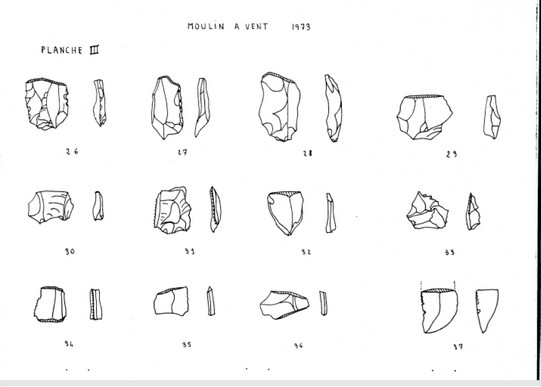
Pointes de flèches et outil néolithiques
Dans les années 2000, à l’occasion de
découvertes fortuites, ont été recueillis non plus à l’extérieur du site, mais
à l’intérieur ( ?), quelques
éclats, une lame en chaille ferrugineuse, peut-être cévenole, couleur blond
roux ou miel clair et à retouches unifaciales, une hachette néolithique, et des
pointes de flèches microlithes. Toutes ces pièces sont actuellement détenues
par Jacques Patard, qui n’en est pas pour autant l’inventeur. Au demeurant,
elles ont légalement vocation à rejoindre des collections publiques (loi du 7
juillet 2016). Les circonstances non encore élucidées de leur découverte impose
toutefois pour le moment une certaine réserve. En effet, Philippe Monteil
rapporte l’avis du préhistorien Robin Furestier selon lequel ces pointes
proviendraient d’Afrique du Nord. Il n’a jamais vu de pointes de ce type dans
le sud-est de la France sur des niveaux de fouille du Néolithique, la période
explorée plus particulièrement par cet archéologue professionnel. En ce cas, il
y aurait supercherie. Pour sa part, Vincent Georges ne semble pas aussi
dubitatif. Une enquête devrait apporter des précisions. Elle permettrait entre
autres, si la découverte est authentique et si les cassures de certaines
armatures sont rituelles, de repérer le lieu exact, information essentielle car
il pourrait correspondre à une aire sépulcrale. Ceci fait beaucoup de
conditionnel. Néanmoins et dans l’attente, il est permis d’émettre quelques
hypothèses : la chronologie de ces pointes pourrait aller du
Chalcolithique Campaniforme au Bronze récent. Les pièces 2, et
vraisemblablement 3 et 4 ne sont pas des pointes de flèche, mais seul 2 d’un
brun tirant sur le roux, donc avec un
apport ferrugineux, est clairement un rebut de taille, sur lequel on distingue
nettement les cercles concentriques dus à une onde de percussion. Son origine
est vraisemblablement la même que celle de la lame de poignard, à savoir le
silex Turonien du Grand Pressigny, et 4 et 8 en proviennent peut-être aussi. 1
pourrait être de l’obsidienne. On en trouve dans toutes les régions volcaniques
françaises, particulièrement et surtout dans l’Auvergne et le Velay tout
proches. J’hésite à voir dans 3 et 7 de
l’ambre, un matériau qui voyageait déjà beaucoup depuis la Baltique, car ce
n’est pas une roche assez dure pour la taille d’outils ou d’armatures :
2,5/10 sur l’échelle de dureté de Mohs, 10 correspondant au diamant. D’autres
matériaux sont tout aussi difficiles à identifier, surtout de visu, mais, de
toute évidence, ces pointes sont taillées dans une grande variété de roches,
certaines assez rares. Même si une assez grande diversité des matériaux est en
général plutôt bien attestée au Campaniforme, ceci induirait des relations et
des échanges à longue distance et confirmerait l’importance du site. Pour les
armatures proprement dites, 1, 6, 10 et 15 seraient les formes les plus
anciennes datables du Campaniforme. Ce sont des pointes triangulaires plus ou
moins symétriques à ailerons peu dégagés, aux bords souvent denticulés et à
base concave ; 8 et 12, avec leur forme légèrement ogivale traduiraient
une évolution vers le Bronze ancien ; mais la majorité, soit 5, 7, 9, 11,
13, 14 et 16, serait surtout du Bronze final. Ce sont des pointes à ailerons
obliques nettement marqués, à bords le plus souvent rectilignes, très allongés
et peu denticulés. Leurs bases sont toutes concaves, mais 17 qui pourrait aussi
en faire partie est la seule pièce dont la base est droite, quasi rectiligne.
L’absence de pédoncules intrigue, mais les cassures pourraient être, au moins
partiellement, à l’origine de leur
disparition. Ces caractéristiques typologiques seraient celles d’une industrie
des plus tardives. Pour sa part, la hachette néolithique milite plutôt en
faveur de l’authenticité de ces découvertes tant sa couleur verdâtre la rapproche des quatre autres connues du
versant rhodanien du Pilat, que j’avais découvertes ou étudiées au début des
années 1970, l’une provenant de La Branche à St.-Appolinard (en dépôt à la
mairie), une autre du Perret à Pélussin, et les deux dernières d’un secteur
privilégié pour ce type de trouvailles, c’est-à-dire entre la Chaize et la
Tronchiat, ce dernier lieu à cheval sur Bessey et Roisey. Tous deux sont
proches du Moulin à Vent. Toutes ces haches en roche verte passaient pour des
serpentinites. Telle était l’opinion que
j’exprimais alors dans un article du GRAL consacré à deux d’entre elles, celle
de St.-Appolinard et celle du Perret (D. Bonnaud (GAFJ, section
Forez-Viennois), « Découvertes fortuites de haches polies en serpentine dans le
canton de Pélussin », Bulletin du Groupe de Recherches Archéologiques du
département de la Loire (GRAL), 1971-1972, 1973, p. 19-21+1 fig.), une opinion
partagée plus longtemps encore par G. Pétillon dans ses fiches. Nous y
souscrivions d’autant plus volontiers qu’à la Tronchiat se trouvent des
affleurements locaux de serpentine. Mais les travaux d’une étudiante en
maîtrise, Annie Masson, autrice d’une recherche pionnière, parue en 1977, ont
finalement infirmé cette croyance erronée. Dès 1974, je parlais non plus de serpentines
mais de jadéitites (Fenêtre ouverte sur le Haut-Vivarais, p. 103), ce
qui prouve que j’étais déjà entré en relation avec elle et c’est par mon
truchement qu’elle put analyser les haches du versant rhodanien, outre une
cinquième en fibrolite trouvée à Roche-la-Molière sur le versant forézien, et
elle identifia toutes celles du versant sud au groupe des jadéitites d’origine
alpine sous forme de galets charriés par les cours d’eau, et non à celui des
serpentinites d’origine locale comme on l’avait cru jusque là (A. Masson, Étude
pétrographique des haches polies du Forez, mémoire de maîtrise dactylographié
d’archéologie préhistorique Lyon II, 1977, p. 52, item 27, p. 55-56, item 126,
127 et 128, et p. 59, item 158, fig. 9 pour les items 126 et 128). Il existe
bien entendu des exceptions, mais la serpentine n’est pas assez dure pour y
confectionner des outils : indice de 2,5 à 3/10, à peine plus que l’ambre,
contre 6,5/10 pour la jadéite. La difficulté de travailler la jadéite a
d’ailleurs conduit les chercheurs à penser que la plupart des hachettes de ce
type n’étaient pas utilitaires, mais représentaient une forme de monnaie ou
étaient destinées à des échanges de dons du genre potlatch. La minuscule
hachette de la Tronchiat, semblable à un jouet d’enfant sans usage pratique,
tend à confirmer cette interprétation. Enfin, et je m’adresse à ceux qui
veulent voir du mégalithisme en des lieux improbables du Pilat où n’ont jamais
été découverts le moindre silex et la moindre hache polie, c’est plutôt ici sur
le piedmont, et particulièrement dans ce secteur entre Pélussin, Bessey et
Roisey, où la plus grande densité de ces objets ont été recueillis, qu’un
mégalithisme est susceptible de se trouver ou de s’y être trouvé. Les traces
éventuelles ont été éliminées par les activités agraires et les labours
profonds.


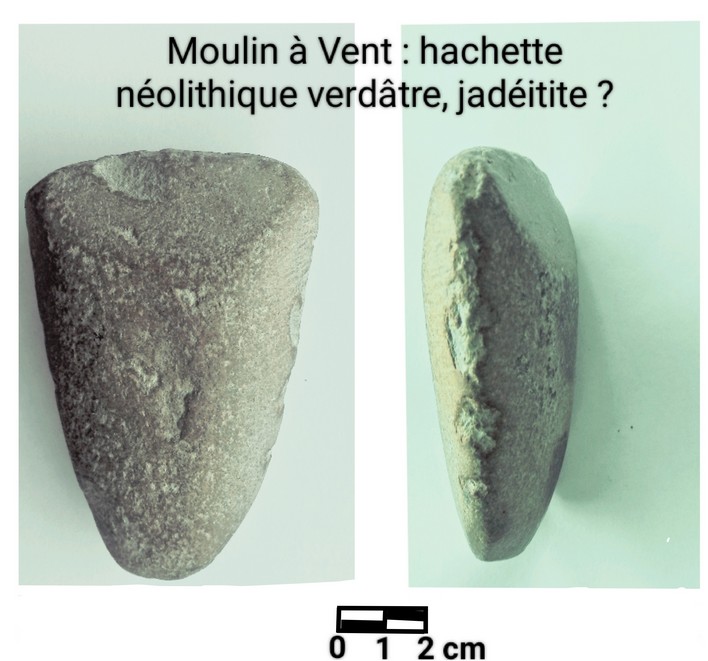
Ébauche de chronologie
En l’état actuel des trouvailles disponibles et
des connaissances que nous en avons, il est permis d’esquisser une synthèse
provisoire, rapide et schématique de l’occupation au Moulin à Vent : à une
phase mésolithique, identifiée en direction du vallon par les silex Pétillon,
aurait succédé, cette fois à l’intérieur du périmètre délimité par les murs, un
Néolithique moyen de type chasséen évolué s’épanouissant jusqu’au Chalcolithique,
comme le faciès de Fontbouisse, avec lequel il pourrait avoir des affinités au
moins partielles. La grande difficulté est de dater l’enceinte et l’habitat.
Elle pourrait bien remonter à ce chalcolithique, sans exclure des remaniements
ultérieurs. En effet, les quelques fragments de céramique mentionnés par G.
Pétillon, aussi insuffisants que soient encore ces indices, tendent à attester
d’une occupation des lieux poursuivie de façon plus ou moins continue sur
plusieurs périodes, à l’âge des métaux et jusqu’à la fin de l’indépendance
gauloise, avec persistance ou non d’influences méridionales soupçonnées, qu’ont
pu entretenir le tropisme méditerranéen et massaliote. Toutes ces hypothèses et
celles formulées précédemment restent à vérifier. Pour le moment, il est
impossible de dire ce qui est vraiment ancien dans les différentes murailles du
Moulin à Vent, mais ce qui a été trouvé tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de
l’enceinte, et pas seulement par G. Pétillon, ne laisse aucun doute sur
l’ancienneté d’une partie au moins de ces structures et sur leur intérêt.
Un site prometteur mais menacé. Appel à des
fouilles encadrées
Aujourd’hui, je suis plus que jamais persuadé
du grand intérêt du site et conscient des menaces qui pèsent sur lui : déjà
en 1985, G. Pétillon rapportait que des enfants venant jouer sur les lieux avaient
complètement démoli une « chibotte » incluse dans le rempart sud le
plus épais, partiellement enterrée, voûtée en encorbellement et équipée d’un
foyer avec cheminée débouchant sur le toit et de deux niches murales. Par comparaison
avec d’autres exemples en d’autres régions, son usage était probablement viticole.
C’est soit un aménagement relativement récent dans le vieux rempart, soit la
réutilisation d’une structure préexistante, mais on voit mal pourquoi des «
guérites » auraient été aménagées sur la face externe du rempart. Elle était
encore en partie debout au début des années 1970 (Dan l’tan, n° 6, p. 28).
Il en subsiste une autre. Mais, peu après, dans sa fiche n° 7 de Pélussin, G.
Pétillon constatait que les enfants continuaient à endommager les murs et, si
rien n’est fait, il sera impossible d’empêcher à l’avenir des fouilles
clandestines qui ont déjà eu lieu dans le passé. Dans un registre plus
optimiste, notons toutefois que le couvert végétal envahissant, notamment dans
la vigne abandonnée où ont été trouvés la plupart des silex Pétillon, contribue
à une relative protection des lieux. Quoiqu’il en soit, le temps est venu pour
les autorités locales et les archéologues professionnels de s’intéresser enfin
au Moulin à Vent, le site probablement le plus intéressant et le plus
prometteur du Pilat. Le Lidar peut apporter de nouvelles informations, mais il
a ses limites et ne pourra donner les réponses que l’on peut attendre seulement
de fouilles sérieuses. Depuis plus d’un demi-siècle que le Moulin à Vent est
maintenant connu, c’est en effet le moment d’envisager les prospections
indispensables et trop longtemps souhaitées.
***************************
***************
Annexe – Répartition de l’estampille CLARIANA sur la rive droite
du Rhône. UN EXEMPLE DU DÉSINTÉRÊT DES
ARCHÉOLOGUES POUR LA RÉGION DU PILAT ET SES CONSÉQUENCES POUR LA
RECHERCHE.
La tuilerie-briqueterie Clariana, dont les
produits ont été largement diffusés, a connu une période d’activité globalement
comprise entre l’époque d’Hadrien (117-+ 138) et la fin du IIe siècle, avec
apogée au milieu du siècle. Sa localisation n’est pas formellement établie : en 1888,
l’archéologue allemand Gustav Hirschfeld (CIL XII, Inscriptiones Galliae
Narbonensis Latinae, 1888, p. 683), suivi en 1906 par Joseph Déchelette («
Les antéfixes céramiques de fabrique gallo-romaine », Bulletin archéologique
du comité des travaux historiques et scientifiques, 1906, p. 40-41),
l’avait associée à la station Figlinis de la Table de Peutinger, à 17
milles/25 km au sud de Vienne, quelle
que soit la localisation de cette dernière, celle du baron Walckenaer ou de
nombreuses autres. De tout aussi nombreux candidats ont d’ailleurs été proposés
pour la fabrique : de la Provence, région de Vaison avec de bien faibles
preuves, au Lyonnais, en passant par les régions alpines, Gapençais, Dévoluy,
pays voconce (Drôme). Toutes hypothèses singulièrement à l’écart de la première station du sud de
Vienne et de l’idée première d’Hirschfeld, vers laquelle les chercheurs sont
revenus en s’accordant aujourd’hui, en raison de sérieux indices, pour la
région de Vienne. La répartition des estampilles CLARIANA
particulièrement abondantes au sud du chef-lieu des Allobroges, conforte
l’hypothèse et, en 1968, Marcel Leglay, alors directeur de la circonscription
Rhône-Alpes des Antiquités historiques, avançait la proposition la plus
probante : St.-Clair-du-Rhône à quinze kilomètres au sud de Vienne, parce
que le lieu-dit et site de Clarasson y cumule concordance toponymique et
présence d’abondantes carrières de glaise. En fait, le problème est plus
complexe, car, outre l’estampille Clariana, il existe celle de Clarianus
qui présente elle-même des variantes, de sorte que l’on tend aujourd’hui à
privilégier l’existence non pas d’une, mais de deux, voire plusieurs officines.
Quant à la répartition de l’estampille toutes variantes confondues, les spécialistes
avaient remarqué sa quasi absence sur la rive droite du Rhône où elle était
censée représentée par un seul site : St.-Paulien/Ruessio
(Hte.-Loire), qu’ils mettaient d’ailleurs en doute au prétexte que le lieu de
découverte n’était pas bien assuré. C’est en fait une estampille Clarianus
(Clarian), donc différente d’une estampille Clariana découverte
en février 1973, rive droite du Rhône précisément, à St.-Appolinard (Loire).
Là, au nord du chemin des Châtaigniers qui,
correspondant probablement au tracé de l’ancienne voie du Tracol, à partir de
Choron, suit en parallèle l’actuelle D503, précisément aux Blaches (blache,
bois, taillis et souvent terre gagnée
sur un taillis), dans la parcelle B513, proche de la station d’épuration et de
l’usine Justin Bridou, un cultivateur avait effectué un labour profond pour la
plantation d’une vigne. Ce défoncement avait fait remonter de la tegula.
Albert Epinat, directeur du collège Gaston Baty de Pélussin, et une équipe de
la MJC, dont j’étais, lors d’un rapide sondage gêné par la neige et les
intempéries, creusèrent une tranchée à travers les 100 m² contenant les tegulae
jusqu’au socle rocheux à 0,60 m de profondeur où reposait une épaisse couche de
cendres et charbons de bois issus de fagots et rondins. Ces fouilles ont donné,
outre les vestiges habituels (fragments de tegulae et d’imbrex,
scories de métallurgie, et de plus rares débris de cornue en terre cuite avec
des scories vitrifiées adhérentes), une
fusaïole en terre cuite, un morceau de meule à main en lave caverneuse typique
du monde romain, une tegula entière estampillée CLARIANA, et un
col d’amphore tronqué portant selon Pétillon la marque PNV ou PNW, une mauvaise
lecture en fait pour PNN selon une correction que j’ai effectuée
récemment (amphore Dressel 20, Bétique, description : lèvre aplatie et
gorge interne profonde, anses massives à section ronde et panse globuleuse à
fond pointu). La fiche rédigée par Pétillon atteste que ces objets se
trouvaient en ma possession, mais la tuile et l’estampille d’amphore, restées
dans la maison familiale après mon départ de Pélussin, lui ont sans doute alors
été confiées, et leur pseudo disparition serait liée à celle de ses silex,
autrement dit ils se trouveraient dans un dépôt régional du SRA. Quant à la
qualification du site, il ne s’agit pas d’un four de potier vu la rareté des
tessons de poterie, mais vraisemblablement d’un petit établissement rural voué,
exclusivement ou non, à la fonderie du plomb, le secteur étant riche en filons
de galène. En croisant les datations disponibles des estampilles, on peut fixer
sa période d’activité à la deuxième moitié du IIe siècle de notre ère. Et G.
Pétillon a vu dans une excavation au nord de la parcelle, près du chemin de
terre, ce qui lui semblait le départ d’une galerie de mine (Dominique Bonnaud, Fenêtre
ouverte sur le Haut-Vivarais, op. cité, p. 105 ; Parc Naturel Régional
du Pilat [G. Pétillon], 1973 – Campagne archéologique. Rapport de sondage et
fouille de sauvetage des Blaches (St.-Appolinard) ; G. Pétillon, sd,
fiche n° 2 de St.-Appolinard, Fonderie de plomb gallo-romaine de La Blache.
Dans cette fiche, Georges Pétillon dit à tort la Blache, source de confusion
avec un autre lieu-dit de la commune voisine de Maclas). Le plomb étant source
de pollution, il est possible que le sol
ait été ici contaminé de longue date. En effet, la vigne plantée n’a pas duré
et la parcelle est aujourd’hui de nouveau en friche.
Au moins à partir de 1997, les spécialistes
avaient la possibilité de dissiper leurs doutes en mentionnant l’estampille de
St.-Appolinard. En effet, à cette date, le fascicule de la Loire de la Carte
archéologique de la Gaule l’avait portée à la connaissance de la communauté
scientifique (Marie-Odile Lavendhomme, 1997, p. 186). Or, en 1999, Alain Bouet,
dans une étude où il fixait la limite occidentale de la zone de répartition de
l’estampille à Gravières (Ardèche), ce qui présentait déjà une contradiction dans
la mesure où cette localité se trouve sur la rive droite, à proximité de la
vallée du Rhône il est vrai, il ignorait l’existence de celle de
St.-Appolinard, un exemple parmi d’autres du désintérêt et de la méconnaissance
du Pilat par les archéologues, qui conduit à s’interroger sur le sérieux de
travaux scientifiques et à remettre en cause la validité des conclusions de
certaines recherches (Alain Bouet, Les matériaux de construction en terre
cuite dans les thermes de la Gaule Narbonnaise, Ausonius, 1999, p.
183-186). En revanche, elle n’a pas échappé à Mme Caroline Chamoux dans son
mémoire de master 2 en histoire et archéologie des mondes anciens sur Les
estampilles sur matériaux de construction en terre cuite gallo-romains en
Rhône-Alpes, présenté en 2010 à l’Université Lyon II (non édité, item
42.TXT.001. Mentionnons aussi les dernières références sur le sujet accessibles
en ligne : Jean-Claude Béal, Caroline Chamoux et Anne Schmitt, «
CLARIANUS, VIRIORUM et les autres : premières remarques sur le corpus des
briques et tuiles gallo-romaines marquées de la région Rhône-Alpes », in Anne
Baud et Gérard Charpentier (éd.), Chantiers et matériaux de construction de
l’Antiquité à la Révolution industrielle en Orient et en Occident, Actes du
colloque tenu au château de Guédelon (23-25 septembre 2015), MOM Éditions,
2020, p. 29-51, carte p. 36, https://books.openedition.org/momeditions/9772 ; Jean-Claude Béal, « À propos de la datation des marques du
groupe de Clarianus sur les terres cuites architecturales antiques », in A.
Borlenghi et C. Coquidé (dir.), Les aqueducs romains de Lyon et
d’ailleurs : nouveaux repères, Gallia Archéologie des Gaules, 80-1,
2023, p. 321-326, https://journals.openedition.org/gallia/8610. Bien entendu, l’omission d’Alain Bouet et ses conséquences ne
présument en rien de la qualité de ses autres travaux et publications et, à la
suite des informations que j’ai pu lui communiquer, il a retiré la publication
fautive dont il avait mis une version en ligne.

Amphore Dressel 20