
Ca ne vaut pas un clou ?
Les Pierres à clous, la clouterie petite métallurgie de nos campagnes |
Présenté
par
Rémy Robert |

|
Mars
2024 |
Il
semblerait que dans le comptage primitif, les Sumériens utilisaient comme
symbole d'unité le clou pour le "rien". Cela aurait précédé le zéro.
Ainsi, deux clous inclinés vers la gauche le représentaient. De là, viendrait
l'expression "des clous", pour signifier qu’une chose n’a que peu de
valeur.
C'est
un autre sujet qui nous amène aujourd'hui à parler de clous. La présence de
pierres curieuses dans notre beau pays de Jarez.

Pierre
à clous à l’entrée d’une ferme (La Carrérarie, Farnay)
Ces
éléments supportant les petites enclumes et matrices des cloutiers sont, la
plupart du temps, fabriqués dans un bloc de granite du pays (on trouve aussi un
billot de bois dense, résistant et ceinturé en haut et en bas par un cercle
métallique à la manière d’une roue de char). Lourdes rondes ou carrées leur
taille varie de 60cm à 1 mètre de large par 40-80 cm de hauteur.

Billot
de bois et matrices

Pierre à clous à l’entrée d’une ferme à La Micale (Rive-de-Gier) :
Trous pour matrices. Empreinte laissée par le dépôt du marteau.

Pierre à clous avec ses éléments

(et druide du
Pilat Saint-Just en-Doizieux)
Le cloutier « urbain »
Cloutier
fut un métier. C’était celui qui fabriquait et vendait des clous. Il les
façonnait à la main dans une petite forge. Du XVIème au XVIIIème siècle
on disait alors « clotier ». Ce métier fait partie du patrimoine et
de l'histoire du pays du Gier. Saint-Chamond et Firminy furent des villes où il
y avait beaucoup de cloutiers et on dénombrait 6000 cloutiers en 1841 à
Saint-Chamond et 200 forges à Saint-Martin la plaine en 1880.
Les étapes de fabrication
Le
fer utilisé était fourni sous forme de longues tringles de différents calibres,
le clou était fait à partir de fer doux exempt de carbone pour être souple et
non cassant au modelage, puis à l’utilisation. Ainsi, après avoir fait chauffer
une tige en fer doux, le cloutier martelait les quatre côtés de l'extrémité
alors ramollie pour façonner une pointe. Cette extrémité était réchauffée, puis
la tige était coupée à la longueur désirée.
Dans
un second temps, le cloutier insérait le clou encore chaud dans une matrice
dite cloutière pour façonner la tête. La matrice pouvait alors avoir plusieurs
formes et tailles.
Ainsi,
selon l'utilisation attendue, des clous de plusieurs formes et tailles
pouvaient être fabriquées : pour les toitures, les charrettes, la
menuiserie, les navires mais aussi pour les fers à chevaux et à bœufs. Mais le
cloutier fabriquait également d'autres petites pièces de métal telles que des
pinces ou des crochets, des hampes et autres fixations pour la marine à voile.
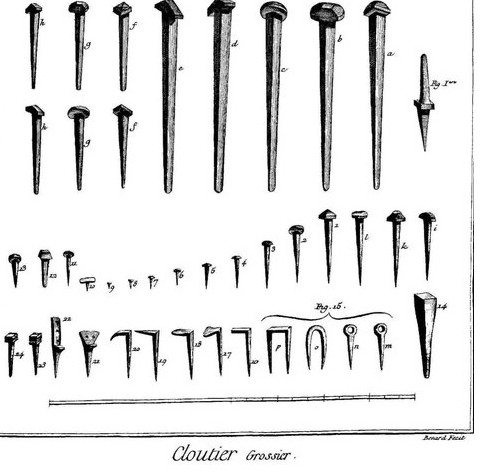
Du cloutier au paysan cloutier
-
Comment expliquer l'apparition de la fabrication des
clous par les paysans ?
-
Quel lien avec nos fermes isolées dans nos hameaux et
coins reculés de campagne ?
Les
paysans vont exercer cette activité comme un second métier dans les périodes de
l'année où l'activité était réduite : temps froid, hivers enneigés. Il
fallait bien gagner sa vie. Des colporteurs livraient des baguettes en automne,
passaient commande puis récupéraient le travail au printemps. Le cloutier était
alors payé en fonction de la quantité produite. Ce sont dans les terres les
plus inadaptées aux cultures que l'on trouve des lieux de production. Ce
travail resta un travail dans l'ombre. Ce cumul de la petite culture et de la
petite industrie, cette juxtaposition du champs-Jardin et du petit atelier fut
une solution adoptée par nos paysans pour répondre à la pénurie de ressource de
nos campagnes et aux hivers rigoureux. Cette petite métallurgie apportant alors
son appoint aux ressources rurales, elle apportera, plus tard, une main d'œuvre
à la grande métallurgie. Les paysans du Jarez étaient « nés avec un
marteau à la main » associant les traditions indigènes au caractère
moderne de l'industrie.
Ainsi
naquit une industrie, certes modeste, mais qui est certainement la plus
ancienne de notre région. Ce sont peut-être les Chartreux de Sainte-Croix-en-Jarez,
maîtres forgerons (qui ont, entre autres, réalisé, de belles croix dont
certaines, du XVIème siècle, sont encore
visibles), qui auraient transmis, aux habitants, les rudiments de l’art de la
forge ? Exercice qui fut repris par des gens à qui le dur travail de
défrichement, l'élevage, les cultures peu rémunératrices ne pouvaient que
procurer une pénible et médiocre existence. Cette activité semble également être
fortement liée à la présence et l'exploitation du charbon qui favorisera
l’implantation de forges puis, plus tard, propulsera les aciéries et
l'industrialisation de la vallée.
Le
forgeage des clous fut donc, à la fois, une ressource nouvelle et une
occupation pour les longues journées d'hiver ; l'homme ayant besoin de
travailler durant les saisons d'inaction forcée. Imaginons le bruit des marteaux
signalant ces hommes au travail invisible. L'été l'homme s'employait à
l'agriculture, l'hiver ramenait son marteau à la pierre à clous.
Le
cloutier n'était pas son patron, il n'achetait pas son fer lui-même et ne
vendait pas ses clous. Le véritable patron était un intermédiaire, un
fabriquant et un commerçant payait au cloutier sa main d'œuvre son travail, le
contrat verbal devait être scrupuleusement respecté. Le cloutier reste un
ouvrier à domicile, penché sur sa pierre à clous de l'aube au soir éclairé par
la lueur du foyer.
L'atelier
extérieur était souvent adossé à la maison d'habitation avec des murs en pierre
de schiste abrité par des poutres grossières et des tuiles réemployées, dans un
coin se trouvait une cheminée, un pan de mur était ouvert servant à la fois
d'éclairage à l'aération et au tirage du petit feu de forge. Une baguette
chauffait, une autre était forgée : en quelques coups de marteaux, la
pointe était faite puis sur un ciseau d'acier le clou était coupé à la longueur
désirée. Ensuite on le mettait dans la cloutière : bloc d'acier percé d'un
trou pour ménager la pointe les têtes rectangulaires étaient généralement
forgées à la main, pour les autres une matrice devait être nécessaire (pièce en
fer portant à son extrémité le forme en acier de la tête du clou) ou une lourde
masse de fer recevant la matrice tel un petit marteau pilon de conception très
simple.
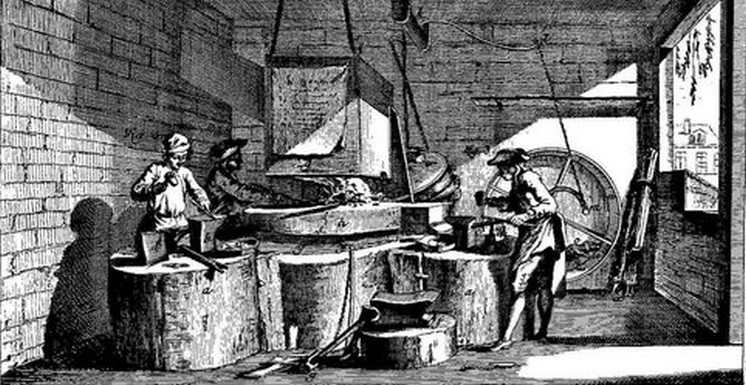
Le
feu de forge était activé par un soufflet. Le matériel était sommaire les
gestes simples mais l'adresse et une longue habitude étaient nécessaires et
chaque geste répété pour chaque clou avait une grande valeur
Il
m’a été dit qu'un bon cloutier faisait un clou en 4 étapes : le temps de
prononcer « Jésus, Joseph, Marie, Amen ». Plus sérieusement on
retient le nombre de 14 coups pour un clou, ne frapper que 9 coups pour un clou
ou faire 3 clous d'une chaude (sans réchauffer) étaient considérés comme des
prouesses.
La production
Le
XIXème siècle correspond au moment de la grande production
manuelle.
On
dit qu'un bon cloutier faisait 2500 clous soit 18 livres par jours. Nous
pouvons estimer le nombre de 6 000 cloutiers dans la région pendant l'hiver qui
pouvaient faire jusqu’à 100 clous à l’heure. Cela en faisait des clous !
La fin, la suite
L'apparition
des machines-outils transformera totalement l'industrie cloutière avec un
rythme de production beaucoup plus rapide produisant jusqu'à 50 fois plus qu'un
bon ouvrier cloutier. Vers 1840 la machine a pris peu à peu la place du
cloutier à domicile, de plus les lois sur les concessions minières vont rendre
plus difficile l'exploitation individuelle du charbon.
L’apparition
du chemin de fer apportera plus rapidement les matières premières et expédiera
partout la production. Le cloutier deviendra ouvrier de « fabrique »,
d’usine. Apportant une main d'œuvre aux nouvelles industries et certainement sa
capacité de travail de production et de savoir-faire Mais il restera souvent
paysan : je me souviens encore, dans mon enfance, de paysans associant
journées d'usine en 3/8, élevage et culture. Les temps de récoltes ou des foins
se faisant dans des périodes d'arrêt maladie généreux.
Il
semblerait néanmoins, que la clouterie à main a quelque peu perdurée et ce
encore au XXème siècle pour des clous spéciaux et de gros modèles que
les machines de l'époque ne permettaient pas de façonner. De plus, les produits
mécaniques étaient de moindre qualité les clous forgés à la main avait une
surface irrégulière et donc plus d'adhérence, d'autre part, sa pointe était effilée
régulièrement ce que ne permettait pas la machine.
Encore
au début du XXème siècle la cordonnerie de haute qualité n'utilisait
que des clous forgés à la main. Et...étonnement entre 1944 et 1950 à Saint-Just-en-Doizieux
l'activité connue une reprise. Cela fut temporaire répondant à une pénurie liée
aux bombardements d’usines de la fin de la seconde guerre mondiale.
Certaines
pierres comportent des initiales, des gravures des signes religieux, l'une
d'elle trouvée dans le Rhône et dite « pierre du Dragon (peut être en
référence aux dragons Napoléoniens qui forgeaient des clous), comporterait le
dessin d’une marguerite et un texte « entre
ici sans y faire tort ». Enfin de nombreuses pierres à clous conservent
une dépression correspondant à l’emplacement ou était posé le marteau et qui a
fait empreinte.
On
en trouve en moindre proportion dans les monts du Lyonnais, le Pilat, l’Ondaine,
à Saint-Héand mais également dans d'autres régions comme dans le département du
Lot, en Bretagne à Paimpont (où chaque début juillet se déroule la fête du fer).
Là encore l'activité était sur le même principe, les paysans travaillaient
l'hiver. Mais il semble que dans ces régions on ne retrouve pas, aujourd’hui,
autant de pierres que dans le Jarez.
De
nos jours, à Saint-Martin-La-Plaine : la fête de la forge (qui se tient
chaque année, mi-mai), et la Mourine (maison des forgerons et musée) témoignent
de cette activité passée.
Le métier de forgeron est difficile, le
mal de dos est fréquent, la poussière du charbon provoquant souvent à terme des
emphysèmes pulmonaires.

Le clou du spectacle Jean-Luc
« Jean du clou » au travail : https://www.youtube.com/watch?v=gPg7OAXS7I8