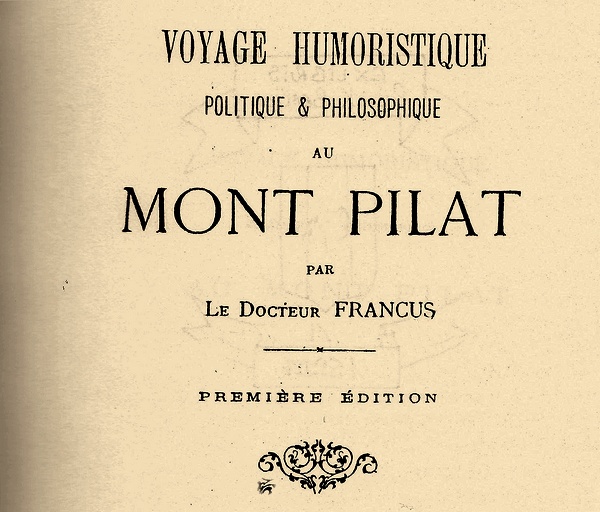“La
maison des fées”, voilà quatre mots qui tintent à nos oreilles comme
une merveilleuse histoire pleine de beauté et de poésie, d’un parfum de
légende qui nous font aimer le lieu avant de le connaître. Nous pensons
aux contes de notre enfance, ceux de Perrault ou ceux d’Andersen, et
nous avons douce souvenance de “Bonne Biche” et “Beau Minon”, mais
qu’en est-il exactement ? La Maison des fées est un site légendaire du
massif du Pilat, sur le territoire de la commune de Doizieux. Le
premier à en parler est Jean du Choul, le plus ancien “historien” du
Pilat qui écrivait au XVIème siècle. Evidemment cette maison n’abrite,
n’abritait , aucune fées. Nous n’y trouverons ni Mélusine ni Morgan et
si on pouvait y trouver une clochette, ce n’était pas la fée , mais
simplement la petite fleur d’une herbe folle. Son histoire n’est pas
non plus un conte de fée, bien au contraire, puisqu’elle nous conduit
des fastes de son origine à des ruines amenant des peurs et des pleurs.
:
Jean du Choul écrit :<<
Aujourd’hui encore existe la “maison des fées” qui a conservé l’ancien
nom de “maison des Fages”. C’est, à mon avis, un palais fort ancien,
situé à environ cinq milles de la forêt. Ses ruines en deuil attestent
assez quelles furent la magnificence et la somptuosité de ce vaste
édifice. Des Lémures nocturnes ont longtemps fréquenté cette basilique,
comme on l’appelle. Quant à moi, quoique je l’ai visitée, je n’ai rien
vu qui puisse faire croire à leurs apparitions. Je n’ignore cependant
pas qu’il existe des esprits de malice dans les édifices publics, dans
les maisons particulières, dans les champs et sur les eaux.>>
Rappelons d’abord que les
“Lémures” sont des esprits ou ombres des morts qui reviennent sur la
terre pour tourmenter les vivants. Ils apparaissent sous forme
d’animaux. Admirons le caractère sibyllin de cette description, par un
homme qui se dit objectif, il y a des lémures, je ne les ai pas vus,
mais cela ne veut pas dire qu’il n’y en a pas puisqu’il existe des
esprits de malice. N’oublions pas que du Choul écrivait en 1555.
Le château qui, suivant cette
tradition, aurait été le séjour des fées, était au Breuil, au-dessous
de Saint-Just, sur le chemin de Doizieux à la Terrasse-sur-Dorlay. Le
docteur Francus assure que le Breuil est célèbre par son “château des
fées, que personne n’a jamais vu mais qui est mentionné par Jean
Pelisson et par du Choul. Celui-ci dit même, répète le docteur en
parlant de du Choul, que, de son temps, on en voyait encore les ruines.
Le docteur Francus mentionne, lui au Breuil, les “caves des Sarrasins”.
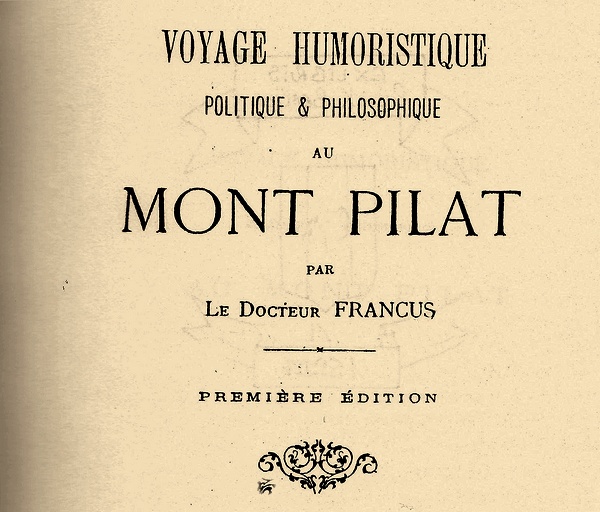
Frontispice du livre du Docteur Francus (1890)
Ne nous laissons pas égarer par
ces mots pleins de mystère, car la réalité est banale, simple,
matérialiste. Nous avons tous les éléments du puzzle, il suffit de les
assembler dans le bon ordre pour avoir toute l’histoire de cette maison.
Du texte de du Choul il faut
retenir plusieurs éléments. Le premier est le nom de “maison des Fages”
écrit en italique dans le texte et non traduit en latin, alors que
l’ouvrage est écrit dans cette langue. Le deuxième est le nom de
“basilique” également donné à cette maison. le troisième est la mention
des “lémures nocturnes” qui auraient longtemps hanté les lieux, mais
qui ne sont plus visibles en 1555.
Du texte du docteur Francus
retenons, qu’à son époque, la maison spacieuse dont les ruines avaient
été signalées par du Choul n’existait plus, mais que seulement des
caves, dites : “des sarrasins” frappaient l’imagination.
On sait que la partie du village
du Breuil, où étaient les “caves des Sarrasins” indiquées plus haut, a
été inondée par la mise en eau du barrage sur le Dorlay en 1973.
Heureusement, avant cette opération, le P. Granger avait eu l’occasion
de faire des fouilles sur le site, et d’en donner le compte rendu.
D’après celui-ci, ces “caves des
sarrasins” étaient un souterrain qui :<< Partait d’une maison
vétuste mais reconstruite sur des fondations encore plus vieilles,
probablement au XVIII° siècle à destination d’atelier de cloutier. Une
grande cage rectangulaire, partiellement taillée dans le sol rocheux,
partiellement construite et s’achevant par un palier à deux mètres de
profondeur, donnait accès au souterrain qui passait perpendiculairement
sous les fondations de la maison et allait à l’extérieur, obstrué
jusqu’au bout, rejoindre environ huit mètres en contrebas un chemin
dallé très encaissé, en provenance du Sud-ouest, c’est à dire des rives
du Dorlay et de l’Artiole. Ce souterrain avait une largeur de
quatre-vingt-dix centimètres et une hauteur de un mètre soixante
environ. Il était comblé de matériaux divers mais dont l’ensemble
révélait des traces d’incendie ancien, fort vaste, étendu à tout le
pourtour et a des profondeurs que nous n’avons pas eu le loisir de
déblayer. A l’extérieur de la maison toutes ces caractéristiques se
découvraient facilement car les parois étaient construites en pierres
sèches soigneusement appareillées et recouvertes de grandes dalles
formant toiture hermétique. Il offrait donc le passage suffisant pour
un seul homme à la fois.
<< Il était tronqué,
n’atteignant plus sa sortie primitive. Il s’ouvrait certainement
autrefois sensiblement plus loin ou plus à droite que son issue bouchée
actuelle. C’était un point mieux dissimulé du chemin creux pavé et sur
ses flancs. Ou bien quelque dérivation latérale disparue. Il
constituait alors une voie secrète aussi bien de pénétration que
d’évasion pour les habitants initiés...>>
Arrêtons là cette citation,
ajoutons seulement que le chemin dont il s’agit est celui de l’antique
voie reliant Vienne à la Loire par Condrieu, la Croix de Montviol,
Doizieux, Rochetaillée, Saint-Etienne, Saint-Victor ou
Saint-Just-sur-Loire. Ce n’est pas la voie mentionnée par Strabon, qui
reliait le Rhône à la Loire en suivant la vallée du Gier, puis celle du
Furan et qui rejoignait la Loire, 800 stades dit-il, en plaine.
Plus loin le P. Granger, cite deux
textes donnés par Baluze. Le premier in “Capitulaire II, colonne 1403”,
mentionne qu’en 812, une église, située “dans le comté de Lyon, sur la
côte de Doizieux”, “In pago lugdunensi, in custe Doaciaco” appartenant
à l’Eglise de Vienne, fut l’objet d’une transaction avec un seigneur
laïc. Et, l’autre texte, à la Bibliothèque Nationale, fonds Baluze LXXV
folio 348 b, indique qu’à la même date une cession est faite également
par le Chapitre de l’Eglise de Vienne, avec l’autorisation de l’évêque
Barnard, qui cède, moyennant charges énoncées, à un certain Sylvion et
à sa femme Didane, des biens qui se trouvaient aussi sur la côte de
Doizieux, dans le comté de Lyon, et qui proviennent d’un don fait
antérieurement par le prêtre nommé Aldon.
Le P. Granger ajoute :
<<L’endroit où il y a une église est Saint-Just-de-Doizieux,
l’endroit où il y a des biens cédés par le prêtre Aldon c’est le
village du Breuil. Et enfin des indices non négligeables portent même à
croire que la donation initiale faite par le prêtre Aldon, à l’église
cathédrale de saint Maurice a pu se produire assez longtemps avant
l’année 800, malheureusement Baluze n’offre que des copies .>>
Un autre élément qui facilitera
l’assemblage de notre puzzle est l’indication fournie, toujours par le
père Granger, de la découverte, sur le même site de “débris de colonnes
cylindriques anciennes quoique fort communes usées, en pierre.”
Terminons notre enquête en
indiquant que Jean du Choul était d’une famille calviniste
pamphlétaire, et nous avons tous les éléments nécessaires pour
reconstituer l’histoire de la “maison des fées” de Doizieux et de ses
légendes, car, sans entrer dans les détails rappelons rapidement les
débuts du Calvinisme en France.
On sait que la Réforme de Luther a
commencé à se propager en Europe vers 1520. A Meaux, avec l’assentiment
de l’évêque lui même, Guillaume Brigonnat, ainsi qu’à Lyon, la
propagande réformée trouva des oreilles attentives. Les premières
persécutions commencèrent dès 1525. Après que le parti de la réforme
eut affiché des placards sacramentaux, c’est à dire qui dénaturaient
l’Eucharistie en ne voyant dans la messe qu’un symbole et non un
sacrifice, l’Eglise de Paris les combattit violemment, et François
premier, à l’automne 1534, prit à son compte la défense de l’Eglise
catholique romaine
A la même époque, en mars 1536,
Calvin publiait, à Genève, : “L’institution de la religion Chrétienne”
qui se répandit en France dès 1538, au moment où s’aggravait les
poursuites religieuses. Malgré ces persécutions, et les édits d’Henri
II, un premier synode des églises protestantes de France s’ouvrit à
Paris en mai 1559.
De ce rapide survol on peut
conclure qu’en 1555, date de parution de la “description du Mont Pilat”
de du Choul, à Lyon, les calvinistes pouvaient espérer la tolérance
religieuse et l’arrêt des persécutions, d’autant que de grands
personnages adhéraient à leur cause.

La retenue d'eau du barrage du Dorlay, vue de Fonterines. De haut en bas : maisons
basses de Saint-Just et le chemin au Breuil, le Breuil, la retenue du Dorlay.
Mettons en ordre tous ces éléments, ce qui donne l’histoire de la “maison des fées”.
Il était une fois,
Il y a bien longtemps, sur
les bords de la Doyse, une tribu celte qui vivait de pêche, de chasse
et d’agriculture. Pour régler leurs disputes et leurs problèmes
communautaires ses membres se réunissaient en un lieu où ils pouvaient
discuter, et tenir leurs audiences. C’est endroit où l’on pouvait
facilement venir était donc près d’un chemin, il s’appela tout
naturellement : “le Breuil”; de “Bruyata” qui voulait dire, dans leur
langue, comme aujourd’hui encore, en breton : “discuter”, et de
“bruyou” qui veut dire : “audience” dans ce même langage. Il y eut une
pierre sacrée sur laquelle on jurait de tenir les engagements pris.
Plus tard le chef de la tribu y établi sa résidence et dirigea de là
son domaine agricole.
Vers le milieu du 1er millénaire
la pierre sacrée fut remplacée par une croix, tandis que les bâtiments
de l’exploitation s’étoffaient. C’est ainsi que, dans le dernier quart
du VIII° siècle, l’Eglise de Saint Maurice de Vienne, reçut d’Aldon, de
la lignée des Chapteuil: “édifices, maisons, hangars, jardins, vignes,
prés, pâturages, bois dîmes, ruisseaux, sources, arbres fruitiers ou
non fruitiers, eaux courantes chutes d’eaux.” On voit par la
différenciation de édifice et de maison , qu’il y avait dans cette
donation des bâtiments à usage public. Mais tout cela est difficile à
gérer, et, aussi pour des raisons politiques en cas de périodes
troublées, Vienne cède à un particulier ce domaine au début du IX°
siècle.
Le nouveau propriétaire s’empresse
d’aménager ces bâtiments qui n’étaient pas très bien entretenus depuis
longtemps, et il construit une villa, il y aménagea une salle avec des
colonnes de pierre pour tenir les audiences. On l’appela bientôt
“basilique” mot qui désignait les édifices romains où se tenaient des
assemblées solennelles et les séances des tribunaux, et qui, suivant
Vitruve, avaient trois travées séparées par deux rangées de colonnes.
Le Breuil populaire devint ainsi la basilique carolingienne. Les années
passant un château fort fut construit à Doizieux, avec une chapelle,
Saint Laurent, et le château remplaça la basilique qui ne devint plus
qu’une maison d’exploitation agricole. Cette maison et ces bâtiments
plus ou moins bien entretenus résistèrent tant bien que mal, aux
affronts du temps et des hommes pour ne devenir, au milieu du XVI°
siècle que ruines, certes encore majestueuses, mais ruines quand même,
avec des toitures en grande partie oubliées et des colonnes encore
debout. C’est ainsi que naquit l’appellation de “maison des fées”.
Maison des “Fages” dit du Choul,
et nos modernes scientifiques patoisant, disent : “Fage est le nom
local du Fayard ou hêtre, c’est ainsi que l’explique le très savant
Antoine Duraffour dans son hommage à J. Saunier. Il va nous fournir
matière à une profonde réflexion sur les textes savants en matière
linguistique que nous devrions suivre si nous ne voulons pas être
considérés comme de pauvres béotiens dont les définitions étymologiques
n’ont de valeur qu’en raison de l’ignorance de ceux qui les croient.
Je cite :<< Le Hêtre, le
continuateur normal de fagu est (la) fay (366) Diminutif au deuxième
degré : “la Fayoleta” (199), d’après “fayola”, signalé sur le
territoire de Violay, en 1292, par le dict. topog. Fayola a été
employé comme surnom d’homme : Durannus Fayola de Monistrol, circa
1288, charte 907 (389).
<< Avec le dérivé en “étum”
de fagu nous faisons connaissance avec la deuxième forme phonétique de
ce suffixe. En effet, “E” libre, en franco-provençal comme en français,
ne donne pas, lorsqu’il est précédé d’une palatale, la diphtongue “ei”,
mais un simple “i”: sera français cire, franco provençal siri. Il en
résulte qu’un bois de hêtres est, à Chalmazel, en 1290 un “fayi” (ou
“i” est accentué): lo boc (le bois) del Fayi (365) (368) (369), ou
simplement, el Fayi (= en lo Fayi) (262)
<< Il va de soit que le
simple fay ( sporadiquement passé au masculin dans les noms de
lieu, cf. Dict. Topog.) et le dérivé “fayi” ont pu devenir des noms de
personne. La note 4 de l’art. 29 nous apprend que les “Fay”, famille et
lieu , noms répandus dans la région, se prononcent : “Faille”. Ils
proviennent donc du simple.>>
Je m’excuse de ce texte dont les
renvois sont quelques peu ésotériques pour les non initiés. Précisons
donc que les renvois concernent la Charte 909 des Chartes du Forez
antérieures au XIV° siècle, publiées par la fondation Georges Guichard.
Le premier renvoi : 366 ( à compléter d’ailleurs en 366-7) n’est à la
Charte elle même qu’un renvoi : “V. art 363, note 3”. Cette dernière
référence est: “V. art. 29, note 4, bois de la Faye, à Duerne”. Cette
dernière note nous est donnée intégralement dans le dernier paragraphe
de Duraffour, sans indiquer d’ailleurs qu’il s’agit d’une citation pure
et simple.
La deuxième référence : (199),
renvoie à : “cf. Le Fayet, au midi de Chatelus, bois de la fayette,
jouxte la fay”. Les références 365, 368, 369, renvoient toutes
trois à une référence 363 non citée par Duraffour, qui renvoie elle
même toujours à la même note 4 de l’art. 29. On s’aperçoit ici qu’en
fait toutes ces références qui donnent, d’après les critères officiels,
du sérieux à l’article, se résument en une seule. Tout cela pour nous
expliquer, sans rien démontrer d’ailleurs, que “Fay”, prononcé “Faille”
vient de fagus.
Contrairement à cette affirmation,
nous disons que, dans bien des cas, Fay et Faye ont une autre origine.
En effet, dans le folklore de notre région, et dans celui d’autres
aussi, “fée” a parfois la signification de : “pierre levée”. Je
n’invente évidemment pas cette interprétation et pourrait dire, si cela
était suffisant, que je l’ai entendu dire quand j’étais enfant, mais
qui me croirait ? je suis donc amené à la faire confirmer.
La première confirmation que je
citerais est : “L’église des fous” à Ronno. Steyert, dans son histoire
de Lyon: tome 1 page 26, à propos de la gravure citée d’après Melville
Glover, monuments préhistoriques des environs de Tarare écrit :<<
Il est probable que l’alignement (de pierres) qui traversait le vallon
de Bouillon devait se prolonger jusqu’à l’église des fous (des fées)
auprès de laquelle se dressent d’autres pierres levées...>>
J.P. Gras, de son coté écrit
:<< Interrogez certains paysans de Doizieux que je connais bien,
au sujet des cavernes des fées du Mont Pilat. Tout le monde sait que
les fées y gardent d’immenses trésors en filant leurs quenouilles.
Elles portent sur la tête d’énormes rochers sans être gênées par le
poids.>> En Auvergne des fées portent ces rochers en équilibre
sur le sommet de leur quenouille. voilà bien nos pierres fées. Pierres
aux fées, monuments mégalithiques, dit le grand Larousse.
Mentionnons encore, à l’appui de
notre dire, M. Boudon Lashermes qui dans: “Les chouans du Velay” écrit
:<< L’abbaye de Bellecombe était une retraite sauvage construite
sur le flan d’un contrefort de la montagnes des fayes... Le monastère
était dominé en arrière par les Fayes, haute cime aride et dénudée
faite de petits rochers en aiguilles entassés dans un enchevêtrement de
pics de rocailles leur donnant l’aspect de quelque féerie.>> pour
lui “fayes” n’est pas synonyme de hêtres mais bien de pierres féeriques.
Je citerai encore M. Hippolyte
Boyer, qui écrivait en 1885 dans les mémoires historiques du Cher
:<< Dans l’ancien idiome que parlait les peuples qui nous ont
précédés sur le sol de France, Fol, Feuil, signifiait pierre rocher.
Dire la “pierre folle” c’est dire la pierre pierre... Ainsi la “Fol”
qui à l’origine voulait dire une pierre, un rocher, une montagne au
sens général du mot, devint la “Fol” spéciale de la contrée. Et, de là
:”Folembray”, “Folguerolles, “Foljuif”, “Folmont” et ailleurs, j’ai
présent à la pensée la montagne dite :”la pierre des Fades” (la
montagne des Fées) dans la commune de Pontarion (Creuse), que surmonte
un des plus beaux groupes mégalithiques que je connaisse. Je me demande
si la “Pierre des Fades” ne se traduit pas plus littéralement par la
“montagne des pierres” que par la “montagne des fées” et si ce denier
mot, au lieu d’être rapporté au latin “fatum”, comme le “fata” italien
ne désignerait pas simplement les esprits des pierres...
<< Signalons en outre qu’en
Irlande, dans le district de Doon existent trois groupes de Dolmens
portant le nom de : “Foily Cleary” et “Foil Mahon”. Foil et Foily
semblent désigner ici quelque chose comme “tombe” ou “pierre”.>>
Mentionnons enfin que, près de
Monistrol-sur-Loire, existe le domaine de Rochepaille, ce nom vient
évidemment de : La roche palée, c’est à dire fichée en terre, comme un
pal, or ce domaine au XVI° siècle s’appelait : Rochefaye. Cela montre
que jusqu’au XVI° siècle, au moins, les paysans, sauvages et ignorants
de la science des grammairiens parisiens, savaient qu’une : faye, alias
fage, était une pierre et pas un arbre.
“Maison des fages” n’est pas
maison des hêtres, du Choul aurait traduit ce mot en latin, s’il ne l’a
pas fait c’est que pour lui “hêtre” et “fage” n’avaient rien de commun.
Tandis que si “fage” et “fée”” sont une pierre debout, nous comprenons
la signification de cette dénomination. Maison des hêtres ne veut pas
dire grand chose, tandis que maison des pierres debout, désigne
clairement une maison avec des colonnes en ruine.
Remarquons que pour Dauzat “Fage”
est la même chose que “Faye”. Mais “Fée” et “Faye” n’ont pas forcément
la même signification, bien que dans les deux cas il s’agisse de
pierres plantées. On sait, en effet, que dans les assemblées les
accords conclus devaient être jurés solennellement. Chez les hébreux,
c’est sur la loi, chez les protestants sur la Bible, chez les chrétiens
sur l’Evangile etc... et chez nos ancêtres sur une pierre sacrée, la
pierre où on engageait sa Foi, sa “Fé”.
Certes mon explication ne
convaincra pas Saint-Thomas qui ne croit que ce qu’il voit et
touche, car il n’y a pas de documents écrits authentiques pour prouver
cette évolution, mais il me semble que le nom d’un arbre dont le pays
abonde n’est pas un bon moyen pour désigner une maison, ou un endroit
précis.
Du Choul ne parle pas de la “Cave
des Sarrasins”, qui n’apparaît que beaucoup plus tard avec le docteur
Francus, simplement parce que, au XVIème siècle, les ruines de la
maison étaient suffisamment importantes encore pour dissimuler le
souterrain, et que, en connaissant l’existence, il n’avait pas à le
dévoiler. D’après son dire et ses réticences on comprend que, vers les
années 1540, des réformés ont tenu des assemblées dans ces ruines en
utilisant le passage souterrain qui permettait une filtration opportune
des assistants en n’autorisant le passage que d’une seule personne à la
fois. Ces réunions nocturnes, dont les ombres se profilaient à
l’extérieur donnèrent naissance à la légende des Lémures. Du Choul
croyant à des jours meilleurs pour ses coreligionnaires avoue
l’existence de ces ombres mais espère bien qu’il n’y en aura plus.
Plus tard les bâtiments
s’écroulèrent encore davantage, et les guerres de religion ne sont pas
étrangères à l’incendie qui les ruina et amena l’obstruction complète
du passage, pour éviter sa réutilisation. Les troubles passés et la
population ayant à nouveau besoin d’espaces habitables plus importants
reconstruisit une maison d’artisan en utilisant le départ souterrain,
tandis que celui-ci toujours visible à l’extérieur, prenait son nom de
légende. Ce nom rappelait néanmoins l’appellation première, car les
“Sarrasins” dans l’esprit populaire, sont souvent considérés comme les
maris des fées. Celles-ci, avec l’écroulement des fûts de colonnes
avaient alors complètement disparues.
Nous voyons donc que le site da la
maison des fées n’a rien de mystérieux. Il doit son nom à une maison
construite au VII ou VIIIème siècle de notre ère. Cette maison était
appelée “Basilique”, parce qu’elle avait une salle avec des colonnes.
Pusieurs fois remaniée, et peut-être même reconstruite, au XVIème
siècle elle était en partie en ruine. Avec son accès souterrain elle
servit alors de lieu de rencontre pour des réunions discrètes, voire
secrètes. Les fûts de colonnes était alors encore, du moins
partiellement, debout. Ce sont ses fûts qui lui ont donné son
qualificatif de fées. Ces futs’étaient, comme on disait à cette époque,
des “Fages” ou des “Fées”, nom générique donné à des colonnes, souvent
même à de simple pierres ou rochers élevés qui avaient une forme
faisant penser à une colonne, pas forcément cylindrique, mais que l’on
considérait un peu comme sacrés. Trois cents ans plus tard la ruine
était consommée,. Les matériaux, y compris des morceaux des fûts des
colonnes, servirent à construire un très modeste atelier de
cloutier. Cet atelier disparu, lui même, moins de cent ans après sa
construction. De la “maison des fées” il ne restait quele souvenir.
Aujourd’hui le site est englouti dans les eaux du barrage sur le Dorlay.

Redécouverte du fond de la vallée du Dorlay au niveau du Breuil,
lors de la vidange du barrage en octobre 2009. A cette occasion le vieux chemin
romain ou médiéval réapparaît, avec l'emplacement de deux ponts