
Les Trois Dents
furent pendant des millénaires un lieu de surveillance
d’envergure et de
rencontres indispensables entre tribus nomades. A ces deux titres
principaux,
elles furent sacrées pour l’Homme. Nous ne pensons pas en
revanche qu’il faille
y trouver un éternel lieu de culte, comme c’est par exemple le
cas avec le site
voisin de Saint-Sabin, là où aujourd’hui est encore
érigée à 1100 mètres
d’altitude la plus haute chapelle du Pilat, au beau milieu d’une
enceinte
celtique. Nous allons nous rendre maintenant à La Pierre des
Trois Evêques,
aujourd’hui simple borne qui délimite la commune de La Versanne
de celle de
Saint Sauveur en Rue.
Les richesses historiques
et patrimoniales du Massif du Pilat
sont innombrables. Certaines semblent bien connues par contre d’autres
le sont
beaucoup moins. La Pierre des Trois Evêques, puisqu’il s’agit
d’elle,
appartient à cette seconde catégorie. Ressortie de
l’ombre grâce au collectif
du cadran du Pilat voici huit ans, nous allons aussi nous attarder sur
son
Histoire.
Si on ne possède
pas un minimum d’explications, on peut ne pas trouver facilement La
Pierre des
Trois Evêques en croyant s’y rendre trop tranquillement. On peut
même se perdre
dans ces bois où les arbres se ressemblent tous. C’est tellement
mal
indiqué ! Pourtant il suffit de stationner à la
Croix de Caille, tout près
des Tourbières de Gimel, les vedettes des lieux en 2024 et
à partir de là
posséder quelques bons renseignements. C’est bien mal
reconnaître l’Histoire
que de délaisser ce patrimoine vraiment important. Certes sur
place il y a bien
un modeste panneau avec quelques moindres explications, mais
très mal résumé
tant le lieu en mériterait plus. C’est bien Thomas de
Charentenay qui a
réveillé cette Histoire à partir de 2016. Eric
Charpentier et ses connaissances
pointues, notamment mathématiques, de l’époque
mégalithique, d’avant et d’après
celle-ci, lui a ensuite fructueusement emboîté le pas. Un
collectif dynamique
s’est ainsi mis en place dans une notable très bonne
convivialité. En se
promenant en forêt à proximité immédiate de
la Pierre, Thomas avait
préalablement cru reconnaître des sortes d’alignements de
Pierres dressées,
certaines couchées, dans une végétation dense et
presque hostile. Notre futur
ami s’est interrogé alors et quelque temps plus tard, est
entré en contact avec
moi via Les Regards du Pilat. Il m’a ainsi fait part dans le
détail de ses
présumées découvertes. Il était en tous les
cas interloqué. Pas suffisamment
compétent, j’ai préféré alors le diriger
sur Eric, une valeur sûre en la
matière. Nous ne le savions pas encore à ce
moment-là, mais allait s’ouvrir une
époque passionnante, doublée d’initiatives et de rigueur
; au final très riche
en découvertes.
Il faut en
réalité prendre en considération un vaste secteur.
Partant de La Pierre des Trois Evêques, nous avons
érigé tout un inventaire de
singularités. En matière mégalithique, quand on a
la chance de se retrouver
incontestablement en présence de ces « constructions
» ancestrales eh bien l’on
doit faire preuve d’une grande humilité quand il s’agit de faire
parler les
pierres quant à leur utilité première, voire
même leur dénomination. Il faut
faire attention à ne pas trop interpréter et surtout ne
pas hésiter à présenter
ses découvertes à un maximum de personnes ayant une
expérience significative en
la matière. Effectivement les archéologues ne se
déplacent pas comme cela sur
le terrain car les organismes compétents ou dits
compétents préfèrent de loin
consacrer les budgets disponibles, pas extensibles, aux valeurs
sûres, celles
qui sont déjà reconnues, archi-reconnues et de longue
date.
Eric Charpentier
maîtrise sur le bout des doigts, la
géométrie mégalithique. Il est en cela devenu
l’égal des grands spécialistes
reconnus à l’échelle nationale et déjà
cités, que sont Howard Crowhurst,
Quentin Leplat, Pierre Coussy et Alan Becquet. Cette science
utilisée là-haut à
La Pierre des Trois Evêques et dans les alentours directs va
permettre bon
nombres de recoupements utiles. Dans le même temps, Thomas de
Charentenay, a eu
la très bonne idée de faire intervenir des
étudiants, de futurs géomètres
précisément. Il s’agissait là de démontrer
grâce à des relevés topographiques
dignes de professionnels que les pierres alignées et qui en tous
les cas
apparaissaient comme telles à tous nos visiteurs
n’étaient pas le fruit du
hasard mais bel et bien dues à une intervention humaine. Cette
opération s’est
déroulée du 23 au 25 octobre 2017 sous la conduite de
Jean-Yves Lozano, professeur
et géomètre professionnel. Il y avait trois
étudiants géomètres en 2ème année
de BTS MGTMN au SEPR de Lyon qui ont participé aux
relevés topographiques,
Antoine Balza, Rudy Despinoy et Arnaud Steghens. Ils étaient
équipés d’une
station totale pour le relevé des points et d’un
récepteur GNSS pour le
rattachement aux réseaux nationaux. Ces compétences
réunies ont permis la
réalisation de la cartographie du site et la
concrétisation d’un inventaire des
roches dressées et certaines en réalité
couchées dans le même alignement
présumé.
Il faut aussi
préciser que le 24 octobre, 2017 toujours, les
étudiants pour qui ce travail constituait le thème de
l’un de leurs travaux
présentés à l’examen, furent rejoints par un
représentant de la société
GEOTOPO. C’est à souligner car Yves Farissier, le
représentant en question, va
grâce à son matériel très professionnel
(High-tech GEOSLAM), pouvoir proposer
un relevé scanner 3D du site étudié. A partir
de-là la Cadran du Pilat a gagné
en crédibilité dans sa démarche visant à
faire reconnaître arguments à l’appui
le site comme mégalithique. Il a été établi
que les pierres concernées et
alignées, l’étaient vraiment rigoureusement, qu’elles
possédaient le même
intervalle entre chacune d’elles et que ceci était valable pour
les trois
files. Nous avons demandé l’avis à un professeur de
mathématiques du
secondaire, notre ami Philippe Monteil, pour connaître en termes
de
probabilités les chances que ce soit la nature qui ait ainsi
positionnée ces
pierres ; la réponse est sans appel puisque la
probabilité est proche de nulle.
Dans les
singularités repérées il y a aussi ce que nous
appelons « la source » de manière arbitraire afin de
bien donner un nom et qui
ici se situe sur le point haut de tous les environs. Là-bas il
faudrait
vraiment être de mauvaise foi pour ne pas conclure que seul
l’Homme peut avoir
agencé ce tout petit périmètre qui ressemble
à une résurgence d’eau mais
asséchée aujourd’hui. Qu’est-ce que c’était
réellement en première intention,
nous l’ignorons. Nous constatons juste, et tous, que seul l’Homme peut
avoir
agencé cette construction d’un autre temps et en aucun cas la
nature.
En ces années
2016/2017/2018 La Pierre des Trois Evêques
s’est comme réveillé de son glorieux passé
historique car nous y viendrons bientôt
dans ce dossier mais le rôle notoire de La Pierre des Trois
Evêques, outre
d’avoir été sacrée, est bien historique. Le monde
associatif a été bien entendu
convié à venir visiter les lieux et toutes les
découvertes ; de nombreuses
associations ne se sont pas fait prier pour inviter leurs
adhérents sur place.
Ces mêmes associations ont organisé dans le Pilat des
conférences rassemblant
un nombre record de participants (Visages de notre Pilat a accueilli
plus de
150 personnes à Saint-Appolinard). Fait notable, France 3
Région y est allée de
son reportage. Enfin, pour faire simple, une vraie dynamique
constructive s’est
mise en place dans le seul but de faire connaître et aussi
reconnaître le site.
Le plus spectaculaire, le
plus parlant, le plus rare aussi
puisque unique dans le Pilat, reste à vous présenter. Une
construction
mégalithique magnifique se situe à un peu moins d’un
kilomètre de La Pierre des
Trois Evêques. La repérer n’a pas été chose
facile mais nous étions aidés par
un renseignement laissé sur le Net par un inconnu, un certain
Alain, qui
évoquait la présence d’un Cromlech présumé
sur les lieux où nous nous
trouvions. Cette information nous l’avions avant même de nous
investir dans
l’opération Pierre des Trois Evêques et nous la tenions
d’Alexandre Parnotte.
Nous avions bien tenté avec ce dernier et quelques un de nos
Amis dont Patrick
Berlier, de chercher ce Cromlech mais autant chercher à
l’époque une aiguille
dans une botte de foin si tant est qu’il soit repérable au
premier coup d’œil.
Pourtant en partant d’en haut, du côté de La Pierre des
Trois Evêques et en descendant
presque tout droit sur 800
mètres, grâce à une herbe basse car dans un
pré, un beau jour nous sommes
tombés sur le Cromlech. Etait-ce écrit comme cela ? Nous
avons même eu la
chance d’inviter un peu plus tard à une énième
visite de tout le site, le vrai
découvreur et premier découvreur du Cromlech, bien
discret jusque-là, un
certain Alain Bellon, devenu un de nos amis depuis.


Cromlech
pyrénéen, semblable à celui
des Faves et ensuite celui des Faves
A La Pierre des Trois
Evêques, si la végétation est un peu
haute, que ce soit l’herbe où les genêts on ne peut pas au
premier coup d’œil
repérer le Cromlech et là la science
géométrique d’Eric Charpentier est bien
commode pour confondre ce très grand cercle de pierres venu d’un
autre temps.
Nous nous situons, précisons-le pour donner un nom à
cette extraordinaire
construction mégalithique, au site des Faves. Il n’est pas
conseillé de se
rendre sur place par respect de la propriété
privée sans l’autorisation des
propriétaires, forts aimables en l’occurrence. Le Cromlech des
Faves puisqu’il
convient de le nommer ainsi est de type pyrénéen pour
ceux qui rapidement sur
Internet veulent se faire une idée. Eric propose un exercice
pratique sur le
terrain qui est imparable pour repérer toutes les pierres
appartenant au cercle
et il y en a quand même 19 à comptabiliser. L’idéal
et nous avons même pu en
abuser si je puis dire avec les groupes que nous avons reçus sur
place s’est
d’y aller donc à plus de 20 personnes. Ainsi une personne par
pierre permet de
matérialiser le cercle. Nous l’avons même filmé au
drone grâce à Thomas de
Charentenay et c’est très parlant autant qu’impressionnant.
Dans cette aventure
archéologique il est regrettable que les
autorités dites compétentes et j’insiste daignent au
moins se déplacer pour
constater alors cet ensemble de singularités. Notons encore ne
serait-ce que
pour souvenir la présence d’un énorme bloc en granit
comme toutes les pierres
et roches environnantes, de plusieurs tonnes dressé et
calé, ceci entre les
Faves et La Pierre des Trois Evêques ; comment là encore
ne pas conclure que
seul l’Homme peut avoir fait cela et le comment ne propose pas de
réponse
simple. Tout ce secteur mériterait des fouilles dignes de ce
nom, approfondies.
Nul doute qu’il y a encore beaucoup à découvrir dans le
secteur et le Cadran du
Pilat sera à n’en point douter un guide de départ
efficace. Malheureusement
aussi, des propriétaires terriens des environs déboisent
progressivement. Ils
n’y vont pas avec le dos de la cuillère comme on dit car ce sont
des gros
engins qui ne font pas de détails : des parties du site sont
menacées. Nous
avons un peu voyagé sur le secteur ; il est temps de revenir
à La Pierre des
Trois Evêques.

La grosse pierre
levée et calée par
des pierres de tailles modestes
Nous avons déjà
noté qu’aujourd’hui cette Pierre des Trois Evêques sert de
borne pour séparer
deux communes. Cette fonction elle l’a aussi eu dans le passé,
dans plusieurs
passés et certainement dans des passés encore plus
lointains. Son nom elle le
doit d’ailleurs à l’un de ses partages territoriaux, religieux
en l’occurrence,
celui qui voyait trois Diocèses se retrouver en ce point, ceux
de Vienne, de
Lyon et du Puy-en-Velay. Mais écoutons Patrick Berlier nous
expliquer : «
Auparavant, elle fut une borne qui délimitait trois provinces
romaines de la
Gaule : la Lyonnaise, l’Aquitaine et la Narbonnaise. Mais une
évidence est
frappante lorsqu’on se rend sur place : cette anodine pierre plate ne
constitue
nullement un point de repère, à l’inverse d’autres
rochers des environs
visibles de fort loin... Pourquoi les Romains, qui affectionnaient les
symboles
ostentatoires, furent-ils si modestes dans leur choix de cette borne
comme
limite commune à trois provinces ? Sans doute parce qu’elle
jouait déjà, bien
avant leur arrivée, un rôle capital dans les croyances
gauloises.
En 1555 le juriste
lyonnais Jean du Choul voyagea dans le
Pilat et en laissa une précieuse description
rédigée en latin : De Monte
Pylati. Dans ce livre il rappelait la notoriété dont
le Pilat jouissait
auprès des peuples de la Gaules, et le qualifiait d’Olympe
gaulois. La Pierre
des Trois Évêques fut probablement un lieu de
rassemblement très discret, et
aussi une sorte de « nombril du monde » tout comme
l’était l’omphalos de
Delphes pour les Grecs. L’annexer permettait de la « romaniser
». Mais on dit
qu’à l’arrivée des Romains, les druides
délaissèrent le Pilat pour leurs
réunions secrètes et se replièrent vers la
forêt des Carnutes qui allait devenir
Chartres... Auguste leur imposa de revenir, non pas dans les
forêts du Pilat
trop difficiles à surveiller, mais à Lyon dont il fit la
capitale des Gaules.
Nous y reviendrons un peu plus loin dans ce dossier et plus en
détails.
Le rôle de La Pierre
des Trois Évêques était cependant loin
d’être terminé ! Après avoir servi de
frontière entre les Burgondes et les
Wisigoths, puis les Francs, elle matérialisa la
démarcation entre les parts
attribuées aux descendants de Charlemagne, Charles le Chauve et
Lothaire, lors
du morcellement de l’empire carolingien par le traité de Verdun
en 843. Elle
marqua encore la limite des zones de juridiction des châteaux de
Montchal,
Argental et la Faye. Elle ne perdit son rôle majeur, en terme de
pouvoir
temporel tout au moins, qu’en 1296, lorsque le comte du Forez
étendit son
territoire par son mariage avec Alix de Vienne ». Le Druide du
Pilat, c’est le
surnom de Patrick Berlier, vient de nous faire entrer de plain-pied
dans
l’Histoire de La Pierre des Trois Evêques.
Le Massif du Pilat est
effectivement sacré et ceci depuis la
nuit des temps ; nous commençons nettement à nous en
rendre compte. Nous
pensons que La Pierre des Trois Evêques et toutes les
cérémonies qui ont pu s’y
dérouler en époques reculées n’y sont pas
étrangères. Les druides dans le Pilat
s’avèrent un point capital. Pour en parler nous allons, nous
appuyer sur
l’expérience et le travail conséquent de Noël
Gardon, lui l’ancien brillant
secrétaire de la Société savante de la Diana.
L’Histoire de France est remplie
d’erreurs, de mensonges, de non-dits, de contre-vérités
et cet auteur nous a
laissé une bible correctrice en rapport au Pilat. « Mon
Pilat, Etymologies,
Rêves, Légendes et …. Réalités »
nous mène sur des chemins peu empruntés,
mal connus ou inconnus. Merci Monsieur Gardon pour ce beau travail
laissé à la
postérité.
Nous nous transposons en
la compagnie de Noël Gardon au Crêt
de l’Airellier, le Crêt le plus oublié de tous les
Crêts du Pilat. Les arbres
vous accueillent timidement là-bas ; il n’y a même pas de
chemin. Nous sommes au sud-est du
Crêt de la Perdrix,
à vol d’oiseau à 1500 mètres. Airellier est une
transformation, volontaire ou
involontaire du nom primitif qui était Aralez. Aralez signifie
« l’assemblée de
l’autel » ou encore « les autels assemblés ».
50 ans avant Jésus Christ les
druides se réunissaient une fois par an, dans le pays des
Carnutes. On suppose
généralement, et peut-être bien trop facilement,
que les Carnutes
correspondraient à la ville de Chartes. Rien n’empêche
pourtant très sérieusement,
de penser, voire d’admettre, que c’est en réalité
Saint-Benoit sur Loire qui
serait les Carnutes. Les travaux d’Eric Charpentier sur le sujet,
présentés sur
Les Regards du Pilat en Juillet 2015 (Sainte-Croix-en-Jarez et la ligne
sacrée
des Druides), tendraient réellement à le
démontrer. D’autres chercheurs y
voient encore Orléans. A chacun donc de se faire son opinion.
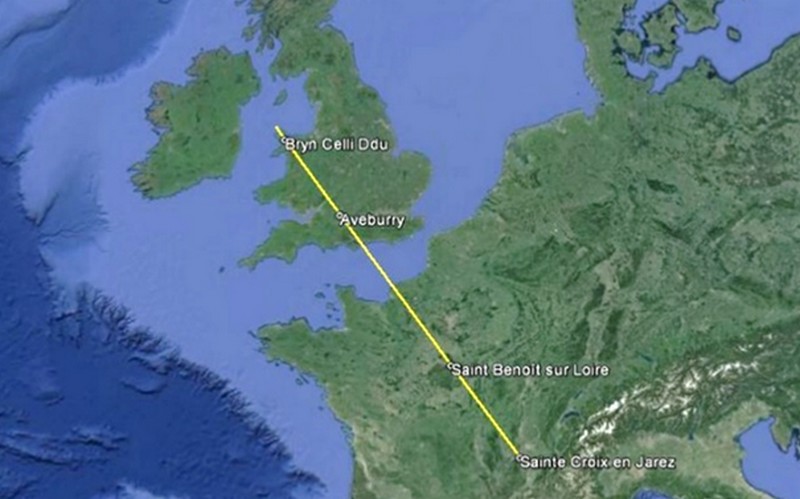
La ligne sacrée des
Druides, travaux d’Eric Charpentier présentés sur Les
Regards du Pilat
Vers l’an 25 avant
Jésus Christ il s’opéra un changement avec
Auguste qui décida de transférer ce lieu de rassemblement
à Lyon espérant avoir
ainsi plus à sa main les gaulois car c’était dans ces
assemblées que se
formataient parfois des révoltes. Les Carnutes ne sont
restées le site de ces
réunions que de moins 120 à moins 50 avant Jésus
Christ et si on remonte avant
eh bien c’est en Pilat qu’il faut se rendre et plus
particulièrement au Crêt de
l’Aralez.
Pour nous parler de ces
cérémonies gauloises écoutons Noël
Gardon : « Il y avait à l’Airellier trois pierres qui
étaient les trois autels.
L’une n’était, en réalité, qu’une table
destinée à recevoir les offrandes,
l’eau nécessaire aux ablutions et autres objets
nécessaires au culte. La
deuxième était l’autel de parfums où l’on faisait
brûler l’huile aromatisée,
enfin la troisième était l’autel des holocaustes. Si vous
montez, entre les
branches rampantes, peut-être finirez-vous par découvrir
les deux ou trois
pierres, patinées par les pieds des prêtres et qui forment
encore comme les
marches d’un autel, mais elles sont tellement mutilées
qu’à peine en reste-t-il
quelques décimètres carrés ». Il faut se
rendre sur place, comme je l’ai fait
avec Jacques Patard pour s’imprégner de ce lieu bien particulier
où durant
plusieurs centaines d’années les druides gaulois se sont
réunis. L’Histoire
officielle l’a oublié mais pas ceux qui s’intéressent
avant tout à la vraie
Histoire. Les druides en ces mêmes époques connaissaient
évidemment toute
l’importance de La Pierre des Trois Evêques dont la
première raison d’être les
dépassait car elle remontait à des ères bien
antérieures à eux.
L’époque
mégalithique n’est pas l’époque celtique et de cette
première on ne sait que peu de choses. A un bon kilomètre
de La Pierre des
Trois Evêques se trouve La Pierre posée de la Roue
découverte par notre amie
Sandrine Jousserand. On a parlé plus avant du gros bloc
dressé et calé. Nous
sommes là en présence de constructions qui remontent
à la nuit des temps. Il ne
faut pas certifier que nous sommes en présence de
mégalithes au sens strict à
savoir donc d’époque mégalithique. Le Pilat, une
des plus vielles
montagnes du monde comme on le sait, peut avoir abrité des
survivants de l'époque antédiluvienne, de ceux
qui ont continué après à reconstruire un nouveau
monde là où tout ou presque
avait disparu. La Pierre des Trois Evêques comme certains
Crêts que nous
étudierons, comme Les Roches de Marlin,
peuvent avoir
joué une sorte de rôle d’Arche de Noé …
