

Rubrique
Les Papes Juillet 2025 |

|
Par Michel Barbot
|
De
Gerbert d’Aurillac à Sylvestre II le pape des 3 R
Gerbert
d’Aurillac natif des Monts du Cantal a vu le jour sur les terres du comte de
Saint-Étienne d’Aurillac à Belliac commune de Saint-Simon vers 940. Était-il le
petit berger que la tradition populaire nous présente ? Certains
historiens s’appuyant sur son nom ont préféré lui reconnaître une origine plus
noble. Pierre Riché, professeur d’histoire médiévale à l’Université de Paris
X-Nanterre, l’un des meilleurs spécialistes du Moyen-Âge publia en 1987 chez
Fayard, l’ouvrage GERBERT D’AURILLAC Le pape de l’An mil dans
lequel il écrit : « Richer de
Saint-Remi nous dit simplement qu’il est ‘’de famille aquitaine’’, mais
l’Aquitaine est grande ! C’est ce qu’indiquent également les chroniqueurs
du XIe siècle. Le nom de Gerbertus ou Gibertus peut
donner une indication sur sa patrie d’origine. Assez courant dans la région
puisqu’on le trouve plusieurs fois mentionné dans les cartulaires de
Sauxillanges (une abbaye auvergnate), de Brioude, de Conques ; d’autre
part, il est porté par quatre générations d’une famille aristocrate de Carlat,
près d’Aurillac. » Cet historien ajoute : « Selon un chroniqueur
romain du XIIIe siècle, le père de
Gerbert s’appelait Agilbert, mais on ne sait d’où il a tiré ce
renseignement. »
P. Riché
ajoute :
« Les
chroniqueurs du XIe siècle s’accordent pour dire que Gerbert était
d’origine obscure, sans pour autant en faire un berger. Parlant à l’évêque de
Strasbourg Wilderod de son élection au siège de Reims, Gerbert lui-même
écrivait :
« ‘’Si
tu me demandes comment cela a bien pu se produire, j’avoue mon ignorance.
J’avoue, dis-je que j’ignore pourquoi un indigent, un exilé, quelqu’un que ne
soutenaient ni son lignage, ni sa fortune, a été choisi de préférence à des
hommes riches et remarquables par la noblesse de leur famille’’ (lettre 217).

Statue de Sylvestre II à Aurillac
Nous
comprenons combien la piste noble famille d’Aquitaine reste ténue. De
tradition, Angilbert dit aussi Agilbert était le fils d’un serf affranchi
protégé par les moines de l’abbaye
Saint-Géraud d’Aurillac pour laquelle il cultivait un petit champ. Au bas de la
colline dans le hameau de Belliac, Angilbert et sa famille vivaient dans une
maison de bois comprenant deux pièces : l’une pour la famille et l’autre
pour les animaux. Gerbert le cadet gardait les moutons dans les bois où il
aimait observer les étoiles.
Près du
hameau vivait dans une grotte un homme étrange nommé Andrade, un ancien clerc
disait-on, descendant des anciens Druides. Gerbert plutôt curieux rendit visite
au vieillard qui lui prédit un destin magnifique : « Tu iras,
lui avait-il dit, de R en R et le dernier R consacrera ta gloire. »
À l’âge de 12
ans, suivant la légende, alors qu’il gardait ses moutons, deux moines de
l’abbaye vinrent à passer. Ils découvrirent le jeune pâtre qui observait les
étoiles du ciel à l'aide d'une branche de sureau évidée. Les paroles échangées
entre les moines et Gerbert furent rapportées à l’abbé qui estima que l’enfant
devait intégrer la petite école de l’abbaye, aussi en informa-t-il Angilbert
son père qui accepta la proposition.
Gerbert y
étudia les arts libéraux qui comprennent le trivium et le quadrivium sous
l'enseignement de l'écolâtre Raymond de Lavaur. Le latin et le roman n’avaient
plus de secrets pour lui et l’élève devenu aussi savant que son maître avait
besoin de tourner son regard vers d’autres horizons afin de progresser plus
encore vers des sciences qu’il pressentait déjà.
Gilette
Ziegler dans son intrigante étude historique titrée GERBERT Le Pape de l’an
mil, publiée en 1975 aux Éditions Culture, Art, Loisirs, évoque ce jour où
l’horizon de l’adolescent allait enfin s’ouvrir vers d’autres cieux :
« un jour d’été de l’an 967, il vit un groupe de cavaliers s’avancer vers
le couvent. […] C’était Borel II, héritier du comte de Barcelone, accompagné de
sa femme Lutgarde, fille du comte de Barcelone, laquelle avait en grande estime
les religieux de Saint-Géraud et avait voulu leur apporter elle-même des
présents. »
Les meilleurs
grammairiens et les plus fins copistes, parmi lesquels se trouvait Gerbert,
furent présentés aux deux époux. Raymond de Lavaur adressa une requête au comte
Borel pour que son élève le plus doué puisse étudier les sciences à l’école
épiscopale de Vich-d’Ausaune. Le comte accéda à sa requête et c’est ainsi que
Gerbert put découvrir dans la bibliothèque de Vich des textes antérieurs à la
venue du Christ et évoquant le « grand mystère de la vie ».
Gerbert fit
la connaissance, suivant Gilette Ziegler, de « Lupito de Barcelone, un
jeune parent de l’astronome juif Abdallah Mohamed ben Lupi, qui venait de
Cordoue » et dont les ancêtres avaient pratiqué, suivant cette auteure, la
religion des Esséniens. Gerbert fut initié à la Kabbale hébraïque et suivit le
Kabbaliste jusqu’à Cordoue. Présent en Catalogne jusqu’en 970, il rencontra des
Savants juifs et arabes dont le fameux Almansour ou Almansor. Dans la cité de
Cordoue il poursuivit ses études dans la
bibliothèque du calife Abd al-Rahman Ier riche de milliers de
livres rédigés par les plus grands auteurs arabes ou grecs. Sa découverte de
l’alchimie auprès des Arabes et des Juifs qui la considéraient comme une
branche de la Kabbale, lui aurait permis de réaliser le Grand Œuvre.
Bien que le
chroniqueur du XIe siècle Adhémar de Chabannes, affirmait que
Gerbert avait franchi les frontières du comté de Barcelone pour se rendre à
Cordoue, l’historien Pierre Riché se montre autrement plus réservé sur ce
point : « Les chrétiens qui se rendaient à la Cour du calife étaient
en général des ambassadeurs munis de lettres de créance. On ne voit pas comment
un jeune moine aquitain aurait pu aller séjourner à Cordoue. Gerbert avait
suffisamment de quoi s’instruire à Vich et surtout à Ripoll. Après trois années
d’études, ce n’est pas vers le sud qu’il se dirigea mais vers Rome. » Il
est vrai que Gerbert se plongea dans les traductions latines des livres arabes
de la bibliothèque du monastère de Ripoll. Il n’est point certain qu’l
maîtrisait La langue arabe au point de la lire.
Gerbert
l’inventeur
Gerbert ne
franchit peut-être pas la frontière entre le comté de Barcelone et l’Espagne
arabe, mais il perfectionna considérablement sa connaissance des sept arts
libéraux comprenant le trivium et le quadrivium. Sa bonne connaissance du
trivium regroupant la grammaire, la rhétorique et la dialectique, le
conduisirent à progresser dans le domaine du quadrivium comprenant les quatre
sciences mathématiques antiques : arithmétique, géométrie, musique et
astronomie. Reconnu pour son grand savoir, Gerannus, l’écolâtre de Reims et
Adalbéron l’archevêque de la ville des Sacres lui confient en 972 la direction
de l’école cathédrale de Reims, très réputée dans l’Occident chrétien.
On retrouve
parmi ses prestigieux élèves : Robert le Pieux, fils du futur roi Hugues Capet,
Richer, ou Bernelin de Paris,
mathématicien auteur d’un traité le Liber abaci.
Ce fut dit-on
pendant cette période qu’il conçut son fameux abaque, ainsi que des globes
armillaires, un orgue à vapeur, une horloge mais aussi une tête
« parlante ». L’utilisation des chiffres arabes, considérés comme
les chiffres du diable et bien entendu la mystérieuse tête, vont
permettre à ses rivaux, assez nombreux, de lui tisser une réputation sulfureuse
allant jusqu’à affirmer qu’il avait fait un pacte avec le diable.
L’une de ses
créations les plus méconnues fut son abaque à jetons neutres que le
mathématicien de l’Université de Genèse, Alain Schärlig,
n’hésite pas à présenter comme « Un fantôme ». Il restera en effet, à
raison pour l’époque, très confidentiel. (Alain Schärlig : GERBERT
D’AURILLAC Mathématicien et pape de l’an mil – EPFL PRESS 2012 Lausanne –
France 2022).
Le mot
« abaque » courant au XIIe siècle est emprunté au latin
abacus, « tablette », du grec abax, abakos, « table à calcul, table de jeu ».
Cet abax qui avait aussi le sens de « table saupoudrée de sable ou de
poussière, utilisée pour dessiner des figures géométriques », dérivait
suivant plusieurs étymologistes, d'une racine sémitique, reconnaissable dans
l’hébraïsme ābāq (prononcé « a-vak ») et signifiant
« poussière ».
L’historien
des mathématiques Alain Schärlig nous présente ainsi l’abaque de Gerbert :
« Comme on dit maintenant dans le marketing, l’abaque de Gerbert serait
donc venu occuper une ‘’niche’’ : il comblait un besoin, en fournissant de
quoi pratiquer efficacement la multiplication et la division… ».
Seuls deux
textes d’époque décrivent l’abaque de Gerbert, planche pourvue de colonnes, sur
laquelle il disposait des jetons : Richer, dans son Histoire de France
(tome II, p. 63 – livre III section 54) entre 991 et 998 et « celui de
Bernelin, qui lui consacre le premier chapitre de son Livre d’abaque ».
Bernelin, élève de Gerbert, aurait rédigé son ouvrage « pendant le
pontificat de Sylvestre II, entre 999 et 1003 ».
Si Gerbert
s’inspire de l’arithmétique arabe, il n’en utilise pas totalement les méthodes
de calcul, en utilisant notamment un abaque à jetons méconnu en Espagne, d’où
l’affirmation présentée par A. Schärlig suivant laquelle « Gerbert a
inventé son abaque, et qu’il ne l’a pas copié. » Il n’hésite pas à
évoquer : « une invention géniale, qui a permis aux sciences exactes
naissantes – et notamment à l’astronomie – de faire de grands progrès, en
rendant tout simplement possibles des calculs auxquels on devait renoncer
jusque-là. » Cet abaque disparut aux XIe ou XIIe siècle : « seules
les écoles monastiques, diocésaines ou cathédrales, préfigurations des futures
universités, développaient quelque peu les sciences exactes et effectuaient des
calculs difficiles, notamment les divisions. »
Mais A.
Schärlig s’interroge : « Gerbert aurait-il eu peur ? »
(Titre du chapitre 11) Il y avait à l’époque, face à l’Église, un grand risque
« de proposer ouvertement le remplacement de l’abaque classique – celui
qui recourait aux jetons neutres – par le calcul écrit tel que le pratiquaient
les Arabes andalous. Ce transfert d’une technique à l’autre s’est réalisé
beaucoup plus tard, à partir du 13e siècle seulement, et de surcroît
très progressivement. » A. Schärlig ajoute au sujet de l’abaque de
Gerbert : « mais c’est en réalité une imitation du calcul arabe qui
se déroule quant à lui en numérotation de position ; à ceci près que grâce
aux colonnes, on y fait du nouveau calcul sans recourir au zéro (qui fut
remplacé par un espace vide). Et donc sans en avoir l’air ! »…
« Ce que Gerbert a peut-être caché serait donc encore plus important qu’on
ne l’imagine en première analyse : ce serait tout simplement qu’il
connaissait le nouveau calcul et ses quatre opérations ! »
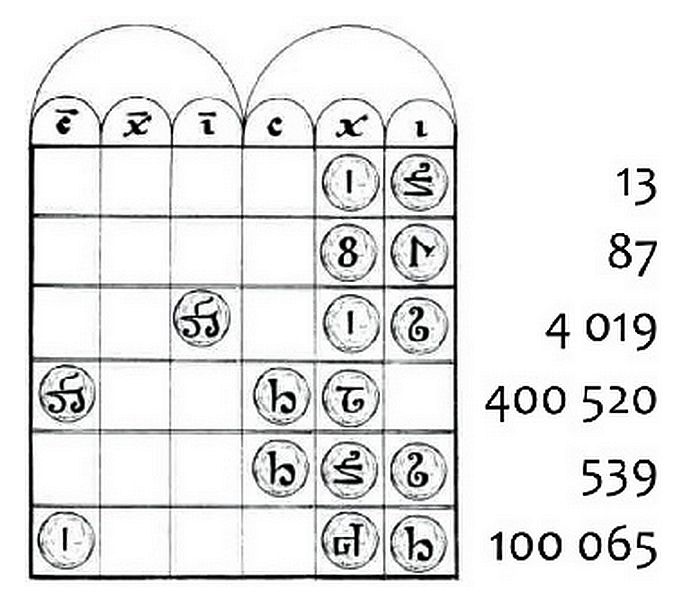
L’abaque de Gerbert d’Aurillac
Il convient
de découvrir sur le sujet la très intéressante traduction du Liber Abaci
(Libre d’Abaque) de Bernelin, élève de Gerbert d’Aurillac. Cette
traduction a été faite par Béatrice Bakliouche, professeure de l’Université
Paul Valéry de Montpellier (Éditions des Régionalismes 2000/2001).
Gerbert
réalisa également l’Horloge à Foliot. Le foliot est un balancier horizontal.
Les chroniqueurs du XIIe siècle, à
l’instar de de Guillaume de Malmesbury, dans son Histoire des rois anglais,
vont écrire la légende diabolique de Gerbert. À Cordoue, le jeune moine aurait
logé chez un savant arabe, dont il aurait volé les papiers et enlevé la fille.
Le diable avec qui il aurait fait un pacte, l’aurait ensuite aidé à franchir
les mers. Cet autre chroniqueur, Gautier Map, dans ses Contes pour les gens
de Cours, consacre pareillement un chapitre sur Gerbert et le diable.
Les légendes diaboliques vont se succéder jusqu’au XVIe siècle.
En 1580
Montaigne en visite à Rome, découvre scandalisé ces légendes : « Dans l’église Sainte-Croix, écrit-il, est
l’histoire du pape Sylvestre second qui est la plus injurieuse qui se puisse
imaginer » (Journal de voyage en Italie par la Suisse et l’Allemagne en 1580
et 1581, éd. Ch. Dedeyan.
Gerbert est
ensuite oublié jusqu’au XIXe siècle, l’heure est à la
réhabilitation. En 1819, Charles Raulhac, conservateur des Antiquités et
premier adjoint du maire d’Aurillac, célèbre Gerbert, l’enfant du pays.
L’historien
Pierre Riché, dans son article Gerbert d’Aurillac et Jules Verne au milieu
du XIXe siècle indique :
« En 1842, est publiée en France la traduction de l’Histoire du pape
Sylvestre II et de son temps et, plus tard, l’Écho du Cantal donne
un article sur Gerbert et les astres. C’est à cette époque que
Louis-Furcy Grognier, maire d’Aurillac de 1840 à 1848, voyant que
Clermont-Ferrand se prépare à avoir une statue de Vercingétorix, décide d’en
faire ériger une de Sylvestre II. » (Bulletin de la Société Nationale des
Antiquaires de France, 2010, 2015. pp. 85-96)
https://www.persee.fr/doc/bsnaf_0081-1181_2015_num_2010_1_12061
En ce XIXe siècle Gerbert est mis en avant en
tant qu’inventeur de l’horloge à échappement. Pierre Riché pose une question à
laquelle il répond ainsi : « Mais qu’entendre par là ? Une horloge a
trois parties : le moteur, le balancier et l’échappement, un organe intermédiaire
qui laisse échapper à chaque oscillation du balancier une dent de roue, dit
‘’échappement’’ ».
En 1854 Le
Musée des familles, l'un des tout premiers périodiques illustrés à bas prix
du XIXe siècle à voir le jour en France, publie un numéro spécial
consacré à l’horloge et à la montre. Une partie de l’article évoque le
« pape mécanicien ». Pierre Riché nous apprend que Jules Verne
« connaît le Musée des familles où il publie notamment Un voyage en
Ballon, en 1851, et en 1852 une pièce, Les châteaux en Californie. Il y
découvre aussi l’article sur les horloges, s’y intéresse, et la revue lui
commande une nouvelle sur un horloger, inventeur de l’horloge à échappement. Il
écrit alors, en 1854, Maître Zacharius ou l’horloger qui avait perdu son âme. »
Jules Verne
pour son récit fantastique utilise la sombre légende de la création de
l’horloge à échappement. Il convient de lire l’article de P. Riché mais aussi
la nouvelle à clés de Jules Verne.
La troisième
réalisation attribuée à Gerbert sur laquelle nous allons à présent nous
pencher, est l’énigmatique tête « parlante ». Gilette Ziegler
dans son livre GERBERT Le Pape de l’an mil, publié aux éditions C. A.
L., sous la direction de Louis Pauwels que nous retrouvons plus avant, nous
présente une bien mystérieuse tête : « Il avait aussi découvert que
grâce à des lames de longueurs différentes, disposées sur un cylindre que
faisait mouvoir un mouvement d’horlogerie, il pouvait reproduire la voix humaine,
la faisant sortir de la bouche d’une tête de cuivre ou de bronze. Cette tête
frappait d’admiration ceux qui l’entendaient répondre aux questions
posées. »
Le OUI ou le
NON prononcé par la tête lors des réponses pouvait rappeler d’autres réponses
murmurées lors des séances de spiritisme ou de nécromancie, aussi les
chroniqueurs médiévaux affirmèrent rapidement qu’elle prédisait l’avenir mais
surtout qu’elle le faisait sous l’inspiration du diable. Coulée dans le cuivre,
cette tête, ainsi qu’indiqué par le Père Migne en 1853 dans la Patrologie
latine (Tome CXXXIX), était le résultat de secrets que Gerbert tenait des
Arabes. Sa réalisation devait coïncider avec le moment où toutes les planètes
sont à l’entrée de leur course. Ce procédé, suivant Gerbert, était fort
simple et correspondait au calcul avec deux chiffres.
Dans Le
Matin des Magiciens, Louis Pauwels et Jacques Bergier évoquent l’une des
plus puissantes sociétés secrètes historiques connue sur la Terre, celle des
Neuf Inconnus dont Les manifestations extérieures sont rares. Gerbert
d’Aurillac « aurait fait séjour en Espagne, puis un mystérieux voyage
l’aurait mené aux Indes où il aurait puisé diverses connaissances qui
stupéfiaient son entourage. » Suite à ces deux voyages, Gerbert aurait
créé cette tête de bronze. Pour les deux auteurs « Il s’agirait d’un automate
analogue à nos modernes machines binaires. […] Le numéro d’octobre 1954 de
Computers and Automation, revue de cybernétique, déclare : ‘’Il faut
supposer un homme d’un savoir extraordinaire, d’une ingéniosité et d’une
habileté mécaniques extraordinaires. »
Le voyage
aux Indes,
bien que réalisé physiquement par l’apôtre Thomas ou par son contemporain
Appolonius de Tyane, n’était guère aisé à réaliser à l’époque de Gerbert. Le
voyage en Espagne bien que long était assurément plus réaliste en tenant compte
du fait que le futur pape eut une vie bien remplie sur le vieux continent. Le
voyage aux Indes apparaît, pourrions-nous le penser, dans sa réalisation,
proche du Voyage en Espagne opéré par de célèbres hermétistes, tel
Nicolas Flamel.
Gerbert
d’Aurillac apparaît comme l’un des vecteurs ayant donné naissance à l’Ordre du
Temple. Gérard de Sède dans son livre Les Templiers sont parmi nous,
place la tête « parlante » de Gerbert dans le chapitre
évoquant LE BAPHOMET. Jean-Michel Angebert dans son livre Les cités
magiques (Éditions Albin
Michel) affirmait aussi l’énigmatique tête comme l’ancêtre du Baphomet des
Templiers.
Certains auteurs, il est
intéressant de le rappeler, ont rapproché l’étymologie du mot Baphomet des
langues sémitiques : l’arabe, l’araméen ou l’hébreu. La tradition
hébraïque évoque les téraphim bibliques dont le nom provient de rapha,
« médecin », mot dont le pluriel Rephaïm caractérise ces êtres
mystérieux vivant sur Terre avant le Déluge. L’article Wikipédia évoquant les
Téraphim rapproche ces objets, de la tête oraculaire des Harraniens
racontée par le khalife Mamoun en 930. Cette tête dans l’article est aussitôt
rapprochée de celle de Gerbert présentée comme une « tête d’or ». Ce
thème oraculaire se retrouve dans l’énigmatique « tête orphique »,
thème proche de celui de « Dion Bouche d’Or » ainsi que dans la
« Bouche de lampe » (saint Philippe) de la Légende dorée.
La célèbre JewishEncycopedia
apporte quelques éléments intéressants permettant d’approcher la tête
« parlante » de Gerbert :
« Ibn Ezra (sur Gen. lc)
enregistre deux définitions de « téraphim » ; à savoir (1) un cadran de cuivre
au moyen duquel on pouvait connaître l'heure exacte, et (2) une image faite par
les astrologues à une certaine heure et sous l'influence de certaines
étoiles, qui le faisait parler. Ibn Ezra lui-même était favorable à cette
dernière interprétation, qui ressort de I Sam. XIX. 13, 16 que les téraphim
avaient la forme d'un homme. Na’manide (sur Gen. lc ), cependant, pense que si
les téraphim de Laban auraient pu être des idoles, ceux de I Sam. ne l’étaient
pas, dans la mesure où il ne pouvait y avoir aucune idole dans la maison de
David. Il pense qu'en général les téraphim étaient des tables astrologiques
au moyen desquelles on pouvait connaître les événements futurs (comp. Ḳimḥi
sur I Sam. lc ). Le ‘’Sefer ha-Yashar ‘’ (section « Wayeẓe », pp. 46b-47a,
Livourne, 1870), après avoir repris la description que Pirḳe R. Eliezer donne
des téraphim, déclare qu'ils étaient en or ou en argent, en l'image d'un homme
et à un certain moment, et que par l'influence des étoiles ils révélaient
l'avenir. Il ajoute que les téraphim de Laban appartenaient à cette dernière
description. »
https://jewishencyclopedia.com/articles/14331-teraphim
Pour Gérard de Sède, la tête
« parlante » de Gerbert doit être rapprochée des « machines
à penser », déjà répandues à l’époque où il rédigea son livre. De là à
parler d’I.A. ou Intelligence Artificielle, c’est peut-être franchir un grand
pas ! Gerbert, homme du Xe siècle n’en était pas moins un grand
savant.
Gerbert d’Aurillac : entre
sociétés secrètes et Royauté
Gilette Ziegler nous
présente 33 ans durant – de 970 à 1003, année de sa mort – un Gerbert affilié à
la société secrète des Croyants
dont le désir était de revenir à un christianisme primitif, tout en proclamant
« l’unité spirituelle des trois grandes religions issues d’Abraham. »
Cette société secrète, paraît
très proche de la Confrérie de bâtisseurs
dont Gerbert fut membre, toujours suivant cette auteure. Lors de son initiation
dans la cathédrale de Reims dont il deviendra plus tard l’archevêque, deux
hommes revêtirent Gerbert d’une robe blanche. Puis l’Évangile de Jean ouvert sur l’autel fut posé sur sa
tête pour lui transmette l’Esprit…
Le Conseil suprême des Croyants aurait affirmé au pape des 3 R : «
Écoute ; dans cette Jérusalem que *Henri veut conquérir, Jean nous a dit que se trouvait le trône du
Maître. C’est là que furent gardées, tu le sais, les Tables de la Loi rédigées
par Moïse, qui avait recueilli la science éternelle des Égyptiens. Il les avait
fait placer dans l’Arche d’Alliance, qui fut ensuite enfermée dans le Temple
construit par Salomon. Jamais ce trésor n’a été retrouvé. C’est à nous de le
découvrir. »
*Henri
duc de Bavière.
Gerbert
d’Aurillac vécut dans l’ombre des rois qu’il faisait et défaisait, ainsi que l’affirment les chroniqueurs. Le roi
Étienne de Hongrie, le « petit » roi Otton des Romains (futur Otton
III empereur du Saint-Empire) et Hugues Capet lui devaient leur couronne.
Conseiller
de l’empereur Otton II, il fit élire Hugues Capet sur le trône des Rois Francs.
Hugues était le fils du duc des Francs Hugues le Grand et naquit en 941 dans le
primitif château de Dourdan où se prépara l’avènement de la 3e race
des rois Francs, ainsi que l’écrit Daniel Réju (La Quête des Templiers et
l’Orient – Éditions du Rocher) « avec l’appui
d’illustres personnages : les évêques de Laon et de Reims et Gerbert
d’Aurillac… pour ce dernier, officiellement, le temps des Carolingiens était
révolu et il fallait porter au trône de France une dynastie capable de bâtir
une alliance durable avec le saint Empire Romain Germanique. »
Et
Daniel Réju d’ajouter : « La tradition assure que des réunions
initiatiques à l’usage de la famille de France, se tinrent en ce château de
Dourdan à l’époque des premiers Capétiens et qu'elles se poursuivirent tout au
long de la monarchie : les souverains venaient à Dourdan pour y rencontrer
de mystérieux émissaires chargés de leur révéler certains secrets relatifs aux
sources de leur pouvoir… »
Après
sa proclamation au château de Senlis en 987, Hugues Capet conte de Senlis et
duc des Francs est acclamé roi de France par les Grands du Royaume réunis
autour de l’archevêque de Reims Adalbéron dans la crypte de l’ancienne
chapelle. Il sera sacré roi le dimanche 3 juillet à Noyon par Adalbéron.
La
nouvelle chapelle, la chapelle royale de Saint-Frambourg fut fondée vers 993
par Adélaïde d’Aquitaine, reine de France et épouse d’Hugues Capet. Saint
Frambourg ou plus précisément saint Fra(i)mbault de Lassay, apparaît comme le
protecteur de la famille royale et du royaume.
En
1177 le roi Louis VII le Jeune va reconstruire la chapelle d’Adélaïde. Réjane
Molina (La chapelle royale Saint-Frambourg de Senlis et
le Graal – in La légende arthurienne de la
Normandie – Éditions Charles Corlet), nous commente quelques
sculptures de l’édifice : « Les deux clés de voûte orientales du
chœur sont ornées de fleurs de lys surmontées de ‘’crapauds’’ ou
‘’raines’’ ; trois autres clés présentent, en surplomb du motif floral,
des sculptures en forme de masques ; deux d’entre elles ont pu être identifiées
comme étant représentatives des rois Hugues Capet et Louis VII ; la
troisième représenterait-elle Clovis ? La reine Adélaïde, pour sa part,
figurait, comme il se doit, au frontispice de la chapelle. »
Pour
cette auteure les crapauds de Senlis renvoient aux crapauds de Reims,
« ville dont l’histoire est étroitement liée à celle de Clovis et à la
naissance de la monarchie chrétienne franque. » Elle
ajoute concernant le royal crapaud : « Cet animal lié au
fondateur de la royauté française, pouvait également servir, en raison de son
caractère aquatique, à évoquer le saint éponyme de la chapelle. »
Sans
faire de l’ombre à saint Denis, il apparaît que saint Frambault ou Frambourg
fut également reconnu comme le saint protecteur du Royaume de France.
R.
Molina n’hésite pas écrire : « Fleurs de lys surmontées d’un crapaud
= Protection accordée par saint Frambourg à la royauté française depuis les
origines. »
Au
XXe siècle, des chercheurs, tels Jean Charles Payen de l’Université
de Caen qui présente l’ouvrage dans lequel Réjane Molina ou Michel Vital Le
Bossé, ont pu mettre en relief de nombreux points concomitants existant entre
les « les ermites du Passais » et les Chevaliers de la Table
Ronde : Ortaire (Athur), Frambault de Lassay ou du Lac – Fram = la
framée : lance des Francs – (Lancelot du Lac), ou bien encore Front
que l’on retrouve au centre du Passay à Donfront. Jean Markale ne rejetait pas
cette hypothèse, rappelant que Lancelot est « l’image héroïsée d’une
ancienne divinité celtique, probablement le dieu Lug. » Dans son Dictionnaire de Mythologie Celtique (Éditions entente),
il rappelle : « Une thèse récente voit dans Lancelot du Lac une
héroïsation d’un ermite du VIe siècle, saint Frambault, ou
Frambourg, et lui donne comme lieu d’origine le Passais, aux frontières du
Maine et de la Normandie (région de Domfront et de Lassay), où le culte de
saint Frambault est très répandu. »
Cette
hagiographie ou chevalerie fractale, fut semble-t-il connue des premiers rois
capétiens mais aussi de Gerbert d’Aurillac qui, Réjane Molina le rappelle,
fut : « enfant d’Auvergne comme saint Frambourg, et qui devint le
premier pape français ». Le « trésor d’Adélaïde »,
du nom de la première souveraine de la dynastie capétienne, déposé dans la
chapelle Saint-Frambourg de Senlis élevée au rang de collégiale, sans cesse
enrichi par ses successeurs et considéré comme l’un des plus importants
reliquaires du monde occidental, « abritait, ainsi que nous le rapporte
cette auteure, deux catégories de reliques : - celles des saints qui ont,
illustré le Maine (en particulier le Bas-Maine) depuis l’époque mérovingienne,
- de nombreuses reliques de la Passion. Dès lors, l’existence d’un lien entre
ces deux types de reliques semblait, s’imposer et il convenait d’en découvrir
la nature. »
La
pierre tombale de saint Frambault fut intégrée à l’angle nord de l’église de
Saint-Fraimbault-de-Lassay. Elle comportait trois motifs gravés en creux :
un trèfle, un calice et une épée. Ces trois symboles sont aujourd’hui visibles sur le fronton de la chapelle Saint-Frambourg
de Senlis.
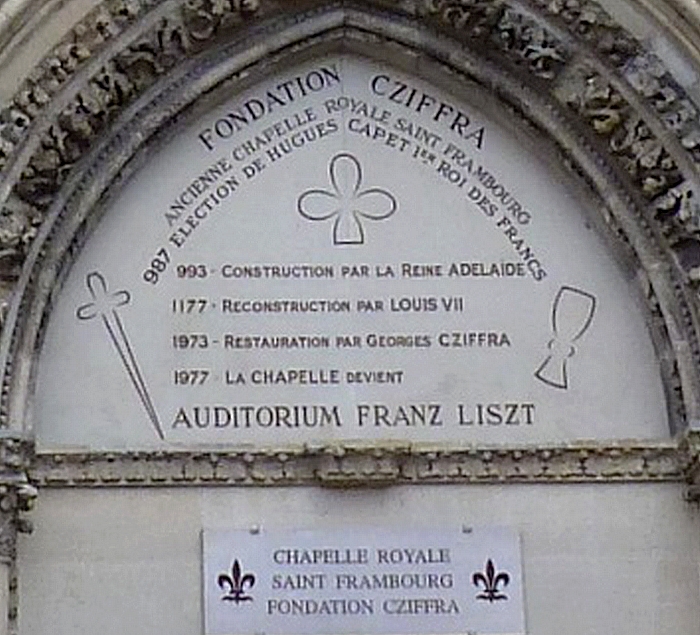
Fronton de la chapelle Saint-Frambourg de Senlis
Les lecteurs ayant pu
lire dans le n° 460 de la revue Atlantis mon article De Reines à Reines ou
le Chemin Dyonisien du Nid d’Oiseau, connaissent l’importance de saint
Front (figure fractale de Taliesin : Front Brillant, l’émule de
Merlin) au sein de la Royauté Française. L’un des points géographiques majeurs
de ce Chemin est la Forêt d’Écouves, forêt royale balisée pour les chasses
royales, par des bornes indicatrices des communes alentours mais dont la
graphie interroge assurément.
Et Gerbert d’Aurillac
devint Pape Sylvestre II
Jean-Michel Angebert
dans son livre Les Cités magiques (Éditions Albin Michel), s’est
intéressé à La Rome magique du Moyen Âge : « Otton III avait
rêvé, en faisant accéder son ami Gerbert au pontificat, de ‘’ressusciter
l’ancien Empire romain, sous la forme nouvelle d’un Empire chrétien où le pape
et l’empereur – ‘’ces deux moitiés de Dieu’’
–, installés côte à côte à Rome et fraternellement unis seront les
maîtres du monde* ».
*Citation tirée du
livre de Léon Homo : Rome médiévale, p. 88.
Pour J.-M Angebert,
« le plus intéressant des pontifes romains est sans aucun doute Gerbert,
le moine d’Aurillac, devenu pape sous le nom de Sylvestre II (999-1003). Bien
sûr, bien qu’il évoque les sulfureuses légendes liées à Gerbert d’Aurillac, il
ne les cautionne pas. Il rapporte les paroles latines prêtées « à
Sylvestre II par un poète anonyme qui
connut bien le pape-initié », ainsi traduites en français : « Ne
soyez pas surpris que le vulgaire ignorant m’ait pris pour un magicien ;
j’étudiais la science d’Archimède et la philosophie quand c’était une grande
gloire de ne rien savoir. J’étais donc un sorcier pour les sots ! Mon
tombeau vous dira combien j’étais pieux, honnête et religieux. »
En 1648, des
réparations de la basilique du Latran parurent nécessaires et il fallut toucher
au sépulcres des papes placés dans la nef et sous le portique. Le chanoine du
Latran, César Rasponni dressa un procès-verbal dans lequel il établit un
rapport sur le corps du pape Sylvestre II, trouvé entier couché dans le marbre
du sépulcre à une profondeur de 12 palmes (1 mètre). Revêtu des ornements
pontificaux, il fut réduit en poussière à l’instant par l’action de l’air. À
l’intérieur de l’anneau du pêcheur était gravée l’inscription « Sic
transit gloria Mundi » (Ainsi passe la gloire du monde). Les
lecteurs de l’hermétiste Fulcanelli connaissent l’importance de l’expression
latine « gloria Mundi ». J.-M. Angebert pense au sujet du
cercueil qui fut alors encastré dans un énorme pilier face au maître-autel où
il demeure encore « Sans doute n’a-t-il pas livré tous ses secrets car
Gerbert fut un grand initié, précurseur des Roses+Croix dont il égalait la
science par l’influence qu’il exerça sur les hommes de son temps. »
Pour cet auteur qui
relate ces faits pages 174 et 175 de son livre, le récit circonstancié de cette
exhumation relatée par le chanoine César Rasponi « à plus d’un titre,
revêt une signification johannite et prémonitoire si l’on songe que le pape de l’an
1000 (aux trois « R) annonçait les
temps apocalyptiques et la renaissance de l’an 2000 ».
Ces derniers mots
peuvent surprendre. Il convient de revenir à la page 172 où l’auteur présente
ainsi le pape de l’An 1000 : « L’ancien bénédictin, abbé de Bobbio,
est surnommé ‘’le pape aux trois R’’ car sa vie se partage entre Reims, Ravenne
et Rome. Si l’on veut bien se souvenir de l’inscription secrète ‘’RRR’’ gravée
sur la paroi d’un temple romain accompagnée du Phénix, on comprendra
mieux la destinée de ce pape, initié à bien d’autres mystères que ceux de
l’Eglise chrétienne. »
Dans une note,
l’auteur renvoie le lecteur au prochain chapitre titré, La symbolique
étrusque du faisceau, dans lequel il présente de longs extraits traduits de
l’italien et figurant dans l’ouvrage Introduction à la Magie (par les
soins du Groupe d’Ur, éd. Bocca, Rome 1955). Dans ce livre on découvre sous la
plume d’un certain Ekatlos un bien curieux récit. Les textes de UR et KRUR
seront traduits et édités en français par les éditions Archè Milano. Ekatlos
dans l’édition française est présenté comme un « personnage richissime,
puissant et bardé de titre, savant orientaliste, représentant de l’aristocratie
‘’noire’’ (i.e. papale)… » Sa véritable identité serait Leone Caetani
(Wikipédia), prince de Teano, né en 1869, issu de la même famille que
celle du pape Boniface VIII. Dans le dernier paragraphe de cet écrit Ekatlos
rédige cet intriguant paragraphe :
« Dans une rue
proche, très centrale de la vieille ville […] au lieu où l’on célébrait le
culte isiaque au temps de la ‘’Rome des Césars’’ (et des restes d’obélisques
égyptiens furent découverts à cet emplacement), se dresse un étrange petit
édifice. De ce témoin historique, une seule particularité est
remarquable : comme l’indestructible certitude d’un possible renouveau de
la Fortune romaine, dans la partie la plus secrète de cette construction on a
inscrit, et l’on peut encore le déchiffrer aujourd’hui, un signe qui, en des
temps pareils, est un symbole hermétique : le phénix couronné renaissant
parmi les flammes. A l’intérieur de ce signe, ces lettres :
R.R.R.
I.A.T.C.P. »
Bien que Julius Évola directeur de la revue UR avait évoqué sans la
nommer une dame anthroposophique, Ricordo di Marco Baistrocchi spécialiste de
l’Égypte et de l’Inde anciennes et surtout de la Tradition de Rome ou romanologia
des origines à nos jours, reconnu derrière Ekatlos, l’historien Léone Caetani.
Dans l’article « Il Genio di Roma », soit en français « le Génie
de Rome », (revue Politica Romana 3/1996) qu’il signa l’Anonimo Roma
(l’Anonyme de Rome) il est revenu sur les lettres I.A.T.C.P. en indiquant que
« les lettres qui vont d'une aile à l'autre de l'oiseau auguste ne sont
pas IATCP, mais IAPTC. » Julius Évola avait déjà rajouté un
« S » à Ekatlo. Il est possible que la position des lettres aient été
modifiées.
J.-M. Angebert note : « R.R.R., sans doute : ‘’Roma
renovatus resurgit’’ ? A rapprocher de Sylvestre II, le pape aux trois
R… » Cette lecture latine va dans le sens de l’analyse présentée sur les
sites italiens du Net pour cette inscription. Les 5 autres lettres IATCP ou
IAPTC apparaissent assurément, elles aussi, comme un acronyme latin de nature
hermétique. J.-M. Angebert n’apporte aucune lecture des 5 lettres. Le chapitre La
Rome magique du Moyen Age dans lequel il évoque le pape des 3 R, apparaît
dans le prolongement du chapitre Les lieux secrets de Rome dans lequel
il évoque La porte alchimique et le mystère de la Villa Palombara en
renvoyant le lecteur au livre d’Eugène Canseliet, DEUX LOGIS ALCHIMIQUES.
Dans cette villa se découvrent les lettres BS ainsi que l’énigmatique
inscription latine : QVANDO IN TVA DOMO NIGRI CORVI PARTVRIENT ALBAS
COLVMBAS TVNC VOCABERIS SAPIENS que le disciple de Fulcanelli traduit :
« Quand, dans la maison, les noirs corbeaux auront enfanté de blanches
colombes, alors tu seras nommé le sage ». Si nous conservons l’énoncé des
5 lettres se terminant par CP, nous pourrions envisager un possible CORVI
PARTVRIENT : « les corbeaux auront enfanté », à savoir,
l’engendrement des blanches colombes. Pour l’autre énoncé nous pourrions
envisager pour les lettres AP, les mots latin Albus Phœnix, le «
Phénix blanc » : la quintessence du feu, aussi représentée par la
colombe blanche régnant au-dessus d’une nuée flamboyante.
Dans
le dernier chapitre consacré à Rome, Les temps à venir,
J.-M. Angebert, sitôt après avoir fermé le chapitre précédent en évoquant les
lettres énigmatiques et le Phénix, en vient à évoquer Pierre Romain, le dernier
pape et son double « le grand monarque », l’un et l’autre liés,
semble-t-il à la cité du Caput Olus, la Tête d’Olus… Rome. La boucle serait
bouclée ?
Il n’est quelque
part, guère surprenant qu’un homme comme Sylvestre II, très en avance sur son
temps, aurait pu être comparé à un Phénix renaissant parmi les flammes et ainsi
revêtir après sa mort, et ce tout au long des siècles, une aura d’ubiquité couvrant
et l’An mil et l’An deux-mille.
L’Église qui avait
retiré le nom de Sylvestre II de la longue liste des papes, à reconnue
aujourd’hui son pontificat comme celui d’un grand pape. Le 12 mai 2005 à Rome
en l’église Sainte-Marie-des-Anges, en ce début de troisième millénaire le
Conseil pontifical rendait hommage au pape Sylvestre II. Le cardinal Paul
Poupard, spécialiste du pape Sylvestre II
préside la messe.
« Le 11 mai
2003, Jean Paul II avait fait référence à Sylvestre II, évoquant alors les
racines chrétiennes de la France. Profitant de la présence d’une délégation
française venue célébrer le pape de l’An 1000, Sylvestre II, à l’occasion du
millénaire de sa mort, Jean Paul II avait présenté ce premier souverain pontife
d’origine française comme ‘’exemple’’, à l’heure de la construction européenne.
Sylvestre II, Gerbert d’Aurillac, fut qualifié d’ ’’homme le plus cultivé de
son temps’’. De fait, avait souligné Jean-Paul II, ‘’il a singulièrement dominé
son siècle par ses connaissances et son érudition, par sa droiture morale et
son sens spirituel’’. ‘’Il fut à la fois un intellectuel et un homme d’action,
un diplomate et un homme d’Eglise. Si les questions actuelles sont différentes
de celles qu’il eut à affronter, son attitude spirituelle et intellectuelle
demeure un appel à rechercher la vérité humaine, qui jamais ne s’oppose aux
vérités de la foi’’. (apic/imedia/ms/pr) »
Ainsi que le rapporte
le journal La Croix le 09/04/2013, le cardinal Paul Poupard, Président
du Conseil Pontifical de la Culture se trouve à Aurillac. Dans son homélie
adressée à Monseigneur Séjourné, évêque émérite de Saint-Flour, il s’extasie
comme il l’a souvent fait, sur le pape de l’An 1000 :
« ‘’1. « Mon
Seigneur et mon Dieu ». Le cri de foi de Thomas est un cri de joie. C'est aussi
le nôtre, au cœur de cette Eucharistie, où Jésus se donne à nous en nourriture
sous les espèces du pain et du vin. Nous sommes dans la joie de Pâques, en ce
dimanche, mémorial de la Pâque du Seigneur, et anticipation de l'éternité qui
s'ouvrira pour nous, au terme de la succession de nos semaines terrestres. Car
pour Dieu, un jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour. Mille
ans, un millénaire, c'est comme un gouffre insaisissable pour notre
imagination. Quand j'étais enfant, j'entendais parler de l'An mil comme d'un
passé mythique quasi légendaire, et l'An deux mille apparaissait si lointain
qu'il revêtait une coloration intemporelle. Aujourd'hui j'ai le privilège
d'être l'Envoyé extraordinaire du Pape de l'An 2000 pour le millénaire du Pape
de l'An 1000, le premier Pape français, qu'il me revient de célébrer au nom du
premier Pape polonais. L'Église s'incarne dans le flux des temps et le mystère
de l'Incarnation se poursuit à travers les temps par le ministère de l'Église,
« Jésus-Christ répandu et communiqué ‘’.
« 2. Nous
évoquons aujourd'hui le ministère papal de Gerbert d'Aurillac, moine, évêque et
Pape dans l'Église de son temps, intellectuel et homme d'action, savant,
diplomate et homme d'Église, qui sut conjuguer l'art de bien vivre et l'art de
bien dire, faiseur et défaiseur de rois, secrétaire du Roi de France Hugues
Capet, puis de l'Empereur Otton III le Germanique, lettré ami des livres et des
hommes, rompu à la science arabe et à l'astrologie, passionné aussi bien de
médecine que de mécanique, d'un savoir encyclopédique et capable d'inventions
pratiques, sphères et astrolabes, machines à calculer avant la lettre.
‘’Unissons toujours, disait-il, la science et la foi’’.
Nous ne pouvons que
méditer sur ces quelques paroles du pape Sylvestre II, le pape de l’An 1000.
Quant à l’évocation de l’apôtre Thomas qui évangélisa les Indes elle n’est
assurément, pas anodine. Le cardinal Paul Poupard se fait plus clair, mais
aussi plus hermétique, lorsqu’il commence ainsi la 3e partie de son
homélie, en évoquant 3 hommes, trois époques, mais un seul message
(tri-unitaire) :
« 3. Mon
Seigneur et mon Dieu. Avec l'apôtre Thomas, avec Gerbert d'Aurillac, Pape
Sylvestre II de l'An mil, avec Karol Wojtyla, Pape Jean-Paul II de l'An 2000,
avec toutes les communautés chrétiennes répandues à travers le monde, nous
vivons la même foi au Christ ressuscité, avec toute l'Église, une, sainte,
catholique et apostolique, communauté de foi, d'espérance et d'amour. »
