Dossier Mars
2012
|
|
VALFLEURY Trésors et curiosités
d’un petit village entre
Pilat et lyonnais  Par PATRICK BERLIER |
|
Lorsque l’on monte vers le Pilat à partir de Saint-Chamond, arrivé à Chavanol on peut prendre le temps d’admirer la vue sur la vallée du Gier et les monts du Lyonnais. Au-delà de Saint-Chamond, derrière la première ligne de crête on devine la vallée de la Durèze, parallèle à celle du Gier. C’est là que se cache le village de Valfleury, invisible, ne se découvrant que lorsqu’on y arrive, si près du Pilat pourtant. C’est un bon prétexte pour s’y intéresser. |
|
PETITE
HISTOIRE D’UN GRAND LIEU DE DEVOTION Ce modeste village doit sa célébrité au sanctuaire marial qu’il abrite, fondé suite à la découverte d’une statue de la Vierge aux alentours de l’an 800. Un soir de Noël, des bergers eurent leur attention attirée par un bouquet de genêts miraculeusement fleuris dans la neige. Et au cœur de ces genêts, près d’une source, les attendait une petite statue de la Vierge, en bois sombre. Ils la rapportèrent chez eux, à Saint-Christo, où elle trouva sa place dans l’église. Mais le lendemain la vierge était retournée dans son vallon sauvage. Alors on décida d’élever un oratoire à cet endroit. Bien vite quelques chaumières vinrent l’entourer. Ainsi est né le val fleuri. Puis rapidement la réputation de sa Vierge et de sa source draina vers lui les chrétiens des environs, les premiers miracles s’accomplirent. Mais le temps passant, on négligea les miracles du val fleuri. Ce sont les Lazaristes, installés à Valfleury depuis la fin du XVIIe siècle, où ils ont succédé aux Bénédictins, qui ont relancé un pèlerinage un peu tombé dans l’oubli. Le curé de la paroisse était désigné par le diocèse de Lyon, et choisi parmi les membres de leur communauté. Généralement c’était son supérieur. Le succès du pèlerinage doit beaucoup à James Lugan, supérieur des Lazaristes et curé de la paroisse, qui à partir de 1840 passa 28 ans de sa vie à Valfleury. Authentique aristocrate languedocien, originaire des environs de Montauban, le comte James Lugan fit construire la nouvelle église, s’adressant à celui qui allait devenir le maître d’œuvre de Notre-Dame de Fourvière à Lyon, le « prince des architectes », Pierre Bossan. C’est le style néogothique, alors très à la mode, qui fut adopté pour la nouvelle église ; Pierre Bossan en était l’un des spécialistes, et avait déjà réalisé dans ce style, quelques années plus tôt, l’église Saint-Georges à Lyon. Sur ce nouveau chantier, il fut secondé par l’architecte lyonnais William Léo. La
première pierre fut bénite le
22 mai 1853. Le devis prévisionnel se montait à
35 000 Francs. De cette
somme, rien ne fut demandé ni à la commune ni au
département, mais le devis
s’avéra très vite dépassé. « Je
croyais que les ressources, que Dieu
mit entre ses mains, auraient suffi », écrivait
le Père Lugan le 14
juillet 1854, en sollicitant l’aide du Préfet de la Loire, par
une lettre
toujours conservée aux Archives Départementales de la
Loire. « Le pays
se trouve en une disposition si extraordinairement difficile qu’il faut
payer
le double de tout ce que l’on peut prévoir »,
précisait-il pour se
justifier. Le Père Lugan ajoutait : « J’ai
dépensé trente sept
mille francs, il en faut encore vingt », avouant ainsi
avoir investi à
titre personnel toute sa fortune dans l’entreprise. Son appel à
la générosité
ne rencontra semble-t-il aucun écho du côté du
département. Il ne trouva pas la
totalité des 20 000 Francs manquants. Faute de
crédits, les travaux
finirent par s’arrêter. Quand le Père Lugan quitta
Valfleury, seuls l’abside et
le chœur étaient achevés. 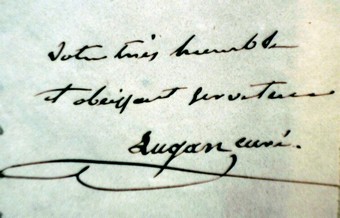 Son
successeur Antoine Nicolle
obtint en 1860 du pape Pie X le couronnement de la Vierge de Valfleury,
insigne
honneur accordé aux statues miraculeuses, qui relança la
piété et favorisa de
nouveaux financements. Le Père Nicolle en avertit la préfecture de la
Loire par un courrier en date du 22 décembre
1860, pour la forme car pas un centime n’était demandé au
département. Ce courrier
est également conservé par les Archives. On y constate
que le Père Nicolle
assortissait sa signature des trois points qui, dans la
franc-maçonnerie,
caractérisent le grade de maître. Le nouveau curé
de Valfleury était
visiblement membre d’un « réseau »
discret, grâce auquel il n’eut
aucun mal à trouver le financement nécessaire. Le
Préfet lui répondit favorablement
cinq jours plus tard, l’autorisant à ouvrir une liste de
souscription. Toutes
les grandes familles d’industriels de la vallée du Gier et du
bassin de
Saint-Étienne y adhérèrent : les Marrel et
les Fleurdelix à Rive-de-Gier,
les Granjon et la famille de Boissieu à Saint-Chamond, les
Balaÿ et les Giron à
Saint-Étienne, pour ne citer que les principales d’entres elles.
Le Père
Nicolle supervisa la construction de la nef et de la façade, et
pour les
sculptures il fit appel bien entendu à Joseph-Hugues Fabisch, le
sculpteur
officiel du diocèse de Lyon. L’église fut
consacrée en 1866. Parallèlement, le
Père Nicolle avait créé l’œuvre
de la Sainte-Agonie, archiconfrérie qui se répandit dans
le monde entier et
comptait au début du XXe siècle plus d’un
million d’adhérents.
Joseph
Courtade, qui lui succéda de 1871 à 1873, s’occupa des
aménagements intérieurs, les boiseries en particulier. Il
fallut attendre 1880
pour voir commencer à s’élever le clocher, et 1885 sa
haute flèche en pierre
terminée. On doit ces travaux à Pierre Souchon,
supérieur de Notre-Dame de
Valfleury et curé de la paroisse de 1880 à 1888. Mais les
travaux se
poursuivirent en réalité jusqu’en 1899. Entre temps, en
1872, Pierre Bossan
avait démarré le chantier de Fourvière, puis sa
santé l’ayant rapidement amené
à quitter Lyon pour la Ciotat, où il devait
décéder en 1888, c’est son disciple
et successeur Sainte-Marie Perrin qui acheva la construction de
Fourvière et de
Valfleury.
|
|
Valfleury
aujourd’hui Flânons dans le village. L’endroit reste agréable, même s’il a perdu sa fervente fréquentation de jadis. Les magasins de « bondieuseries » qui lui donnaient l’allure d’un petit Lourdes ont disparu, mais il subsiste un peu partout des décors surannés qui témoignent de l’ancienne magnificence. À l’entrée de l’église, voici une œuvre en haut-relief, réalisée par Fabisch pour orner le tympan. Elle représente la Vierge à l’Enfant, couronnée par deux anges, assise sur un tertre fleuri, vers lequel se dirigent à gauche un pèlerin, un handicapé appuyé sur ses béquilles, une mère et son enfant, et à droite un agriculteur et son bœuf. Pénétrons
dans l’église où nous
sommes accueillis par une tête de démon… Cela nous
rappelle certes quelque
chose : Rennes-le-Château, vous avez dit
Rennes-le-Château ? Mais
l’on sait désormais que le fait n’est pas si exceptionnel que ce
que l’on
croyait à une époque. Et puis contrairement à son
homologue Asmodée, le diable
de Valfleury a l’air plutôt sympathique, car il offre
étonnamment un visage
souriant, malgré ses grandes oreilles pointues et ses yeux en
escarboucles.
Les vitraux de la nef proviennent de l’atelier Mauvernay, réputé vitrailliste de ce temps et de cette région, célèbre pour ses bleus. « Regards du Pilat » s’est déjà intéressé à lui lorsque nous avons étudié les vitraux de Véranne, en particulier celui du mariage de la Vierge, dont on trouve ici une autre variante. Ceux du chœur et de l’avant-chœur sortent quant à eux de l’atelier Barlon, à Grigny (Rhône). Les seconds illustrent les litanies de la Vierge au moyen de 20 médaillons porteurs de symboles et de devises latines. Notons tout de même que ces vitraux-là ont été dessinés par le Père Antoine Nicolle. Les stations du chemin de croix attirent notre attention. Elles offrent la particularité de représenter des cavaliers romains, tout comme celles (entre autres) du chemin de croix de Notre-Dame de Marceille, dans l’Aude, qui sont dues à un certain Marc Louis Emmanuel Solon, fabricant de statues et d’ornements d’église à Paris dans le troisième quart du XIXe siècle. Solon était semble-t-il le créateur de modèles originaux, reproduits ensuite par moulage, et dont on retrouve la production un peu partout en France. Divers détails permettent de conclure que le chemin de croix de Valfleury est lui aussi de Solon, qui devait sans doute être l’un des fournisseurs attitrés des Lazaristes. Il
y a aussi dans le chemin de
croix de Notre-Dame de Valfleury des détails curieux, qui
raviraient notre ami
Daniel Dugès, auteur de Entre la rose et l’équerre,
où il traque une
société secrète paramaçonnique ayant
laissé des traces un peu partout. En effet
à la station IV un personnage, qui brandit deux des clous de la
croix au-dessus
de l’auréole de Jésus, reproduit subtilement le geste
bien connu du
« Grand Architecte » traçant de son compas
l’orbe de la terre. Là
encore, l’ombre d’une fraternité paramaçonnique et
catholique semble planer sur
Valfleury.
L’église de Valfleury se complète par un ensemble calvaire et chemin de croix champêtres, réalisé en 1881 sous le supériorat de Pierre Souchon, conçu et dessiné par le Père Forestier, construit par Jean-Marie Voron, maître-maçon et rocailleur, et agrémenté de statues en terre cuite sortant de l’atelier de Fabisch. Tout au long d’un sentier bucolique longeant le Jardin des Pères, le pèlerin pouvait se recueillir dans une suite d’édicules en rocaille, véritables petites grottes construites à peu de frais avec des résidus industriels, scories de hauts-fourneaux et déchets de verreries, mêlés à des cailloux trouvés sur place. Leur décor particulièrement « kitsch » était alors très à la mode. Après le calvaire, très ressemblant à celui de Saint-Irénée à Lyon, réalisé par le même Fabisch, le pèlerin pouvait poursuivre sa pérégrination par un chemin de croix monumental, implanté tout au long de l’Allée des Pères : quatorze croix dont les socles sont ornés de bas-reliefs en fonte, sortant des réputées fonderies d’art du Val d’Osne, à qui l’on doit aussi les décors « art nouveau » des entrées de métro à Paris, et les célèbres « fontaines Wallace. » Tous
ces oratoires souffrent
aujourd’hui des outrages du temps et de la désaffection des
fidèles ; ils
ont pourtant attiré des milliers de pèlerins dans les
années qui ont suivi leur
implantation. À tel point que cet ensemble calvaire et chemin de
croix de
Valfleury s’est doublé en 1900 d’un rosaire, procédant du
même principe et du
même art, voulu par le Père Jean-Marie de Bussy, en poste
de 1899 à 1903. Ce
rosaire composé d’une suite de quinze édicules en
rocaille a été réalisé par le
même entrepreneur. Il est orné de bas-reliefs de Fabisch,
et illustrant les
quinze mystères du Rosaire, c’est-à-dire les
épisodes de la vie de la Vierge.
L’artiste étant décédé en 1886, ces
bas-reliefs n’étaient évidemment pas une
création originale, mais plutôt sans doute des moulages
provenant de son
atelier. On peut regretter cependant les
« restaurations » naïves qui
n’ont fait qu’empâter les sculptures, par la superposition des
couches de
peintures, et l’emploi de couleurs particulièrement criardes et
tape-à-l’œil.
La
déambulation champêtre aboutit
à une tour néogothique, tout en haut du coteau,
d’où la vue magnifique
permettait de découvrir la région dans son ensemble,
jusqu’à Lyon. À condition
de ne pas souffrir du vertige ! Aujourd’hui la
végétation envahissante a
quelque peu réduit cette vue.
Chose étonnante, jusqu’à une époque récente les habitants de Valfleury n’avaient pas de nom officiel. On employait volontiers le mot « couflachures » pour les désigner, terme issu du patois et signifiant littéralement « gonfle chèvres ». Les autochtones avaient en effet jadis la réputation de frotter les pis de leurs chèvres avec des orties pour les faire enfler, et ainsi donner l’illusion de pis bien remplis, ce qui pouvait leur permettre d’en tirer un meilleur prix aux marchés aux bestiaux. Il a fallu un referendum pour remplacer ce terme peu élogieux par le gentilé officiel « Valflorentins ». |
Il est à présent
temps de retrouver notre nouvel invité, notre ami et aventurier,
Philippe Monteil.
|
 |
|
Simplement
curieux, avec un goût pour
l'aventure, une envie de comprendre le monde qui m'entoure, mes
confrères et
moi-même. D'abord étonné et passionné par
les mathématiques (j'ai
malheureusement encore du mal à cerner la mathématique,
un langage ludique ou
11 peut aussi bien valoir 3* que 6*, et qui en plus d'être
ludique nous donne
accès aux secrets de la nature), je me suis
intéressé aux regards
scientifiques, et enfin historiques. Depuis mes 14 ans je me suis
intéressé aux
grottes et à l'Ardèche méridionale en particulier,
l'exploration du monde
souterrain et les découvertes et études qui s'en suivent
m'ont permis de
croiser tous ces centre d'intérêts.
*(11 en base
2 signifie 1x2 + 1 unité soit 3, en
base 5, 11 indique 1x5 + 1 unité soit 6, les ordinateurs comptent en base 2 et les chinois avec leur
bouliers en base 5, les mésopotamiens eux
comptaient en base 60 avec leur 5 doigts d'une main pour 5
douzaines et
leur douze phalanges de l'autre main, le pouce étant le pointeur
et malgré plus
de 5000 ans qui nous sépare de cette civilisation nous comptons
notre temps
toujours ainsi...) voir Georges Ifrah, Histoire universelle des
chiffres,
1994.
D'abord les
paysages sculptés par le temps et la
force de l'eau, puis un terrain d'aventure parcouru dès
l'adolescence. Cette
potentialité, offerte dans les régions karstiques, de
découvertes de paysages
géographiques souterrains encore inconnus anime en moi une
curiosité et un
engagement motivant.
Enfin j'ai trouvé beaucoup de richesses et d'amitiés dans les rapports humains, dans et autour de l'association le Césame (http://cesame.ardeche.free.fr/) qui fréquente cette région depuis les années 60.

La grotte
Chauvet est pour moi le meilleur
exemple de la richesse de ce patrimoine karstique. Le jour de la
découverte de
ce site par mes amis spéléos ardéchois,
j'étais juste au-dessus avec mon épouse
dans les falaises du Cirques d'Estre à la recherche d'un aven
que je voulais
revoir. Mais nous n'avions pas la même motivation et, alors que
l'équipe de
Jean-Marie trouvait ce joyaux mondialement connu aujourd'hui, nous nous
n'avons
même pas retrouvé notre aven et nous avons profité
du soleil hivernal ardéchois…
Plus tard
quand j'ai appris la découverte de
cette grotte, je suis tout de suite descendu à Vallon, seul je
suis allé sur ce
site que je connaissais bien pour m'imprégner une
dernière fois de cette
ambiance. J'ai tout de suite compris que cela allait être le
déclic pour une
autre histoire. Le monde allait porter son regard vers ce site. J'en
étais en
même temps ravi et un peu apeuré. Qu'allait-il advenir de
notre terrain de jeux
?
Nous nous
doutions que cela allait finir par
arriver et nous le cherchions un peu. Avec le Césame, en 1990
pour le
centenaire de la Préhistoire nous avions publié un film
« les Gorges de
l'Ardèche aux origines de l'Art » et la
découverte de la grotte Chauvet
venait confirmer ce travail.
(Voir http://www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/chauvet/fr/)
L'intérêt
que nous y portons aujourd'hui
(scientifiques, politiques et citoyens) me motive et m'encourage. Les
efforts
de protection, d'études et aujourd'hui de restitution des
vestiges que recèlent
cette cavité me donnent une touche d'optimisme au milieu de tous
les délires
orgueilleux des modernes angoissés que nous sommes devenus. Bien
sûr le moteur
de ces investissements sont les plus anciennes et les mieux
conservées des
représentations artistiques préhistoriques, mais
l'étude pluridisciplinaire de
cette cavité amène une réflexion
paléontologique, karstologique, éthologique
même qui apporte beaucoup d'éléments de
réponse à la compréhension et la
connaissance de l'ensemble du massif. J'espère que ces travaux
feront dates et
que d'autres vestiges moins flamboyants suivront aussi ce chemin de la
protection, de l'étude et de la restitution.
Le
compte-rendu de ma visite de la grotte
chauvet sur http://cesame.ardeche.free.fr/?p=69)

4/
L’activité de spéléologie
est un autre de vos virus. Comment est né votre
intérêt pour ce ‘sport’ bien
particulier ?
Cette
activité n'est pas pour moi un sport. Bien
sûr cela demande un engagement physique et des connaissances
techniques pour la
progression sur corde et dans un milieu hostile à l'homme, mais
la spéléologie
est avant tout une école de l'humilité, du bonheur de se
dépasser, et d'avancer
de façon raisonnée. En effet dans cette activité
plus on progresse, plus le
retour sera long. Il faut se fixer des objectifs ambitieux mais
accessibles
pour le groupe. C'est une aventure humaine merveilleuse qui permet son
lot de
surprises, de découvertes…
Cela apprend
à rester humble face à la puissance
de la nature mais aussi face à la beauté des formes
sculptées ou agencées. Et
surtout c'est une école de liberté, une fois les
contraintes et le respect du
milieu acceptés...
De plus le
croisement des regards de
préhistoriens, d'historiens, de géologues, de
karstologues, de passionnés que
l'on trouve dans le milieu spéléologique, est une
richesse incomparable. (voir http://ffspeleo.fr/)
Notre
activité nous amène à construire des
hypothèses que l'exploration spéléologique valide
ou anéantit. C'est très
intéressant, très grisant et suivi de la
découverte de réseau c'est très
valorisant.
Il me
paraît que nos sociétés modernes vont trop
vite en oubliant le passé. L'histoire ancienne ou plus
récente se perd dans
l'instantanéité contemporaine de notre existence. Aussi
les vestiges
(géologiques, paléontologiques, préhistoriques ou
historiques) encore
observables sur et sous terre dans le milieu protégé des
grottes sont pour moi
une priorité pour parvenir à la compréhension du
monde. Et leur mise en valeur
pour le grand public afin de prendre conscience de notre histoire est
le chemin
vers la continuité de notre humanité.
Malheureusement
je n'ai pas eu la chance de
parcourir cette immense barrière montagneuse qui barre
l'accès terrestre vers
le sud. C'est uniquement dans les Pyrénées Atlantiques,
plus précisément à la
Pierre Saint Martin, haut lieu de la spéléologie connu et
reconnu dans le monde
entier que nous avons hérité d'un espace de
« jeux ». Depuis les
années 50 le monde souterrain de ce massif est exploré et
de grands explorateurs
y ont laissé un bout de leur histoire (voir http://www.arsip.fr/).
Depuis plus
de vingt ans nous passons avec
quelques amis, une quinzaine de jour en altitude à la
frontière espagnole pour
explorer ce massif. Notamment le gouffre des Partages (plus de 80 km de
réseau
depuis la jonction en 2008 avec le réseau de la Pierre Saint
Martin) dans
lequel nous avons vécu des moments exceptionnels et inoubliables
lors
d'expéditions de plusieurs jours loin, très loin du
brouhaha superficiel de la
surface. J'ai commencé à ce sujet un travail de
rédaction de quelques unes de
nos aventures mais cela n'a pas encore abouti.
Lors de ma
quête de modèles mathématiques pour
représenter le monde, j'ai été confronté au
modèle linéaire continu du temps
qui m'apparut trop simpliste en rapport à ce que je ressentais.
Aussi j'ai lu
de nombreux ouvrages de géologie, de paléontologie, de
préhistoire, de
biologie, de physique théorique, de mathématiques, de
sciences cognitives, ….
je cherchais à accéder à un modèle temporel
plus proche de ce que j'observais
entre hasard, structures et complexité. Mais mon manque de
culture, ma
difficulté à accéder aux ouvrages philosophiques
incontournables sur un tel
sujet, ne m'ont pas permis d'accéder à cette quête.
Il fallait revoir mes
ambitions, être plus modeste alors j'ai écris une
synthèse de ces lectures en
essayant de dévoiler la beauté et la fragilité de
cet équilibre entre hasard,
structures et complexité. Le temps d'une histoire raconte
brièvement et de
façon très accessible l'histoire de la terre, de la vie,
et des hommes en
particulier. Cette histoire est volontairement réduite à
une échelle d'un an.
Une année durant laquelle le 1er janvier se forme une
planète pour arriver le
31 décembre à minuit aux modernes angoissés. Si
certains lecteurs sont
intéressés, il m'en reste encore quelques exemplaires et
je suis ouvert à toute
proposition de réédition.
7/ Nous arrivons
sur votre
territoire de vie : le Pilat. Vous qui avez étudié
l’époque, que pourriez-
vous nous dire ou nous apprendre sur le Pilat
mégalithique ? Pierre Juthon
demeure un site ancestral remarquable. Quels commentaires vous inspire
t-il ?
Il me semble
que l'humain a toujours voué un
lien profond avec la roche. D'abord matière première pour
ses outils, la roche
devient support de ses images mentales avec l'art pariétal,
frontière entre
plusieurs mondes : jours/nuits, avant/après,
esprit/matière... Puis, avec la
sédentarisation au néolithique, la relation avec la roche
change. Cette
frontière devient « mur ». La roche est
utilisée comme protection,
d'abord des morts puis des vivants. Taillée elle devient hache,
meule, pierres
de construction. Transformée par la chaleur, elle se
métamorphose pour donner
le métal, le béton.
Dans le
Pilat, cette roche est une des plus
anciennes de France du point de vue géologique. Ces
affleurements rocheux
sculptés par le temps, ces « chirats »
désertés par le monde végétal,
marquent les paysages et ont du interpeller les hommes. De plus la
situation
géographique du Pilat entre le Rhône et la Loire en fait
un lieu particulier,
frontière hydrologique sur la ligne de partage des eaux entre
l'Atlantique et
la Méditerranée. Alors certainement les occupations
humaines ont eu un lien
fort avec ce massif. Malgré les difficultés dans la
conservation, quelques
vestiges d'époques reculées ont été
retrouvés dans le Pilat. Mais vu la
difficulté de lecture, peu de préhistoriens ont
étudié de près toutes ces
traces. En contrepartie, beaucoup de passionnés se sont
engouffrés dans
l'interprétation peut-être moins objectives sur de
nombreux sites.
Aussi pour
mieux comprendre ce Pilat
mégalithique il faudrait s'intéresser de près
rigoureusement et objectivement à
quelques sites qui me paraissent emblématiques comme le Menhir
du Flat, Saint
Sabin, ou le Moulin à Vent ces travaux nous permettraient
d'affuter notre
regard pour mieux appréhender d'autres sites remarquables comme
les Trois
Dents, Pierre Juthon, Château Bélise, ou les Roches
Merlin... En tout cas cela
me paraît un travail important, passionnant mais de longue
haleine difficile à
mettre en route efficacement dans notre contexte actuel. Il faudrait
s'appuyer
sur des regards de spécialistes extérieurs via des
structures reconnues dans le domaine (Labo
universitaire, Musée de Saint Roman en Gal ?) et trouver
quelques moyens pour
financer ce genre de projet.
Mais, en
tout cas, il y a de la matière sur le
sujet dans le Pilat.

Voilà
justement un exemple de vestiges anciens oubliés qui
méritent protection, étude
et mise en valeur. Ces sites
d'extraction de meules (des dormantes
pour la plupart) nous racontent une histoire ancienne. Suite à
une rencontre
avec Colette Veron qui réalise une thèse sur les
meulières en Ardèche et a
publié un article dans Ardèche Archéologie, une
revue de la Fédération
Ardéchoise de Recherche Archéologique et
Préhistorique en Ardèche (http://www.farpa-ardechearcheologie.fr/), j'ai pris
contact avec son directeur de thèse, Alain Belmont,
universitaire du Laboratoire de Recherche Historique en Rhône
Alpes, qui a pris
en charge la réalisation d'un inventaire européen des
meulières. Je l'ai
renseigné sur les sites du Pilat (http://larhra.ish-lyon.cnrs.fr/Database/Meuliere_fr.php).
Après de nombreux échanges nous sommes arrivés
à des conclusions très
intéressantes. L'ensemble des recherches et observations que
nous avons pu réaliser
montre que nous disposons dans le
Pilat de meulières tout à fait remarquables
abandonnées et oubliées depuis fort
longtemps. D'après
les diamètres observées, la plupart sont
forcément antérieures aux XIIIème-XIVème
siècles.
Il
reste aujourd'hui, un travail important de sauvegarde, d'étude
et de mise en
valeur à mener afin que ce patrimoine, lié à une
première activité quasi
industrielle dans le Pilat et à l'histoire du pain en europe, ne
tombe pas à
nouveau dans l'oubli. Voir l'article dans le prochain Danl'tan revue de
l'association Visages de Notre Pilat (http://visagesdenotrepilat.com/).

9/ La Fête du Livre de Roisey.
Vous avez été un acteur notoire dans le renouveau de
cette manifestation.
Comment voyez-vous l’avenir de ce moment annuel particulièrement
convivial ?
Depuis
2004, nous avons créé une association pour reprendre
l'organisation de cette
manifestation. Et nous avons réussi pour la 8ème
année consécutive à organiser
différentes actions et les journées du livre le 1er week
end de juin, afin de
dynamiser la lecture et le livre. Nous travaillons avec beaucoup
d'écoles du
canton et nous efforçons de resserrer nos liens avec les
bibliothèques locales.
Cette
année le thème fil conducteur est la littérature
policière. Il se peut bien
qu'il se passe quelque chose de surprenant dans la région et il
faudra mener
l'enquête, jusqu'au premier week end de juin où nous vous
espérons nombreux à
Roisey. (http://www.livre-ensemble.fr/)