La
légende des GAGA-ATHEUX ou nos
ancêtres les celtes |
Rémy Robert |
 |
2022 |
Il y a sept ans,
dans un article pour les Regards Du Pilat, chapitre « Farnay
terre à
cupules », je reprenais une vielle hypothèse. En
1840, un certain Baron
Walkenaer[1],
alors conservateur au département des cartes de la
bibliothèque royale de Paris
partait des distances de la carte de Peutinger, de la toponymie et d’un
peuple
rayé des cartes (et cité par Pline dans son Histoire
Naturelle (IV, 107) pour situer hypothétiquement un forum
à Farnay. Je
remettais au goût du jour une hypothèse très
contestée et contestable
de l’existence de deux forums : le fameux forum segustavorum
et un
éventuel forum segusiavorum dans la Jarez. Wlakenaer se basant
sur les
distances de la table de Peutinger nous conduisaient vers Rive-de-gier
avec les
toponymes Egarande, Milan… Cela nous
autorisait toutefois à envisager une
localisation Jarezienne pour ceux que nous pouvons nommer : Atheux
Atesui
ou Etusiates.
 Walckenaer, Charles Athanase Baron (1771-1852) Cet ensemble de noms qui
n’en formerait qu’un seul, apparait
comme un peuple bien mystérieux.
Nous retrouvons toutefois
ce nom sous la forme d’Atheux dans
nos toponymes locaux. Comme l’a récemment démontré
Pierre Teyssier : Saint-Romain-les-Atheux
mais également le hameau des Atheux à Saint-
Héand, certainement dans Saint-Jacques
d’Atticieux et comme nous allons le voir peut-être bien d’autres. Aujourd’hui,
je tiens à saluer Jacques, Pierre-Bernard, Patrick, Eric et Thierry non pas parce que leur direction me va bien
mais pour
leur travaux, leur réflexion, leur savoir et la participation
à cette aventure
chargée de nos regards sur le Pilat. Un hommage s’impose
à feu Auguste Callet*,
Etienne Abeille* et bien d ‘autres modestes et grand-détectives
de notre passé. Dans l’idée de
vouloir apporter une petite pierre à
notre édifice commun sur Regards
Du Pilat,
c’est une
approche toponymique et une réflexion quelque peu sociologique
que je propose
ici. Comme dans la plupart de
nos contrées, le Pilat
concentre les symboles du passé,
d’une
activité tout au moins d’une pratique cultuelle de peuples
anciens. Le rôle du
chercheur est de repérer, de retrouver, mais aussi d’associer, de comprendre les similitudes.   Mais
qui pourraient-être les Atheux ? Un peuple
oublié ? Atheux, Atesui tels sont les noms
connus et arrivés jusqu’à nous pour nommer un groupe
social, un peuple, une tribu
dite « Gauloise » et succinctement
évoquée par Pline l’ancien[1]
dans une
suite de peuples de la Gaule Narbonnaise et à
précédant un peuple de chez nous
(le Forez) et bien connu : les Ségusiaves. Pline nommant les Atesui juste avant les
Ségusiaves
doit-on en déduire qu’ils ne sont que peu
éloignés ? Les
écrits plus modernes nous disent : les Atheux
ou Atesui ou
Étusiates étaient un peuple
gaulois faisant partie
eux-mêmes des Ségusiaves. Ils occupaient une
région de la vallée du
Rhône, au nord de Loire-sur-Rhône.
Leur nom s'est perpétué dans le nom de Saint-Romain-les-Atheux[2]. Voilà,
le décor est planté. Toutefois et pour reprendre, une
nouvelle fois la thèse de
Walkenaer qui logeait, au final, deux forums dans la Loire, et selon
lui un
dans le Forez avec Feurs pour les Ségusiaves et un autre dans la
Jarez avec Farnay,
entre Forum Segustavarum et Segusiavorum cette histoire serait-elle,
aussi, une
histoire de double ? [1]
Pline,
Naturalis Historia, Livre IV ; La
Gaule Lyonnaise renferme les
Lexoviens, les Vellocasses, les Gallètes, les
Vénètes, les Abrincatuens, les Osismiens;
la Loire, fleuve célèbre ; une péninsule
remarquable
qui s'avance dans l'Océan, à partir des Osisiens, dont le
tour est de 625.000
pas, et dont le col a 125.000 pas de large ; au delà de
cette péninsule,
les Nannètes; dans l'intérieur, les Héduens,
alliés, les Carnutes, alliés, les
Boïens, les Sénons, les Aulerques, surnommés
Éburoviques, et ceux qui sont
surnommés Cénomans; les Meldes, libres; les Parisiens,
les Trécasses, les
Andegaves, les Viducasses, les Bodiocasses, les Unelles, les
Cariosvélites, les
Diablindes, les Rhédons, les Turons, les Atésuens, les
Segusiaves, libres, dans le territoire desquels est Lyon, colonie. [2] Abeille, E. (1912). Histoire
de
Givors. Lyon : Eds Brun.   Deux Pagus ? En y regardant de plus près et en nous
penchant sur
nos cartes, la grande toponymie ne nous apprend pas grand-chose, si ce
n’est que
voilà là des frontières bien naturelles. Le
Rhône d’un côté et de l’autre la Loire. Nous voici près du
Gier
autre nom du Jarez, sa vallée et ses coteaux avec les restes
d’un aqueduc
romain captant les eaux du Gier à Izieux et les conduisant
jusqu’à Lyon. Ce Jarez est également une zone
géographique qui nous
conduit jusqu’au nord de Saint-Etienne avec les communes de
Saint-Priest-en-Jarez,
et La-Tour-en-Jarez. Les sonorités de ce toponyme sont
voisines de Forez (pagus
forensis
ou pays de Feurs, l’antique forum segusiavorum qui donna son nom à la région).
Ce pagus fut l'une des divisions administratives du territoire
des Ségusiaves sous Auguste[1]
et cela perdura sous les Carolingiens. D’un autre côté les noms Atheux
ou Atesui nous renvoient à deux
sources possibles : -d’une part, le mot attueor signalé
par Varron (écrivain, et magistrat
romain, 1er siècle avant JC) :
signifiant regarder, avoir les yeux sur, porter les yeux, la vue. Il est remarquable de retrouver sur
les sites présentant des traces d’activité antique et ce
dans de nombreux cas
des toponymes en lien avec le champ lexical de la vue, de
regarder : par
exemple les gardes sous Montieux à
Farnay, et près du hameau les Atheux à
Saint-Romain : le Gardiol et Mirande. De plus,
ces lieux sont très adaptés à
l’observation, avec des secteurs de pierres à cupules et la
possibilité de
communication d’un point de garde à l’autre, d’un flanc de
colline à un sommet
et sur de longues distances. Mais encore : Gardier près
de Chavas (au-dessus de la
Terrasse-sur-Dorlay), Vigelon à
Saint-Paul-en-Jarez. Et enfin au sommet de ce petit pays nous
retrouvons le crêt
de l'Œillon, lieu
où l’on a savamment
installé l'émetteur de
télévision du mont Pilat. -d’autre part,
« Atesui » renvoi également à mot gaulois
attegia signifiant « cabane, hutte »
que nous retrouvons dans
la commune d’Athis-Mons (département de
l’Essone (Atheiae en 1163, Athegiae
en 1135, Athiae en 1280, Athysium,
Athis, Atis en
1273, Athis-sur-Orge). Il
est à noter que Mons renvoie à Mont et
donc à hauteur. In situ, ce Mont qui est dans une plaine une élévation modeste mais un
point culminant
juste au-dessus de la Seine. Dans ce secteur on retrouve
d’intéressants
mégalithes, polissoirs et pierres levées. Nous
voici donc déjà avec des « Atesui »
gardiens du Jarez, de la Vallée
du Gier, personnages singuliers vivant dans des habitations typiques.
Et par
ces faits voici donc peut-être : un peuple, une fonction et
un lieu. [1]
Octave
fils adoptif de Jules César portant le nom de Imperator
Caesar Divi Filius Augustus mort le 19
août 14
apr. J.-C.
à Nola,
premier empereur romain, du 16
janvier
27
av. J.-C. au 19 août 14 apr.
J.-C.   Un peuple, un lieu, une
fonction… Remontons le temps,
mettons-nous dans la peau d’un Atesuen…
suis-je casqué avec un menhir sur le dos et des braies
rayées ? Pour le
menhir ce n’est pas certain. Je suis surtout un homme de la nature, des forêts et des rivières mais
peut-être bien
plus simplement un éleveur et un cultivateur avec un paysage
localement bien
plus déforesté que celui que nous voyons de nos jours.
Car : je construis avec
le bois, il me chauffe ; je déforeste pour créer des
terres cultivables. Je
fais partie d’un écosystème ou la nature est
divinisée. Elle me réchauffe, elle
me nourrit. Le rythme des saisons est celui du temps qui passe.
L’avenir est
incertain ; dépend-il du choix
des
dieux ? Ces derniers influencent donc ma vie et ma survie, celle
des
miens. Les dieux font partie de mon quotidien, ils sont le pouvoir tu
temps qu’il
fait, du temps qu’il fera, du temps qui passe. Ils font partie de mon
peuple et
sont mon peuple. Ce sont aussi mes ancêtres. Je leur rends
hommage, je donne pour
recevoir, je respecte, je protège ce qu’ils représentent
comme ce qui
m’entoure. Ils sont le présent et l’avenir des miens. Ma vie n’est
peut-être pas si éloignée des paysans qui ont
perduré jusqu’à nos époques. Le village du
XXème siècle trouve ses fondations
dans les « attegiae » ;
la christianisation n’est qu’une suite et je garde en mémoire
l’importance des
sources, la vigilance pour mon élevage, ma force de travail pour
ma terre nourricière.
Je suis un homme au milieu de tout cet ensemble, avec les mêmes
préoccupations
depuis plus de 2000 ans. Les anciens m’ont transmis leurs savoirs et le
nom des
lieux qui a traversé les âges. Je comprends ces noms
où je les adapte et je
suis leur héritier. Sans en avoir tout à fait conscience,
je fais partie d’un
peuple, je m’en aperçois quand d’autres cultures viennent
bousculer la mienne,
je préserve, je garde et j’adopte lorsque je trouve ça
bon ou que je n’ai pas
le choix. Je perds, je gagne telle est mon histoire. Cette histoire est
celle de
l’homme. Un jour, je redécouvre, je me souviens, je me pose des
questions, je
cherche, je trouve. Je pense que j’en suis,
j’en fais peut-être partie, j’en suis
dans tous les cas un héritier. Telle est l’histoire de notre
petite région où
mon grand-père pour me dire de me tourner me disait dans un
régionalisme affirmé
« tourna-teu » (Tourne-toi)… voulait-il me dire
aussi tourne Atheu ?!! Il est également
très intéressant de voir que dans notre
vocabulaire local des mots celtes ont perdurés et
restent fréquents : comme le darbon pour
la taupe issu de darbo, et l’ollagnier pour le noisetier. II) La toponymie : le
nom des lieux La toponymie peut nous
conduire dans bien des chemins, voire
nous perdre dans des impasses des erreurs d’interprétations. Les
mots sont ceux
des gens du cru. De leurs croyances de leur compréhension du
monde, de leur vie quotidienne. Ces mots
ont parfois pu
évoluer, changer et se sont vus adaptés car mal compris
ou tout autant mal traduits
par de nouvelles langues, de nouveaux occupants. La conservation des
toponymes anciens, voire antiques nous apprend
toutefois deux choses : - les lieux étaient
occupés, repérés, utilisés car
nommés à
une époque très ancienne. - il y a eu
héritage : ces mots ce sont perpétués, d’une
génération à l’autre, d’une époque à
l’autre, d’une culture à l’autre cela
témoigne d’une transmission culturelle et donc d’une
continuité. Forez et Jarez ne se
démarquent que par une première syllabe. Les
locaux ne prononcent pas dans ces deux cas
le « Z », la terminaison EZ devenant un
« è » marqué par la
prononciation locale. De par cette nomination et cette similitude, le Jarez se démarque, de fait, du Forez
et du
forum segustavorum.  …Des traces Mais revenons à nos
Atheux qui réapparaissent directement sur nos cartes avec le
Village de saint
Romain-les-Atheux et le lieu-dit les Atheux . On retrouve ce même toponyme à
Saint-Héand avec les Atheux mais
également les Asthiers et peut-être
cette même commune l’Athaud ou encore
pré Mathieux qui n’est pas très
loin
de pré Athieux. Mais aussi depuis
Saint-Genest-Malifaux et vers la Ricamarie voici : la
vallée du Cotatay
(cote Atheux). Sous Cellieu, nous trouvons le crêt
Até. Doit-on également
voir dans les Toponymes Monthieu et
Monthieux que l’on retrouve à Saint-Etienne et à
Saint-Paul-en-Jarez et Farnay
des mont-atheux ? Entre Bayole et
Paraqueue le chemin de la Bieratière
serait il le bié (le contour de bié-Atière) ? Et plus loin Combatier
près de Saint Just-Saint-Rambert
serait « combe athié » ? Entre Saint-Didier-sous-Riverie
et Saint-Maurice-sur-Dargoire, la
Cognatière serait-elle « cogne
Athière » (de Cogn Cognus
coin/angle). Doit –on enfin voir
dans pierre Ratière entre Saint-Régis-du-coin et
Saint-Sauveur-en-rue, une
pierre Athière qui selon Patrick Berlier est une pierre rempart
au sens de
Frontière. Tout ceci a le
mérite de délimiter le Pagus Jarensis. Ceci
délimiterait-il donc le pays des
Atheux ? Le secteur du Pilat
semblant exclu de cette zone tel un sanctuaire. Alors au final qui furent
donc sont ceux qui habitaient les
contreforts du Pilat et dominaient la vallée du Gier ? Peut-être bien de
tout ça : peuple, tribu et gardiens du
Pilat. Toutefois la proximité des toponymes liés aux
Atheux et de termes liés à
la vigilance (les gardes, gardiol, mirande….) me laissent pencher pour
un rôle
de vigie. Ces Toponymes liés à
« garde », gardaient quelque chose. Il
est intéressant de noter que les points de vue sont
significatifs et auraient
permis de communiquer facilement d’une colline à l’autre par un
système de
signaux. Il est également nécessaire de noter qu’à
proximité, il y a de belles
pierres à cupule. Gardaient-ils des lieux de culte ? Un
sanctuaire ? Ou
tout simplement veillaient-ils sur leur pagus tout en vivant dans des
cabanes. Le crêt de Montieux
: fanum,
nemeton, tumuli et champs funéraire ou champ d’urnes ? 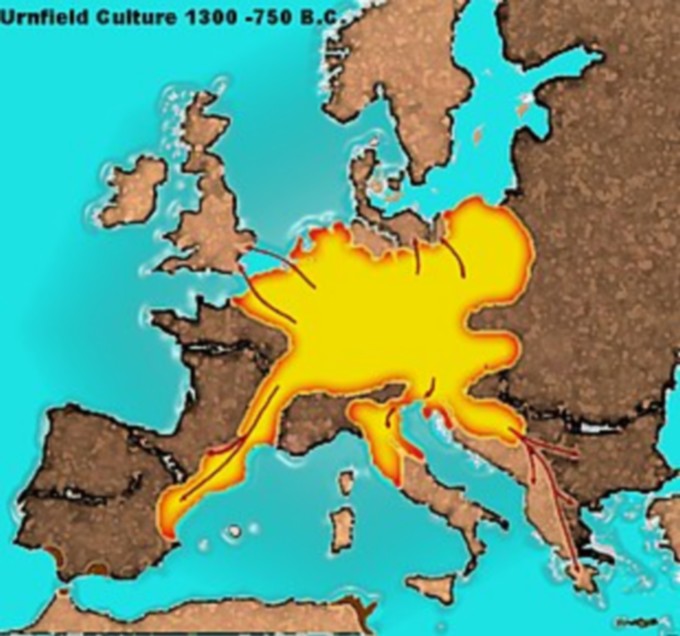 Pour tout vous dire,
j’avais prévu à l’origine de démontrer
la présence d’un beau Fannum Atesui au beau milieu de nos sites
à cupules. Ce
vieux tas de pierre et enceinte reste encore à l’état
d’hypothèse mais nous y
voilà. Le crêt de Montieux
correspond au sommet d’une colline située
au Sud de la commune de Farnay (lieu-dit le
sud). Le sommet partage la commune de Farnay de celle de
Saint-Paul-en-Jarez
et à proximmité se trouve le lieu-dit « la
croix du mazet » qui
sépare les communes de Farnay/ Saint-Paul et
Sainte-Croix-en-Jarez (Mazet
donnant macellium, marché,) et encore le lieu-dit les
Trèves (de trivium). Monthieux serait-il Mont
Atheux ? Dans tous les cas ce site
est remarquable par deux aspects : Sur
son versant sud-
ouest nous trouvons de très nombreuses roches à cupules
entres lesquelles des
amas de roches de type nemeton. Nous nous trouvons donc sur le couchant
et sans
vouloir m’étendre aujourd’hui sur ce sujet, nous voici
certainement sur un lieu
de sépultures. Les cupules allant de la croix du Mazet au site de Tetrette et jusqu’au ruisseau « Le
Sellon » en contrebas. Nous voici avec
un site (et peut être
un champ funéraire) de près 5 KM², voire davantage,
avec plusieurs dizaines de
tumuli encore bien identifiables. Sur le versant nord Est,
là où le jour se lève et où la naissance
prend nature, une maison isolée sur
le
modèle des fermes du Jarez. Au fond du vallon nous retrouvons le
ruisseau egarande
(eco-randa) et certainement frontière. A flanc de se versant
donc coté est et
plus précisément à 300m du sommet, nous trouvons
la source du ruisseau dit
« egarande ». Cette source est
matérialisée par un puit. A côté de ce
puit, une structure rectangulaire faite
de mur en pierre sèches. Doit-on y voir un jardin ? Bien éloigné de la ferme ;
peut-être plus
certainement les restes d’un fanum. Les anciennes photos
aériennes de l’IGN
nous laissent entrevoir, au beau milieu de ce
« jardin » une structure
unique érigée. Est-ce un arbre un pilier une pierre
levée ? La mémoire
collective n’en a pas gardé souvenir, les recherches sur place
demanderaient
des moyens. Mais pourquoi faire un enclos si vaste pour un arbre
seul ?
 Ces éléments demanderaient une étude approfondie mais, il y a eu sans aucun doute pour ma part culte et lieu de culte au crêt de Montieux, le site en gardant toutes les traces. Attachons-nous à d’autres toponymes alentours. Nous trouvons à proximité et près du hameau de ban : la bornarie, la chansamerie, la rabarie. Bornarie fait spontanément penser à borne mais le suffixe féminin ne nous en apprend pas davantage. Doit-on en déduire qu’en ces lieux (comme dans VER-CIN-GETO-RIX) se trouvaient : une Borna-RIX, une chansame-RIX une Raba-RIX et le domaine du chef du clan des Atheux ? |