Présenté
par
Patrick Berlier |
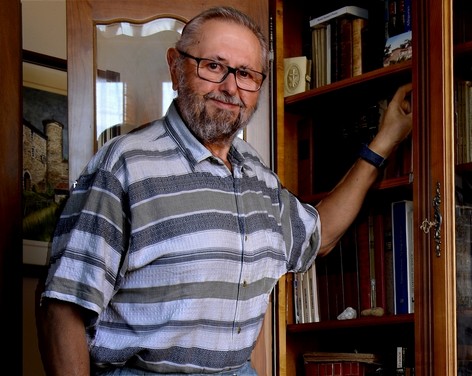 |
MARS
2019 |
Le Dossier
PIERRES
& MÉGALITHES DU CHEMIN DES ÉTOILES Avec « Quand les
pèlerins de Compostelle
traversaient le Pilat », toujours en ligne sur La Grande
Affaire, j'ai
évoqué le passage, sur le sol pilatois, des
pèlerins se rendant au
Puy-en-Velay, pour prendre de départ du pèlerinage de
Saint-Jacques
de-Compostelle, le grand chemin des étoiles comme on le nommait
aussi. Divers
édifices religieux jalonnaient ce parcours, et ce premier volet
se limitait à
cet aspect. Mais les pèlerins ne manquaient pas de
s'arrêter également sur les
mégalithes et autres pierres visibles sur leur chemin ou
à proximité – quitte à
faire un léger détour. Ce sera l'objet de ce second volet. En préambule, il
convient de rappeler que tous
les auteurs du XIXe siècle, et même d'une bonne
partie du XXe,
attribuaient les monuments mégalithiques à ceux qu'ils
pensaient être les
premiers habitants de notre pays : les Celtes (ou Gaulois). Mais
on sait
aujourd'hui que les mégalithes datent en réalité
d'une période allant de 4000 à
1500 ans avant notre ère, donc bien avant les Celtes.
Néanmoins ceux-ci – qui
commencèrent à arriver vers -600 – furent les
dépositaires du savoir
mégalithique, et on trouve dans le Pilat des vestiges purement
celtiques,
auxquels nous allons aussi nous intéresser.
Répartition
temporelle des mégalithes et des Celtes AU PAYS DES PIERRES QUI
CHANTENT Le premier site abordé,
passée la montagne des
Tourettes qui barrait l'horizon sud dans la montée depuis
Rive-de-Gier, est
celui des Roches de Marlin. Ou de Merlin, puisque tel fut son nom
jusque dans
les années quatre-vingt. Les deux appellations ne sont
d'ailleurs que les deux
variantes d'un même nom, Marlin étant la forme populaire
de Merlin. Le passage
obligé pour accéder au site de ce
côté-là est la Croix de Crème,
située
au col entre les Tourettes et la colline de Marlin proprement dite. Crème,
variante de crémation, est un toponyme révélant un
lieu souvent soumis aux
incendies, et cela s'est vérifié une fois de plus durant
l'été 2015. Même la
croix, en bois, a brûlé, elle a depuis été
refaite à l'identique.
L'arrivée
sur le site Le site des Roches de Marlin
représente une
surface de terrain axée sur la ligne de crête, longue d'un
peu plus de 1000 m,
pour 200 à 300 m de largeur. Il se partage entre les communes de
Châteauneuf,
Sainte-Croix-en-Jarez, Longes, et donc entre les départements de
la Loire et du
Rhône. Dans cet espace, sont dispersés une trentaine de
rochers de micaschiste,
de toutes les tailles. Certains émergent naturellement du sol,
et d'autres sont
des pierres détachées posées sur le socle rocheux.
La plupart présentent des
cupules ou bassins, plus ou moins marqués. Les Roches de Marlin
constituent
l'un des sites mégalithiques majeurs du Pilat. On en trouve sur
Internet une
description exhaustive et précise. La première roche
à se présenter, à l'entrée du
site côté est, est à l'écart du
chemin ; il faut traverser le pré à droite
pour l'atteindre. C'est la Roche du Châtaignier,
nommée ainsi sur
d'anciens documents car elle sert de limite de parcelles. Elle est
creusée d'un
beau bassin d'une trentaine de centimètres de diamètre,
alimenté par tout un
système de cupules reliées entre elles par des canaux, et
reversant le
trop-plein de liquide par une rigole. À l'autre
extrémité du site, côté ouest, un grand
rocher émerge du sol et pointe son éperon vers l'horizon,
comme l'étrave d'un
navire. La Proue est d'ailleurs le nom qui lui est donné
le plus
souvent. Plus bas, fermant le site à l'ouest, un abri sous roche
est formé par
un amoncellement de dalles. Entre ces points
extrêmes, vers le centre du site
deux roches se remarquent principalement. C'est d'abord la pierre dite
du Dauphin,
nom qui lui a été donné parce que sous un certain
angle, et avec un peu
d'imagination, on lui voit la silhouette d'un dauphin bondissant hors
de l'eau.
C'est une pierre détachée et posée sur le socle,
elle a une forme oblongue,
comme une amande... ou un visage humain. Cet aspect est d'ailleurs
souligné par
une arête, naturelle ou taillée par l'homme, qui semble
dessiner un nez, tandis
qu'un bassin de taille moyenne paraît vouloir représenter
l'œil droit.
Le
Dauphin Un peu plus bas on trouve la
roche principale, la
plus connue, c'est la Pierre qui Chante ou Pierre du Diable.
Comme le Dauphin, à qui elle ressemble beaucoup, mais en
paraissant plus
aboutie dans sa conception, la Pierre qui Chante est une roche
détachée
de forme oblongue, de 4,20 m de long pour 1,60 m dans sa plus grande
largeur.
Ces proportions ne sont pas anodines, elle découlent du nombre
d'or 1,618. En effet,
la longueur 4,20 m est le produit de la largeur 1,60 m par le nombre
d'or 1,618
élevé au carré soit 2,618. La pierre
présente une arête dessinant un nez, et
trois bassins d'inégales grandeurs dessinant deux yeux et une
bouche largement
ouverte, comme si elle criait... ou chantait.
La
Pierre qui Chante Pour expliquer le nom Pierre
qui Chante,
certains n'hésitent pas à affirmer que la pierre
émet un son, comme un chant,
sous l'action du vent. Dans certaines régions on place sur le
toit des maisons
une « tuile à loup » émettant un
son semblable au hurlement d'un loup
sous l'action d'un certain vent. Ailleurs c'est une « pierre
qui
chante », émettant un son modulé. Mais cela
fait maintenant plus de
quarante ans que je connais le site des Roches de Marlin ; j'y
suis allé
en toutes saisons, à toutes les heures du jour ou de la nuit, et
par tous les
temps. Je n'ai jamais entendu la Pierre qui Chante
émettre le moindre
son sous l'action du vent. Cette expression doit donc se comprendre
autrement.
D'abord, en ancien français, le verbe chanter signifie aussi
enchanter, jeter
des sorts, d'où sans doute l'idée de dédier les
roches à l'enchanteur Merlin.
Ensuite, par pierre qui chante il faut comprendre pierre en
chant,
une pierre angulaire, une balise. Voir à ce sujet :
« En suivant le
regard de la Pierre qui Chante », disponible en ligne sur
Les Regards du
Pilat. Quant au nom de Pierre du
Diable, il est
dû à une légende affirmant que le diable
était allé chercher cette pierre en
Dauphiné, pour finalement venir la poser sur cette colline du
Pilat, sur le
conseil d'un preux chevalier rencontré en chemin. On trouve
d'ailleurs un peu
plus bas une petite roche zébrée de trois sillons plus
clairs, et l'on dit que
ce sont les traces laissées par les griffes du diable, lorsqu'il
s’agrippa à ce
rocher pour se baisser et poser sa pierre. La légende de la Pierre
du Diable
est tout à fait comparable à celle de la Pierre
Druidique de Tence
(Haute-Loire) que certains pèlerins trouveront ensuite sur leur
chemin en
direction du Puy-en-Velay.
Les
Griffes du Diable Il est probable que les
pèlerins quittaient la
colline de Marlin par le chemin classique, celui emprunté par
Béatrix de la
Tour lorsqu'elle suivit l'apparition divine devant l'amener à
fonder la
chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez, selon la légende bien
connue. Mais
certains descendaient peut-être par la face ouest, pour rejoindre
ce rocher
parfaitement visible jadis depuis la Pierre qui Chante, ce
pseudo-dolmen
composé d'une pierre oblongue posée sur un affleurement
rocheux en forme de
berceau, lui-même creusé d'une vingtaine de cupules. Par
ce
« collimateur » ainsi ménagé, on
visait directement la Pierre qui
Chante. Ce curieux mégalithe se dresse au lieu-dit les
Loives, près du
hameau de Jurieu. Aujourd'hui la végétation abondante ne
permet plus ces
visées, ni dans un sens ni dans l'autre.
La
roche des Loives Quel que soit le chemin suivi,
les pèlerins
passaient obligatoirement par Jurieu et sa chapelle Sainte-Brigitte.
Une
tradition dit que ladite chapelle fut construite sur l'emplacement d'un
tumulus, ce qui reste sans doute à prouver. Par contre dans le
petit cimetière
qui jadis jouxtait la chapelle, on observait plusieurs pierres tombales
constituées de simples dalles de micaschiste, certaines
creusées de petites cupules,
peut-être détachées d'une roche plus importante.
Certaines de ces dalles sont
aujourd'hui dans les jardins des maisons avoisinantes, selon les Fiches
archéologiques de Georges Pétillon. SUR LES CRÊTS DE
QUATREGRAINS ET DE BARONNETTE Après une halte dans la
chartreuse de
Sainte-Croix-en-Jarez, ou, selon les époques, dans le
château qui l'a précédée,
les pèlerins attaquaient l'ascension de ces deux collines
jumelles. Sur le Crêt
de Quatregrains – nom qu'il faut peut-être comprendre
« quatre granges »–
s'élève un grand rocher dont le sommet semble
creusé en une sorte de fauteuil,
mais il paraît difficile de déterminer s'il s'agit
là de l'œuvre de la nature
ou des hommes. Quoi qu'il en soit, lorsque l'on s'y assied, on dirige
son
regard vers le point de l'horizon où se lève le soleil le
jour du solstice
d'hiver. C'est une particularité propre à tous les
« fauteuils »
mégalithiques de ce secteur. Le premier
« archéologue » à s'être
intéressé à ce crêt semble être F.
Gabut, employé à la Compagnie des Eaux de la
ville de Lyon, qui en 1892 déposa plusieurs notes manuscrites
à la mairie de
Pélussin. Il devait publier en 1901 Essais
d'archéologie préhistorique,
petit ouvrage laissant une part belle aux sommets du Pilat, mais sans
utiliser
lesdites notes qui concernaient la région de Pélussin.
Aussi lorsque Louis
Dugas publia en 1927 son Étude sur quelques monuments
celtiques du Mont
Pilat, il signala l'existence de ces notes, dont il reprit le texte
in
extenso pour les rendre publiques. Pour F. Gabut il y avait quatre
grands
rochers sur le Crêt de Quatregrains, ce qui pour lui justifiait
l'orthographe
« Quatre Grands » qu'il utilisait, en mentionnant
toutefois le nom
« Quatre Grains » que lui donnait le
propriétaire de la Grange-Rouet
en contrebas. Sur l'une des roches, écrit-il, « on
voit une grande
cuvette en forme d'arc de cercle, elle garde l'eau. »
Cette cuvette ne
peut pas être autre chose que le
« fauteuil » signalé plus haut.
Le
rocher du Crêt de Quatregrains et son fauteuil Voisin du Crêt de
Quatregrains, le Crêt de
Baronnette (ou de Bourchany) abrite sur sa face occidentale la grande
enceinte
celtique dite Château de Bélize. Pour les anciens,
ces amoncellements de
pierres ne pouvaient être que les ruines d'un château,
d'où ce nom. En réalité
il s'agit des vestiges d'une enceinte de l'époque celtique,
l'une de ces
fortifications que les Ségusiaves avaient édifiées
sur les sommets, entre
autres pour surveiller leurs turbulents voisins les Allobroges. L'un des premiers auteurs
à signaler l'existence
du Château de Bélize semble être
Étienne Mulsant, dans ses Souvenirs
du Mont Pilat, tome II. Puis
c'est F.
Gabut, précédemment évoqué, qui vint sur le
terrain vers 1892 et laissa une
description assez précise du site, reprise et
vérifiée en 1927 par Louis Dugas.
Plan
sommaire de l'enceinte de Château de Bélize Le plan schématique
joint à l'ouvrage de Louis
Dugas montre que l'enceinte possédait une entrée à
l'ouest (en 1 sur
le plan ci-dessus) à laquelle succédait
une sente sinueuse ménagée dans l'épaisseur de la
muraille du nord (2)
pour finalement accéder à l'intérieur de
l'enceinte par l'est (3).
F. Gabut a
vu une sorte de « petite caverne » en
forme de triangle
rectangle longue d'1,50 m (4),
ainsi qu'une
grande pierre de 3 x 2 m pour 0,90 m d'épaisseur, qu'il
identifiait comme
« une sorte de table destinée à recevoir
les offrandes des
fidèles ». (5). F. Gabut nous apprend
également que
l'enceinte mesure 70 m de long ; la largeur des murailles varie de
4 à 8
m, pour une hauteur apparente de 1,50 m. Le mur sud, côté
falaise, était selon
l'auteur « relevé
en parement avec des
roches énormes calées au moyen de pierres et de
pierrailles ».
Vestige
de muraille du Château de Bélize Dans l'épaisseur de ce
mur sud, F. Gabut voyait
une sorte de réduit, protégé du nord par une
grande pierre verticale, qu'il
imaginait comme le lieu où se tenait le prêtre. Ce
réduit toujours visible
aujourd'hui a fait l'objet fin 2002 d'un tag mystérieux – comme
plusieurs autres
sites de la région, entre autres les Roches de Marlin.
Pierre
de protection du réduit décrit par F. Gabut – tag
tracé fin 2002 Côté nord de
l'enceinte on peut voir encore
diverses murailles, déjà signalées par F. Gabut,
dont un fond de cabane carrée
bien visible sur le croquis de Louis Dugas (6). Peu après sa
création en 1974, le Parc Naturel
Régional du Pilat publia une série de Fiches
archéologiques, réalisées
par son directeur adjoint Georges Pétillon. La Fiche n° 1 de
Pélussin est
consacrée au Château de Bélize. On y
apprend qu'en 1973, un
sondage a révélé plusieurs fragments de
céramique, grise pour la plupart, et un fragment
apparenté aux sigillées
jaunes, qui semblaient traduire une longue occupation du site, allant
depuis le
bronze moyen jusqu'à la guerre de cent ans. Cette fiche signale aussi la
découverte par
Raymond Grau, au pied de la falaise, d'une tête humaine en forme
de boule, de
15 cm de diamètre environ, dont les yeux et la bouche sont
parqués d'un trait
creux. Georges Pétillon ajoute que cette tête était
extrêmement semblable à
celle de la statuette encastrée dans le mur d'une grange au
hameau du Montant
près de Chuyer, au pied du Crêt de Baronnette
côté est. Cette figure paraît
dater, selon les spécialistes venus l'examiner, de l'âge
du bronze.
La
statue du Montant Autour du Château de
Bélize on voit de
nombreux fonds de cabanes dans les bois, ce qui prouve que le lieu
connut une
certaine occupation. Le site était même déjà
fréquenté dès l'époque des
mégalithes. F. Gabut signalait la présence d'une cuvette
avec déversoir qui
paraît être un bassin mégalithique. Au centre de
l'enceinte, on voyait encore
dans les années 80 une dalle de roc, creusée d'un grand
bassin, brisée en deux
morceaux. En poursuivant sur le sentier
qui traverse tout
le site et sa belle hêtraie, en direction du sommet proprement
dit du crêt, on
accède au Rocher de la Fausse Monnaie, un nom qui a
disparu des cartes
actuelles alors qu'il figurait sur les éditions
précédentes. De toute évidence
ce nom doit être la déformation d'un nom ancien, dont les
gens ne comprenaient
plus le sens, et qu'ils ont transformé en un équivalent
phonétique
compréhensible, mais incongru. Par exemple on trouve à
Marseille l'Anse de
la Fausse Monnaie, un toponyme sujet à bien des
interprétations. Fausse
pourrait aussi dériver de fosse, ou du grec phos,
lumière, ou encore de fau,
nom local du hêtre, un arbre abondant sur ce crêt. Quant
à monnaie, ne
pourrait-on pas y voir la déformation du celtique nemeton,
temple ou
clairière consacrée, par sa ressemblance avec le mot
monnaie en latin : monetæ
(prononcer monété) ? Cela dit, en dehors de son nom
curieux, ce Rocher
de la Fausse Monnaie n'a rien de particulier. C'est un gros bloc de
micaschiste émergeant du sol, sur lequel reposent plusieurs
pierres détachées,
couvertes de mousse. Le site est donc tout à fait comparable aux
Roches de
Marlin, sauf qu'ici aucune cupule ne vient particulariser ce rocher,
qui
n'aurait rien de plus intéressant s'il n'avait pas
été répertorié sous ce nom
particulier.
Le
site du Rocher de la Fausse Monnaie AUTOUR DE PÉLUSSIN Plusieurs sentiers descendent
sur le versant sud
des collines de Quatregrains et de Baronnette. Tous permettent de
rejoindre la
vieille voie romaine, qui depuis le col de la Croix de Montvieux
descend sur
Pélussin. Elle passe à deux pas du hameau de la Roche,
où un grand rocher, orné
de cupules et bassins, a été amputé d'une partie
en 1935 pour élargir la route.
Dans le morceau qui a disparu, on pouvait voir jadis un fauteuil
taillé
regardant le soleil levant du solstice d'hiver, ainsi que la gravure
d'un
svastika, comme l'a signalé Louis Dugas dans son livre Étude
sur quelques
monuments celtiques du Mont Pilat, paru en 1927. En descendant de la Roche, les
pèlerins pouvaient
accéder à la « carrière de
meules » située près du Pont du Mas. Dans
l'angle d'un pré un rocher granitique émerge du sol, on
peut y voir plusieurs
traces d'extraction de meules, une technique utilisée jusqu'au
Moyen-Âge pour
fabriquer des meules de moulin. Jusque dans les années 80, on
voyait également
à l'autre bout du pré une belle meule intacte, non
détachée de son socle, mais
elle a disparu et il n'en reste plus que des photos. Il y a plusieurs
carrières
de ce type dans la région, celle du hameau du Moulin, tout
proche, celle du bois
de la Chanal, également à proximité, ou un peu
plus loin celle des Alouettes
près de Gencenas.
Pierres
à meules près du Pont du Mas – à droite la meule
disparue Après Pélussin,
les pèlerins avaient le choix
entre plusieurs itinéraires possibles. L'un d'eux passe par le
Bois de la
Valette, dans lequel on trouve plusieurs sites mégalithiques. Il
y a un grand
rocher, dominant le paysage, avec de multiples cupules, bassins,
rigoles. Puis
en contrebas plusieurs rochers dans le sous-bois, avec de beaux
bassins. Tout
en haut du même bois, au sommet de la colline, se cachent les
Pierres Juton
(orthographe ancienne) ou Juthon (orthographe sur les cartes plus
récentes).
C'est un site dégagé dans les années 70, mais la
végétation ayant repris ses
droits il est un peu difficile à retrouver aujourd'hui.
Plusieurs pierres
émergent plus ou moins du sol, dont un dôme principal en
deux parties. Chacune
est creusée d'un bassin ; le premier est rond, très
net, de 30 cm de
diamètre environ, pourvu d'une petite rigole
d'écoulement ; le second est
ovale, moins marqué et utilisant une cassure naturelle de la
roche. Dans le
premier bassin le liquide devait atteindre un certain niveau avant de
s'écouler, dans le second il s'infiltrait dans la roche
dès qu'on l'y versait.
Pierres
Juton – les deux bassins du dôme rocheux principal Il y a aussi cette grande
dalle, où l'on peut
voir ce qui ressemble à la gravure d'un personnage, ainsi que
des lignes qui
paraissent désigner les levers du soleil aux solstices
d'été et d'hiver. Et puis
encore une autre trace d'extraction de meule, bien nette, de
près d'un mètre de
diamètre.
Pierres
Juton – trace d'extraction de meule VERS LES SOMMETS Commençait ensuite la
partie la plus ardue du
parcours, l'ascension en direction du Pic des Trois Dents, laquelle
pouvait se
faire par différentes approches. Signalée dès 1555
par Jean du Choul, cette
montagne au profil caractéristique est devenue
emblématique du Pilat. L'une des
variantes dans la légende de Ponce Pilate dit qu'elle fut
créée en une nuit par
un tremblement de terre, afin que l'ancien préfet de
Judée ait devant lui
l'image des trois croix du calvaire. Au printemps, quand les genets
sont en
fleurs, le paysage magnifique fait oublier la rudesse du sentier
d'accès.
Le
Pic des Trois Dents Entre les deux
premières dents, les Celtes
avaient édifié deux murailles parallèles, qui
isolaient un espace sacré.
Étienne Mulsant dans ses Souvenirs du Mont Pilat, tome
II, fut l'un des
premiers à décrire cette enceinte. Lorsque dans les
années 60 Jean Combe
écrivit son Histoire du Mont Pilat, des Temps perdus au XVIIe
siècle, il fit appel à Raymond Grau pour dessiner un
plan de l'enceinte des
Trois Dents, et lui demanda de la décrire. Il ressort de ses
indications que la
muraille du haut, construite au sommet de la crête, a 50 m de
long pour 1 m de
large ; une entrée, située au milieu, a 1 m de large
(1 sur le plan
ci-dessous). La seconde muraille
est située 50 m plus bas ; elle mesure 100 m de long pour
1,50 m de
large ; une entrée de 2 m de large (2)
est située en regard de l'entrée du haut. Au bout de
cette muraille côté SE,
une sorte de passage de 2 m de large remonte en pente douce (3).
Plan
sommaire de l'enceinte des Trois Dents Outre sa fonction de
surveillance, le site des
Trois Dents devait aussi servir de temple en plein air
réservé à une élite
religieuse, ce que pressentait Étienne Mulsant lorsqu'il
écrivait à propos de
son enceinte : « elle était chargée
d'isoler, de la multitude, les
druides ou prêtres des Gaulois, quand ils offraient leur
prières ou leurs
sacrifices à l'Éternel. »
Carte
postale ancienne – les murailles sont bien visibles On a assisté à
un boisement de la montagne au XXe
siècle, qui a eu pour effet de masquer totalement l'enceinte
celtique – bien
visible sur les cartes postales du début du siècle –
jusqu'à ce que le Parc
Naturel Régional du Pilat vienne débroussailler le site
et lui redonner son
aspect ancien, dans les années 90. Le sentier, qui partait du
Crêt du Graland
en descendant à travers un chirat, était assez sportif.
Il a été remplacé par
un nouveau sentier, partant du col du Gratteau, un peu plus facile.
La
muraille inférieure aujourd'hui L'enceinte des Trois Dents ne
devait pas
accueillir un grand nombre de desservants, car l'alimentation en eau se
limitait à ce que l'on nomme le Puits des Fées,
décrit par plusieurs
auteurs, dont L.-Pierre Gras dans son Essai de classification des
monuments
pré-historiques du Forez paru en 1872. L'eau sort d'un
orifice circulaire,
creusé dans le roc à 1,70 m de hauteur environ, puis suit
un large chenal
jusque dans une vasque au niveau du sol. Ce n'est pas à
proprement parler une
source, mais plutôt semble-t-il un système de drainage des
eaux pluviales
infiltrées dans le rocher. Ce Puits des Fées (en 4 sur le plan) est
situé au pied de la
première dent, à l'amorce de la muraille du bas. Le
sentier d'accès arrive à ce
niveau, et longe ensuite la muraille inférieure.
Le
Puits des Fées Après avoir
pérégriné sur le Pic des Trois Dents,
les pèlerins se dirigeaient vers Saint-Sabin. Les Gaulois
avaient transformé le
sommet de cette montagne en enceinte de forme elliptique.
Côtés nord, ouest et
sud, c'est une muraille en pierres sèches qui fermait
l'espace ; côté est
le talus abrupt suffisait à interdire l'accès au site.
Cette enceinte devait
faire dans les 400 m de long pour 150 de large, avec une entrée
à chaque
extrémité, au nord et au sud. Il reste par endroits de
beaux vestiges de la
muraille, en particulier au niveau de l'entrée du sud, où
l'on peut voir encore
les restes de deux cabanes carrées, l'une tournée vers
l'extérieur et l'autre
vers l'intérieur.
Entrée
sud - Vestige de la cabane intérieure L'entrée du nord a
été élargie en 1683 lors de la
reconstruction de la chapelle, pour permettre le passage des chars
apportant
les matériaux. À l'origine elle devait présenter
une physionomie comparable à
celle de l'entrée sud. Au centre nord de l'enceinte se trouve
cette grande
pierre que Louis Dugas – et tous les auteurs qui lui ont
succédé – qualifiait
de « cubique » et de « pierre
à sacrifices ».
Sa surface présente une légère concavité,
et l'eau s'y amasse par temps de
pluie. Une cuvette triangulaire y est visible, mais elle semble
d'origine
purement naturelle.
La
chapelle Saint-Sabin vue de la « pierre à
sacrifices » Une sorte de tumulus jouxte
cette pierre au sud.
Ce grand tas de pierre a été fouillé dans les
années 30, et des poteries ont
été mises à jour. En contrebas, au bord du
sentier, une pierre levée haute de
1,60 m environ, qualifiée de menhir par certains,
présente sur sa face plane
trois croix, dues aux failles naturelles de la roche. Par contre une
petite
croix latine très nette a été gravée au
sommet. Il est certain que Saint-Sabin
a toujours été un site sacré, occupé par
toutes les religions qui s'y sont
succédé, depuis le temps des mégalithes jusqu'aux
premiers chrétiens.
Le
« menhir » de Saint-Sabin VERS COLOMBIER ET SAINT-JULIEN Les pèlerins quittaient
Saint-Sabin par le vieux
chemin, bien oublié aujourd'hui, qui descend à travers le
Bois de la Corée
jusqu'au hameau de Buet. De là ils poursuivaient en direction de
Colombier par
le Moulin-Michel. Ils passaient donc immanquablement devant ce grand
rocher
auquel la tradition populaire a donné le nom de Pierre
à Dents. C'est
une petite falaise dominant le ruisseau du Ternay. Vue de loin, elle
paraît
« montrer les dents », d'où son nom.
Lorsqu'on s'approche, on
découvre deux rangées sculptées chacune d'une
sorte de frise, sans qu'il soit
possible de déterminer ce que celui qui a ainsi taillé le
rocher a voulu
représenter. Aucun auteur ancien ne parle de ce site, il faut
attendre les Fiches
archéologiques de Georges Pétillon pour le voir
mentionné.
L'étrange
Pierre à Dents, aussi mystérieuse de loin que de
près Il était possible
autrefois de monter directement
vers le hameau des Roches, par un sentier disparu aujourd'hui. Ce
hameau doit
son nom à la présence de grands rochers aux formes un peu
tourmentées. Deux
blocs semblent adossés l'un à l'autre. En face d'eux, une
sorte de banc naturel
invite le promeneur à s'asseoir. Dans cette position, par le
faible espace
entre les deux rochers, on « vise » exactement le
Menhir du Flat,
distant d'environ 1200 m.
Les
Roches – visée vers le menhir du Flat Ce menhir constituait donc
l'étape suivante.
C'est une grande pierre haute de 4 m, encore attachée au socle
rocheux. Ce
n'est donc pas strictement un menhir – au sens de pierre
détachée, déplacée et
replantée – mais plutôt une aiguille de roc taillée
dans un rocher plus gros à
l'origine. Le résultat est le même sans doute, et le cas
n'est pas unique. Les
pierres débités ont servi à édifier le
tumulus situé en contrebas. Le menhir
appartient à une veine rocheuse aux fractures verticales, bien
visible quelques
mètres à l'est, où elle a été
taillée pour permettre le passage d'un chemin
creux formant une sorte d'enceinte. L'érosion naturelle, ou les
hommes, a
creusé dans ce rocher deux « gorges de
visée » permettant
d'apercevoir depuis le chemin le sommet du menhir. Deux bassins sont
également
creusés dans ce roc, l'un rond à rigole et l'autre ovale
sur une cassure
naturelle, exactement sur le principe déjà observé
aux Pierres Juton.
Le
Menhir du Flat Un visage paraît
taillé sur la face ouest du
menhir. Il était déjà visible sur des photos
prises au début du XXe
siècle. La ressemblance avec les
« statues-menhirs » de Filitosa en
Corse est frappante. Un peu plus près de nous, le menhir central
du cromlech
des Perrarines sur le Causse de Blandas (Gard) s'orne lui aussi d'un
visage sur
sa face occidentale. La comparaison avec celui du Flat est troublante.
Patrick
et le menhir de Blandas – en médaillon le visage du Flat Suivant toujours plus ou moins
le cours du
Ternay, le chemin quittait Colombier pour se diriger vers
Saint-Julien-Molin-Molette.
Si la route actuelle longe la fameuse carrière tant
controversée, le chemin
ancestral longe quant à lui l'ancêtre de cette
carrière, un front de taille
paraissant particulièrement ancien, et abandonné depuis
longtemps. Ici se
termine le sentier des pierres, car plus aucun mégalithe ne
viendra émailler le
chemin des pèlerins en terre pilatoise, à moins de
consentir à quelques écarts
significatifs. SUR LES DEUX VERSANTS DE LA
DÉÔME Après Bourg-Argental,
les étapes suivantes sur le
chemin des étoiles étaient Saint-Sauveur-en-Rue et le col
du Tracol. Certains
pèlerins faisaient peut-être des détours par l'un
ou l'autre versant de la
haute vallée de la Déôme, soit côté
nord, soit côté sud. Par le versant nord,
ils pouvaient monter jusqu'au Menhir du Bouchet, grande pierre
posée sur
une aire rocheuse creusée de cupules et bassins. Par le versant
sud, la
grimpette encore plus rude les amenait jusqu'à Montchal, et un
peu au-delà aux
sites de Joanabel et de la Baignoire des Gaulois. Le hameau de Joanabel semble
devoir son nom au
dieu Bel ou Belenos, l'Apollon gaulois, dieu du soleil, qui a
donné de nombreux
toponymes en Bel, comme Bel-Air que l'on rencontre très
fréquemment. Un grand
rocher est à l'écart du hameau. Outre de nombreuses
cupules, certaines aux
formes très suggestives de sexe féminin, il est
creusé d'un fauteuil dans
lequel on peut s'asseoir, pour fixer une fois encore le lever du soleil
au
solstice d'hiver.
Le
rocher de Joanabel En continuant un peu plus loin
par le même
chemin, on accède au lieu-dit la Volière et à ce
site auquel on a cru bon de
donner, dans les années 90, le nom saugrenu de Baignoire des
Gaulois.
Invention journalistique probablement, ce vocable a malheureusement
perduré.
Pourtant, si on y voit un rocher avec un grand bassin ressemblant en
effet
vaguement à une baignoire, celle-ci ne doit rien aux Gaulois,
lesquels
d'ailleurs n'appréciaient l'eau que très
modérément. Pour les géologues ce
bassin est totalement naturel, il est dû au
phénomène de gel et dégel de l'eau
infiltrée dans les cassures naturelles du « granite
à cordiérite »,
ce qui a fini par créer cette excavation. Pour les tenants d'une
hypothèse
mégalithique, ce sont évidemment les hommes qui ont
créé ce bassin, destiné à
des bains à valeur purement thérapeutique. Il faut noter
qu'une « sœur
jumelle » de cette baignoire est visible sur le site du
château fort de
Polignac (Haute-Loire).
La
« Baignoire des Gaulois » Après
Saint-Sauveur-en-Rue, les pèlerins
grimpaient vers le col du Tracol. Un dernier regard sur le Pilat, et
c'était la
descente vers le Velay. Et c'est une autre histoire... La suite est
à découvrir
dans mon livre Avec les pèlerins de Compostelle, en
Lyonnais, Pilat et Velay,
Actes Graphiques éditeur. |
A
présent il est temps de retrouver notre nouvel invité,
notre Ami Adrien Tidjarian.
|
|
|
 |
1/
Regards du Pilat : Bonjour Adrien. Vous exercez la profession
très peu connue de santonnier. En quoi consiste ce métier
d’art ? Adrien
Tidjarian : Bonjour à vous. Il s’agit pour moi de
réaliser
des santons, en réalité de petites figurines
régulièrement de 8 centimètres de hauteur, mais
parfois plus
grandes aussi. Pour ce
faire, j’utilise uniquement l’argile. Avant la Révolution
française, les
premiers santons étaient en plâtre et sont arrivés
en provenance d’Italie. 2/
Regards
du Pilat : Comment
est-ce que l’on fabrique un santon
et combien de temps faut-il pour arriver jusqu’à sa
commercialisation ? Adrien Tidjarian : Un santon est fabriqué à partir de moules qu’il me faut préalablement réaliser ; chacun est en fin de compte un prototype en deux parties. Pour réaliser un santon, je mets de l’argile à l’intérieur et une fois la quantité nécessaire bien répartie, j’appui très fort. J’obtiens donc ainsi un santon qu’il me reste à cuire et à peindre. Avant ces deux opérations, je retire préalablement avec de petits outils les quelques imperfections laissées à la suite du démoulage. Pour résumer les différentes étapes successives sont : la création du prototype et du moule, le pressage de l'argile dans le moule, puis l'ébarbage, le séchage, la cuisson et la peinture.
Pour
remplir mon four, pour l’optimiser,
j’attends d’avoir réalisé environ 300 pièces ce
qui signifie environ deux mois
de travail. La cuisson à proprement parler se fait à une
température de 980
degrés. Il faut environ 6h30 pour monter le four à 650
degrés puis 1h30
supplémentaire pour atteindre les 980 degrés requis. Il
me reste ensuite
l’opération ‘peinture’. Cette dernière phase impose
beaucoup de précision et de
minutie. Il faut compter de 1 à 2 heures par santon pour
atteindre l’objectif
de qualité recherchée. 3/
Regards
du Pilat : Quelle
est votre formation initiale et
comment vous est venue l’idée de devenir santonnier ? Adrien
Tidjarian : Je
suis titulaire d’un BTS Système Constructif
Bois Habitat. Avant de devenir santonnier, j’ai préalablement
exercé la
profession de menuisier-ébéniste. J’ai de très
longue date, depuis ma petite
enfance, apprécié la réalisation de crèches
à l’occasion des fêtes de Noël.
C’est là que j’ai manipulé mes premiers santons et que
remonte sûrement ma
vocation. Je crois bon d’ajouter qu’il est souhaitable d’avoir à
la base de
bonnes aspirations pour la sculpture. 4/
Regards
du Pilat : Avez-vous
suivi une formation complémentaire
pour pouvoir exercer ce métier ? Adrien
Tidjarian : Oui.
Durant mes études, j’ai déjà eu l’occasion
de vivre des expériences riches et variées chez
différents maitres de stages.
Mais la plus enrichissante de mes rencontres fut sans doute celle avec un vieux monsieur, un santonnier qui
normalement ne dispensait pas de formation. Je ne le remercierai jamais
assez.
Aujourd’hui, il a près de 80 ans et exerce toujours ce beau
métier de santonnier. 5/
Regards
du Pilat : A
combien estimez-vous le nombre de
santonniers en France et ce chiffre est-il plutôt en hausse ou en
baisse ? Adrien
Tidjarian : A
ma connaissance, il y a environ 250
santonniers en France principalement en régions
Rhône-Alpes et PACA ;
vient ensuite le Languedoc. Nous sommes seulement 2 dans le
département de la
Loire et je suis seul dans le Parc Naturel Régional du Pilat.
Je
ne connais pas l’évolution future du nombre
de santonniers sachant que beaucoup sont déjà aujourd’hui
âgés. Je préciserai
toutefois que bien souvent c’est un métier d’appoint, une
seconde profession
exercée par exemple par des paysans qui l’hiver réalisent
des santons là où leur
activité première est moins intense. 6/
Regards
du Pilat : Est-ce
que ce métier demande des
investissements financiers importants avec notamment l’achat de
matériels
couteux ? Adrien
Tidjarian :Le
plus gros de mes investissements fut
l’acquisition d’un four pour un montant voisin de 3 000 euros.
Autrement, mes
dépenses courantes sont destinées à l’achat de
l’argile et des peintures. Je
dispose d’un vaste choix parmi 300 teintes pour réaliser toutes
les nuances
nécessaires à la décoration des figurines. 7/
Regards
du Pilat : Vous
participez à des salons, vous pratiquez
également la vente par correspondance grâce à un
magnifique site Internet que
nous invitons vivement nos internautes à aller visiter www.lessantonsadrien.fr.
Est-ce là les seuls moyens pour vous faire
connaitre ? Adrien
Tidjarian : Ce
sont effectivement les principaux. Je
participe à 8 salons majeurs situés entre Loriol sur
Drôme et Arles. La Vallée
du Rhône reste le principal point d’ancrage des santonniers.
Parallèlement, mon
site Internet a permis et continue de me faire connaitre aux quatre
coins de
l’hexagone et aussi progressivement à l’étranger. 8/
Regards
du Pilat : Combien
de santons différents propose votre
catalogue qui semble riche et en constante évolution ? Adrien
Tidjarian : J’avais,
pour vous donner un ordre d’idée, 47
santons dans mon catalogue en 2017 et 65 à fin 2018. Je travail
par thème et
ceux-ci sont en développement permanent. Pour exemple, je
propose bien
évidemment la Sainte Famille incontournable pour les
crèches mais pas seulement.
Les métiers comme les foins, l’agriculture, les
lavandières … mais également le
thème des gitans très apprécié dans le sud
de la France … Résidant sur la
commune de Sainte-Croix-en-Jarez, là où l’on peut admirer
une ancienne
Chartreuse renommée, il m’est apparu naturel de réaliser
des santons
concrétisant des Pères Chartreux.
9/
Regards
du Pilat : Est-ce
qu’il se dégage une origine
territoriale de la clientèle ou bien au contraire cette
dernière provient
vraiment des quatre coins de l’hexagone ? Adrien
Tidjarian : Je
développe mes ventes maintenant dans toute
la France mais comme je vous l’ai dit un peu avant, le grand quart
sud-est, de
par ma présence à des salons ; demeure encore mon
premier secteur de
vente. Internet faisant le reste, j’ai des commandes en provenance de
toutes les
régions et aussi de l’étranger. 10/
Regards
du Pilat : Depuis
de nombreuses années, vous proposez
au public de venir à l’église de Sainte-Croix-en-Jarez
durant les mois de
décembre et janvier pour y admirer l’une des plus belles
crèches de Noël de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes. Positionnée dans le
chœur de l’église, cette
dernière, une crèche provençale animée,
dépasse les 60 mètres carrés. Comment
est né ce magnifique projet ? Adrien
Tidjarian : La
réalisation de cette crèche, améliorée
chaque année, s’avère, effectivement, une très
belle aventure, commencée voici
plus d’une décennie. J’ai toujours aimé les
crèches. Tout petit, ma mère, qui
travaillait à Saint-Chamond chez les Frères Maristes,
m’emmenait tous les ans
voir leur crèche de Noël et cela m’enchantait. Avec le
temps, je m’efforçais à
mon tour d’en réaliser une à la maison et de l’embellir
sensiblement chaque
année. Une année, le bulletin municipal de
Sainte-Croix-en-Jarez a glissé une
photo de mon travail sur l’une des pages du bulletin municipal. Puis,
un jour,
c’est le Maire du village qui m’a proposé de réaliser une
crèche dans l’église
de Sainte-Croix. J’avais 14 ans et cette première crèche
de 4 mètres carrés fut
présentée sur la table de communion. Progressivement, au
fil des ans, cette
crèche est passée à 8 puis à 20
mètres carrés. J’ai un temps investi, une
chapelle latérale de l’église. En 2011, on a
décidé de l’installer dans le
chœur. C’est une entreprise conséquente que de monter la
crèche aujourd’hui, un
travail collectif soigné, réalisé avec des amis
bénévoles, regroupés au sein
d’une vraie association. Même si avec le temps, on prend
certaines habitudes,
c’est sur près d’un mois et demi que l’on monte progressivement
la crèche de
Noël de Sainte-Croix-en-Jarez qui aujourd’hui dépasse les
60 mètres carrés en
occupant tout le chœur de l’église. Regards
du Pilat : Adrien,
nous vous remercions beaucoup pour
l’ensemble de vos réponses et pour le bel accueil que vous nous
avez réservé
dans votre atelier, ici chez vous à Sainte-Croix-en-Jarez. Si
des internautes
veulent en savoir plus ou sont intéressés par vos
magnifiques santons, voici le
lien qui permet d’entrer en contact avec vous : contact@lessantonsadrien.fr |