LES GUERRES DU
PILAT
|
 |
|
GUERRES MéDIéVALES DE
VOISINAGE EN VALLéE DU RHÔNE |
|
Au
Moyen-Âge, le Rhône sert de
frontière entre le Royaume de France, sur sa rive droite, et
l’Empire
germanique, sur sa rive gauche. La frontière est plus
théorique que réelle, et
de nombreux échanges ont lieu entre les deux rives, donc entre
les deux pays.
Cependant des querelles de territoires vont naître rapidement,
à cause de
situations particulières, cadeaux empoisonnés des
ancêtres à leurs descendants
ou successeurs. Il est nécessaire, et même indispensable,
de commencer par le
commencement.
|
|
L’éphémère
ROYAUME DE BOURGOGNE - PROVENCE Les rois de France lorgnaient depuis longtemps sur cette région en espérant l’annexer, ce qui leur aurait donné un débouché sur le Rhône et donc sur la Méditerranée. Il leur fallut attendre 1296 et le mariage de Jean Ier, comte de Forez, avec Alix de la Tour, fille du Dauphin du Viennois. Alix apporta en dot à son époux toutes les terres formant la partie sud du Pilat, que l’on prit alors l’habitude de nommer Forez Viennois. Le comté de Forez étant alors un allié du roi de France, un premier jalon était planté. Une quinzaine d’années plus tard, le roi Philippe IV de Valois, le fameux Philippe le Bel, négociait la réunion du Lyonnais à la couronne de France. Dès lors le Rhône servit de frontière entre royaume et empire. Il restait cependant deux exceptions, sources de querelles incessantes : Les Roches-de-Condrieu, bastion royal en terre impériale, et Sainte-Colombe, bastion impérial en terre royale. L’affaire allait se régler dans le sang. |
|
LE Siège de
condrieu Revenons près d’un siècle en arrière. En 1195 Condrieu appartient au comté du Lyonnais, aux mains des archevêques de Lyon depuis la scission ratifiée par le traité de Tassin en 1173, officialisant la séparation du Forez et du Lyonnais. L’archevêque est alors un certain Renaud de Forez, qu’il ne faut pas confondre avec son homonyme, le fils du comte Jean Ier et d’Alix de la Tour, seigneur de Malleval au début du XIVe siècle. Renaud de Forez veut faire de Condrieu une place forte puissante, verrouillant l’accès à Lyon par le sud. Côté nord, en Beaujolais le château d’Anse jouera le même rôle.
On entoure la ville de
remparts : une première enceinte clôt la ville basse,
autour de l’église
et du quartier de la Garenne, une seconde enceinte clôt la ville
haute. À
l’intérieur de celle-ci, une troisième enceinte dessine
les contours du
château. Comme il est d’usage à cette époque,
celui-ci se complète par un
puissant donjon, constituant l’ultime réduit en cas d’attaque,
et des
souterrains permettent de s’en échapper discrètement. Le
donjon de Condrieu est
de plan circulaire, de 15 m de diamètre et de 25 m de haut. Il
s’adosse à une
tour carrée encore plus haute, vestige d’un beffroi ancien.
C’est l’un des plus
gros donjons du monde médiéval, et l’ensemble du
système fortifié est jugé
imprenable. Tout au moins, il l’est pour un assaillant venant du sud,
puisque
le rôle de Condrieu est de protéger l’accès
à Lyon. Il paraît impensable qu’une
attaque puisse venir du nord, de l’intérieur, aussi les
défenses sont-elle
beaucoup plus légères de ce côté-là.
Renaud de Forez accorde aux Condriots de
nombreux privilèges, la population augmente et la ville devient
rapidement
prospère, en particulier dans le domaine de la batellerie qui
fera sa renommée.
|
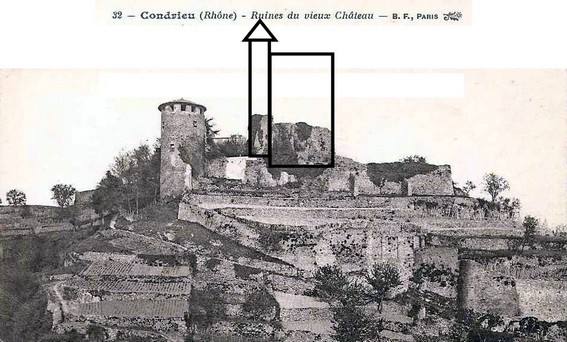 Carte postale ancienne montrant l’état des
ruines du château
de Condrieu au début du XXe siècle. On remarque l’embase
du donjon et de son
beffroi, dont il est facile de dessiner les contours. Cette zone est
aujourd’hui totalement envahie par la végétation. |
Face à Condrieu
s’élève le bourg des
Roches-de-Condrieu, bâti sur un rocher faisant obstacle au
Rhône. Le fleuve le
contourne par un méandre, apportant aux Roches les alluvions qui
rendent sa
terre fertile. Depuis toujours les Condriots se sont attribués
ce lopin, auquel
ils accèdent par un bac à traille, au grand dam des
habitants de
Saint-Clair-du-Rhône, le village voisin, qui le guettent
jalousement. Il faut
dire que les Roches ont fourni une base avancée, permettant aux
Condriots des
incursions nombreuses sur la rive gauche du Rhône. Or si à
l’origine les deux
rives dépendaient de deux comtés différents,
Lyonnais à l’ouest et Viennois à
l’est, les deux appartenaient au même état, l’Empire
Germanique. Il n’en est
plus de même depuis 1312 et la réunion du Lyonnais
à la couronne de France.
Désormais, c’est le royaume de France à l’ouest et
l’empire d’Allemagne à l’est,
exception faite de la terre des Roches-de-Condrieu, enclave royale en
terre
impériale.
|
 Panorama pris du Calvaire : Condrieu (on
devine
l’emplacement du château au premier plan), le Rhône, les
Roches-de-Condrieu
dans le méandre du fleuve, au fond Saint-Clair-du-Rhône. |
|
En 1328, les gens de Saint-Clair,
excédés par les incursions
de plus en plus fréquentes des Condriots, décident de
frapper un grand coup. Avec
l’aide et le soutien de l’évêque de Vienne ils vont mettre
le siège devant le
château de Condrieu. Pour cela, ils ont choisi d’attaquer par le
nord, le côté
le moins défendu. Leur expédition remonte jusqu’à
Vienne par la rive gauche du
fleuve. Traverser le Rhône ne pose aucun problème :
non seulement il y a
un pont, mais la terre de Sainte-Colombe, face à Vienne,
appartient à l’empire.
Il ne leur reste plus qu’à redescendre le long de la rive droite
du fleuve,
discrètement, de nuit sans doute, et Condrieu se réveille
un beau matin avec
une armée de dix mille hommes amassée sous ses murailles.
Ce qu’il reste
aujourd’hui des remparts, de ce côté-là de la
ville, permet de juger de leur
faiblesse : le mur n’a qu’une soixantaine de centimètres
d’épaisseur.
Seulement deux tours, une à chaque extrémité,
défendent une muraille percée de
trois larges portes, peu fortifiées. |
 La « Porte romane », seul
vestige des 7 portes de
la cité |
Le
siège ne va pas durer très longtemps. Les
fortifications sont enfoncées, cédant l’accès au
château qui sera ruiné, et à
la ville qui sera livrée au pillage. Condrieu aura beaucoup de
mal à s’en
relever, souffrant ensuite du passage des Grandes Compagnies et surtout
de la
peste, qui en 1349 tuera le tiers de ses habitants.
|
|
LE
COUP DE FORCE DES VALOIS Les Condriots criaient vengeance, l’archevêque de Lyon et le roi de France étaient fort mécontents de la situation. Toutes leurs rancoeurs accumulées allaient se focaliser sur l’enclave de Sainte-Colombe, chancre impérial en terre royale. Son existence s’expliquait par le legs fait en 984 par Conrad le Pacifique, roi de Bourgogne - Provence, à son fils bâtard Burchard II, archevêque de Lyon : toute la rive droite du Rhône, jusqu’à Chavanay, passait alors dans le comté du Lyonnais, à l’exception du territoire de Sainte-Colombe, que Conrad se gardait pour lui, qui resta affilié au comté de Vienne. En 1334 le roi Philippe VI de Valois profite des querelles entre les archevêques de Lyon et de Vienne, au sujet de la guerre fratricide entre Condrieu et Saint-Clair. Il envoie le bailli de Macon prendre possession en son nom de l’enclave de Sainte-Colombe, et il somme Saint-Clair de restituer à Condrieu les terres des Roches, dont ses habitants ont été dépossédés à la suite du siège.
Le bailli
fort zélé estime que les ordres du roi ne trouvent pas
beaucoup d’écho
favorable. Il va se faire un devoir de mettre le siège devant
Saint-Clair, dont
la garnison sera passée au fil de l’épée, le
château détruit, la ville pillée
et brûlée. Quant à Sainte-Colombe, dont il s’est
emparé sans coup férir et dont
il a fait un bastion royal, il va l’entourer de remparts et dresser
face au
pont de Vienne une puissante tour carrée, haute de plus de 30 m,
à laquelle le
pont donnera accès par une porte fortifiée. Tout ce qui
transite par le pont,
voyageurs et marchandises, doit passer par la tour pour
pénétrer en terre de
France. Bien entendu, le roi en profite pour prélever une taxe,
et il impose de
même un péage fluvial pour la circulation sur le
Rhône. Malgré des agencements
plus ou moins heureux au fil des siècles, et malgré la
disparition de ses
créneaux et de ses mâchicoulis, la « Tour des
Valois » garde encore fière
allure aujourd’hui et continue de narguer la ville de Vienne. |
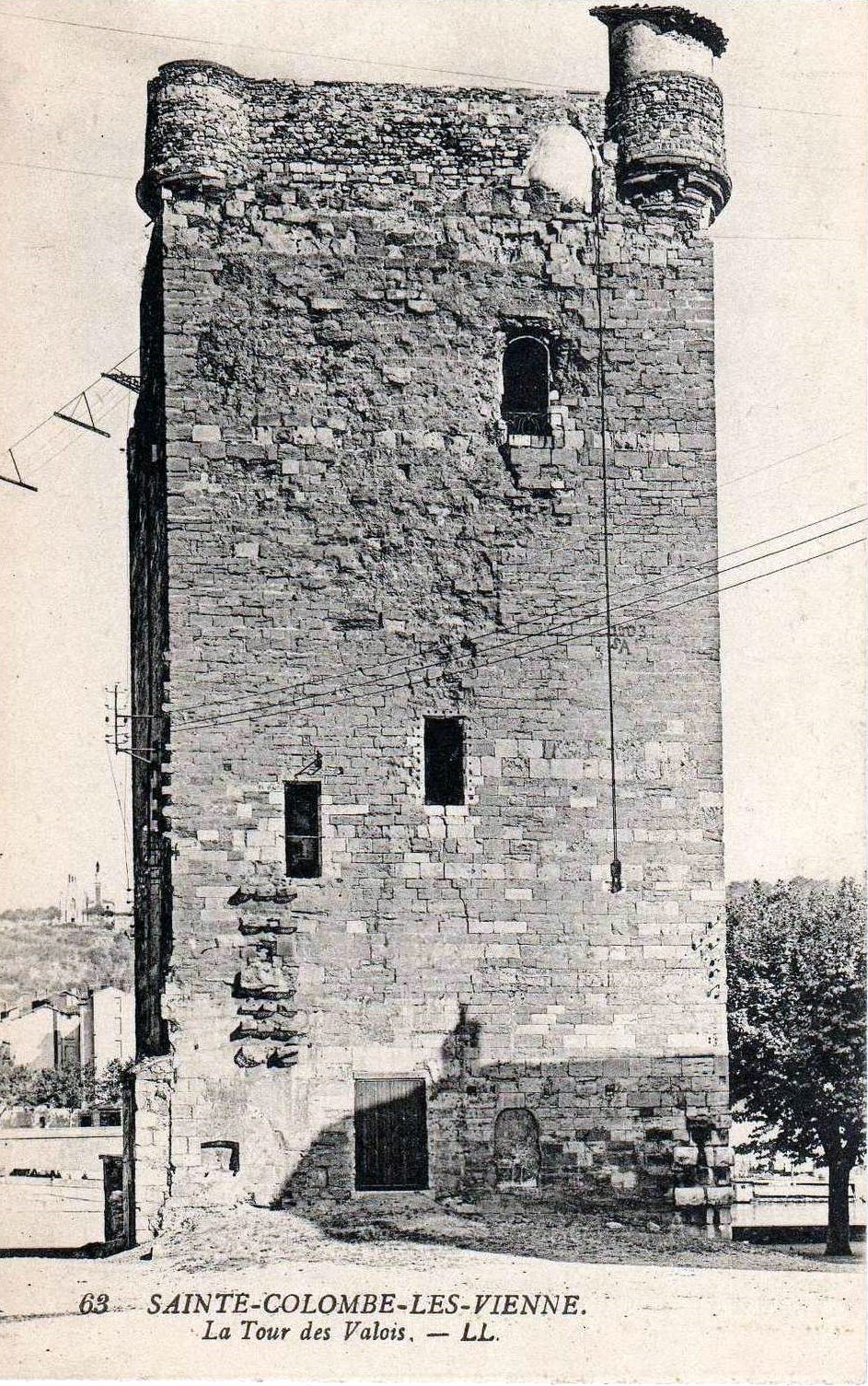 La Tour des Valois (carte postale ancienne) |
La région connaîtra
d’autres périodes troubles, en
particulier lors des guerres de religion. Mais c’est une autre
histoire… Ce
n’est véritablement qu’au début du XVIIe siècle
que la paix reviendra sur la
Vallée du Rhône.
|