
Jean-Jacques Rousseau dans le Pilat en 1769
|
Présenté
par
Patrick Berlier |

|
MARS
2025 |
Peu après la création
du Parc Naturel Régional du Pilat en 1974, plusieurs chemins de randonnée
pédestre furent tracés, venant des vallées et convergeant vers les sommets. À
l'époque les itinéraires de marche étaient en ligne, ce n'est que plus tard que
l'on comprit toute la commodité d'un itinéraire en boucle. Ces grands sentiers
prirent le nom d'une personnalité, gloire locale pour la plupart : Claude
Berthier, Laurent Odouard, Béatrice de Roussillon, etc La seule exception fut
pour le premier d'entre eux, qui fut dédié à Jean-Jacques Rousseau, célèbre
écrivain et philosophe, en souvenir de l'expédition d'herborisation qu'il mena
dans notre massif en août 1769. Allant de Condrieu à la Jasserie, ce sentier
suit plus ou moins l'itinéraire historique emprunté par l'homme de lettres qui,
dans les quinze dernières années de sa vie, s'était pris de passion pour la
botanique.
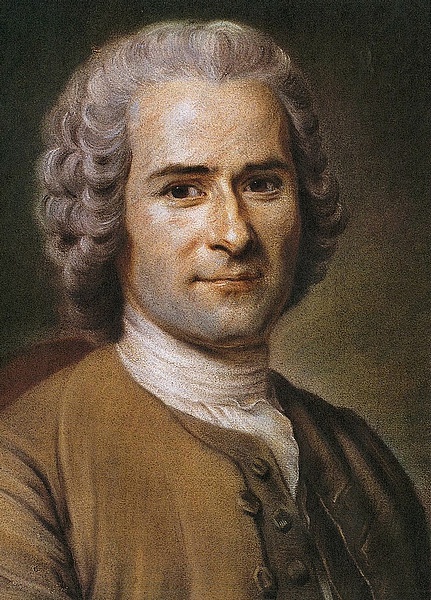
Portrait le plus connu de Jean-Jacques Rousseau
(pastel de Quentin de la Tour - 1753)
Jean-Jacques Rousseau
est né à Genève en 1712 dans une famille protestante. Son enfance fut
difficile : sa mère étant décédée quelques jours après sa naissance il fut
élevé par son père et la sœur de celui-ci. Quant à sa jeunesse, on dit qu'elle
fut aventureuse, dans le sens où, très attiré par les femmes, il passa de l'une
à l'autre sans se fixer avec aucune. Il eut ainsi très jeune un caractère bien
forgé, ce qui le prédisposa sans doute à devenir l'un des plus grands penseurs
de son siècle, l'égal de Voltaire ou de Diderot, avec qui d'ailleurs il ne
s'entendait guère. On dit souvent que ce sont leurs idées qui amenèrent la
révolution française. Concernant Rousseau, on peut ajouter qu'il inspira aussi
le Romantisme qui allait devenir très à la mode au début du XIXe
siècle, aussi bien en littérature que dans l'art pictural.
Jean-Jacques Rousseau
se fit d'abord connaître comme musicien. Puis au milieu du XVIIIe
siècle il publia deux essais philosophiques, Discours sur les sciences et
les arts (1750) et Discours sur l'inégalité (1755). Il y avançait
l'idée que les vertus naturelles de l'homme primitif avaient été corrompues par
la vie sociale. Pour lui l'homme au début de son évolution était foncièrement
bon, ce n'est que beaucoup plus tard que la fréquentation de ses semblables
dénatura sa générosité naturelle. De telles idées firent considérer comme un
utopiste celui qui les avait proclamées. Néanmoins Rousseau persista dans cette
voie, estimant toutefois que la morale individuelle et collective pouvait
permettre de retrouver une part de ces vertus originelles. C'est la thèse qu'il
développa dans ses écrits suivants, Julie ou la nouvelle Héloïse (1761),
Du contrat social (1762), et Émile (1762).
Vivement critiqué par
les autres philosophes, poursuivi par l'Église, étant en outre de confession
réformée, Rousseau ne trouva le salut que dans une existence errante. Il
voyagea en France, en Italie ou en Angleterre, avant de se convertir au
catholicisme au soir de sa vie. Plusieurs personnes de l'aristocratie – souvent
des femmes qui étaient éprises de ses idées, et parfois de l'homme – le prirent
sous leur protection et lui fournirent des résidences provisoires.
Rousseau vint
plusieurs fois à Lyon, mais c'est en Suisse qu'il fit la connaissance, en 1762,
d'une Lyonnaise, Madame veuve Boy de la Tour, très admirative de ses œuvres.
Elle mit à sa disposition la résidence qu'elle possédait en Suisse à Môtiers,
dans le val de Travers. Il y séjourna durant plus de trois ans. C'est là qu'il
écrivit ses Confessions, et c'est lors de ses promenades solitaires
qu'il commença à s'intéresser aux fleurs et à la botanique.
En juin 1768
Jean-Jacques Rousseau était à nouveau à Lyon, rendant visite à Madame Boy de la
Tour. Lors de ce séjour il sympathisa avec l'éminent botaniste Marc Antoine
Louis Claret de la Tourrette. Nul doute que c'est lui qui lui parla du Pilat,
car il affectionnait particulièrement ce massif, où il se rendait souvent. La
tradition orale a conservé pour le grand chirat du Crêt de l'Étançon le nom de
chirat de la Tourrette, bien qu'il n'apparaisse sur aucune carte. Ce nom lui
aurait été donné en souvenir de ce savant, car c'était dit-on l'un de ses
lieux favoris. Il est vrai que la vue y est exceptionnelle. M. A. L. Claret de
la Tourrette allait publier en 1770 Voyage au Mont-Pilat, qui constitue
l'une des premières descriptions du Pilat après celle de Jean du Choul en 1555.
Devant se rendre à
Grenoble en juillet 1768, Rousseau décida de profiter du voyage pour explorer
le massif de la Grande Chartreuse, accompagné des deux grands fils de Madame
Boy de la Tour. Leur guide était Marc Antoine Louis Claret de la Tourrette, « botaniste
aussi savant qu'aimable ». Rousseau fut ravi et emballé par cette
excursion, mais il n'apprécia guère ensuite son séjour à Grenoble, où trop de
gens se mirent en devoir de rechercher sa compagnie. Non pas parce qu'ils
partageaient les mêmes convictions philosophiques – l'un de ces personnages lui
avoua même n'avoir jamais lu un seul de ses livres – mais par pure mondanité.
Rousseau, excédé, reprit la route de Lyon. Passant par Bourgoin-Jallieu, où il
arriva le 12 août, il s'y arrêta, logeant à l'auberge de la Fontaine d'Or. Là
le rejoignit Thérèse Levasseur, une humble lingère avec qui il entretenait une
liaison depuis de nombreuses années. Ils avaient d'ailleurs eu plusieurs
enfants, que Rousseau n'avait pas reconnus, et qu'il avait abandonnés aux Enfants
Trouvés, l'équivalent de l'époque de l'Assistance Publique. Fin août 1768 ils
se marièrent civilement à Bourgoin.
Durant l'hiver qui
suivit, Rousseau tomba malade, et fut soigné par un jeune médecin, le Docteur
Meynier, qui lui conseilla de changer de résidence. Une aristocrate, la
marquise de Cézargues, mit à sa disposition la gentilhommière de Monquin
qu'elle possédait non loin de là. L'air y étant plus sain et l'eau meilleure,
dès le printemps 1769 la santé de Rousseau s'améliora grandement.

Ferme de Monquin à Bourgoin-Jallieu (Isère), lieu de séjour de
Jean-Jacques Rousseau en 1769-1770 (carte postale ancienne)
Durant l'été 1769,
alors âgé de 57 ans, il décida d'organiser enfin cette excursion au Mont Pilat
qui était « arrangée depuis longtemps ». S'il l'évoque brièvement
dans ses Rêveries d'un promeneur solitaire, c'est surtout dans sa
correspondance, lettres adressées à divers destinataires, que Rousseau a relaté
en détails son expédition, ce qui nous permet d'en donner ici de larges
extraits, qui par commodité seront transcrits en français moderne. Trois personnes
se joignirent à lui, les deux fils de Madame Boy de la Tour et le Docteur
Meynier. Le botaniste Claret de la Tourrette n'était pas présent pour les
guider, mais il avait sans doute longuement expliqué à Rousseau les chemins à
suivre. Le dimanche 13 août 1769 ils quittèrent Bourgoin, à pied. Le soir-même
ils arrivèrent à Vienne, où ils soupèrent et couchèrent.
À l'aube du lundi
matin 14 août, les excursionnistes passèrent sur l'autre rive du Rhône, mais
Rousseau ne précise pas de quelle façon ni à quel endroit. À l'époque, aucun
ouvrage n'avait encore remplacé le vieux pont médiéval reliant Vienne à
Sainte-Colombe, dont il ne restait plus que quelques piles ruinées. Pour
franchir le fleuve, il fallait emprunter l'un des bacs à traille assurant la
traversée. Il y en eut plusieurs, mais le seul dont on ait la certitude qu'il
existait déjà en 1769 est celui de Vaugris, à 5 km au sud de Vienne, mis en
service dix ans plus tôt en 1759. Il permettait de rejoindre Ampuis. Il
existait encore au début du XXe siècle comme en témoignent les
cartes postales de l'époque.
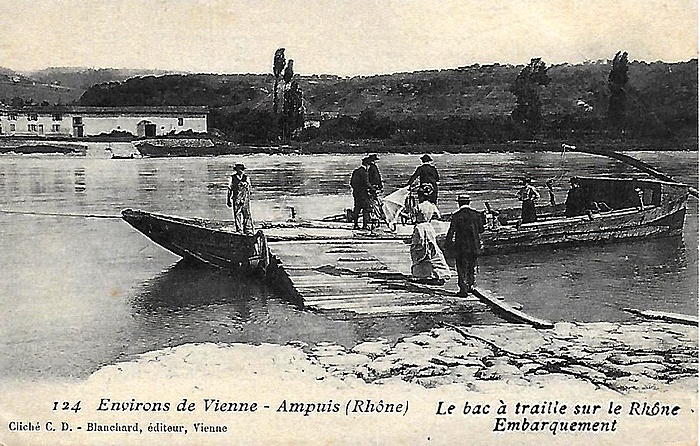
Bac à traille entre Vaugris et Ampuis (carte postale ancienne)
Jean-Jacques Rousseau
écrit : « Je partis à pied avec trois Messieurs dont un Médecin, qui
faisaient semblant d’aimer la Botanique, et qui désirant de me cajoler, je ne
sais pourquoi, s’imaginèrent qu’il n’y avait rien de mieux pour cela que de me
faire bien des façons. Ils m’ont trouvé très maussade, je le crois bien. Ils ne
disent pas que c’est eux qui m’ont rendu tel. »
Après avoir traversé
le Rhône, Rousseau et ses compagnons longèrent sa rive droite jusqu'à Condrieu,
où commença vraiment l'expédition d'herborisation, par une météo très
défavorable, pluie incessante et brouillard. Rousseau écrit à ce propos :
« nous avons eu mauvais temps presque durant toute la route. Ce qui
n’amuse pas quand on ne veut qu’herboriser et que, faute d’une certaine
intimité l’on n’a que cela pour point de ralliement et pour ressource. »
Les excursionnistes
prirent le chemin de Pélussin, et pour cela ils empruntèrent certainement
l'ancienne voie romaine y conduisant, la montée de Sainte-Agathe. Au hameau de
la Pélarie, sur le replat, elle rejoint une autre voie antique, venant de la
vallée du Gier par Trèves et le Pilon. Réunies en un seul chemin, les deux
anciennes voies romaines se poursuivent par Métrieux, la Croix Blanche, la
Guintranie et Pélussin.
Commença ensuite le
plus difficile, l'ascension vers les sommets du Pilat. D'abord vers le Crêt de l'Œillon, que plusieurs chemins
permettaient d'atteindre : par la Croix de Montvieux, par le Collet de
Doizieux, ou par Champailler. Quel que fût l'itinéraire choisi, à partir de
l'Œillon la petite troupe suivit ensuite tout l'enchaînement des crêts :
Bote, Rachat, Étançon, Arnica, jusqu'à atteindre leur point culminant, dont
Rousseau ne donne pas le nom. Il explique d'ailleurs qu'il a eu beaucoup de
difficulté à se souvenir des noms des lieux :
« Quant
à la désignation particulière des lieux, il m’est impossible de vous la
donner : car outre la difficulté de la faire intelligiblement, je ne m’en
ressouviens pas moi-même. »
Dans
un autre courrier, Rousseau confesse : « Tout ce que nous avons eu de
meilleur dans notre pèlerinage a été l’excellent vin
d’Espagne que vous connaissez qui nous a grandement réconforté tout au sommet
de la montagne ». Ceci explique peut-être cela.
On devine que ce
sommet est le Crêt de la Perdrix, un nom familier aujourd'hui, mais qui ne
l'était pas encore à l'époque, puisqu'il allait être cité pour la première fois
seulement l'année suivante par M. A. L. Claret de la Tourrette dans son livre.
Il devait être déjà bien tard lorsque le petit groupe arriva au sommet de ce
qui allait devenir le Crêt de la Perdrix, au terme d'un cheminement de plus de
30 km, depuis Vienne, et d'un dénivelé de plus de 1300 m. Un bel exploit,
surtout sous la pluie, il faut au moins reconnaître ce mérite à Jean-Jacques
Rousseau. Les excursionnistes n'eurent sans doute que le temps, avant la nuit,
de parcourir les quelques centaines de mètres les séparant de la Grange du
Pilat, cette ferme isolée en contrebas du Crêt de la Perdrix, servant
occasionnellement d'auberge, que l'on nomme aujourd'hui la Jasserie. Marc
Antoine Claret de la Tourrette était sans doute lui aussi un familier du lieu,
et l'on peut imaginer que c'est sur son conseil que Rousseau vint frapper à la
porte de la Grange du Pilat, ce qui ne lui laissa pas un souvenir impérissable.
Le repas qu'on leur servit fut « maigre et détestable », mais le pire
restait à venir :
« nous
avons trouvé sur la montagne un très mauvais gîte. Pour lit du foin ressuant et
tout mouillé, hors un seul matelas rembourré de puces, dont comme étant le
Sancho de la troupe, j’ai été pompeusement gratifié. »
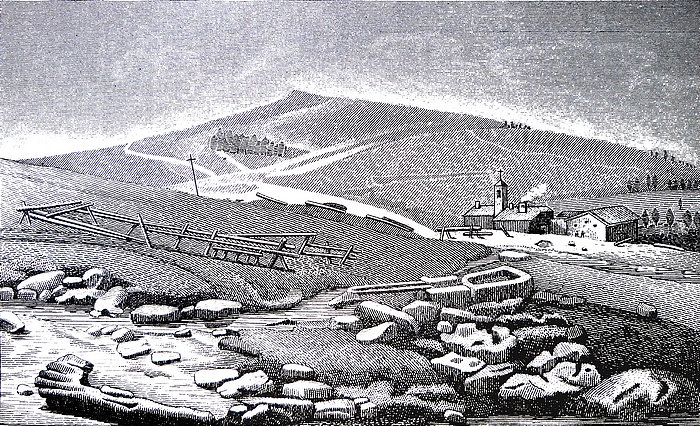
La Grange du Pilat et le Crêt de la Perdrix jadis (gravure
ancienne)
On
peut imaginer que la matinée suivante du mardi 15 août fut occupée à explorer
les prairies et les bois environnant la Grange. Chacun des compagnons de
Rousseau se mit en devoir de lui être agréable : « Tout en marchant
M. le médecin Meynier m’appela pour me montrer, disait-il, une très belle
ancolie. Comment Monsieur une ancolie ! lui dis-je en voyant sa plante,
c’est le Napel. Là-dessus je leur racontai les fables que le peuple débite en
Suisse sur le napel, et j’avoue qu’en avançant et nous trouvant comme ensevelis
dans une forêt de Napel, je crus un moment sentir un peu de mal de tête, dont
je reconnus la chimère et ris avec ces Messieurs presque au même instant »

Le Napel
L'aconit
napel est une plante de montagne, toxique pour l'être humain, d'où sa mauvaise
réputation. S'il est vrai que les Gaulois l'ont utilisé pour enduire les
pointes de leurs flèches lorsqu'ils chassaient les loups ou les ours, c'est
sans doute une légende que de dire que les célèbres Borgia en faisaient une
grande consommation. Il est très commun en Suisse, mais on trouve quelques
plants de Napel dans le Pilat, dûment répertoriés et protégés. En aucun cas
cette plante, pas très grande, ne peut former une forêt, c'est là une belle
image, voire une exagération de Rousseau, qui poursuit :
« A
la fin je me le tins pour dit, et m’amusant avec mes plantes, je laissai ces
Messieurs s’amuser à me faire des façons »
« le
pire est que nous n’avons presque rien trouvé, étant allés trop tard pour les
fleurs, trop tôt pour les graines, et n’ayant eu nul guide pour trouver les
bons endroits. Ajoutez que la montagne est fort triste, inculte, déserte, et
n’a rien de l’admirable variété des montagnes de Suisse. »
Rousseau
et ses compagnons cherchèrent cette source « d'une froideur telle qu'elle
fait enfler la bouche de ceux qui en boivent et qu'il est impossible d'y tenir
la main ». C'est ce qu'écrivait Jean du Choul en 1555. Depuis, c'est la
mauvaise réputation de cette source que la rumeur populaire avait fait enfler.
On affirmait désormais que quiconque s'aventurerait à boire de son eau
s'exposerait au risque de perdre la vie aussitôt.
Rousseau
écrit : « J'ai vainement cherché à Pila une fontaine glaçante, qui
tuait, à ce qu'on nous dit, quiconque en buvait. Je déclarai que je voulais
faire l'essai sur moi-même, non pas pour me tuer, je vous le jure, mais pour
désabuser les pauvres gens sur la foi de ceux qui se plaisent à calomnier la
nature […] Mais au lieu de cette fontaine homicide qui ne s'est point trouvée,
nous trouvâmes une fontaine très bonne, très fraîche, dont nous bûmes tous avec
grand plaisir, et qui ne tua personne. »
Dans
la forêt l'un des fils de Madame Boy de la Tour fut cruellement mordu par un
chien, et un autre molosse s'en prit à Sultan, le fidèle caniche de Rousseau
qui avait suivi son maître comme dans toutes ses excursions. Rousseau le
chercha partout et le crut mort. On raconte qu'en revenant à la Grange, les
excursionnistes eurent la surprise d'y être accueillis par tout un aréopage des
notables du coin, car le bruit s'était rapidement répandu que le grand
Jean-Jacques Rousseau séjournait à la Grange du Pilat. Un édile se lança dans
un discours alambiqué, émaillé des citations de l'auteur. Rousseau lui aurait
répliqué : « et vous n'avez pas vu mon chien ? ».
Ce
qui était arrivé au caniche, il le raconta dans une lettre à Madame Boy de la
Tour : « Notre voyage fut assez triste,
toujours de la pluie, peu de plantes vu que la saison était trop avancée, un de
vos Messieurs fut mordu par un chien, Sultan fut estropié par un autre. Je le perdis dans les bois où je
l’ai cru mort de ses plaies ou mangé du loup ; à mon retour j’ai été tout
surpris de le retrouver ici bien portant, sans que je sache comment dans son
état il a pu faire sans manger cette longue route, et surtout comment il a
retraversé le Rhône. »
En
effet le brave caniche avait échappé à son agresseur, son instinct lui avait
fait reprendre le chemin de Bourgoin, pourtant situé à près de 50 km, en
traversant le Rhône sans doute à la nage, et Rousseau le retrouva chez lui à
son retour quelques jours plus tard. Au final l'homme de lettres fut très déçu
par son excursion au Mont Pilat, entreprise par trop mauvais temps. Dans une
lettre à la duchesse de Portland, il écrit : « la pluie et d’autres
accidents nous ayant sans cesse contrariés m’ont fait faire un voyage aussi peu
utile qu’agréable ».
Et
dans un autre courrier, pour Marc Antoine Louis Claret de la Tourrette, il
déclare : « je ne suis pas étonné qu’avec tous les avantages qui me
manquaient vous ayez trouvé dans cette triste et vilaine montagne des richesses
que je n’y ai pas vu. »
Le
botaniste ne lui tint pas rigueur de ce jugement peu flatteur à l'égard de ce
Pilat que lui appréciait. Il est vrai que Jean-Jacques Rousseau lui avait
adressé une nomenclature des plantes qu'il avait trouvées, bien qu'arrivé
« trop tard pour les fleurs, trop tôt pour les graines ». L'année
suivante, Claret de la Tourrette publia son Voyage au Mont-Pilat, dans
lequel il ne manqua pas d'évoquer Rousseau, sans le nommer :
« j’ai
eu lieu de faire usage des excellentes notes qui m’ont été fournies, sur
quelques plantes tardives du Mont-Pilat, par un homme célèbre,
qui, après avoir percé d’un œil philosophique les replis du cœur humain, n’a
pas cru qu’il fût indigne de lui, de fixer ses regards sur des herbes
& sur des mousses. »
Jean-Jacques Rousseau mourut en 1778 au château
d'Ermenonville près de Paris. Onze ans plus tard, les révolutionnaires
redécouvrirent son Contrat social, et trouvèrent qu'il contenait déjà toutes les idées de
leur Révolution. Entre temps, avaient été publiées à titre posthume en 1882,
les Rêveries d'un promeneur solitaire, écrites dans les dernières années de sa vie, lesquelles
rêveries contenaient quant à elles les ferments du Romantisme qui allait
fleurir au XIXe siècle.
Malgré les mots fort peu aimables de Rousseau à propos du
Pilat, c'est donc en son honneur que fut créé le premier des grands sentiers du
Parc Naturel Régional du Pilat. Il est temps pour nous de le parcourir à pied,
même s'il ne fait que s'inspirer de l'itinéraire historique suivi par l'homme
de lettres. Son point de départ est donc la cité de Condrieu. C'est en
remontant la combe du Vernon que le sentier s'élève au-dessus de la vallée du
Rhône. Par le Plomb et les Trois Fortunes, il rejoint la Pélarie, mais au lieu
de se diriger sur Pélussin il passe par
la Vieille-Chapelle pour monter jusqu'au col de Grenouze.

La Vieille-Chapelle (chapelle Sainte-Marguerite)
De là et par le flanc nord du Mont Ministre le sentier
rejoint le col de Pavezin, puis il continue par Grange-Rouet, la Croix de
Montvieux et le le hameau de Veylon. Entre ces deux derniers points le sentier
moderne, comme peut-être l'itinéraire historique, passe devant le Châtelard,
une vieille bâtisse que l'on dit avoir été occupée par des religieux vivant en
permanence cloîtrés. Une curieuse tradition est attachée à ce lieu. On dit que
les enfants malades étaient apportés aux religieux qui les soignaient
prestement et peut-on dire miraculeusement. C'est par une ouverture ménagée
dans le mur de clôture que les enfants étaient passés aux bons pères, lesquels
par le même procédé les rendaient guéris aux parents, sans jamais les voir. Il
ne s'agit peut-être que d'une croyance sans fondement, si ce n'est le souvenir
éthéré de cette « infirmerie » jadis installée à la Croix de
Montvieux sur le passage de la voie romaine. De nos jours la fameuse ouverture
dans le mur est fermée par une grille, même si elle est toujours surmontée
d'une croix. Portant la date 1749, elle était déjà là lors du passage de
Rousseau. L'eau d'une source ou d'une citerne s'écoule dans un bachat formé
d'un tronc d'arbre évidé.

Le Châtelard, sur le sentier Jean-Jacques Rousseau
Après Veylon le sentier grimpe dans la forêt pour atteindre
le Collet de Doizieux. Là il oblique à droite et descend jusqu'au village de
Doizieux, qu'il traverse, pour remonter vers la Jasserie par le hameau de la
Roche. En sortant du Bois du Bœuf on arrive enfin en vue du Crêt de la Perdrix
et de cette bonne vieille Grange du Pilat, notre Jasserie. Il y a quelques
décennies on y montrait encore le lit dans lequel Jean-Jacques Rousseau avait
dormi. Il faut bien reconnaître que les lieux se sont considérablement
améliorés depuis son passage. Plus de literie humide ou infestée de puces, plus
de nourriture exécrable. Il va être temps de déguster l'excellente tarte aux
myrtilles emblématique de la maison.