Un Coin Sympa
|
Patrick Berlier |
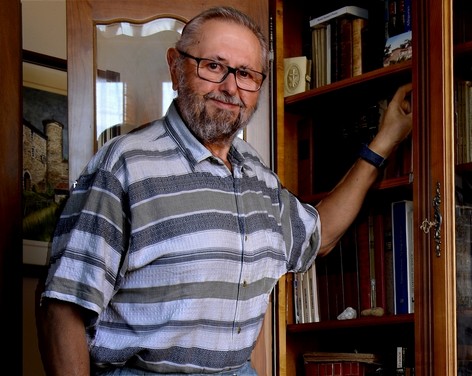 |
Octobre
2018 |
|
LES
HAUTS DE LA VERSANNE |
Pour ce nouveau
« coin sympa » nous
voici sur la commune de la Versanne, dans le canton de Bourg-Argental.
C'est un
territoire rural qui s'étage de 750 m à près de
1300 m, assez pentu en
conséquence. Le village lui-même est à la limite de
deux paysages différents,
une partie basse au sud, mélange de terres agricoles, de
prairies et de bois,
entrecoupés de nombreuses rivières encaissées, et
une partie haute au nord,
plus homogène, constituée principalement de forêts,
et qui forme le versant sud
du Grand Bois. C'est à cette partie haute que nous allons nous
intéresser. DE RUTHIANGES À LA
VERSANNE La Versanne est un nom assez
récent, puisqu'il
date seulement de 1790. Versanne est un dérivé de
versant, le nom résume à lui
seul la topographie de la commune. Avant la Révolution, le
village se nommait
Saint-Didier-de-Ruthianges, la première partie du nom correspondant au patron de la paroisse,
évêque de Vienne au VIe siècle, et la
seconde étant l'appellation du
village proprement dit, un dérivé du germain,
caractéristique par la
terminaison « anges », fréquente surtout
en Haute-Loire. Les
habitants de la Versanne, fidèles à l'appellation
d'origine, sont toujours
nommés les Ruthiangiers. La paroisse est connue depuis 1276,
date où elle apparaît
dans le cartulaire du prieuré de Saint-Sauveur-en-Rue, son
église étant à
l'origine l'une de ses succursales. Elle a ensuite été
rattachée à l'église de
Bourg-Argental. De la chapelle primitive il ne reste rien,
l'église actuelle,
de style néoroman byzantin, datant du milieu du XIXe
siècle. C'est
une œuvre de l'architecte Boisson, à qui l'on doit plusieurs
églises dans la
région.
La
Versanne, le village (carte postale ancienne) LE COL DU GRAND BOIS OU DE LA
RÉPUBLIQUE Ce point de passage entre
Saint-Étienne et
Bourg-Argental constitue la limite entre Saint-Genest-Malifaux et la
Versanne.
Le col possède deux noms : du Grand Bois parce qu'il se
trouve au cœur de
cette immense forêt, et de la République parce que c'est
le nom d'un hameau
proche. Mais cette république-là n'a rien à voir
avec la République Française.
En fait il y a deux versions pour expliquer l'origine de ce toponyme.
À vous de
choisir celle qui vous paraît la plus pertinente. Soit il s'agit
de la
« République de Jésus-Christ »
fondée en 1794 sur ce plateau par une
secte religieuse, les Béguins, venus ici attendre
l'arrivée du prophète Élie,
et dont le campement illégal fut dispersé par les
gendarmes, soit il s'agit de
la déformation de « l'arrêt
public », autrement dit la station des
diligences assurant la ligne Saint-Étienne – Annonay. La
« route
bleue » franchit le col depuis 1830, année de son
percement. Elle fut
route impériale, puis route nationale 82, aujourd'hui simple
départementale
1082. Auparavant c'étaient des chemins muletiers qui passaient
par là. Aux Trois-Croix les touristes
ignorants
l'étymologie du nom sont très étonnés de ne
trouver qu'une seule et
« vraie » croix, au sens premier du terme. En
fait ce nom est dû aux
trois embranchements successifs : depuis la D 1082, par une
bretelle à
droite on peut rejoindre la D 22 qui va de Saint-Sauveur-en-Rue
à
Saint-Genest-Malifaux. Un peu plus loin s'embranche la D 28 en
direction de
Saint-Régis-du-Coin. Trois croix certes, mais au sens
géographique du terme,
trois carrefours autrement dit.
L'auberge
du Grand Bois, aux Trois Croix (carte
postale ancienne) DANS LE GRAND BOIS La frontière de la
commune de la Versanne
serpente à travers le Grand Bois jusqu'à atteindre le
sommet d'une colline, la
Tourière (1292 m), son point culminant. Pour parcourir les
forêts situées sur
le territoire de la Versanne, nous allons emprunter le grand chemin
partant à
droite (quand on vient du village de la Versanne) au niveau des
Trois-Croix.
C'est le vestige d'un projet né dans les années qui
suivirent la seconde guerre
mondiale, celui d'une route des crêtes qui devait relier les
Trois-Croix au col
de l'Œillon. Dans les années cinquante, les défenseurs de
la nature réussirent
à empêcher sa réalisation. Aujourd'hui le GR 7
emprunte ce tracé en grande partie.
Sur ce chemin se présente bientôt le lieu-dit
Fourvière, un nom qui paraît
incongru. C'est en fait la déformation du latin furca viarum,
fourche de
chemins, qui a subi l'attraction du Fourvière lyonnais. Le
chemin de droite,
par où nous allons continuer, sert en grande partie de
frontière à la commune
de la Versanne. Nous laissons à droite
les Loges de Monteux,
ensemble de fermes et de granges, dont il ne reste plus rien, à
part quelques
pierres perdues dans les bois. Jadis on pouvait descendre à
droite jusqu'au
« cimetière des Polonais », mais ces
chemins-là aussi semblent avoir
disparu. Nous arrivons à un carrefour de quatre chemins, bien
connu des
randonneurs et des ramasseurs de champignons. Nous continuons tout
droit pour
descendre dans un creux de vallée humide, un lieu justement
nommé la Flotte.
Nous remontons sur la ligne de crête, puis au carrefour suivant
nous tournons à
droite pour descendre vers les Loges de Lapras. Peu après, le
chemin rejoint le
GR 42 qui vient du Bessat. Nous le suivons sur quelques centaines de
mètres
pour atteindre la Croix Fayard et la Grotte Sarrasine. LA GROTTE SARRASINE Il y a bien une croix à
la Croix Fayard, la croix
aux fées. C'est une croix rustique, de bois mal
ébranchée, qui a remplacé une
croix plus ancienne, laquelle avait fini par tomber en morceaux.
D'après la
légende, les fées du Pilat se retrouvaient autour de
cette croix, pendant que
leurs époux les Sarrasins amassaient leurs trésors dans
la grotte qui porte
leur nom, au sommet de la colline.
La
Croix Fayard (Photo
Altituderando.com) Il est temps d'y grimper.
Sentier agréable,
ombragé, bien qu'un peu rude. Au sommet un grand amas de rochers
domine un
chirat, qui s'étale sur la pente. Il ne faut pas monter jusqu'au
faîte de la
colline, mais juste avant prendre à gauche et contourner les
gros blocs de
rochers, pour trouver enfin, au pied de l'escarpement, l'entrée
de la grotte.
C'est une ouverture basse, qu'il faut franchir en se baissant, mais
à
l'intérieur on peut se tenir debout. On comprend que les anciens
ait attribué
cette cavité aux Sarrasins, personnages en grande partie
légendaires, mais il
est vrai que cette grotte sans doute naturelle paraît avoir
été aménagée par
l'homme, un peu sur le principe de la Grotte des Fées du Mont
Ministre.
Entrée
de la Grotte Sarrasine (Photo
Altituderando.com) Nous redescendons à la
Croix Fayard, puis par un
chemin agréable nous rejoignons la petite route de la Biousse,
qui nous ramène
à la Versanne. LE MONUMENT DU MAQUIS
FRANCO-POLONAIS Pour accéder à
cet émouvant souvenir de la
Résistance, le plus simple, depuis la Versanne,
est de remonter la D 1082 jusqu'au hameau des Rouaires, et
là prendre à
droite la petite route de la Biousse. À l'embranchement, un
panneau avertit les
passants : « L'oubli est pire que la mort. Rendez
hommage au maquis
franco-polonais ».
Le
panneau du maquis au début de la route Un peu plus loin sur cette
route, nous tournons à
gauche comme nous y invite un nouveau panneau indicateur. Le chemin
goudronné
s'arrête au niveau d'une ferme, en un lieu nommé les Trois
Dents. Curieux nom,
car on cherche vainement quelles dents seraient à l'origine du
toponyme. Nous
continuons par un chemin de terre, qui pénètre rapidement
dans la forêt. Un peu
plus loin se présente une fourche de chemins. Si un panneau nous
prévient que
nous sommes bien sur le sentier du maquis, rien n'indique quel chemin
il faut
prendre. Les rares personnes qui connaissent l'emplacement du monument
savent
qu'il faut partir par celui de gauche, puis poursuivre tout droit
après avoir rejoint
un chemin venant de la droite, et enfin monter par le sentier à
droite, pour
arriver dans la clairière où s'élève le
monument. « L'oubli est pire que
la mort », disait la pancarte, pourtant c'est bien à
l'oubli que le
monument semble voué. À l'absence de balisage s'ajoute le
mutisme de la carte
topographique. Sur l'édition la plus récente, rien
n'indique la présence du
monument, ni mention, ni symbole. Il faut avoir recours à une
édition plus
ancienne (avant 2016) pour le voir signalé, sans mention
particulière, par le
symbole traditionnel d'un monument, un minuscule carré,
d'à peine 1 mm de côté,
que seul un œil exercé peut discerner.
Le
monument du maquis franco-polonais Nous voici donc au
« cimetière des
Polonais », comme disaient les anciens. Un petit enclos, une
croix de
Lorraine en gazon, trois marches, et une croix de granite
adossée à une
murette, voilà à quoi ressemble le monument. Un peu plus
haut, à l'autre bout
de la clairière, on voit aussi le dernier pan de mur restant de
la maison qui
servait de base aux maquisards. Le devoir de mémoire nous impose
de raconter
cette triste histoire, sans nous faire l'écho des ragots et
calomnies qui
circulent encore sur Internet. En mars 1944, un groupe de travailleurs
de la
Ricamarie, mineurs pour la plupart, et presque tous d'origine
polonaise, décida
de défendre contre l'occupant nazi le pays qui les avait
accueillis. Affiliés à
la branche Main d'Œuvre Immigrée (MOI) des Francs-Tireurs et
Partisans (FTP),
considérés comme la mouvance communiste de la
Résistance, ils prirent le maquis
et s'installèrent dans des bâtiments de ferme entre le
Grand Bois et
Saint-Genest-Malifaux. Leur but était d'attaquer les
véhicules allemands
passant par le col. Ces maquisards étaient au nombre de 24, dont
une femme. Comme il leur fallait bien
trouver de quoi
manger, ils décidèrent de réquisitionner la
nourriture là où elle était, chez
les paysans aux alentours ou dans les épiceries des villages.
Certains s'y
prêtèrent de bonne grâce, mais cela déplut
à d'autres personnes, à tel point
que ceux qui se disaient victimes de pillages se plaignirent à
la Kommandantur
de Saint-Étienne. Doit-on les blâmer ?
Dénoncer les maquisards leur
permettait de se dédouaner aux yeux des autorités
d'occupation, et on sait que
parmi ceux qui aidèrent la Résistance certains le
payèrent au prix fort. Le 12
juillet, 7 maquisards se lancèrent dans une opération de
plus grande envergure.
Ils réquisitionnèrent un camion et le conduisirent
à Saint-Régis du-Coin. Là
ils investirent la villa du président de la Légion des
Combattants du canton,
par ailleurs administrateur du Nouvelliste, un journal vichyste
lyonnais. Ils firent main basse sur les denrées alimentaires,
qu'ils chargèrent
dans le camion. Le propriétaire déposa plainte à
son tour. La Kommandantur
chargea la police militaire allemande, la redoutable Feldgendarmerie,
de
résoudre le problème. Comme la situation devenait
tendue, vers le 16
juillet les maquisards décidèrent de changer de base, et
ils s'installèrent
dans un bâtiment inoccupé des Loges de Monteux, dans le
Grand Bois, sur la
commune de la Versanne. Deux d'entre eux commirent l'erreur d'aller
faire un
tour vers l'auberge du Grand Bois, l'un armé d'une mitraillette
et l'autre d'un
fusil de chasse. On les reconnut, on les épia, on les suivit
peut-être.
Toujours est-il qu'une femme prit la décision de les
dénoncer à la police
militaire allemande, contre une récompense de 7000 Francs. Sans
doute ne se
doutait-elle pas de la portée dramatique de son geste, et on
peut espérer
qu'elle fut ensuite atterrée d'avoir entraîné la
mort de plus de 20 personnes.
Plaque
du souvenir Le 20 juillet à l'aube,
une importante troupe de
la Feldgendarmerie investit les lieux, aidée par la Gestapo et
quelques
miliciens français, soit 400 hommes au total. Des barrages
furent mis en place
sur les routes. Les Allemands obligèrent l'aubergiste du Grand
Bois à leur
montrer le chemin des Loges de Monteux. Les militaires se
déployèrent autour de
la ferme, qu'ils prirent en tenaille. Les feldgendarmes, connus pour
leurs
méthodes expéditives, lancèrent l'attaque et
ouvrirent le feu sans sommations
préalables. À 24 contre 400, les maquisards n'avaient
aucune chance. Un premier
fut tué sur le pas de la porte. Repliés dans la ferme,
les autres ripostèrent
de toutes leurs armes, mais plusieurs tombèrent sous les balles
allemandes. Les
survivants, à court de munitions, résolurent de se
rendre. Ils furent aussitôt
fusillés, et les blessés furent achevés d'une
balle dans la tête. Puis les
feldgendarmes firent sauter la ferme. Après le départ des
Allemands, les
paysans virent un homme sortir d'un trou sous un gros rocher, où
il avait
réussi à se cacher ; c'était le seul
survivant du massacre. Ils se
demandèrent ce qu'il fallait faire de ce
« terroriste ». Finalement
le maire le fit reconduire chez lui. Le lendemain les villageois,
accompagnés du
secrétaire de mairie, décidèrent d'inhumer les 23
cadavres, que les Allemands
avaient laissés sur place. On creusa une fosse, qui accueillit
les Polonais. Le
cimetière improvisé fut entouré d'une
barrière, et marqué d'une croix. En 1954
sept corps devaient être exhumés pour être
inhumés à la Nécropole de la Doua à
Villeurbanne. En juillet 1946 la croix provisoire fut remplacée
par le
monument, qui, pour ceux qui réussissent à le trouver,
perpétue le souvenir du
maquis.
Inauguration
du monument en juillet 1946 SAINTE-AGNÈS En remontant vers le col du
Grand Bois, nous
arrivons, peu avant de l'atteindre, au hameau de Sainte-Agnès.
Quelques
maisons, et surtout un grand terrain arboré, où nous
attendent de nombreuses
« pierres mystérieuses ». Nous avons
déjà eu l'occasion par le passé
d'évoquer ce site, dont l'histoire est bien connue. Il doit son
existence à
Philibert Réocreux, l'ingénieur chargé de la
construction de la « route
bleue ». Lors des travaux de percement, diverses pierres aux
formes
curieuses furent découvertes. L'ingénieur eut
l'idée de les rassembler et de
les agencer dans un terrain qu'il venait d'acheter, dont il voulait
faire un
lieu de promenade où son épouse, prénommée
Agnès, pourrait profiter du bon air.
Dans ce parc il voulait aussi construire un oratoire
dédié à sainte Agnès.
L'oratoire
Sainte-Agnès On entre dans le parc aux
pierres en passant sous
une sorte de dolmen, mégalithe moderne s'il en est. Les pierres,
dressées pour
la plupart, portent des noms évocateurs : l'ermite et son
chien, la Vierge
et l'oiseau, le singe, le grand serpent, etc. Il y eut au début
du XXe
siècle toute une collection de cartes postales qui leur fut
consacrée, ce qui
permet de connaître tous ces noms, sans quoi ils seraient perdus
aujourd'hui.
L'oratoire est un petit édicule avec une niche grillagée,
surmonté d'une croix.
Il manquait à notre première évocation des
photos du site, les voici pour clore ce nouveau
« coin
sympa ».
Les
« dolmens »
Un
« menhir » - le grand serpent de pierre  La Vierge et l'oiseau |