
 |
|
Pilat et Liens Mars 2019
|
 |
Michel
Barbot
|
DU
LÉON AU FOREZ OU LA
PROMESSE D’UN NOËL AU PIED DES ARBRES Première
partie Le
Pays de Léon est situé à l'extrême
nord-ouest de la
Bretagne, il forme le département du Finistère. Bien loin
du Forez et du Pilat,
et pourtant les deux régions sont liées d'étrange
façon par des traditions
légendaires. Suivons Michel Barbot dans sa quête, entre
Léon et Forez. Lorsque
l’historien
de formation interroge le passé, il le fait de façon
linéaire. Il suivra
l’ordre du temps ne s’autorisant nulle déviation susceptible de
modifier cette
ligne assurément immuable. Il est un autre historien souvent
qualifié de local.
La linéarité du temps apparaît soudain volumineuse.
Il s’autorise des
modifications, des prolongements qui lui permettront
d’appréhender ce passé
brumeux restitué en partie par des récits
légendaires. L’historien
Forézien Noël Gardon appartient assurément à
cette seconde catégorie. Cet
érudit régional s’est évertué à
décrypter de belle façon le passé opaque de
cette région centrale dans son livre Mon Pilat
Étymologie Rêves
Légendes et… Réalités. L’étymologie
présentée par l’auteur surprend
assurément le puriste. Faite d’homonymie elle s’appuie sur la
cabale phonétique
des anciens chère à François Rabelais.
Le
livre de Noël Gardon Noël
Gardon va
utiliser ces clefs, pour décrypter la Légende du
comte de Forez. Ce
récit légendaire nous conte l’histoire d’un
« noble homme nommé Henry de
Léon, hardi dans les combats, prudent dans les conseils,
féal chevalier et
loyal vassal. » Le roi de Bretagne, « vieillard
sans enfant »,
reconnaissant ses qualités de droiture, l’établit
Sénéchal de sa Cour. Le
prince du Léon remplissait tant et si bien ses fonctions, que le
vieux roi
« lui faisait des cadeaux et à l’occasion
agrandissait son fief ». De
telles faveurs ne pouvaient que susciter de la jalousie parmi les
puissants du
royaume… Josselin,
seigneur
jaloux, convainquit son ami Alain, neveu du roi, et donc
héritier du trône de
Bretagne, que son oncle allait le déshériter au profit de
son sénéchal. Ce
dernier aimait la solitude de ses terres et venait se ressourcer
dès que
l’occasion se présentait dans son château de Léon.
Un chevalier visière baissée
s’en vint en Léon pour le tuer. Mal lui en prit, le
Léonard était un fin
bretteur et c’est ainsi qu’il occit l’inconnu. Malheur pour Henry de
Léon, cet
inconnu n’était autre que le prince Alain, héritier du
royaume de Bretagne. Contraint
à la
fuite : « Il rentre rapidement chez lui, prend un peu
d’argent,
détruit quelques vieux titres devenus inutiles puis s’en va en
direction du
sud. » Il « traverse la Bretagne, la
Touraine, entre en Sologne
où il songe s’arrêter ermite près des
marécages, mais il ne serait pas assez
loin de la Bretagne, alors il continue »… puis
pénètre « dans une
vaste clairière. Au centre, de grands hêtres abritent
d’énormes rochers d’où
jaillit une source où murmure un léger
clapotement. »
De
grands hêtres... (Hêtraie
du Crêt de Peillouté dans le Pilat) Dans ce
bosquet règne
une paix… personnifiée par la belle, mystérieuse et
accueillante fée
Uriande : « Salut Henry de Léon,
Sénéchal de Bretagne ! Il y a
longtemps que je t’attends. » Elle fait partie « de
cette noble
confrérie » qui assiste, telles ses consœurs, les
petits enfants à leur
naissance. Troublé, Henry fait un signe de croix. La belle
Uriande le rassure
par ses paroles : « Point n’est besoin de te garder,
car il n’y a ni
maléfice, ni sortilège, je suis de la communion de la
Sainte-Église. Mon père
fut roi d’Albanie et ma mère Pressine. » Cette
mystérieuse
fée Uriande est commune à deux légendes :
celle du premier comte de Forez
Henry de Léon et celle – merveilleusement contée par Jean
Combe – de la perdrix
qui fut sacrée reine du Pilat et donna son nom au plus haut
sommet du massif,
le Crêt de la Perdrix. Or pour Noël Gardon il faut
comprendre ce nom comme Peyre
de Rix, la Pierre du Roi, version pilatoise de la Lia Fail
irlandaise, sur
laquelle les premiers comtes de Forez auraient été
sacrés en secret, devenant
ainsi les Rois du Pilat. La fée Uriande, semble-t-il,
n'apparaît que dans ces
deux légendes. Deux Castels,
un
Roi et une Église en Pays de Forêt Lorsque Henry
de
Léon découvre ce sylvestre pays, il le trouve plaisant
mais s’étonne de n’y
apercevoir nulle demeure, nulle habitation... En épousant la
fée Uriande le
noble Breton va devenir le premier roi d’un étrange royaume
qu’il appellera Pays
de Forêt. Ce nom apparaît lourd de signification pour
le prince du Léon
qu’il fut encore récemment… Épris
l’un de
l’autre, les deux amants pourraient vivre en parfait amour dans le
domaine de
la fée mais le futur époux pénétré
de son passé, informe son aimée de son
désir : « chercher ailleurs quelque refuge
du temps qu’on bâtirait ? ». Un tel lieu où se
réfugierait le temps,
un lieu où, on bâtirait le temps… un temps…
serait un lieu
assurément prédestiné de toute
éternité et, pour toute éternité... La fée
Uriande
entend pleinement les sibyllines paroles de son futur époux.
Elle invite le beau
seigneur à se retourner… un tel lieu existe… Henry, bien
qu’étranger au
pays, reconnaît ce lieu unique : « Sur une
colline qui dominait le
fleuve, se dressait, construit par art de magie, un château
fièrement campé. Il
était tout semblable à celui de Léon, et Henry y
trouva
son vieil écuyer et son fidèle chapelain. » Quel
était donc ce
château ? Dans leur pays, les comtes du Léon
possédaient plusieurs
châteaux dont le l’énigmatique Roc’h Morvan, qui aurait pu
être un bon
prétendant… 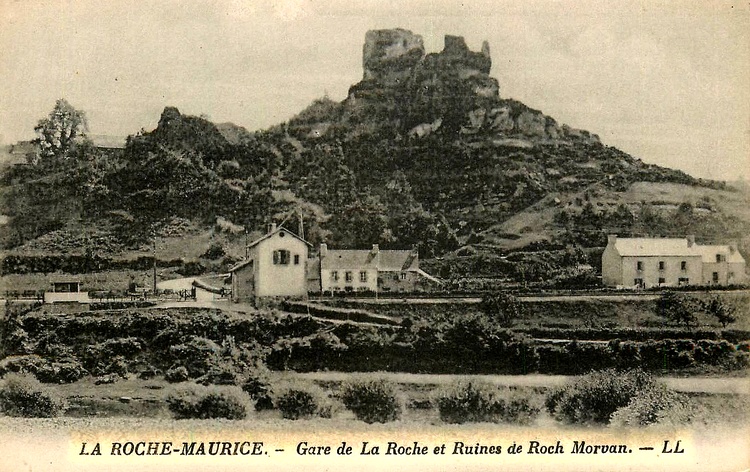 Ruines
du château de Roc'h Morvan (carte
postale ancienne) Mais les
comtes du
Léon possédaient aussi le château de LA FOREST
près de Landerneau, dressé,
ainsi que le précédent, au-dessus de la rivière
Elorn. Ce légendaire château
fut aussi le château de Joyeuse-Garde, de par la présence
en ses murs des
chevaliers du roi Arthur… La forteresse de La Forest aurait reçu
la visite de
Walter Caldenius (mort en 1151), archidiacre
d’Oxford, qui en aurait rapporté un récit où
Arthur délivrait le château de la
Douloureuse-Garde, qui prit le nom de Joyeuse-Garde.
Ruines
du château de Joyeuse-Garde (carte
postale ancienne) Geoffrey
de
Monmouth
prétendait que sa principale source pour l'Historia
Regum Britanniae émanait de l’archidiacre Caldenius, son
ami, qui avait
trouvé « un livre très ancien »
écrit en breton. En Grande-Bretagne,
le nom de Walter Caldenius reste associé aux récits de la
tradition brittonique
du Brut… Ainsi Henry
de Léon
retrouve-t-il dans son nouveau Pays de Forêt ou Forez le
château qu'il
possédait à la Forest en Bretagne. Nous aurions ici un
prodige de type effet
miroir quantique dit aussi miroir inter-dimensionnel. Mais
à la
différence, qu’ici, l’effet miroir serait inter-lieu,
l’in
between des Britanniques. Henry retrouve dans le Pays de
Forêt, son
château de Léon pareillement édifié dans un
pays également nommé Forêt…
Ce miroir inter-lieu nouvellement créé par la
fée Uriande, permettra,
pouvons-nous le penser, à Henri de Léon, nouvellement
intronisé Henri de Forêt,
de passer allègrement de ce Pays de Forêt… à cet
autre Pays de Forêt en Léon,
puis de s’en revenir. Cet aspect miroir était déjà
pressenti dans mon article
« Deux Fontaines pour un Roy » (la Grande
Affaire – mai 2017)
lorsque je j’effectuais quelque incursion dans les prophéties
des Bardes
chrétiens et principalement celles de Merlin que les
Maîtres du Brut étudiaient
avec minutie dans les écoles monastiques Culdéennes. Au jour des
fiançailles, avec l’accord d’Henry, la fée nommera ce
haut-lieu : la
Madeleine, car dit-elle, « nous sommes le jour de la fête
de cette pécheresse a
qui il fut beaucoup pardonné parce qu’elle avait beaucoup
aimé. » Il
s'agit bien sûr des Monts de la Madeleine, qui forment la partie
septentrionale
des Monts du Forez. Mais la tradition magdalénienne se retrouve
aussi dans la
Pilat, avec la chapelle, la montagne et le chirat dédiés
à la sainte
pécheresse.
Panorama
du Pilat depuis Chirat-Rochat En
médaillon : le même paysage visible sur le
tableau de la chapelle Sainte-Madeleine, peint par Jean Bonnel Je ne puis
que
renvoyer le lecteur à cet autre article « MADELEINE
EN SON MIROIR :
ECHEC ET MAT » (les Regards du Pilat décembre
2012) dans lequel je
revenais sur le tableau de Jean Bonnel représentant
Marie-Madeleine dans sa
grotte pilatoise. Ainsi que je l’écrivais :
« Lorsque Jean Bonnel
peint sa Madeleine pénitente, il recompose quelque peu le
paysage visible
depuis la grotte du Mont Ministre. Le Pic des Trois Dents surgit
soudain par
magie. Ce paysage recomposé semble révéler tout en
le cachant le Grand Mystère
du Pilat. » Puis j’ajoutais : « Jean Bonnel
utilise un
gigantesque miroir, le Miroir Magdalénien. Ses pinceaux peignent
l’intérieur du
miroir que nos yeux observent sans en pénétrer la
profondeur. » Cette
étude
décryptant le paysage enfermé dans le Miroir
Magdalénien, peut tout à fait
s’appliquer à la légende de la fée Uriande et
d’Henry de Léon. Un couple qui,
proportions gardées, rappelle celui hautement sacré de
Marie-Madeleine et de
Jésus. Au cœur de la
Forêt, Henry de Léon retrouve assurément avec enchantement,
son propre
château, la forteresse Léonarde où, suivant la
légende, épris de solitude
« Il s’enfermait alors des semaines […] heureux du silence
et de
l’oubli. » En retrouvant son château, il retrouve,
pouvons-nous le penser,
certains de ses vieux titres bien que détruits car
devenus inutiles dans
sa Bretagne natale… Ces titres ou
titles
médiévaux désignaient des marques, des actes
juridiques, voire même des bornes.
Ils affirmaient la position tant géographique
qu’héréditaire. Le château de
Léon (ou du Forêt), refuge de titres,
apparaît lui-même en tant que
monument commémoratif comme un titre. Henry de
Léon,
assisté de son vieil écuyer, le héraut d’arme
détenteur de la langue oiselée et
de son fidèle chapelain quant à lui, détenteur
sous le couvert de la chape,
du Secret, étudie dans le silence de son château, les
titres médiévaux encore
pétris de tradition celtique, dans lesquels il y
découvrira sa propre
légitimité à occuper le trône des Rois du
Pays de Forêt. Le
Comté de Léon,
devenu Principauté par le bon plaisir des puissants Rohan
successeurs des Léon,
apparaît comme un nom mystérieux. Cette contrée a
longtemps été associée à la
présence d’une légion romaine mais son origine
apparemment plus ancienne ne
serait pas étrangère à celui du dieu celtique et
pré-celtique Lug, la Lumière.
Cette appellation de Léon intimement liée à celui
du Finistère (en breton le Penn
ar Bed ou Bout du Monde) se retrouve en Grande-Bretagne dans le nom
de
l’ancien royaume de Lyonesse où se déroula, selon Lord
Tennyson, poète
britannique de l’époque victorienne, la dernière bataille
entre le Roi Arthur
et son fils Mordred.
Drapeau
du Pays de Léon Au XVIe
siècle un écrivain racontait que le Land’s End (ou
Finistère britannique)
s’étirait encore plus loin vers l’Ouest et que c’était le
point qui servait de
guide pour les marins. Le rocher, connu de nos jours sous le nom de
Seven
Stones (les sept pierres), serait la partie émergée du
royaume, environ
dix-huit miles à l'Ouest de Lands End et huit miles au Nord-Est
des îles de
Scilly. Les marins locaux l’appellent The Town (la ville) et racontent
qu’ils
entendent parfois les cloches des églises de Lyonesse sonner par
delà les
vagues. L’ancien royaume de Lyonesse englouti au large du cap Lizard,
reconnu
pour ses riches cités et ses verts pâturages, inspira le
romancier Américain de
science-fiction, Jack Vance pour sa Trilogie de Lyonesse, œuvre majeure
de
fantasy. La
péninsule
ibérique participe pareillement à cette géographie
finistérienne. On y découvre
un Finisteria qui inspira de belle façon Louis Charpentier ainsi
que Henri
Vincenot pour la rédaction de son beau roman Les
étoiles de Compostelle –
éditions Denoël. Le romancier mettait dans la bouche du
Prophète, des paroles
significatives quant aux liens unissant les deux Finisterra
continentaux :
« Nous entrons en Léon !... Léon !
s’écriait-il, tu entends
bien : Léon ! Et les monts d’Arro avant le promontoire
où finit la
terre, ‘’Finisterra’’ comme disent les moines. Exactement comme dans
mon
Armorique natale : le pays de Léon et les monts
d’Arrée, avant notre
Finisterra, le bout du monde occidental ! La même estacade,
où sont venus
atterrir les Géants venus de la mer, les Maîtres
après le grand
effondrement ! »
Le
Cap Finisterre espagnol Pour Louis
Charpentier, les Finisterra voisinant les Léon et les Monts
d’Arrée ou Arro,
furent après la submersion de l’Atlantide, des havres où
débarquèrent les
rescapés… Ces lieux furent de haute Antiquité, des
centres de pèlerinages très
importants. Henry de Léon vécut suivant le conte, dans ce
pays de Léon
armoricain ouvert à l’Ouest par le fameux cap Finistère
qui donna son nom au
département et fermé à l’Est par les Monts
d’Arrée. De Haute Antiquité, des
pèlerins arpentaient du Nord au Sud le Grand Chemin qui reliait
entre eux les
Finisterra. Ce Grand Chemin géographique cache un second Grand
Chemin temporel
suivit par d’autres pèlerins œuvrant sur la Voie Royale menant
au Grand Œuvre… Fin de Terre
~
Genèse d’un Royaume Christophe de
Cène
dans son livre Finis Gloriae Mundi de Fulcanelli. La
Révélation
(éditions BOD) évoque cette énigmatique «
cloche du roi Marc » présente
dans la cathédrale de Saint-Pol-de-Léon :
« Saint-Pol-de-Léon fut un
évêché : on découvre dans la
cathédrale une cloche du VIe
siècle que la légende dit
être celle du
roi Marc, faisant ainsi référence aux récits de la
Table Ronde et à l’épopée de
Tristan. Cette cloche figure en 4e page de couverture des Demeures
Philosophales de Fulcanelli, première (1930) et seconde
(1960) éditions. Le
texte original des Demeures ne fait aucune
référence à l’objet.
Canseliet ajouta seulement, en 1960, la note suivante : « Cul-de-lampe
de la couverture – Saint-Pol-de-Léon (Finistère) – cloche
miraculeuse du VIe
siècle, qui fut, dit-on, apportée d’Angleterre à
l’île de Batz par un poisson.
Le Finistère (Finis Terrae) sonne le glas de la gloire
du monde. » Il
apparaît
intéressant de lire ce 8e chapitre du livre de
Christophe de Cène
titré « L’espace du Finis Gloriae Mundi »,
chapitre révélant une
certaine géographie sacrée de la France.
Carte
postale ancienne célébrant la cloche miraculeuse L’histoire de
cette
cloche bien réelle et demeurée au fil des siècles
dans le trésor de l’ancienne
cathédrale du Léon, initie en ce Haut Moyen Âge,
une filiation de cloches
saint-politaines qui marqueront de leur sainte empreinte la
cité. Cette cloche
miraculeuse appartenait à saint Paul ou Pol Aurélien,
premier évêque de
Saint-Pol-de-Léon. Le Breton Wrmonoc (prononcer Ourmonoc), moine
de
Landévennec, premier historien de l’apôtre du Léon,
est l’auteur d’une très
énigmatique Vita sancti Paul Aurelian. Cette Vie demeure
pour les
historiens le texte majeur. Pol naquit vers 490 dans la région
de Penohen dans
le Clamorgan en Galles du Sud. Très jeune, il rentre dans la
grande école
monastique d’Ynis Bŷr dirigée par l’illustre saint Iltude
où il côtoiera
notamment Gildas le Sage et Samson futur évêque de
Dôle en Petite Bretagne. Il
deviendra le chapelain du roi Marc’h, monarque du double royaume de
Domnonée,
géographiquement réparti d’une part au Nord de la
péninsule armoricaine et
d’autre part sur la Cornwall-Devon en Grande-Bretagne. Le roi offrait
à Pol
l’évêché mais le chapelain refusa car il souhaitait
se rendre en Petite
Bretagne. Avant son départ, Pol sollicita du roi un seul
présent, une des sept
cloches utilisées pour appeler les invités à la
table royale. Le roi n’appréciait
guère le choix de Pol, aussi refusa-il. Accompagné de 12
moines et de proches,
l’abbé Gallois quitta sa patrie pour le la péninsule
armoricaine. Il accosta
sans encombre dans l’île d’Ouessant, avant de s’installer dans ce
qui deviendra
le Kastell Léon, actuel Saint-Pol-de-Léon. Withur, tiern
(prince souverain) du Léon, séjournait en l’île de
Bath (Batz) dans l’Endroit
Secret, une demeure écartée et paisible. En cette
année 525, l’abbé Pol
rendit visite au prince Withur de Léon qui, heureuse surprise,
n’était autre
que son cousin venu en Petite Bretagne vers l’an 510. Premier souverain
du
Léon, Withur gouverna le pays jusqu’en 530, année
supposée de sa mort. Dans cet Endroit
Secret, Withur s’adonnait à la création d’ouvrages
manuscrits. Lorsque Pol
lui rendit visite, le tiern travaillait sur son
Évangéliaire. Nous pouvons
imaginer Withur ouvrant à son cousin les portes de son
scripturaire, assurément
la pièce la plus secrète de son palais de Bath. Le tiern,
à l’instar de son
cousin, avait étudié dans une grande école
monastique de la Grande Bretagne,
peut-être l’école de saint Iltude. Ils parlaient
du
pays qu’ils avaient quitté, lorsque soudain, le gardien du
vivier royal,
apporta un ésox, nom latin et grec d’un poisson de
grande taille, un
saumon, voire un brochet, dans lequel ils trouvèrent une
cloche ! L’abbé
surpris, se mit à rire ! Il venait en effet, de
reconnaître la cloche du
roi Marc’h ! Le tiern transmit la cloche à son cousin mais
un tel don
(assurément le DON A, ainsi que nous le découvrirons plus
avant), don divin par
excellence, possédait une contrepartie ! En l’acceptant,
Pol Aurélien ne
pouvait que devenir le premier évêque du Léon. La
cloche avait choisi son
Maître ! Et pourtant, Pol une fois encore, refusa ce nouveau
siège épiscopal.
Mais nul n’échappe à son destin ! L’abbé fut
missionné par Withur à Paris
auprès du fils de Clovis, le roi des Francs Childebert que
Wrmonoc nomme
étrangement, assurément non sans raison, Philibert...
L’abbé avait-il
connaissance du message rédigé par Withur, contenu dans
le pli scellé ?
Dans ce message, le tiern du Léon demandait au roi Franc de
convaincre Pol
d’accepter le siège épiscopal du Léon.
Devenons-nous accepter comme monnaie
comptant l’énoncé du message formulé par le moine
Wrmonoc ? Pol Aurélien,
homme intelligent, ne souhaitant aucunement occuper le siège
épiscopal
aurait-il toléré de se faire abuser de la sorte par son
cousin, fut-ce le tiern
du Léon ? En vérité, Pol avait dû
déjà, bon gré, mal gré, accepter
le poids lourdement tombé sur ses épaules. Les signes
étaient là, Withur et Pol
avaient ensuite sanctifié ce jour en mangeant le saumon
sacré, symbole de la
Connaissance. Wrmonoc, le moine de Landévennec, nous apprend que
sitôt après
avoir rencontré le roi, Pol reçut l’onction
épiscopale dans la cité de Paris.
Le roi remit à saint Pol Aurélien une crosse d’ivoire. La
missive scellée
devait en partie concerner cette onction mais son prolongement
contenait
assurément un message d’une importance assurément
supérieure. Certains
commentateurs ont douté des propos du moine Wrmonoc ;
comment un Breton
venu de la Grande Île pouvait-il, à la demande du premier
prince de Léon son
parent, approcher le roi des Francs qui n’étaient pas
précisément les amis
des Bretons… ?
Saint
Pol Aurélien (icône) Il est vrai
que
Wrmonoc sème le doute en nommant le roi non pas Childebert mais
Philibert. Les
commentateurs reconnaissent dans ce lapsus – volontaire ou involontaire
– la
volonté de mettre en relief le saint Philibert ou Filibert
né à Eauze vers l’an
617 ou 618, fils unique de Filibaud, premier magistrat et
évêque de Vicus
Julii, aujourd'hui Aire-sur-l'Adour. Filibaud qui était en
grande
recommandation auprès du roi Dagobert Ier,
ménagea pour son fils,
une place à la cour où il fit la connaissance de saint
Ouen dont il devint le
disciple et l’ami. Avec le nom
de
Philibert ou Filibert (Très Célèbre en
germanique), et le nom de son
père Filibaud (Très Audacieux en germanique) nous
pouvons noter la
présence commune de l’élément FILI.
Filibert clôt-il ou poursuit-il une
dynastie des Filid ? Le Fili (pluriel Filid en irlandais ancien)
désignait
les poètes dans la classe druidique irlandaise. Lorsque le
christianisme
pénétra l’Irlande, la classe druidique dans sa
majorité, se fondit dans la
classe des Filid (classe supérieure à celle des Bardes)
et devient le noyau des
premiers évêques ou abbés de l’île. Saint
Philibert, après son père l’évêque
Filibaud, adoptera la règle de saint Colomban l’Irlandais… Saint
Philibert
(latin Filibertus) est fêté le 20 août, nous
rentrons avec cette date, dans ce
que je nommais le « calendrier hagiographique de
Champailler »
(« Le pentagramme de Champailler » - Les Regards
du Pilat – Année
2007). Philibert apparaît indissociable de saint Ouen,
fêté 4 jours plus tard,
soit le 24 août. Pour rappel, saint Ouen (Even ou Owen forme
adaptée sur celle
des rois Owen du Pays-de-Galles…) de son vrai nom Dadon, frère
d’Adon et de
Radon, apparaît avec ses frères au 34e jour (24
août, soit 4 jours
après Philibert). J’osais pareillement dans cet article un
rapprochement entre
la MELENCOLIA§I d’Albrecht Dürer et le nom même d’ADON
que l’on peut retrouver
dans l’anagramme DONA : « Au-dessus
du
Chérubin se trouve la Balance, emblème de l’archange
solaire Michel. Et puis il
y a le fameux carré de quatre surmonté d’une cloche et
accosté à gauche, d’un
sablier :
Détail
de la gravure de Dürer « Les
lignes,
colonnes et diagonales du carré donnent pour résultat 34.
A. Dürer a fait
ressortir en clair la date de son œuvre : 1514, dans les deux
cases
médianes de la dernière ligne. En plaçant cette
date entre le 4 et le 1, il
associe l’œuvre à son nom : 4 – 1, chiffres qui
transposés en lettres font
apparaître le D et le A, 4e et 1e de notre
alphabet et
initiales de Dürer Albrecht. L’ensemble, ainsi que le note Run
Futthark (André
Lécossois) dans son livre Comment interpréter la
Kabbale, transposé en
lettres, révèle les lettres DONA : 4 15 14 1
Cloche
de la gravure de Dürer et représentation de la
cloche de Saint-Pol-de-Léon (couverture de l’édition
originale des Demeures
Philosophales (1930)
Fulcanelli) La cloche
Hir-Glas
de saint Pol Aurélien (ou du roi Marc’h), fut associée
par Fulcanelli à une
autre illustration ne comportant également aucun commentaire et
qui intrigua
bien des chercheurs. Voici ce qu’écrit sur
le sujet Christophe de Cène dans son
article
« Fulcanelli : quelle Rose-Croix ? » http://www.rose-croix.net/fulcanelli-rose-croix.html : « Hommage
discret du Rose-Croix Fulcanelli à l'un des pères de la
fraternité: en
couverture et au dos des Demeures Philosophales de Fulcanelli (1ère
et 2ème éditons) figurent la Cloche du roi
Marc à Saint-Pol-de-Léon
en Bretagne et les armes de Robert Jolivet (abbé du
Mont-Saint--Michel de 1411
à 1444) sur les remparts du Mont. Le roi Marc est une figure
majeure du cycle
arthurien et de la quête du Graal. Né près du
Mont-Saint-Michel quand Jolivet
en était l'abbé, Thomas James fut évêque de
Saint-Pol-de-Léon. Ce clin d'œil en
couverture est d'autant plus singulier qu'aucun paragraphe des Demeures
Philosophales ne se rapporte au Mont-Saint-Michel ou à
Saint-Pol-de-Léon. »
Les
armes de Robert Jolivet L’association
de la
cloche Hir-Glas avec le Mont-Saint-Michel serait une clef essentielle
dans
l’énigme développée dans cet article, ainsi que
nous le verrons plus avant. Retrouvons
à
présent saint Pol Aurélien dont la mission future
apparaît ainsi,
pourrions-nous le penser, placée sous le Sceau de Saint
Philibert, le Fili. Le
problème est que Philibert ne naîtra qu’au siècle
suivant ! Nous pouvons
évidemment émettre l’hypothèse que les Filid
auxquels Philibert et Filibaud son
père, se rattachaient, pourraient avoir préparé la
mission de saint Pol
Aurélien, une mission assurément très importante. Wmonoc,
l’auteur de
la Vita sancti Paul Aurelian, fut, il convient de le rappeler,
moine de
Landévennec, abbaye qui favorisa le culte de saint Philibert
dans toute la
Bretagne. Les historiens Bretons se sont interrogés sur
l’importante présence
du culte de saint Philibert en Bretagne. Des marins venus de
l’île de
Noirmoutier, où il avait fondé une abbaye, seraient
à l’origine de son culte en
Bretagne. La réalité apparaît néanmoins pour
ces chercheurs, beaucoup plus
complexe. Ainsi que
nous le
découvrons sur différents sites du Net et
précisément sur https://mairie-lannedern.bzh/enclos-paroissial-et-eglise/ :
« Dans les vieux, les très vieux documents de
l’abbaye de
Landévennec, il est un texte du cartulaire dont la lecture au
premier degré
raconte en gros ceci. Un jour, Gradlon, roi des Bretons, reçut
la visite de trois
émissaires de Charlemagne. Ces trois hommes-là
étaient alors des saints en
devenir puisqu’il s’agissait, assure l’antique chronique, de
Médard, Florent et
de notre fameux Philibert, fondateur de l’abbaye de Jumièges en
Normandie puis
de celle de Noirmoutier. » Leur mission
était
d’obtenir l'aide du roi Gradlon qui vécut entre le IVe
et Ve
siècle ! l’aide face à la race païenne :
les Vikings. Le roi Breton
en remerciement recevrait quatorze villes franques. La Charte XXe
du
Cartulaire de Landévennec dans laquelle sont
évoqués ces faits, causa bien du
tracas parmi les érudits qui pour beaucoup n’y voyaient que
fable. Comment, par
exemple, saint Philibert – qui vécut quant à lui au VIIe
siècle –
aurait-il pu représenter Charlemagne, qui plus est en un temps
où il ne vivait
pas encore ! Les historiens ont convenu que le roi Gradlon en
question
était en fait Gradlon Plonéour, qui était
précisément un contemporain de
Charlemagne. Quant aux trois saints missionnés par l’empereur,
il s’agissait
des abbés des monastères de Saint-Florent à
Saumur, de Saint-Médard à Doulon
(près de Nantes) et de Saint-Philibert à Noirmoutier. Les
compagnons de
Gradlon, saint Guénolé et saint Corentin présents
lors de cette rencontre,
suivant le Cartulaire, étaient respectivement l’abbé
fondateur de Landévennec
et l’évêque de Quimper.
Ruines
de l'abbaye de Landévennec et tombeau du roi
Gradlon (carte
postale ancienne) Gradlon
Plonéour,
comte de Cornouaille et grand protecteur de l’abbaye de
Landévennec, alla
effectivement guerroyer contre les Vikings, à l’embouchure de la
Loire. Il a
même tenu à finir ses jours à l’abbaye de
Noirmoutier. Reste que les moines de
Landévennec avaient le sens du raccourci et du mystère
qu’ils entretenaient
savamment. Deux chroniques de l’abbaye finistérienne de saint
Guénolé
présentent le roi Childebert sous le nom de Philibert (la Vita
sancti Paul
Aurelian de Wrmonoc) ou Hilibert (Charte XLIe du
Cartulaire de
Landévennec). Le roi (P)Hilibert y apparaît en
qualité de
« suzerain du Léon » !? Des
historiens Bretons, tels Albert Le
Grand, ont préféré voir dans ce roi Hilibert, un
roi de Landerneau dont
l’existence reste aujourd’hui encore sans fondement. Quelles
étaient les
intérêts des moines de Landévennec de confondre
ainsi les pistes géographiques,
temporelles et humaines ? Il est
certain
qu’en mettant en avant saint Philibert, les moines de
Landévennec qui
s’installèrent un temps à Montreuil-sur-Mer, avaient pour
intention de mettre
en avant l’aspect plutôt méconnu d’un Philibert (…ses
successeurs ainsi que ces
prédécesseurs…) émissaire royal. Saint Pol
Aurélien monte à Paris et rencontre
le roi Childebert. En rencontrant le roi des Francs, il devient
à son tour un émissaire
royal placé sous la sainte protection de Philibert. Ce
missionné philibertin
ou pré-philibertin naquit en 490, soit quelques 127 ou
128 années avant
Philibert qui ne naîtra qu’en 617 ou 618. Saint Pol
Aurélien se place ainsi
sous le Sceau des Filid évoqués plus haut. Nous pouvons
et
nous devons placer sous ce Sceau des Filid, Withur de Léon, le
premier roitelet
du Léon, cousin de Paul Aurélien, et chez qui la cloche
miraculeuse fut
apportée par un poisson. Withur ou MorWithur, soit en vieux
breton Withur le
Grand, serait venu en Léon, d’après l'historien Arthur Le
Moyne de la Borderie,
Monsieur Jourdan de la Passardière et l’abbé Thomas
(auteur d’une histoire de
Saint Pol Aurélien), vers l’an 510 et aurait régné
sur le Léon jusqu’à sa mort
vers 530. Si le nom de WITHUR aurait, d’après François
Jaffrédou, le sens de
« victorieux », il devient plus parlant de
décomposer son nom en
With-Ur, soit l’Homme (Ur, Uur, Uros) des Bois, des Forêts
(With). Le terme
With, présent dans la langue des Germains, apparaît en
vieux breton sous la
forme Guid, en gallois sous la forme Gwydd, en gaulois sous la forme
Vidu et en
celtique sous la frome Uidhu. L’anglais Wood y puise son origine. La
forme Ur, Homme,
se retrouve dans le nom du roi Arthur, l’Homme-Ours. Withur,
l’Homme des
Bois, premier « roi » du Léon,
apparaît comme la CLEF qui nous permet
de connaître l’identité du premier Roi du Pilat. En effet,
suivant le conte
présenté par Noël Gardon, le premier Roi du Pilat ou
du pays nommé Forêt
(Forez) se nomme Henry de Léon qui est pour lui :
« le Roi
persécuté ». Il n’est pas non plus de le
canoniser mais de rappeler que
suivant cet historien Forézien, le « Premier
Roi » fut le Comte
Sylvain, soit le Comte des Forêts ! Pour Noël Gardon,
le premier roi du
Pays de Forêt Henry de Léon, correspond à ce
Sylvain le roi de la Forêt. Bien
que le Withur, premier Roitelet du Léon n’ait occupé les
lieux que vers l’année
510, il apparaît – il convient de le signaler – comme un
contemporain de
Sylvain, premier Roi du Pilat ou du Forêt/Forez. L’effet miroir
s’affirme ainsi
entre Withur le « Premier Roi du Léon » et
Sylvain le « Premier
Roi » du Pays de Forêt qui mit son sceau à la
loi Gombette en 501 ou 502.
Comment et surtout pourquoi, ce Sylvain, membre de la puissante famille
des
Chapteuil, peut-il apparaître dans le conte
présenté par Noël Gardon, sous le
titre hautement hermétique de LÉON ? Il est
difficile de démêler cet
écheveau des plus hermétiques. Le vrai nom des
Léon serait Ursolis, soit les
Roussillon… Mais Léon reste quoiqu’il en soit le nom de ce pays
Breton du
Finistère et de la noble famille qui l’occupait. Je ne puis
que
remercier Éric Charpentier qui dans un mail m’informait
qu’à l’époque de la Loi
Gombette, le royaume Burgonde était administré par 31
comtes : « Notre
contrée faisait partie des plus grandes cités du royaume
Burgonde, avec
alternativement Vienne et Lyon pour capitales, c’était la
cité du confin du
Royaume, elle embrassait le Lyonnais, le Viennois et la vallée
du Rhône, le
Forez et les premiers contreforts du Massif central. Pour
l’administrer, les
rois Burgondes avaient confié ce vaste territoire au Duc
Burgonde Ancemond ou
Ennemond (Aunemundus qui signe la loi Gombette en seconde position
fixant ainsi
sa position hiérarchique parmi les 31 comtes signataires) et
dont la résidence
était Vienne sur le Rhône. Le Duc Ennemond avait pour le
seconder dans
l’administration de son territoire, deux comtes d’origine Gallo-romaine
: le
comte Sylvain ou comte des forêts (Forez), 26è
signataire, et le
comte Dauphin (Offinis) ou comte ‘’del finis’’ (le comte des confins),
29è
signataire. Tous deux étaient probablement frères et fils
de Sylvanus 1er
: ce sont les deux fils d’Henry de Léon mentionnés dans
la légende de Mélusine,
à savoir le comte de Forez et son frère Raymondin de
Forez…. » Le titre du
second
frère : le comte Dauphin (Offinis) ou comte ‘’del finis’’,
s’applique au
comte des confins. Noël Gardon écrivit à propos du
mot ‘’Fines’’ :
« Ce mot est d’ailleurs resté dans note langage
actuel avec confins,
ou Finistère, sans parler de Finage terme
utilisé dans certaines
régions. « Personne
ne
met en doute que le titre de ‘’marquis’’ vient de ‘’marche’’. Le comte
marquis
est le comte délégué à la gestion de la
‘’marche’’ c’est le comte ‘’mark’es’’.
Si la ‘’Marche’’ est un ‘’Fines’’ le comte qui s’en occupe est le comte
‘’del
fines’’, le ‘’comte Dauphin’’. » Nous pouvons
affirmer que si le Tiern du Léon l’était du
Finistère, le comte Dauphin, fils
de Sylvain, l’était DU FINES qui correspondait au Forez. À
suivre... |
 |