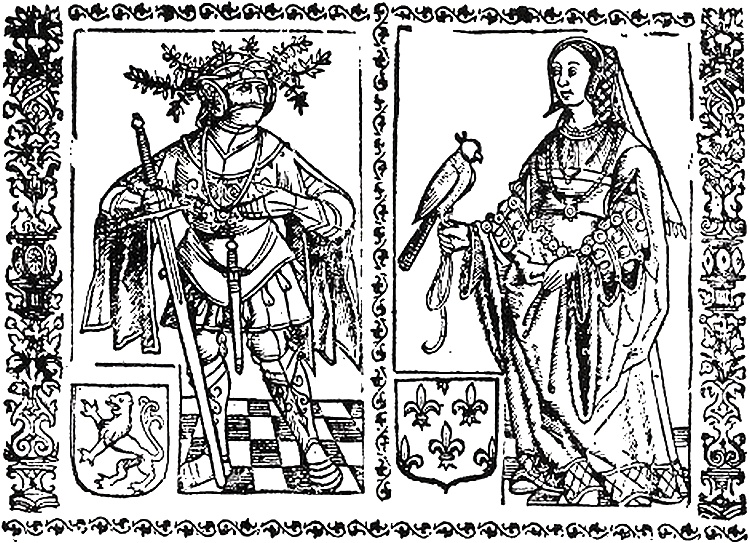|
|
Pilat et Liens Mai 2019
|
 |
Michel
Barbot
|
DU
LÉON AU FOREZ OU LA
PROMESSE D’UN NOËL AU PIED DES ARBRES Deuxième
partie Retrouvons
Michel Barbot, qui dans la suite de son
dossier continue de nous entraîner de la Bretagne au Pilat... Du Royaume de
Petite-Bretagne au Royaume des Petits-Chênes De tradition,
saint
Pol Aurélien encore abbé, va occuper dans l’ancien Pagus
Léonensis (actuelle
Saint-Pol-de-Léon), le castrum où se retira et mourut en
421 le roi Conan
Mériadec (le Kynan Meiriadog des
Gallois),
prince venu d’Albanie (l’Écosse). Ce roi à l’existence
très discutée, considéré
comme le premier des lignaiges des Bretons d’Armorique,
converti
au christianisme, aurait édifié sur cet oppidum une
chapelle près de laquelle
fut érigée ensuite la sépulture royale.
Réel ou fictif, Conan l’ancêtre des
grandes familles bretonnes, deviendra rapidement pour les Maîtres
du Brut, les décrypteurs de la
Prophétie Bretonne, un nom
symbolique de la Petite Bretagne.
Conan
Mériadec Les
Prophéties de Merlin qui eurent leur heure de gloire au
Moyen-Âge et à la Renaissance,
se font l’écho d’un Conan, devenu symbole du Royaume de
Petite-Bretagne : « Cadwallader
convoquera Conan et fera alliance avec Albany. Alors les
étrangers seront
massacrés et les rivières seront rouges de sang. « Les
monts d’Armorique entreront en éruption et l'Armorique
elle-même sera couronnée
du diadème de Brutus. La Cambrie se réjouira et les
chênes corniques
fleuriront. L'île prendra le nom de Brutus, et le titre qui lui
avait été donné
par les étrangers sera rejeté. « De
Conan descendra un Sanglier féroce qui testera le tranchant de
ses canines dans
les forêts de Gaule. Il coupera tous les plus gros chênes,
tout en ayant soin
d’épargner les plus petits. « Les
Arabes craindront ce Sanglier, ainsi que les Africains, car
l'élan de son
attaque le portera jusqu’aux endroits les plus reculés
d'Espagne. » Cette
prophétie de Merlin présentait pour les Maîtres du
Brut, plusieurs niveaux
d’interprétation, tant géographiques qu’historiques. La
Bretagne continentale,
le Royaume de Conan Meriadec , répond à l’appel de la
Bretagne insulaire nommée
Caladwallader, nom du dernier descendant du roi Arthur ayant
réussi à maintenir
la paix douze années durant. Alliés à l’Albanie
(le pays du père de la fée
Uriande qui deviendra l'épouse d'Henry de Léon, selon la
légende évoquée par la
première partie de ce dossier, les deux Bretagne vont combattre
l’occupant
Saxon. De cette coalition, la Cambrie (le Pays de Galles)
libéré, la royauté
retrouvera de sa superbe notamment avec la dynastie des Owein. Mais il
appartiendra au 5e Owein suivant l’eschatologie
chrétienne enseignée
par les Kuldées, de rétablir l’antique royaume du roi
Arthur. « De
Conan descendra un Sanglier féroce » De la
Petite-Bretagne descendra un
« Sanglier féroce ». Il n’aura de cesse
que de combattre « dans
les forêts de Gaule ». Les Francs, nouveaux
maîtres de la Gaule, ne sont
pas les amis des Bretons. Le « Sanglier
féroce » ou « sanglier
belliqueux » prédit par Merlin, révèle
une dynastie Sanglier
(d’aucuns écrivent Sang Liés…) bien que le sens secret de
cet animal-royal
apparaisse dans la langue des anglais, fils des Saxons ! Le
premier de ces
Sangliers ne pourra que « tester le tranchant de ses canines
dans les
forêts de Gaule ». Il s’agit de Morvan (750 ? –
818), le premier roi
d’une Bretagne unifiée. Prince du Léon il résidait
notamment dans le légendaire
château de Roc’h Morvan qui deviendra plus tard l’un des
principaux châteaux
des Comtes du Léon. Le roi Morvan est surnommé dans la
chanson de geste du XIXe
siècle : Lez-Breiz, soit littéralement La Hanche
de la Bretagne,
dans le sens de Soutien. Bien que vainqueur des armées de Louis
le Débonnaire,
il fut à son tour vaincu et tué en 818 quelque part entre
Priziac et Carhaix,
ainsi que rapporté dans les Annales d’Éginhard
et par l’Anonyme,
dit l’Astronome.
Merlin La
Prophétie de Merlin ajoute que le « Sanglier
féroce », coupera
« les plus gros chênes » de la Gaule, mais
qu’il prendra « soin
d’épargner » ou de
« protéger », suivant les traductions,
« les petits »… Avant de régner sur
la Bretagne, Morvan en
qualité de prince du Léon, comme ses
prédécesseurs et comme ses successeurs, va
protéger « les petits chênes »
de la Gaule. En
lisant Jean-Pierre Le Mat Enquêtes sur les prophéties
de Merlin (Yoran
Embanner éditions), nous comprenons combien cette
prophétie du « Sanglier
belliqueux » fut importante pour l’abbaye Saint-Matthieu de
Fineterre où
aurait été rédigée le Chronicon
Briocense, la Chronique de Saint
Brieuc dans laquelle ce royal animal est très souvent
évoqué. L’original de
la chronique serait un manuscrit du XIe siècle, une Historia
Britannica qui aurait été écrite par un
prêtre Guillaume, vivant dans cette
partie de l’évêché de Léon où se
trouve l’abbaye.
L'abbaye
de Fineterre (gravure
ancienne) La
Chronique de Saint Brieuc utilise en fil rouge les Prophéties de
Merlin. Le
« sanglier belliqueux » va protéger le
« royaume des Petits
Chênes » en lui imposant une certaine tutelle. Alors
suivons le chemin
emprunté par Henry de Léon pour passer de la Bretagne au
Forez. La
première famille des
comtes de Forez comportait dans ses
rangs de farouches guerriers tels Giraud II, également comte du
Lyonnais avant
qu’il ne fût chassé de Lyon, ou
encore Guillaume III
dont Guillaume de Tyr parle avec éloge et qui périt en
Terre Sainte au siège de
Nicée. Avec son fils mort sans descendant s’acheva sa
lignée qui gardait Feurs
(ou Sury ?) comme capitale et dont le blason bien que sujet à
caution, aurait
été un chêne de sinople (vert), arbre commun de ce
vieux pays celte où les
forêts sont nombreuses. Le
R.P.
Marie-Alain Couturier (1897-1954) qui fut un des grands maîtres
de la peinture
contemporaine et du vitrail, ami de Chagall, de Braque, Malraux,
Picasso ou
Julien Green, natif de Montbrison, aimait dans sa correspondance pleine
de
poésie, évoquer son Forez natal : « Et
puis, la grande plaine du
Forez avec les bancs de sable de la Loire et des arbres partout. J'ai
vite
retrouvé tous les sentiers de mon enfance, dans les petits bois
de chênes et de
pins qui s'appellent le Bois d'Amour, le Verdier… C'est un pays que
j'aime trop
pour avoir encore envie de le peindre. Il me suffit de le
regarder… » (Hommage au Père Couturier sa vie
et son œuvre – Marguerite-Victor
Fournier) http://forezhistoire.free.fr/pierre-couturier.html Bien
entendu, des bois de petits chênes il y en a dans la France
entière, mais le
royaume du Forez peut assurément s’affirmer comme le royaume des
« petits
bois de chênes », voire des « petits
chênes ». La
prophétie de Merlin se termine ainsi : « Les
Arabes craindront
ce Sanglier, ainsi que les Africains, car l'élan de son attaque
le portera
jusqu’aux endroits les plus reculés d'Espagne. » Le
final de la prophétie n’est pas sans évoquer le Roman
de Ponthus et de
Sidoine. Ponthus en épousant Sidoine, deviendra ainsi roi de
Bretagne.
Auparavant, il combattra avec vaillance les Arabes (les Africains) qui
causèrent la mort de son père dans son Espagne natale. Après
avoir fui l’Espagne, Ponthus réfugié en forêt de
Brocéliande deviendra le
nouveau Chevalier Noyr. D’illustres chevaliers se présenteront
à Barenton afin
d’y affronter l’Hermite de la forêt. Si ces joutes ne sont
en rien
belliqueuses, elles n’ont sont pas moins très importantes. Le 8e
des
52 chevaliers, porte un nom illustre, il s’agit de Robert de
Roussillon. Il se
murmure que ce chevalier serait le premier des Rois du Forez, ou Rois
du Pilat.
Ponthus
et Sidoine (gravue
ancienne) Les
Saxons définitivement anglicisés, n’auront pas de
difficulté à
transformer à leur gré le mot
« bor », sanglier, en
« beare », ours mais également
l’inverse ainsi que le confirme
le récit arthurien Le Morte Darthur rédigé
par Thomas Malory peu avant
1470. Dans ce récit apparaît le mot
« beare », soit l’ours. En
1485 paraît une édition imprimée de William Caxton.
Celui-ci apporte des
modifications subtiles du texte de Mallory, l'ours a
été
transformé en sanglier. Ainsi que l’a noté PJC Field,
cela semble être un
changement conscient, inspiré par la situation politique du
jour :
« En C, l'ours est transformé (six fois) en sanglier.
Le changement devait
être délibéré et il a créé une
allusion politique audacieuse: le sanglier était
l’insigne du roi Richard III et le dragon celui de Henry Tudor.
L'allusion
n'aurait eu de sens qu'en 1485 ou juste avant, et il est difficile de
voir qui
aurait pu en être responsable sinon Caxton
lui-même… » (cité dans Crofts).
En échangeant l'ours contre le sanglier, Caxton a
transformé le rêve
prophétique de Mallory en un commentaire sur la situation
politique de 1485. Le
rêve, modifié par Caxton, est devenu réalité
! Caxton avait publié Le Morte
Darthur le dernier jour de juillet 1485 et, moins d’un mois plus
tard,
Henry Tudor, battant une bannière de dragon, battait Richard
III, portant une
bannière de sanglier, à la bataille de Bosworth le 22
août 1485. Dans la
Prophétie
de Merlin, le « Sanglier féroce » (Boor en
moyen-anglais, baedd en
gallois) protégera « les petits
chênes » correspondant, pouvons-nous
le penser au Royaume du Forez ou du Pilat dont les Rois étaient
de tradition,
des Roussillon et dont le principal symbole était l’ours (Bar,
homonyme du
sanglier…).
Londres,
British Library, Ajouter MS 59678,
fol. 75V et
le passage correspondant dans Le
Morte Darthur de Caxton (1485) Trois sons de
cloches au-dessus du Léon et dont l’écho se
répercute dans le Pilat Comme
évoqué dans
la première partie de ce dossier, la cathédrale de
Saint-Pol-de-Léon peut
s’enorgueillir de détenir encore la « cloche du roi
Marc’h » dont le
véritable nom était Hir-Glas. L’histoire de cette cloche
royale racontée par le
Breton Wromonoc apparaît quelque peu hermétique.
Yves-Pascal Castel-Kergrist
dans sa très intéressante étude Les reliques
de Paul Aurélien, n’hésite
pas à sur-titrer la partie de son étude consacrée
à cette hermétique cloche :
« Tel un midrash rabbinique, le vieux récit de
Wrmonoc ». https://diocesequimper.fr/bibliotheque/files/original/daa304d5f5928b0c580c17ff08ccdda7.pdf Ainsi qu’il
l’explique : « Tel un ‘’midrash’’ rabbinique, le
récit de la cloche
illustre le fameux ‘’frappez et l’on vous ouvrira‘’ de
l'évangile. Il invite à
démêler différents niveaux de lecture où le
propos didactique spirituel vient
expliciter des données proprement
archéologiques. » Il nous
appartient
de pénétrer en partie ce
« midrash » formulé en latin mais dont
l’auteur est un celte du Finistère nommé Wromonoc,
assurément un Maître du
Brut... Ce moine indique au sujet de la cloche après la
traversée
maritime : « L'anneau
de cette
dernière, ouvert et rongé, était couvert de
‘’sangsues de mer’’. (Cuius
annulus marinis plenus sanguisugis perforatus atque ambesus erat) ». Cette
affirmation
causa quelques discutions. Le latin sanguisuga avant de
désigner des
sangsues de mer, s’appliquait originellement à l’annélide
des eaux douces, soit
la sangsue, d’où l’idée que le voyage de la cloche ne fut
pas que maritime.
Détail d’importance, la langue latine connaît un synonyme
du mot sanguisuga,
il s’agit de hirudo, terme utilisé par Galien (131-201
après J.C.) et
provenant de hoero qui signifie « j’adhère ». Cette hirudo
bien que n’apparaissant pas ouvertement dans le récit de
Wrmonoc, n’est
curieusement pas sans nous rappeler le nom de la cloche :
Hir-Glas,
l’Hir-Verte (voir bleue, grise)… Le mot Hir commun au breton et
au
gallois (vieil-irlandais Sir, gaulois Siros) signifie
« long ». Apparenté au latin Serus :
« tardif ». La tradition celtique évoque
la Main Longue du dieu Lug.
La symbolique liée à cette Main sera reportée par
les moines celto-chrétiens
aux longues mains du Christ visibles sur certains frontons
d’église. L’Hir
des Celtes doit aussi être rapprochée de l’Hir des
Latins désignant la
paume de la main. Ce mot est apparenté
au grec ancien kheír, la « main ».
La
longue main du Christ Tympan
de la basilique de Vézelay Le
mot
Glas qui désigne la couleur de la cloche, prend dans les langues
bretonne et
galloise, un sens spécifique approchant le mystère.
Couleur difficile à situer
sur le cercle chromatique, elle correspond approximativement au bleu
canard,
situé entre le bleu et le vert. C'est d'ailleurs le sens
véritable, dans la
langue française, du mot glauque, dans lequel on ne peut que
retrouver la
racine GLA. Cette couleur définit à l'origine les
différentes teintes que peut
prendre la Mer Bretonne. Ce mot intraduisible et que d’aucuns ont
qualifié de
magique, a été rapproché du mot Glas
présent dans les langues nordiques
ou germaniques et que l’on retrouve dans l’anglais Glass, avec
le sens
de « verre ». Et n’oublions pas le Glas, triste
son de cloche mais
qui à l’origine désigna chez les Latins un son de
trompette pour réunir la classe.
En ancien français, le glas ou clas,
désignait également un
« retentissement », un
« bruit », un « orage »,
ainsi que le son de toutes les cloches d’église. Si le glas est
synonyme de
mort, il pouvait aussi fêter une victoire… Le
mot
gaulois Clocca qui donnera plus tard le nom français de
la cloche, a été
réintroduit en Bretagne puis dans la France entière, par
les moines Celtes.
L’Irlande connaissait la cloche druidique dite Clocc ou Cloc’h,
mot signifiant « Pierre » et désignant
principalement une
« Pierre tournante ». La
cloche druidique apparaît ainsi comme une Pierre-Longue, que les
Bretons
nommèrent Men-Hir. Le mot Hir est bien celui qui apparaît
dans le nom de la
cloche Hir-Glas. Fernand Guériff dans l’article « Les
fêtes de l’Hirmen au
Croisic (L.A.) » publié dans la revue de Mythologie
Française, évoque ce
« magnifique menhir planté sur le bord de la Grande
Côte, au
Croisic », en Loire-Atlantique. Christianisé, le
menhir sera gravé d’une
croix accostée de deux cœurs. L’Hir-Men n’est pas sans
évoquer, tout au moins
dans la structure de son nom, l’Hir-Glas.
Le
menhir du Croisic (carte
postale ancienne) Le
nom
de la cloche se retrouve dans la commune de Plestin (Côtes du
Nord). En 1086,
Hugues, évêque de Tréguier, donnait à
l'abbaye du Mont-Saint-Michel, le Grand
Rocher haut de ses 84 m que l’on nomma Roc'h Hirglas, avec ses
dépendances et
sa dîme sur Plestin. Une bulle du
pape
Alexandre III, datée de Tusculum le 6 des calendes de
février 1178, confirma
toutes les possessions du Mont Saint-Michel ; cette bulle transcrite
à la suite
du cartulaire, mentionne : in episcopatu Coriobsitenti
ecclesiam de
Hyrglas cum villa de Treveruer et aliis pertinentiis suis. René
Larguillière
dans LE PRIEURÉ DE ROC'H HIRGLAS EN PLESTIN
(infoBRETAGNE.com) reconnaît
cette mention curieuse : « elle marque que dès
cette époque, on
réunissait et confondait déjà le prieuré de
Hirglas, évêché de Tréguier, et la
villa de Treveruer dans la paroisse d'Elliant,
évêché de Cornouaille ». « Ce
second
établissement nous est bien connu. Le chanoine Peyron en a
écrit l'histoire
dans une petite brochure intitulée Recherches sur le culte
de Saint-Michel
au diocèse de Quimper et de Léon (Rennes, 1896,
in-8°, pp. 8 et seq.). Nous
n'avons pas la charte de fondation de ce prieuré, mais une
confirmation en l'an
1170 de l'incarnation, par laquelle le duc Conan IV confirma la
donation de
Treveruer (Dom Morice, Preuves, tome I, 662). Ce prieuré a
été appelé Locmikael
ou Le Moustoir. Plus tard des pièces citées par
l'abbé Peyron ajoutent à son
nom celui de Roquillas en 1551 (p. 12) : ‘’prieur du prieuré du
Moustaer,
autrement dit Locmikaël Rocquillas’’, en 1692 (p. 13) ;
‘’prieuré de
Roquillas Trévérer, autrement dit Saint-Michel du
Moustoir’’. Roquillas est une
déformation de Roc’h Hirglas. Le prieuré de Roc'h
Hirglas en Plestin ayant
été réuni à celui de
Trévéruer […] il n'y a pas de lieu dit Roquillas, en
Elliant, le prieuré portait primitivement le nom de
Tréverer, aucun doute que
Roquillas est emprunté au prieuré de
Plestin. »
Le
Roc'h Hirglas de Plestin (carte
postale ancienne) Il
apparaît qu’une
fois le Prieuré de Roc’h Hirglas réuni au Prieuré
de Locmikael (le Saint-Lieu
de l’archange Michel), ce dernier prit le nom de Locmikaël Roc’h
Hirglas. « L’acte
du
duc Conan IV fut donné l'an 1170 de l'incarnation
(c'est-à-dire en l'an 1171 de
la nativité du Sauveur) par-devant Gaudeffroy,
évêque de Cornouaille ; Hamon,
évêque de Léon ; Ruallendou Rivallon,
abbé
de Quimperlé ; Simon, archidiacre ; Even, maître de
l'Hopital, et Guillaume
Ferron, maître du Temple ». (Dom Morice, dans ses
Preuves – T. I, col.
662) Dans cette
charte ô
combien importante, nous découvrons le nom et le titre de Hamon,
évêque de
Léon, personnage proche de l’Ordre du Temple, membre
lui-même de la puissante
famille des Léon. Fulcanelli
par la
représentation des deux illustrations évoquées
plus haut, aurait établi une
connexion entre la cloche Hir-Glas et le Mont-Saint-Michel. Cette
connexion
liée au Finis Terrae et ainsi au Finis Gloriae Mundi,
pourrait
s’établir sur le nom même de cette cloche qui, nous
l’avons vu apparaît aussi
comme le nom de deux (peut-être plus) prieurés ayant
appartenu à la célèbre
abbaye montoise. Ces prieurés pourraient apparaître comme
des jalons, des
bornes délimitant une route. Le Prieuré de Locmikaël
Roc’h Hirglas fut
curieusement notifié Locmikaël Rocquillas. Bien que ce
Rocquillas soit une
déformation de Roc’h Hirglas, il se pourrait que cette
déformation soit
volontaire. Nous pourrions avoir un Rocquillas pour Ro’ch Il(l)is. Je
me suis
attardé dans de précédents articles sur la
commune bretonne d’Illifaut proche
de Brocéliande. Le nom de cette commune a été
interprété comme l’Église du ou
des Hêtre(s). Nous aurions ici un Roc’h Ilis, soit le Rocher de
l’Église… La tradition
occidentale affirme que le jour de Pâques, les cloches prennent
le Chemin de
Rome. En transposant cette tradition à l’époque gauloise,
nous pourrions affirmer
que les cloches celtiques mentionnées plus haut, suivaient le
Chemin menant à
l’Olympe gaulois, lieu du Rassemblement des Druides… Hir-Glas, la Longue
Verte peut aussi se lire la Main Verte… Cette Main
ainsi que
j’ai pu le démontrer dans le livre Le Pilat Mystérieux
montre la route.
Dans l’Antiquité, le puissant
« collège » des Nautæ Ligerici
était le Maître du fleuve Loire, le fleuve du dieu Lug
pendant du saint Michel
des chrétiens. Cette Main, Verte ou Bleue, est une Main maritime
et fluviale.
La puissante confrérie des Nautes de la Loire, la nomma la Main
du Bon Accueil.
C’est ainsi qu’elle apparaissait dans la cité de Saint-Nazaire.
Elle invitait
le voyageur à remonter la Loire. Dans le livre L’épopée
des mariniers de la
Loire (Raoul Toscan – Éditions des Régionalismes),
nous lisons :
« Ces nautes, il va sans dire, étaient en contact
direct avec les
marchands des deux rives. Ils assuraient les arrivages et pourvoyaient
aux
transports. Ils remontaient la Loire à la voile, transbordaient
en chariots aux
Monts Lyonnais : rechargeant sur la Saône, descendaient
à fière allure le
Rhône, et, d’Arles, conduisaient à Marseille, pour confier
aux flottes des navicularii,
les marchandises les plus diverses : bois, vins, huiles, fers,
etc… dont
Rome avait besoin. » La cloche
Hir-Glas
n’a pas officiellement remonté la Loire et moins encore
été transbordée dans un
chariot menant aux Monts Lyonnais ou aux Mont du Forez mais elle n’en
comportait pas moins, suivant le Midrash de Wrmonoc, la marque
de
quelques sangsues ligériennes… Fernand
Guériff,
l’historien de la Presqu’île de Guérande a écrit de
belles pages sur les Nautes
de la Loire. Cet auteur prolifique a aussi rédigé la
monographie Les
Templiers en Pays Nantais et Guérandais (APHRN 1983) dans
laquelle il
évoque en la cité de Guérande, l’ancienne
Confrérie Saint-Nicolas. Il rappelle
que suivant F. Jégou (La très noble et ancienne
Confrérie de Monsieur
Saint-Nicolas de Guérande, in Revue de Bretagne et
Vendée, 1874, tome
II.) : « le culte de saint Nicolas (originaire d’Asie
Mineure) aurait été
introduit dans l’Ouest par les
Croisés bretons, compagnons de Hervé de Léon,
et surtout par les
Templiers qui avaient une dévotion particulière pour ce
saint, et placèrent
beaucoup de leurs chapelles sous son vocable. » L’auteur
reconnaît que
cette théorie est loin de faire l’unanimité. Les
Templiers auraient en fait
confirmé et imposé cette confrérie
guérandaise qui ainsi que l’indiquait
Pierre-Aristide Monnier (le MA de Nantes…) existait déjà,
de tradition, au VIIe
siècle. Bien que les
archives de la confrérie aient été
dispersées, le registre de l’année 1350
toujours conservé : « nous apprend que les
réunions se passaient dans
une maison sise rue Saint-Michel, près de la porte, et offerte
gracieusement
par ‘’Monsieur Éon de Léon’’. » F.
Guériff poursuit :
« Est-il exagéré de voir dans ce personnage
important un descendant direct
de la puissante Maison de Léon dont – nous l’avons écrit
plus haut – le chef
Hervé mourut dans le naufrage de Brindes, en 1218, en revenant
des
Croisades ? Et l’on peut supposer de ce côté encore
des relations
possibles avec les Templiers. Cet Éon n’était-il pas
lui-même un chevalier au
‘’blanc manteau’’ ? » F. Guériff rappelle pour
conclure « qu’un
évêque de Léon signa la charte de Conan
IV. » Bien que cette charte
(double charte, des possessions templières et
hospitalières) serait postérieure
de quelques années à l’Ordre du Temple – le duc Conan IV
étant décédé en 1171)
elle sert aujourd’hui encore de point d’appui chez les historiens pour
affirmer
la présence de l’Ordre du Temple dans tel ou tel haut lieu du
duché de
Bretagne. Ce très célèbre apocryphe, bien
qu’incomplet quant aux domaines
templiers, n’en reste pas moins un document très important. Hamon de
Léon,
évêque de Saint-Pol-de-Léon, est
présenté comme le principal
signataire de la charte. L’antidatation du
document commise par les faussaires,
infirme cette signature qui aurait pu assurément figurer sur une
telle charte.
Hamon proche du duc Conan IV fut assassiné le 21 janvier
1171 (ou 1172),
à la sortie d'une messe à la cathédrale de la Ville
Sainte, la cité de
saint Pol-Aurélien. Cet Hamon de
Léon
prend sa place dans l’histoire campanologique de la cathédrale
Saint-Pol-de
Léon. En 1563 fut fondue pour la cathédrale la plus
ancienne cloche de la
Bretagne toujours en activité, Le Jacques. Cette grosse
cloche comporte
l’inscription suivante : JE.
FVS. FAIT. PAR. MR. GVY. DE. KERGOET. CHANOINE. DE. LEON. FABRIQVE.
LORS. ME.
FIT. FAIRE. PAR. ARTVS. GVIMARCH. FONDEVR. POVR. SERVIR. LAN. MVcLXIII.
EN.
JACOBVS. SVM. NIVES. ET. FVLMINA. PELLENS. FVLGVRA. CONFRINGENS. VOX.
DOMINI.
SABAOT. ET. TVBA. QUE. CLANGENS. NOMEN. CELEBRARE. SVPERNI. ADMONEO.
CVNCTOS.
ANTE. NOMINABAR. HAMO. Ce
vocable Hamo, donné autrefois à cette cloche, rappelle le
nom d’un ancien et
célèbre évêque de Léon, Hamon, qui
fut assassiné le 21 Janvier 1171 (1172), à
la sortie de l’office, par son neveu Guyomarch du Fou. http://www.infobretagne.com/saintpoldeleon-cathedrale-comptes.htm Une
traduction française de la partie latine de l’inscription
apparaît sur le
Net : « Je suis le Jacques qui dissipe la foudre et le
tonnerre.
C’est moi qui brise les éclairs. Je suis la voix du seigneur
Sabaoth et la
trompette dont le son éclatant appelle le monde entier à
venir célébrer le nom
du Très Haut… Auparavant c’était Hamon qui appelait tout
le monde ». Le
Jacques,
clôt en 1563 la trinité
campanologique historique et hermétique de la
cathédrale Saint-Pol-de-Léon.
Son nom cache assurément quelques mystères. Il convient
de se rappeler dans un
premier temps, l’apôtre Jacques, frère de Jean,
surnommé par le Christ,
Boanerges, le « Fils du Tonnerre ». Il convient
d’évoquer ensuite le Jacquemart,
mot apparu dans la langue française au XVIe siècle
et caractérisant
une « figure d’homme armé d’un marteau qui frappe les
heures sur une
cloche ou un timbre » (Rabelais, Gargantua). On
reconnaît dans ce mot,
Jacques (l’apôtre ? le paysan du royaume de France ?)
et le mart ou
marteau. Le Jacquemart est considéré comme un emprunt
à l’ancien provençal Jacmart
(1472 d’après Pansier) de même étymologie. Une seconde
hypothèse, assurément complémentaire, pourrait
apparaître une fois encore dans
le chapitre « L’espace du Finis Gloriae Mundi »
du livre précité de
Christophe de Cène La Révélation. L’auteur
évoque la cité bretonne de
Guingamp sise au pied d’une des sept collines sacrées de la
Bretagne
armoricaine, le Menez-Bré : « C’est là
qu’un couple d’alchimistes
recueillait au printemps la rosée du matin. Le patronyme de
l’adepte ?
Jacob, une famille bretonne implantée dans le Trégor. Ses
armoiries […],
figurent, en guise de signature, au bas de la dernière planche
du Mutus
Liber, célèbre livre d’images alchimiques. On
comprend mieux pourquoi ce
traité s’ouvre avec le songe de Jacob
biblique. » La
cloche Hamon, ainsi qu’indiqué dans les Extraits des comptes
de la
cathédrale de Saint-Pol-de-Léon, fut ainsi
baptisée en hommage à l’évêque
Hamon de Léon assassiné par son neveu et sur ordre de son
propre frère. Datée
du XIIe siècle elle fut peut-être l’œuvre de
son successeur.
La
cathédrale de Saint-Pol-de-Léon (carte
postale ancienne) HAMO,
tout comme son successeur JACOBUS, doit être associé
à la voix des instruments
musicaux (cloche, trompette), ainsi qu’à la multitude du monde
et surtout… à la
voix du Très-Haut. Le
nom
latin HAMO de la cloche, dans le contexte biblique de
l’inscription
s’appuie sur l’hébreu HAM (HAMŌ, HAMON),
mot dont
l’importance a été mise en relief dans le chapitre L’AXE
ROYAL DES ROUSSILLON
(livre LE PILAT MYSTÉRIEUX Thierry Rollat – Patrick
Berlier – Michel
Barbot). Dans ce chapitre je m’arrête sur l’Axe Majeur de
Cergy-Pontoise dont
la 12e et dernière station correspond au Carrefour de
Ham annoncé
par les étangs de Ham pétrifiés en leurs
miroirs de plomb, ainsi que
l’écrit Jean Parvulesco. Cet auteur spécialisé
dans les thèmes ésotériques,
participa à la création de cet axe, il invite le pèlerin
à monter au
sommet de cet axe, ainsi que le fait la cloche pour la ville sainte :
« venez, venez saluer la renaissance de la parole
pré-humaine, le chant à
peine chuchoté des générations post-humaines en
leur architecture
clandestine… » (Cergy-Pontoise, 1969-1989 – éditions
Moniteur Images) Nous
retrouvons le carrefour et les étangs de Ham, la symbolique
présence de la cité
biblique de Ham, contrée des Zouzim, créatures
pré-humaines. Si la cité de Ham,
de par son nom apparaît comme la cité du Murmure, elle est
aussi la cité du
Bourdonnement ou de la Foule… Le Dictionnaire (biblique)
Hébreu-Français
de Sander et Trenel, associe les mots Hama et Hamon
à la voix des
instruments de musique et désigne aussi la foule, les peuples,
la multitude,
acceptation du mot que l’on retrouve dans le nom d’Abraham : le
Père de la
Multitude. La
traduction de l'inscription sur la cloche, telle qu'elle est
présentée sur le
Net, apparaît quelque peu différente du texte latin, aussi
ai-je soumis ce
texte à notre ami Patrick Berlier. Le résultat me
paraît plus qu’intéressant.
La longueur de cet article ne me permet, hélas, de le reprendre
dans sa
totalité. Pour Patrick il s’agirait de latin poétique,
l’inscription peut ainsi
se traduire de trois façons différentes : une
transcription littérale et
donc basique, une traduction poétique qui serait plutôt
une interprétation, et
enfin une version obtenue en mettant bout à bout les traductions
littérales de
chaque terme, sachant que certains verbes sont mal placés, sans
tenir compte de
la grammaire et des déclinaisons. Cette troisième
possibilité, qui ferait
évidemment hurler les latinistes puristes, se présente en
réalité comme le
message caché, ésotérique, d'un texte comportant
trop d'erreurs pour que cela
ne soit pas volontaire. Dans
le
texte latin apparaît le mot Nives
« neiges ». Patrick
reconnaît : « on attribue souvent aux cloches le
pouvoir d'écarter
les orages, mais je n'ai
trouvé nulle part qu'elles pouvaient
aussi empêcher les chutes de neige, c'est peut-être pour
cela que la traduction
ne retient pas ce nom ''neige'', préférant traduire nives
et fulmina par
''la foudre et le tonnerre'', mais si fulmina est bien la
foudre, aucun
dictionnaire ne traduit nives par tonnerre. ».
Patrick pense que
dans une traduction poétique : « on peut bien
imaginer que nives
se rapporte à Jacobus, ce qui donnerait pour la première
phrase : ''Voici,
je suis le Jacques blanc comme les neiges, qui écarte les orages
et qui brise
les éclairs'' ». Dans les
Prophéties
de Merlin, la prophétie évoquant l’alliance de Cadwalader
(la Grande-Bretagne),
de Conan (la Petite-Bretagne) et d’Albion (l’Écosse) est
précédée par cette
énigmatique phrase : « Un vieil homme
gelé sur un cheval blanc de
neige détournera la rivière Periron et en amont, il
mesurera un moulin avec sa
baguette blanche. » Ce vieil
homme n’a
rien d’un Jacques blanc écartant les orages et brisant les
éclairs. Mais avec
son cheval blanc il n’est pas sans nous rappeler
l’ancêtre des comtes
d’Albon qui donna naissance aux Dauphins du Viennois. Ce fameux
ancêtre que
l’on a longtemps considéré, à tort, comme le
premier Dauphin, fut Guigues le
Vieux (1000-1070), lui-même successeur de plusieurs Guigues. Il
apparaît plus
justement comme l’ancêtre des Dauphins du Viennois. Ses
successeurs, Dauphins
du Viennois, n’ont pas de suite affiché sur leur écu le
Dauphin. Ainsi le
Dauphin Guigues André est représenté à
cheval sur le premier côté de son sceau,
tandis qu’apparaît sur le second un château à trois
tours (armoiries des Comtes
d’Albon). Le nom des Comtes d’Albon (proche de celui d’Albion…) est
celui d’une
commune attestée en 517 sous la forme Epao, puis Epauna
en 571.
En 1080, puis en 1328, le nom de la commune apparaît pour la
première fois avec
un Villa de Albon, puis avec un Castrum de Albone. Le
premier nom
dérive du gaulois Epo, « cheval »
– que l'on retrouve avec
Épona, la déesse gauloise des cavaliers et des voyageurs
– tandis que le second
dérive de l’occitan Alba,
« blanc ». Epauna/Albon se présente
bien comme le cheval blanc.
La
tour d'Albon (Drôme), berceau des Dauphins (carte
postale ancienne) Dans cette
puissante Maison d’Albon, il convient de mentionner Guigues Ier
de
Forez (1107-1138), fils de Guigues-Raymond d’Albon (lui-même fils
de Guigues II
d’Albon, lui-même fils de Guigues Ier d’Albon, dit le
Vieux) et de Ita
de Forez. Il succéda à son cousin Guillaume en 1107,
comte de Lyon et de Forez.
(Nouveau traité de diplomatique..., Volume 4 – de Charles
François
Toustain) Une autre
famille
d’Albon apparaît dans le Lyonnais. Elle s’est éteinte en
ligne masculine en
2015. Bien qu’elle soit présentée comme différente
de celle des Dauphins du
Viennois, il apparaît néanmoins qu’elle lui serait
apparentée. Le porche du
château des d’Albon à Albigny-sur-Saône,
présente dans le détail, les armes des
d’Albon, qui sont au 1 et 3 d’Albon et au 2 et 4, des Dauphins du
Viennois :
Armes
des d'Albon Devise :
A Cruce Victoria (La victoire vient de la
croix) Pour
l’histoire de
cette famille se reporter au Dictionnaire des familles
françaises anciennes
ou notables à la fin du XIXe siècle. T. Ier.
(1903 / par C.
d'E.-A. [Chaix d'Est-Ange] impr. de C. Hérissey à
Évreux – mis en ligne
sur https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1119943).
« La
branche
cadette s’éteignit avec Jacques d’Albon, Seigneur de
Saint-André, chevalier de
Saint-Michel et de la Jarretière, 1er gentilhomme de
la chambre du
roi, gouverneur du Lyonnais, maréchal de France en 1547, connu
sous le nom de
maréchal de Saint-André, qui fut un des plus vaillants
hommes de guerre de son
temps et qui mourut sans postérité en 1568. »
Portrait de Jacques d'Albon vers 1562 (Musée
national du château et des Trianons, Versailles) Ce Jacques,
fils de
Jean, défenseur du Catholicisme, naquit vers 1525 et mourut en
1562. Cette
année fatidique pour Jacques d’Albon précède
fortuitement la fonte de la cloche Le Jacques de Saint-Pol-de
Léon en 1563. Patrick
Berlier
entrevoit pour l’inscription latine relatant la fonte de cette cloche,
un message
caché ou sens ésotérique :
« Voici, (moi) Jacques, blanc comme
les neiges, je suis l'impétueuse tempête écartant
les éclairs qui abattent la
voix de Dieu tout-puissant, et la trompette qui sonne le nom
célébré du
très-haut. J'avertis le monde entier. Auparavant j'étais
nommé Hamon. » Patrick
commente
ainsi ce qu’il présente comme la troisième
traduction : « Le Jacques
se présenterait donc comme le protecteur de Sabaoth, une
tempête capable
d'écarter les éclairs qui risqueraient de neutraliser sa
voix. Autrement dit,
un vent impétueux éloignant les orages dont le tonnerre
pourrait masquer la
voix de Dieu, que la Bible compare justement au bruit du tonnerre. Le
Jacques
est aussi la trompette sonnant le nom de Dieu. De tout cela il avertit
le
monde. On retrouve fortement le thème du bruit et du son, mais
tonitruant et
non murmurant. « On
peut
noter que le texte commence par Jacobus et se termine par Hamo, nom de
son
prédécesseur. Or Jacobus signifie justement ‘’celui qui
supplante’’ : le
Jacques a bien remplacé Hamon. » Il est
certain,
cette inscription dépasse le cadre spécifique de la
campanologie, elle nous
projette dans des thèmes eschatologiques s’appuyant sur des
textes de l’Ancien
Testament, tels les Psaumes de David et le Pentateuque… Bien qu’une
conclusion ne puisse être rédigée pour cette
étude, il paraît intéressant
d’évoquer le blog « L’Avènement du Grand
Monarque », de l’écrivain
Rhonan de Bar qui fut un proche de l’Association ATLANTIS. Ce blog,
ainsi
qu’indiqué, a pour but de « Révéler la
Mission divine et royale de la
France à travers les textes anciens ». Sur son blog,
apparaissent deux
études complémentaires :
« D’ALBON » et « DAUPHINS ET
DAUPHINÉ ». L’auteur s’appuie pour cette
dernière étude sur les auteurs
anciens, tel M. de Terrebasse qui, après bien d’autres
s’interrogea sur
l’origine du mot DAUPHIN. Cet auteur écrivait :
« Quelle que soit la
signification qui se cache sous cette traduction, la valeur et la
majesté de
l'expression ne sont pas moins garanties par l'adoption qu'en ont faite
trois
dynasties souveraines, et, plus tard, les rois de France
eux-mêmes. » Rhonan de Bar
s’interroge à son tour : « Quelles sont ces
trois dynasties ? Je
connais les comtes d'Albon et les comtes de Clermont ; mais si M. de
Terrebasse
fait allusion aux comtes de Forez, il se trompa. Ceux-ci ont
placé, il est
vrai, le dauphin dans leurs armes, mais ils n'ont jamais pris le titre
de
dauphin. » Après
cette étude
consacrée aux Maîtres du Forez, il m’apparaît
difficile de ne pas retenir cette
troisième (ou première) dynastie souveraine… une dynastie
« del
finis », placée sous la sainte protection d’un
Jésus, Soleil naissant,
en la Nuit de Noël. Ce grand mystère fut, pouvons-nous le
penser, partagé par
les princes du Léon détenteurs des secrets du
« Fines » dont les
arcanes ont été formulés par Fulcanelli. Mais laissons
Noël
Gardon nous parler du « Fines » :
« Ce mot est d’ailleurs
resté dans note langage actuel avec confins, ou Finistère,
sans
parler de Finage terme utilisé dans certaines
régions. « Personne
ne
met en doute que le titre de ‘’marquis’’ vient de ‘’marche’’. Le comte
marquis
est le comte délégué à la gestion de la
‘’marche’’ c’est le comte ‘’mark’es’’.
Si la ‘’Marche’’ est un ‘’Fines’’ le comte qui s’en occupe est le comte
‘’del
fines’’, le ‘’comte Dauphin’’. » Il convient
assurément de s’intéresser, à défaut de le
suivre… à ce « comte
Dauphin » régnant sur le royaume « del
finis », un royaume qui
appartient autant au passé qu’au futur… |