DECEMBRE 2019
|
 |
Par Notre Ami
Eric CHARPENTIER
|
SUR
LES TRACES DU PIED DE NOS ANCÊTRES LES
GAULOIS A
PROPOS DE LA LIEUE GAULOISE Dans
un article récent signé Jacques Laversanne1,
l’auteur propose de localiser le forum segusiavarum de la table
de
Peutinger2, non pas à Feurs dans la plaine du
Forez mais à
Saint-Chamond dans la vallée du Gier. Une hypothèse
audacieuse, qui s’étaye
entre autres arguments par l’utilisation d’une mesure de la lieue de
2,5 km
environ. La table de Peutinger, indique effectivement qu’à
partir de Lyon, il
convient d’utiliser la lieue3 et non plus le Mille romain.
Cette
unité de mesure tire son nom du latin leuga ou leuca,
terme qui
d’après les auteurs latins fut emprunté au vocabulaire
gaulois . Toutefois, en
déclarant que « la celticité du mot, en
l'absence de corrélats insulaires,
est très incertaine » , Xavier Delamarre4
laisse transparaître
que la lieue pourrait appartenir à un langage encore plus ancien
que l’époque
celte.
Quoi
qu’il en soit, il apparaît de plus en plus évident
que la lieue gauloise est bien présente sur tout le territoire
entre Rhône et
Loire. Déjà à la fin du XIXe
siècle, M. Louis-Jules Michel avait
établi en étudiant les antiquités des villes de
Lyon et de Vienne, qu’une
mesure de 32,5 cm environ apparaissait dans les relevés de ces
monuments. C’est
le cas notamment du Portique du Forum de Vienne (Isère) dont
l’ouverture mesure
6,83 m soit 21 pieds et sa hauteur du pavé jusqu’à la
clef 11,045 m, soit 34
pieds. Outre un rapport harmonique évident de 34/21
correspondant à deux
nombres de la suite de Fibonacci, la mesure de la hauteur
relevée à cinq
millimètres près permet d’établir l’utilisation
d’un pied de 11,045 / 34 =
32,485 cm.
En
conclusion de son étude, Louis-Jules Michel propose de
voir dans la mesure de 32,48 cm celle du pied gaulois,
équivalente à celle du
pied du roi qui était en vigueur en France avant 1795. Cette
mesure correspond de
fait à une lieue de 2 436 mètres (1 lieue =
7 500 pieds). Plus
récemment, l’archéologie a su détecter la
récurrence
de cette distance entre bornes ou cités : « le
pied de Paris n’est
certainement pas un pied romain dégénéré,
mais le descendant direct d’un pied
en usage dans les campagnes et les boutiques depuis des siècles
»6.
Ici, Daniel Jalmain renvoie aux recherches métrologiques de C.
Cochet-Cochet et
à ses Notices historiques sur le Brie ancienne (1933),
lequel donnait
une lieue commune en usage à Provins de 4 385,55 mètres,
correspondant à 2250
toises de Paris, à côté de laquelle subsistait une
Grande lieue de 2500 toises
de 4 872,55 mètres. Cette distance étant sensiblement
le double de 2 436
mètres renverrait à la lieue gauloise de 7500 pieds de
32,48 cm. De
même, en étudiant cette grande lieue gauloise,
l’archéologue Jacques Dassié déclare : « Une
mesure récente, mais antérieure
au système métrique, est la toise de Paris qui fait 1,949
m. Il y a 6 pieds par
toise, d’où le pied de Paris (ou Pied de Roy) = 0,3248 m. Si
nous calculons une
lieue à partir de ce pied gaulois, nous obtenons : 1 lieue =
0,3248333 x
7500, soit 2 436 m. C’est l’une des valeurs de la lieue
gauloise la plus
fréquemment rencontrée. On peut donc raisonnablement
supposer que le pied
de Paris n’est que la continuation d’un pied gaulois qui aurait
perduré jusqu’à
l’époque moderne »7. Historiquement,
le pied du roi de France de 32,48 cm fut
établi par Jean-Baptiste Colbert en 1668 lorsqu’il révisa
la Toise de Paris.
Avant cette date, le Pied de Roy était
légèrement supérieur. La
tradition donne aussi au pied du roi réformé en 1668 le
nom de Pied de Charlemagne comme si finalement celui-ci
était la
résurgence d’une mesure plus
ancienne.
NOTES 1. Jacques Laversanne,
« Lecture iconoclaste de
la table de Peutinger », in Bulletin du groupe
archéologique Forez-Jarez,
n°21, année 2017, pages 5-14. Jacques Laversanne est membre de la Société
d’Histoire du Pays de
Saint-Genest-Malifaux ainsi que du Groupe Archéologique
Forez-Jarez. Il a
dirigé en 2015 l’édition du livre « Canton de
Saint-Genest-Malifaux » dans la
collection « Le patrimoine du département de la Loire
», édité par Liger
(Liaison Inter Groupes d’Etudes Régionales) avec le soutien du
Conseil général
de la Loire. Jacques Laversanne est l’un des meilleurs
spécialistes des voies
antiques et protohistoriques du Forez et du Massif du Pilat. 2. La Table de Peutinger est une compilation de cartes
romaines antérieure
à la fin du 1er siècle qui a ensuite
été mise à jour au IVe
siècle et au Ve siècle. « La table de Peutinger (Tabula Peutingeriana ou
Peutingeriana Tabula
Itineraria), appelée aussi carte des étapes de Castorius,
est une copie du XIIIe
siècle d'une ancienne carte romaine où figurent les
routes et les villes
principales de l'Empire romain qui constituaient le cursus publicus,
parfois
appelé vehiculatio durant le Haut Empire, qui était le
service de poste
impérial assurant les échanges officiels et
administratifs au sein de l’Empire
romain » (Wikipédia, 2019). 3. « Lugduno, caput Galliay (Galliœ), usque hic
legas», Lyon, capitale de
la Gaule, jusqu’ici ce sont des lieues 4. Xavier Delamarre, Dictionnaire de la langue gauloise,
éditions errance,
2è édition, 2008, page 199 : leuca, leuga ‘lieue’ « Mesure de distance adoptée officiellement
dans les trois Gaules depuis
Sévère (3e s.) et valant environ 2,4 km. Attesté
leucas par St-Jérôme, puis
régulièrement leugas, leuvas (> français lieue,
anglais league) ; considéré
comme mesure spécifiquement gauloise : « mensuras viarum
nos miliaria dicimus,
Graeci stadia, Galli leuvas … ». La diphtongue eu est
certainement secondaire,
et la celticité du mot, en l’absence de corrélats
insulaires, est très
incertaine. H2197, DAG 571. » 5. Louis-Jules Michel,
« Détermination de la longueur
du Pied Gaulois, à l’aide des monuments antiques de Lyon et de
Vienne »,
Discours de réception à l’Académie des Sciences,
Belles-Lettres et Arts de
Lyon, Lyon, Association typographique, 1872. 6. Daniel Jalmain,
«Archéologie aérienne
en Ile-de-France », Ed. Technip, 1970. 7. Jacques Dassié, « La grande lieue gauloise :
approche méthodologique de
la métrique des voies », in Gallia, tome 56, 1999,
pp.285-311. LE
PIED GAULOIS ET LE MERIDIEN DE LA TERRE L’EXEMPLE
DE LA CHAPELLE SAINT-VINCENT D’AGNY En
1799, Charles-Pierre Claret de Fleurieu8
rappelle que 47 pieds et demi du Roi constituent la 120ième
partie
de la minute du méridien de la terre9. Cette minute
de méridien est
ce que nous appelons aujourd’hui le Mille Nautique :
« On doit
l’idée d’utiliser la longueur de la minute d’arc sur la Terre
comme unité de
distance à un abbé de Lyon, Gabriel Mouton, qui la
proposa en 1670 »10.
Le rapport du pied du roi réformé aux dimensions de la
Terre avait dû être
établi dès son institution par Colbert en 1668 pour que
les manuels de
navigation maritime de la fin du XVIIè et du
XVIIIè siècle en fasse
état : inspirées du Traité complet de la
navigation de Jean
Bouguer, publié en 1698, les Leçons
de navigation que donne M. Dulague en 1768 rappellent en effet ce
rapport
entre le pied du roi de France et la longueur de la minute du
méridien de la
Terre :
Puisque
l’archéologie a établi que le pied du roi de
France en vigueur entre 1668 et 1795 est l’exact équivalent du
pied gaulois, on
peut déduire un rapport identique entre ce dernier et la
longueur de la minute
du méridien de la Terre : 47,5
pieds gaulois = 120ième
partie de la minute du méridien terrestre 47,5
x 0,3248 = 15,428 mètres = 120ième
partie de la minute du méridien terrestre Il
se trouve que cette définition trouve une expression
tout à fait remarquable dans un petit édifice religieux
du plateau mornantais.
Il s’agit de la chapelle Saint-Vincent d’Agny qui a fait l’objet d’une
attention particulière dans notre livre récemment paru11 :
« Située sur la colline qui domine au nord-ouest
le bourg de
Saint-Laurent-d’Agny, le chapelle Saint-Vincent est donnée pour
être la plus
ancienne chapelle romane du département du Rhône. Il ne
fait aucun doute de
l’ancienneté du site dans la mesure où quelques
mégalithes des temps
préhistoriques jalonnent encore les lieux. Il n’est donc pas
illusoire d’imaginer
que cette chapelle soit venue remplacer ici un ancien site cultuel
païen.
La
chapelle Saint-Vincent d’Agny est également un site
reconnu pour ses qualités énergétiques. Elle fait
régulièrement l’objet de
visites géobiologiques et a retenu l’attention de
géobiologues renommés, tels
que Jean-Louis Augay ou encore Georges Prat, qui ont tous deux
étudiés la
chapelle dans leurs ouvrages respectifs. La
chapelle a été classée Monument Historique le 17
août
1945, et elle a été restaurée en 1956 par M. Louis
Mortamet, architecte en chef
des Monuments Historiques. Nous lui devons les plans et croquis
ci-dessous, que
nous empruntons pour notre propos. »
Cette
chapelle dont l’existence est attestée au Xè
siècle fut bâtie avec le nombre 36412 et la
mesure du pied gaulois.
De nombreux indices détectés dans son tracé
régulateur le montrent
clairement : le chevet en cul de four voit sa base tracée
par un cercle de
rayon 2,364 mètres, ce qui correspond à la mesure de 2 x
3,64 pied gaulois de
32,48 cm ; l’épaisseur des murs nord et sud mesure 1 verge
gauloise de
0,9744 m13 (1 verge ou 1 yard valent 3 pieds : 3 x
32,48 cm =
97,44 cm). Mais la véritable révélation de cette
chapelle est sa longueur
totale que nous avons mesurée à 15,425 m. Or, à 3
millimètres près, il s’agit
de l’expression exacte de 47,5 pieds gaulois, c’est-à-dire la 120ième
partie du méridien de la Terre qui précisément
définit cette mesure. NOTES 8. Charles-Pierre Claret, comte de Fleurieu, est un
explorateur,
hydrographe et personnalité politique français, né
le 2 juillet 1738 à Lyon et
mort le 18 août 1810 à Paris. Il fut notamment ministre de
la Marine sous Louis
XVI, membre de l'Institut de France. Il est le frère du
botaniste Marc Claret
de La Tourrette bien connu dans notre région pour être
l’auteur de
« Voyage au mont Pilat dans la province du Lyonnais,
contenant des
observations sur l'histoire naturelle de cette montagne, & des
lieux circonvoisins
; suivi du catalogue raisonné des plantes qui y
croissent », Avignon :
Regnault, 1770. 9. Il est très difficile de définir
précisément les dimensions de notre
planète dans la mesure où celle-ci n’est pas une
sphère parfaite. La Terre est
de forme ellipsoïdale, c’est-à-dire qu’elle est
légèrement aplatie aux pôles et
inversement légèrement gonflée à
l’équateur. Depuis 1984, nous utilisons le WGS84 (World Geodetic System
1984) qui est
le système géodésique international utilisé
notamment par les applications GPS
ou satellitaires comme Google Earth par exemple. Nos systèmes de
coordonnées
GPS actuels sont toujours basés sur un quadrillage de la surface
de la Terre
par des cercles verticaux appelés méridiens ou
longitudes, lesquels passent par
les pôles et par des cercles horizontaux appelés
parallèles ou latitudes. Ces
cercles se divisent en 360 degrés, chaque degré en 60
minutes et chaque minute
en 60 secondes. Dans ce système les mensurations de la Terre ont
été établies
sur les mesures suivantes : - Circonférence Polaire (méridien terrestre) :
40 007 864 mètres - Longueur de 1 degré de méridien : 111 132,95
mètres - Longueur d’1 minute de méridien : 1 852,21
mètres - Longueur d’1 seconde de méridien : 30,87
mètres 10. Pierre-Yves Bely, Deux cent cinquante réponses
aux questions du
marin curieux, Gerfaut, 2004, page 274 11. Eric Charpentier, Les Bâtisseurs du
Sacré, des mégalithes aux
édifices religieux. Mégalithes oubliés du sud
lyonnais : Tome 1, la Déesse
Mère de Mornant, Vienne, Editions Morel, 2019. 12. Bien que le
nombre 364 soit la base numérique de cet édifice, il
s’exprime aussi de manière
évidente sous la forme du nombre 953, extrêmement
présente sur le plateau
mornantais. Or 953 est le produit du nombre 364 par le Nombre d’Or au
carré : 953 = 364 x ϕ2. LE
PIED GAULOIS DANS L’ORGANISATION
MÉGALITHIQUE DU
PLATEAU MORNANTAIS Il
apparait donc avec évidence que la mesure du pied
gaulois de 32,48 cm était encore bien connue et utilisée
dans les constructions
des édifices religieux au moyen âge. La chapelle
Saint-Vincent d’Agny en est
l’exemple manifeste, mais il n’en est pas le seul. Sur le même
plateau
mornantais, existe une autre chapelle romane probablement contemporaine
de
Saint-Vincent d’Agny puisqu’une charte du Xè
siècle en fait mention.
Il s’agit de la chapelle Saint-Martin de Cornas. Celle-ci n’est pas
bâtie sur
la mesure du pied gaulois mais sur celle du yard mégalithique.
Cependant, elle
est reliée à sa jumelle de Saint-Vincent d’Agny par une
relation des plus
subtiles dans laquelle la mesure du pied gaulois apparaît
à nouveau.
-
360°
- 335,02° = 24,98° -
7
465 x sinus(24,98°) = 3 152,48 -
1
Pied Gaulois (PGL) = 32,48 cm -
3
152,48 m = 100 x 6,294 x 15,425 x 0,3248 (Précision
99,97 %) Observer
ici que les dimensions de la chapelle Saint
Vincent sont de 6,294 x 15,425 mètres et que la mesure de 3
152,48 mètres
inscrite sur l’axe Est-Ouest du triangle qui relie les deux chapelles,
est
l’expression de 100 x 6,293 x 15,425 Pieds Gaulois, montre à
l’évidence
l’exactitude de toutes ces mesures et confirme de surcroit cette
relation entre
les deux édifices. Mais
là ne s’arrêtent pas les observations qui
corroborent cette relation. En effet, du site de Saint-Vincent d’Agny,
nous
allons maintenant étudier une relation qui fait apparaître
la même mesure de
3 152,48 mètres. Cette
relation que nous pouvons observer
entre le site de la chapelle Saint-Vincent et celui de l’église
de Mornant est tout
à fait singulière. Elle
s’opère en
effet, non pas à partir d’un point précis de la chapelle
Saint-Vincent mais
bien à partir de l’un des mégalithes encore en place sur
le site.
Il
s’agit plus précisément des deux blocs
mégalithiques (a priori le bloc le plus au nord) situés
à une trentaine de
mètres à l’ouest de la chapelle et à quelques pas
du magnifique tilleul,
gardien du lieu.
A
partir de ces mégalithes, la relation vise
précisément le clocher de l’église de Mornant
situé à plus de 3 km, selon une
orientation remarquable de 4,76° Nord. Il s’agit cette fois d’une
orientation
caractéristique de la diagonale d’un rectangle de proportion
1/12, que nous
avons d’ailleurs déjà rencontré sur la relation
entre l’église de Mornant et
celle de Saint-Sorlin.
§
3 152,48
/ Ѵ145 = 261,8 mètres14 §
261,8
/ 0,5236 = 500 CRE Cette
mesure peut à nouveau être exprimée en
fonction des nombres 364 et 953, puisque : §
261,80
m = 3,643 x ϕ2
exprimé en Toise Mégalithique (1 TM = 2,0736 m) §
261,80
m = 3,642 x 9,53 exprimé en
Toise Mégalithique (1 TM = 2,0736 m) Cette
relation où apparaît pour la deuxième fois la
mesure de 3 152,48 m, résultat du produit numérique
100 x 6,294 x 15,425 x
0,3248 comme expression des dimensions et métrologie de la
chapelle, ne laisse
plus aucune place à la coïncidence. Cette organisation est
non seulement
intentionnelle, mais elle dépasse la cadre chronologique d’une
science de la
construction qui incomberait uniquement aux bâtisseurs du moyen
âge. En
effet, il n’est pas envisageable que le mégalithe de
Saint-Vincent d’Agny soit contemporain de la chapelle romane. Les
textes qui,
du Vè siècle jusqu’à l’an Mil,
jalonnent toute la première partie du
moyen âge, sont sans ambiguïté : ordre est
donné d’abattre ces pierres
auxquelles les païens rendent hommage. « Le
vingt-troisième canon du concile d’Arles (entre 443 et 452)
condamne ceux qui
« sur le territoire d’un évêque quelconque, ou
bien allument de petits
flambeaux ou bien adorent des arbres, des sources ou des
pierres ». Un
capitulaire du roi Childebert Ier (511-558) présente
des
remontrances à tous ceux qui, malgré certains
avertissements, n’ont pas
aussitôt jeté bas, dans leur domaine, partout où il
y en avait, des pierres
alignées ou des idoles consacrées au démon. En
567, le vingt-troisième canon du
concile de Tours récidive : « Que tous ceux qui
paraissent persister
en leur folie d’accomplir auprès de l’on ne sait quelles
pierres, arbres ou
fontaines, lieux manifestes de paganisme, des actes incompatibles avec
les
règles de l’Eglise, soient chassés de la Sainte Eglise et
qu’on ne leur
permette pas de s’approcher du saint autel. » En 789,
Charlemagne dans un
« avertissement général »,
précise : « Pour ce qui est des
arbres ou des pierres ou des fontaines, où quelques sots
allument des feux ou
font d’autres pratiques, nous ordonnons de la manière la plus
expresse, que cet
usage, le pire de tous et exécrable à Dieu, partout
où il se rencontrera, soit
extirpé et détruit »15. NOTES 13. Nous avons
mesuré la largeur extérieure de l’édifice au
millimètre près à 6,294 m. En
supposant que les murs nord et sud font chacun 3 pieds gaulois
d’épaisseur,
soit 1 verge, la largeur intérieure de la chapelle serait
de : 6,294 – 2 x
3 x 0,3248 = 4,345 m. C’est la mesure que donne au
demi-centimètre près,
l’architecte des monuments historiques sur son plan. 14. C’est aussi
l’expression de 100 fois le nombre d’or au
carré exprimé en mètres : 100 ϕ2
= 261,80m 15. Philippe Walter,
« Mythologie chrétienne »,
Imago, 2005, page 150. Professeur à l’Université de
Grenoble, mais aussi
Professeur des Universités, Philippe Walter enseigne les
mythologies
chrétiennes et notamment la littérature arthurienne. Il
est reconnu comme l’un
des meilleurs spécialistes français de la mythologie
merlinesque. LE
PIED GAULOIS DANS L’ORGANISATION
MÉGALITHIQUE DU
SITE DE LA PIERRE DES TROIS ÉVÊQUES Dans
la mesure où ces traditions païennes sont d’origine
celtique, il semble évident que la science des bâtisseurs
du moyen âge tire
aussi son origine de la connaissance des druides qui officiaient
à l’époque
gauloise. Après tout, le nom même de pied gaulois,
nous renvoie
directement à cette période. Cependant,
l’organisation lithique du plateau mornantais,
que nous datons par l’archéoastronomie aux années
1 000 – 1 300 av.
J.C., sort du cadre chronologique habituellement attribué au
peuple celte
(arrivé en Europe occidentale vers -800). De même, nos
travaux sur le site de
la Pierre des Trois Evêques, connus aujourd’hui sous le nom de
Cadran du Pilat,
montrent une organisation des mégalithes aux alentours des
années 2 500
av. J.C., bien avant l’existence supposée des druides de
l’âge du fer. Et
pourtant, la mesure du pied gaulois se trouve exprimée à
deux reprises sur ce
site, dans des relations qui là non plus ne laissent pas de
place au hasard. Le
relevé topographique effectué par les étudiants en
2ème
année de BTS géomètre a permis de confirmer et
compléter l’organisation
géométrique des mégalithes : ainsi, le Viseur
des Ecrins se positionne par
rapport à la Pierre des Trois Evêques selon la
géométrie du triangle 7-24-25 ;
l’Aménagement de
« la Source » du point haut du site, se
positionne quant à lui par
rapport au même Viseur des Ecrins, selon la
géométrie du triangle 5-12-13. Il
se trouve que la géométrie mégalithique permet de
« boucler la boucle » en reliant
l’Aménagement lithique de la Source à la Pierre des Trois
Evêques.
Une
ligne reliant le centre de l’Aménagement la Source au
point de départ sur la Pierre des Trois Evêques, sera
orientée selon un angle
de 7,13° qui correspond à un angle remarquable. Il s’agit de
celui de la
diagonale d’un octuple carré,
c’est-à-dire un rectangle de proportion 1 (largeur) sur 8
(longueur), dont les
côtés 1 et 8 sont respectivement orientés sur les
axes cardinaux nord/sud,
d’une part et est/ouest d’autre part. Ce
qui vient étayer de façon probante cette nouvelle
géométrie mégalithique, est l’expression des
mesures : la diagonale
reliant la Pierre des 3 Evêques à la Source mesure 261,80
mètres. Il s’agit de
l’expression de 100 fois le Nombre d’Or au carré (ϕ
= 1,61803… ; ϕ2
= 2,61803…), mais aussi celle de 500 Coudées
Royales Egyptiennes (1 CRE = 52,36 cm). Pour enfoncer
le clou et finir de « boucler la boucle », cette
géométrie très
subtile nous apprend qu’un octuple carré ayant 500 CRE pour
diagonale, aura
pour unité 32,48 mètres, soit l’expression de 100
Pieds Gaulois de 32,48 cm !
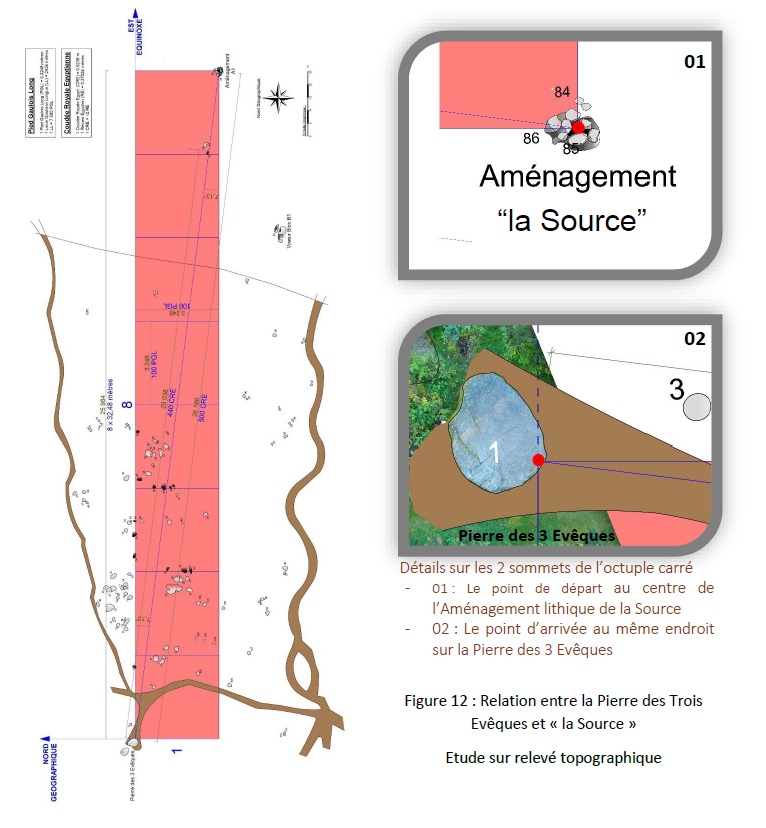 L’utilisation
ici de la mesure du pied gaulois comme
unité de l’octuple carré dont la diagonale correspond
à une valeur exacte de
500 coudées royales égyptiennes montre encore à
l’évidence le caractère
intentionnel de cette organisation. Ce genre de relations
géométriques où deux
systèmes métrologiques sont en résonnance est
typique de la géométrie
mégalithique. L’exemple
du cromlech des Faves qui fait partie du même
site de la Pierre des Trois Evêques, le montre à
merveille. Ce cercle de
pierres est construit selon des principes géométriques
basés sur le triangle
3-4-5, dit premier triangle de Pythagore. Ils corroborent les
conclusions de
l’archéologue français Jacques Briard, qui
déclarait en parlant des cercles de
pierres préhistoriques16: 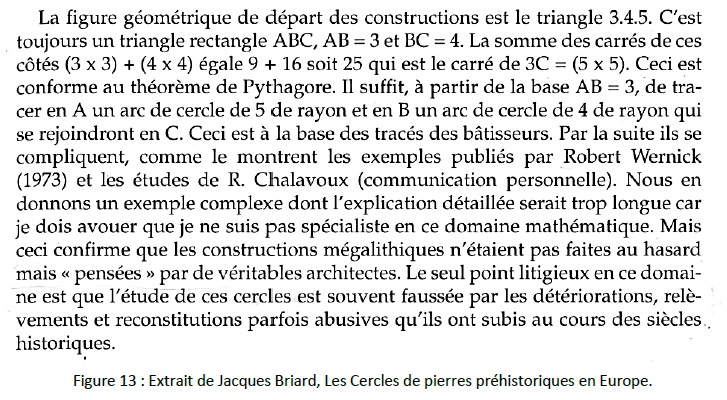
Outre
l’aspect géométrique de cette construction, la
métrologie révèle ici, dans cette composition, la
relation qui existe entre la
mesure du yard mégalithique et celle du pied gaulois. En effet,
le cercle de
pierres des Faves a été conçu de manière
à ce que son périmètre mesure
exactement 100 yards mégalithiques. En le construisant à
partir d’un triangle
3-4-5, on s’aperçoit que l’unité de ce triangle est la
mesure de 4,22 mètres,
c’est-à-dire 13 pieds gaulois de 32,48 cm. Cette mesure n’est
certainement pas
anodine, puisque nous l’avions déjà rencontrée
plus au nord dans le Pilat, sur
le site des Roches de Marlin. Là-bas, c’est la fameuse Pierre
qui Chante,
monument mégalithique phare de tout le massif du Pilat, qui
affiche une
longueur exacte de 4,22 m, se traduisant à nouveau par une
mesure de 13 pieds
gaulois.
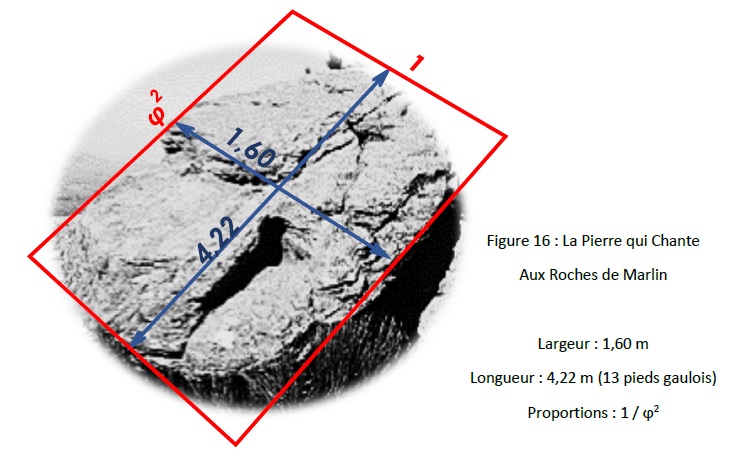
Le
pied gaulois de 32,48 cm semble encore entretenir une
relation très particulière avec le yard
mégalithique dans la géométrie du
cercle. En effet, un cercle ayant pour diamètre 100 pieds
gaulois, soit 32,48 m
(pour reprendre l’unité de l’octuple carré dont nous
avons parlé plus haut),
aura une surface de 1 000 yards mégalithiques à la
précision de 99,93 % et
un écart de 0,55 m2 (1 YM = 82,944 cm). (32,48/2)2
x (22/7) = 828,89 m2
Plusieurs
gravures sont visibles sur face supérieure de
la Pierre des Trois Evêques : les fameuses croix qui
caractérisent cette
pierre borne, les patronymes d’individus ayant vécus dans les
environs, et en
définitive, trois cupules. Or deux de ces cupules indiquent
clairement une
orientation nord/sud exacte.
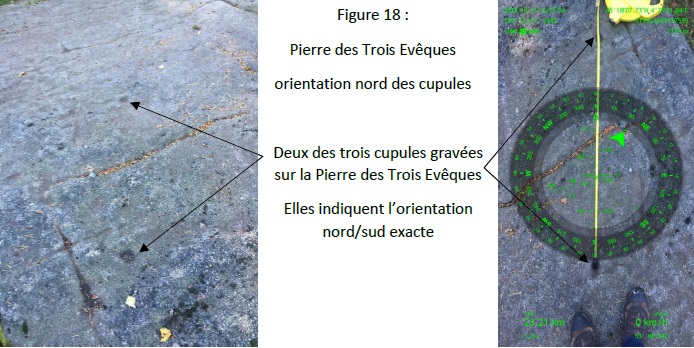
Or
une mesure de 97,44 cm correspondrait à celle de 3
pieds gaulois de 32,48 cm : 3
x 32,48 cm = 97,44 cm
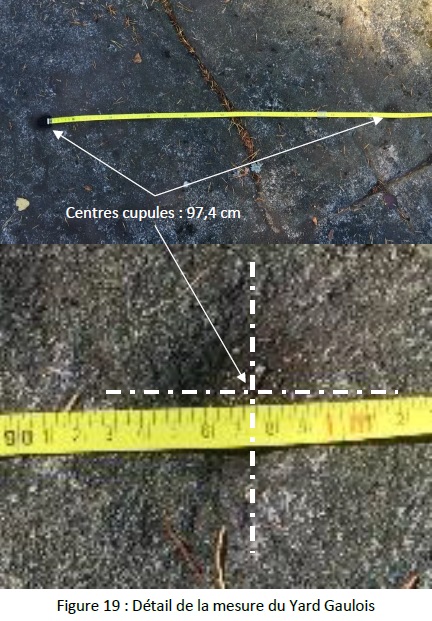
Il
s’agit aussi de la mesure de 1 verge gauloise (ou 1
yard), laquelle en métrologie vaut 3 pieds. C’est cette
même mesure que nous
avons vue plus haut comme étalon fixant l’épaisseur des
murs de la chapelle
Saint-Vincent. Une
telle inscription sur la dalle de la Pierre des Trois
Evêques, évoquant à la fois l’orientation cardinale
et à la fois une mesure
utilisée à deux reprises dans l’organisation lithique de
ce site, pourrait très
bien être une dédicace comme l’on en trouve encore dans
certains édifices
religieux du moyen âge. Elle
pourrait aussi être la trace d’une antique base
d’arpentage, dont le matériel de mesure aurait
nécessité ces marquages sur la
pierre. De tels procédés ont été
montrés par Jacques Laversanne quant à
l’utilisation de la groma romaine.
A
Saint Sorlin, le 13 novembre 2019 Eric
CHARPENTIER NOTES 16. Jacques Briard, Les
Cercles de pierres préhistoriques
en Europe. Editions Errance, 2000, page 29 |