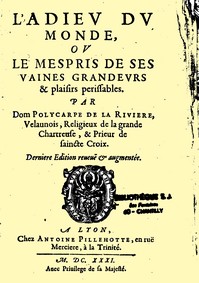Dossier Novembre
2011
|
|
Dom
Polycarpe de la Rivière 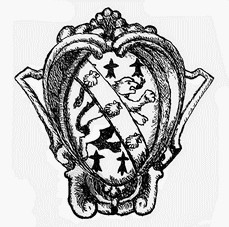 énigmatique
prieur de Sainte-Croix-en-Jarez |
 |
 |
Par
Patrick Berlier |
 |
|
De
1618 à 1627, le prieur de la chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez
était un
certain Dom Polycarpe de la Rivière, un religieux Chartreux bien
énigmatique.
Il fut peut-être l’un des esprits les plus brillants du XVIIe siècle,
auteur de plusieurs ouvrages de dévotion, qui connurent un beau
succès en leur
temps. Mais plutôt que de rechercher les honneurs, il
préférait le calme de la vie
monacale, écrivant à ce propos : « Je me contente qu’on me connaisse
Religieux et Religieux solitaire ». On
ignore en réalité qui était Dom Polycarpe de la
Rivière. On ne connaît de ses
origines que les maigres indications qu’il a bien voulu nous laisser
dans la
préface de son livre le plus connu, L’adieu
du monde. Il se disait natif du Velay, région formée
par les actuels
arrondissements du Puy-en-Velay et d’Yssingeaux, dans le
département de la
Haute-Loire. Il était sans doute issu d’une famille De la
Rivière, dont on
retrouve la trace en particulier au village de Tence, où il
existe encore un
lieu-dit « la Rivière ». Il semblerait que
le véritable nom de notre
homme ait été François de la Rivière,
Polycarpe n’aurait été que son nom
d’église. Il serait né fin 1585 ou début 1586, une
date que l’on peut déduire
de celle de sa profession à la Grande Chartreuse : 1er
mars
1609. à cette
date il avait alors
23 ans. Le
jeune François, ou Polycarpe, entreprit ses études
à la maîtrise de la
cathédrale du Puy-en-Velay. Là il eut comme professeur de
chant et de musique
un jeune chantre, un chanteur portant un nom
prédestiné : Claude François.
Un jour qu’Honoré d’Urfé, le célèbre auteur
de L’Astrée, se trouvait
dans la cathédrale du Puy, il fut charmé par sa voix, et
lui proposa d’entrer
au service de Marguerite de Valois, l’épouse du futur Henri IV,
la fameuse
« Reine Margot », comme maître de chapelle
et secrétaire. Marguerite
vivait alors recluse au château d’Usson, en Auvergne, où
elle entretenait une
cour très prisée, fréquentée par les plus
grands esprits du temps. Claude
François devint donc le secrétaire de Marguerite, mais un
secrétaire… très
particulier. Le jeune Polycarpe suivit son maître, puis un peu
plus tard il
devint en toute logique le page de la reine Margot. Il le laisse
d’ailleurs
comprendre clairement dans son livre L’adieu du Monde.
Marguerite de Valois |
|
Polycarpe
de la Rivière trouva à la cour de la reine Margot les
bases de son érudition,
grâce à tous ces maîtres savants. Dans la
bibliothèque fort bien garnie on
l’imagine fouinant, étudiant et prenant des notes. On sait, par
l’inventaire de
cette bibliothèque réalisé en 1608, que tous les
auteurs que Dom Polycarpe
devait citer dans ses ouvrages ultérieurs y étaient
présents. Marguerite de
Valois finit par trouver un arrangement avec son époux, qui
avait réussi à
faire annuler leur mariage en 1599, dix ans après son accession
au trône. Elle
quitta Usson en 1605. Polycarpe, alors, rentra sans doute chez lui.
À Tence, le
vieux prieuré bénédictin venait de passer aux
Jésuites de Lyon. Le jeune homme,
qui désirait se mettre au service de Dieu, entra en religion,
précisément chez
les Jésuites, où il fit un court séjour. Mais on
ignore dans quelle ville. Puis
il se présenta en 1608 à la Grande Chartreuse, et fut
reçu religieux profès
l’année suivante, sous le nom de Dom Polycarpe de la
Rivière. Sa vocation
religieuse n’ayant pas modéré sa fibre littéraire,
il mit son talent et sa
plume au service de la dévotion, entreprenant dès son
arrivée à la Grande
Chartreuse la rédaction de plusieurs ouvrages, qui
restèrent cependant à l’état
de manuscrits pendant une dizaine d’années.
Pendant
ce temps, à Lyon la chartreuse du Lys-Saint-Esprit,
créée en 1584 et baptisée
par Henri III, périclitait en raison d’un cruel manque de moyens
financiers. La
situation semblait désespérée, et seuls deux ou
trois religieux tentaient de
maintenir un semblant d’âme à la grande maison. Mais en
1616, quelques notables
de la ville de Lyon décidèrent de mettre la main à
la poche, et en avertirent
l’ordre des Chartreux. Afin que la chartreuse de Lyon puisse enfin
démarrer une
activité normale, le Révérend Père
général de l’Ordre, Dom Bruno d’Affringues,
décida d’y envoyer dix-neuf religieux : trois frères
convers et seize
pères. Parmi ceux-ci se trouvait Dom Polycarpe de la
Rivière, avec le titre de
procureur. Le procureur est le religieux en charge de la vie
matérielle d’une
chartreuse, c’est un poste de gestionnaire et d’intendant, qui
l’autorise à de
nombreux contacts avec le monde extérieur. Cette
fonction allait permettre à Dom Polycarpe de rencontrer l’un des bienfaiteurs de la chartreuse,
Balthazar de Villars. L’homme était aussi un fin lettré,
gendre de Nicolas de
Langes, le fondateur ou l’organisateur d’une étrange
société secrète d’érudits,
la Société Angélique, née en 1552 sur les
pentes de Fourvière. Il se lia
d’amitié avec Dom Polycarpe, et sut l’encourager dans ses
travaux d’écriture,
dont il favorisa la publication. C’est ainsi qu’en 1617 parut Récréation spirituelle
sur l’Amour Divin et
le bien des âmes, un
recueil de conseils destinés à la conversion des
grandes âmes de la cour. Pour aller plus vite, ce livre qui
s’adressait plus à
des gens du monde qu’à des religieux parut de manière
anonyme. En réalité la
signature de l’auteur y apparaissait sous une anagramme astucieuse.  |
<Retour au Sommaire du Site>
|
Ce
premier livre ayant connu un beau succès, Balthazar de Villars
sollicita
lui-même auprès du Révérend Père
Général l’autorisation de publier sous le nom
de l’auteur les autres ouvrages de Dom Polycarpe, écrits depuis
longtemps, dont
son Adieu du monde auquel il avait
commencé à travailler dès le lendemain de son
admission à la Grande Chartreuse.
La réponse favorable arriva fin 1617. Au cours de l’année
1618 parurent donc L’âme pénitente
auprès de la Croix et L’éloquent
Amoureux ou Pensées sur le
Cantique de Salomon. Ce dernier titre est parfois
considéré comme mythique,
car c’est un livre réputé introuvable, connu seulement
par une citation qu’en
fit Dom Polycarpe lui-même dans un ouvrage ultérieur. Puis
ce fut le tour du
célèbre L’Adieu du monde ou le mépris
de
ses vaines grandeurs, un véritable
« best-seller » de près de 900
pages qui devait connaître pas moins de quatre
rééditions successives. Durant
cette même année 1618, Dom Polycarpe de la Rivière
était nommé prieur de la chartreuse de
Sainte-Croix-en-Jarez. La charge de
prieur étant moins prenante que la fonction de procureur, Dom
Polycarpe en
profita pour mettre en chantier une œuvre littéraire plus
importante, Le mystère
sacré de notre
Rédemption,
trois volumes dont la publication s’échelonna entre 1621 et
1623, et qui ont été entièrement écrits
à Sainte-Croix. En 1626 Dom Polycarpe
de la Rivière publia son ouvrage considéré comme
le plus littéraire et le plus
abouti sur le plan de la maîtrise de la langue française
et de l’élégance
d’écriture : Angélique.
Des excellences et perfections de l’immortalité de l’âme.
Ce livre
est une longue méditation, appartenant au genre
littéraire alors très en vogue
du « miroir », où l’auteur se livre
à une sorte de dialogue avec son
âme, qu’il avait nommée Angélique. L’année
suivante Dom Polycarpe quittait Sainte-Croix en laissant la chartreuse
dans une
parfaite santé financière et économique,
grâce à l’excellence de sa gestion,
qui allait permettre aux Chartreux de poursuivre tout au long du
siècle les
grands travaux de restauration qu’il avait commencés. Dans la
force de l’âge
Dom Polycarpe était nommé prieur de la chartreuse
Sainte-Marie à Bordeaux. Sa
nomination s’accompagna d’une autre
« promotion », puisqu’il devint à
cette occasion covisiteur de la province d’Aquitaine. Le visiteur,
comme son
nom l’indique, va vérifier sur place la bonne marche de chaque
maison. Les
chartreuses sont regroupées en
« provinces », qui ne correspondent
pas forcément avec les provinces administratives. L’Aquitaine
par exemple,
englobe toute la moitié sud de la France entre l’océan
Atlantique et le Rhône.
Même si cette vaste région ne comprenait qu’une douzaine
de maisons en activité
à l’époque, l’étendue considérable du
territoire et la difficulté des voyages
rendaient certainement la charge assez prenante.
Balthazar de Villars |
|
La
chartreuse de Bordeaux était nouvellement créée,
puisqu’elle avait été fondée
en 1605 par François d’Escoubleau, cardinal de Sourdis, qui
devait mourir en
1628. Dom Polycarpe y connut quelques soucis de santé, sous la
forme d’une fièvre
paludéenne qui l’affecta durant plus de six mois. Il ne put
même pas se rendre
au Chapitre général de 1629. Le successeur du cardinal de
Sourdis n’était autre
que son frère, Henri d’Escoubleau, « homme
d’église et homme d’épée tout à la fois ». Dom Polycarpe se trouva
rapidement en butte à ce personnage irascible, qui remplissait
« du bruit de ses
querelles, Bordeaux, le
royaume, l’église et la cour ». Ce « turbulent prélat », comme l’ont nommé
ses biographes, avait
ses aises et ses habitudes dans la chartreuse dont il appréciait
la fraîcheur,
et notre prieur eut fort à faire à la fois pour
ménager sa susceptibilité et
préserver la tranquillité de ses moines. Pour
éviter un affrontement qui
paraissait inexorable, en 1631 on rappela Dom Polycarpe à la
Grande Chartreuse.
Autant dire que durant les quelques années qu’il passa à
Bordeaux, il n’eut pas
le loisir de poursuivre son œuvre littéraire. Mais sa
carrière était loin
d’être terminée... Dom
Polycarpe de la Rivière ne resta que peu de temps à la
Grande Chartreuse. La
même année le Chapitre général le nommait
prieur de la chartreuse Notre-Dame à
Bonpas, près d’Avignon, une charge qu’il allait cumuler avec
celle de
covisiteur de la Provence. Bonpas, ce fut d’abord pour notre prieur un
changement radical de paysage et d’environnement. Après les
montagnes de
l’Auvergne de son enfance, ou le Pilat, et leurs rudes climats
continentaux,
après les deux fleuves de Lyon et leurs brumes, après les
marécages du
Bordelais et leurs moustiques qui lui avaient donné la
fièvre, voici que se
présentaient la Provence et ses douceurs. Bien que proche
d’Avignon et de ses
fastes, la chartreuse fortifiée jouissait d’une position
privilégiée et
tranquille au bord de la Durance, mais sur un talus qui la mettait
à l’abri de
ses colères, et adossée à une colline qui la
protégeait du Mistral. Tout cela,
Dom Polycarpe pouvait le découvrir depuis l’ermitage du prieur,
qui est un
véritable petit château Renaissance.  |
<Retour au Sommaire du Site>
|
À
Bonpas, Dom Polycarpe put à nouveau s’adonner à sa
passion de l’écriture, mais
ses textes changèrent curieusement de teneur : après
s’être consacré à la
dévotion et au mysticisme, Dom Polycarpe entreprit de faire
œuvre d’historien.
Cependant, alors que ses premiers ouvrages avaient été
unanimement salués, ses
recherches historiques ne soulevèrent que vives critiques et
interrogations, à
tel point qu’aucune d’elles ne fut publiée de son vivant !
Dans les
Annales de la chartreuse de Bonpas, Dom Polycarpe était
présenté comme un
« rat de bibliothèque », allant faire des
recherches dans « toutes les villes où l’on voulait bien le lui permettre ».
Honoré Bouche ne le dépeignait
pas autrement, affirmant : « il
avoit eu autrefois l’entrée des meilleures bibliothèques
de France, & la
rencontre des plus curieux manuscrits qui s’y pouvoient trouver ».
Il
ne faut pas oublier non plus que Dom Polycarpe était un
religieux, et donc
adhérait forcément à des croyances sans doute peu
plausibles mais jugées
merveilleuses, voire miraculeuses, par l’Église. Notre
prieur se fit également remarquer pour ses affirmations
concernant l’histoire
d’Avignon. En réalité, lorsque les critiques
commencèrent à s’élever, son
ouvrage n’était encore qu’un assemblage de notes, de citations
et
d’informations les plus diverses, qu’il lui restait à mettre en
forme. Nul
doute que le livre final aurait eu un aspect plus apuré.
Vexé peut-être, Dom
Polycarpe en resta là et ne l’acheva pas. Il entreprit alors
d’écrire
l’histoire de l’Ordre des Chartreux, un ouvrage qu’il ne termina pas
lui non
plus, le Révérend Père Général
refusant de l’approuver. Tout ce travail n’avait
sans doute pas été vain, puisque Dom Polycarpe de la
Rivière se lança ensuite
dans une entreprise autrement plus ambitieuse, qui devait être
l’œuvre de sa
vie : l’histoire des évêchés, chapitres,
monastères et communautés de
France, en dix-sept gros volumes. Trois tomes étaient
terminés en 1636, mais il
dut les retravailler pour y apporter des corrections, suivant la
recommandation
du Révérend Père Général qui pour le
soulager lui attacha les services d’un
jeune religieux. À la fin du XIXe siècle et
au début du XXe, plusieurs historiens lancèrent
leurs foudres contre
Dom Polycarpe, l’accusant d’avoir falsifié des textes. Ces
détracteurs qui
n’ont surtout pas cherché à retrouver ses sources de
documentation, certains de
leur non-existence, étaient Émile Duprat, Canron et
l’abbé André. Il a fallu toute
la fougue d’un Joseph Hyacinthe Albanès pour tenter de disculper
Dom Polycarpe
en assénant aux accusateurs la référence de l’une
de ses sources, preuve
matérielle de sa bonne foi. Elle figure dans l’ouvrage
d’Albanès Gallia
christiana novissima.Hélas
c’est l’opinion des détracteurs qui a prévalu.  Bonpas ; hermitage du Prieur |
|
En
1638, malade, Dom Polycarpe de la Rivière souffrait des jambes
et ne marchait
plus qu’avec difficulté. Sur sa demande, le Chapitre
général le releva de ses
fonctions et le dispensa de suivre toutes les règles de l’Ordre.
À cette
occasion il eut droit à des éloges solennels.
L’année suivante, la maladie
avait empiré. Dom Polycarpe souffrait assurément de
rhumatismes : dans une
lettre datée de 1634, adressée à Peiresc, il se
plaignait déjà des douleurs que
son « mal de jambe » lui
causait. À l’époque, la seule façon de soulager
ces douleurs était d’aller
« aux eaux ». On lui permit de se retirer pour se
soigner dans la
chartreuse Saint-Joseph à Moulins (Allier). Il quitta Bonpas,
laissant ses
manuscrits à un confident et ami. Mais pourquoi Dom Polycarpe
a-t-il choisi une
destination si lointaine pour se soigner ? Plusieurs stations
thermales
plus proches traitaient les douleurs et les rhumatismes, on peut citer
Gréoux-les-Bains ou Balaruc. Admettons
que Dom Polycarpe ait préféré l’Auvergne ou le
Bourbonnais. D’ailleurs, si
notre prieur avait choisi la chartreuse de Moulins comme lieu de repos,
c’est
sans doute parce que cette maison était située à
une trentaine de kilomètres à
l’ouest de la station thermale de Bourbon-Lancy, par une bonne route.
Après
quelques mois passés à Moulins, il demanda l’autorisation
de se rendre en cure
au Mont-Dore, en Auvergne. Étrange choix, en
vérité ! C’est une localité
très éloignée de Moulins, près de 150
km ! De plus la station thermale du
Mont-Dore a toujours soigné l’asthme et les affections
respiratoires, pas les
rhumatismes ! En septembre 1639 il prit la route avec un
domestique et
deux chevaux. Arrivé à Clermont, il renvoya son valet et
les chevaux et prit
seul et à pied la route du Mont-Dore. Pourquoi renvoyer
domestique et chevaux
alors qu’il restait près de 50 km à parcourir pour
arriver à la station
thermale ? Comment un homme qui souffrait des jambes et avait du
mal à
marcher pouvait-il s’engager à pied, et seul, sur une telle
distance ?
Tout cela paraît bien mystérieux, et d’ailleurs Dom
Polycarpe n’arriva jamais à
destination, et les Chartreux de Moulins ne le virent jamais revenir
parmi eux. Deux
mois plus tard, le Révérend Père
Général très préoccupé par cette
disparition demanda
au procureur de Moulins d’aller enquêter sur ce qu’il
était advenu de Dom
Polycarpe, mais on ne retrouva aucune trace. Avait-il été
assassiné par un
valet cupide, attiré par l’importante somme d’argent qui lui
avait été confiée
pour son voyage, ou avait-il renoncé à la religion comme
on le prétendit ?
Le Révérend Père Général diligenta
une enquête qui ne put ni confirmer ni
infirmer l’une ou l’autre des versions. Plusieurs
rumeurs se répandirent aussi, situant la réapparition de
l’énigmatique prieur
en des lieux très divers. Mais en réalité, jamais
personne ne revit Dom
Polycarpe de la Rivière, ni vivant ni mort. Comme devait
l’écrire de manière
fort sibylline son ami Honoré Bouche : « Mais par de certains secrets, à
fort peu de gens connus, l’Auteur a
disparu, & son ouvrage a esté condamné aux tenebres ». Comment ne
pas penser à un acte réfléchi,
prémédité ? Certes on ne peut pas
écarter
totalement l’hypothèse d’un crime crapuleux. Mais tout se
présente comme si Dom
Polycarpe, froissé par les refus successifs qu’il venait
d’essuyer, avait
soigneusement organisé, peut-être avec l’accord de ses
supérieurs, une
disparition qui finalement arrangeait tout le monde. Patrick
Berlier
 |
A
présent retrouvons notre invité,
notre ami, le chaleureux Antoine Herrgott |
|
Humble, Antoine se présente d'abord comme victime d'une passion
tardive de la recherche, celle de ses racines locales, passion qui chez
lui est à l’origine, du hasard, de l’écriture et de la
compilation d’archives. Cet attrait concerne plus
particulièrement la partie
sud du terroir du Haut Pilat. Sa carrière dans la technique et
le commerce des combustibles a
contribué très certainement à faire la
connaissance aussi bien des ressources
de la terre que de la capacité des hommes aux découvertes
permanentes de
l’ancien pour le bien du futur. Dynamique, Antoine, comme nous allons
le voir, aime se donner les moyens de réussir dans l'entreprise
de ses projets. C'est un homme concret dont la vie est bien
remplie. Doté d'un sens de l'amitié inné,
fourmillent autour de lui des petits groupes de proches ; c'est autant
de
cellules 'ouvrières' permettant de faire aboutir ces projets.
Ecrivain, conférencier, archiviste, mais
également marcheur et organisateur d'un salon, cet homme va
toujours de l'avant, en minimisant d'avance tous les obstacles qui
viendraient sur son chemin. Nous vous proposons maintenant de le
découvrir afin
de mieux le connaître. Nous le remercions pour cet interview.
|
 |
|
Bonjour Antoine. En 2008 vous avez sorti un livre consacré au château de La Faÿe, un monument privé et restauré situé dans le Haut Pilat, entre Marlhes et Saint-Genest Malifaux. La famille Courbon La Bonjour
Thierry. Je suis très heureux d'avoir pu sortir ce livre sur ce que j'appelle un domaine scientificoagricole emblématique pour toutes les raisons propres aux propriétaires des lieux agronomes de leur état et qui ont inventé toute leur vie. Le château date de 1783 et sa restauration est en cours avec une nouvelle destinée : l'ouverture d'un musée archéologique privé.
Né sur ce
terroir à moins d'un kilomètre, ma marraine est ma tante
Edith Courbon La Faye
dernière famille de sept enfants ayant vécu sur les
lieux. Mon oncle Jean
Courbon et son frère Paul ont été les derniers
exploitants de cette ferme de 160
têtes bovines pour la production industrielle du lait de vaches.
Electricité
par turbine depuis 1894, scierie, carrière de granit,
étable ultra moderne
(évacuation du purin par wagonnets sur
rails centraux , une usine de velours (80 ouvrières).
Deux grandes
motivations sont associées à ce côté
familial et donc sentimental: 1-
c'est au cours de mes recherches dans
les archives locales et régionales que je devais
découvrir que les ascendants
de Jules Verne avaient été les anciens
propriétaires des lieux "le château
ancien" et les terres.Ils ont vendu ce domaine aux Courbon La Faye en
1742. 2- le fait de rapporter une histoire
locale inédite à été moteur dans ma passion
de transmettre la valeur
patrimoniale de mon lieu de naissance. |
Le babeurre tient une place toute particulière dans
cet
ouvrage. On ressent une certaine fiereté à nous mener sur
les pas de l'histoire du babeurre. Pouvez-vous nous résumer cet
attachement au babeurre et déjà nous le définir ?
Dès la traite
des vaches le lait était
stérilisé (époque de Pasteur) et des manipulations
de refroidissement et de réchauffement par l'eau
canalisée du
ruisseau traversant le domaine, le lait était
complété et mise en boîtes et en
bouteilles sur place. Le nom babeurre à été
donné à l'époque sur les
réclames, terme approprié au cours de son exploitation
entre 1894 et 1965.
Ce n'est donc
pas le petit lait résidu de la baratte lors de la fabrication du
beurre. Une
partie de la fabrication destiné aux nouveaux nés,
était en appellation
médicamenteuse dans le "Vidal" la bible des médecins. Ma
mère m'a rapporté avoir complété ma
nourriture avec l'absorption du babeurre, couplé avec du lait de
la Faye.
Une
production de boite sertie de 250grs à été
expédiée durant deux ans en
Indochine et notamment à Dien Bien Phu, la pire des batailles
subie par le corps
expéditionnaire français. |
En restant
géographiquement
peu éloigné de votre ouvrage sur La Fayë, vous venez
en 2011 d'en consacrer un sur Pierre de Tarentaise, le premier
Dominicain à devenir Pape et ce sous le nom d'Innocent V en
1276. La rigueur et la vie exemplaire de ce religieux
oublié, guide le lecteur de la première à la
dernière page du livre. Comment avez-vous
appréhendé ce
nouvel ouvrage et surtout comment la vie de Pierre de Tarentaise
est-elle devenue la source d'une telle motivation ?
Effectivement le territoire de Tarentaise
se trouve à quelques kilomètres de La Faye et à
l'époque de la grande
exploitation des terres , des bois et des bâtis faisaient partie
du domaine de
La Faye. Ce dernier ouvrage qui devait-être sur l'histoire de la
maison forte
de Prarouet, m'a fait découvrir cette légende sur la
naissance de Pierre de
Tarentaise.
Immédiatement je me suis porté sur la
recherche et le pourquoi de cette
légende avec une envie démesurée d'aller trouver
les éléments aux archives du
Vatican dans le travail de traduction effectué par ce
Révérend Père H. Laurent.
Mes démarches n'ont pas abouti et c'est la raison qui m'a
freinée dans
l'aboutissement de ce livre.
Mes
recherches ont abouti à la certitude de sa naissance sur ces
lieux nommés au
bord du Furan près de Saint-Etienne, par cet Historien chercheur
aux archives du
Vatican dans les année 1937-1947. Voilà encore un
Inédit de notre histoire
locale.
Le
patronyme de Pierre de Tarentaise, Pierre Aleysson famille de
Montbrison m'a aussi conforté dans
cette quête de la vérité historique. |
Le choix du titre (le silence de
Pierre) demeure presque énigmatique ? Quelles en
sont les raisons et y a-t'il dans
ce silence une
véritable notion de
discrétion ?
Oui il est vrai que
Pierre de Tarentaise
a été toute sa vie très modeste, simple et
très diplomate. Il est accompagné
par sa grande érudition à un niveau très en
théologie, faisant référence,
encore récemment, (au XIX° siècle) dans les
formations catholiques. Il
a eut pour condisciples d'études Saint
Thomas D'Aquin et Saint Bonaventure un peu plus scientifiques que lui
et pour
lesquels lors de l'arrivée de l'imprimerie l'accent s'est
porté sur eux en
omettant Pierre de Tarentaise.
Il a
fallu son procès en béatification, peu avant 1898, pour
réunir toutes ses
archives et enfin traduire ses manuscrits du latin.
Le Silence de Pierre est la pure traduction
de la représentation de ce grand homme un peu trop effacé
peut-être.
Et puis
associer l'image de la pierre, très présente dans notre
région, comme gardienne
de l'histoire locale et rompre justement son silence m'est apparu
réconfortant
et solide dans cet aboutissement de
mes recherches un peu chaotique
car lointain et peu accompagné d'écrits dans notre
région. |
|
En vous lisant attentivement, on a l'impression d'être en présence d'un homme d'exception avec ce religieux comme revenu d'un si lointain passé. Est-ce réellement ce sentiment qui a guidé votre plume si flatteuse envers cet homme et ce tout au long de votre ouvrage ?
Un homme d'exception
c'est indéniable, je
suis très heureux d'avoir fait passer ce message, car j'ai
été habité tout au
long de mes lectures par sa grandeur d'âme.
Il a
côtoyé les grands de son époque que ce soit les
Rois , les cardinaux, évêques
et nombreux prêtres de son époque. Proche de la famille de
Savoie, elle même
très active auprès de la royauté et le Vatican,
trait d'union très influent,
laisse supposer cette volonté de le nommer fils de la
Tarentaise un diocèse lui
même un des plus important après le diocèse de Lyon.
Grégoire X, son guide, lui a imposé
des responsabilités immenses, et
très lourdes tout au long de son activité après
avoir tenu à deux reprises le
professorat en théologie à Paris au cours des premiers
pas de la Sorbonne.
A la
fois très présent au concile II de Lyon; en charge de
l'Evêché, Primat des
Gaules à une période extrêmement secouée et
assurant en même temps sa fonction
De Cardinal d'Ostie, avant d'être élu par ses pairs sur
le siège Épiscopal.
On
image mal toutes ses interrogations lors des prises de ses fonctions
éminentes. A la lecture de nombreux ouvrages sur le Haut moyen Âge (vie du peuple et vie des dignitaires) et sur les ordres religieux, (Chartreux, Dominicains, Franciscains, Oratoriens) j'ai ressenti très vite la très grande valeur de cet homme qui dans sa modestie a grimpé avec panache et quelques fois avec contrainte toutes les marches de la hiérarchie de L'Église Romaine. |
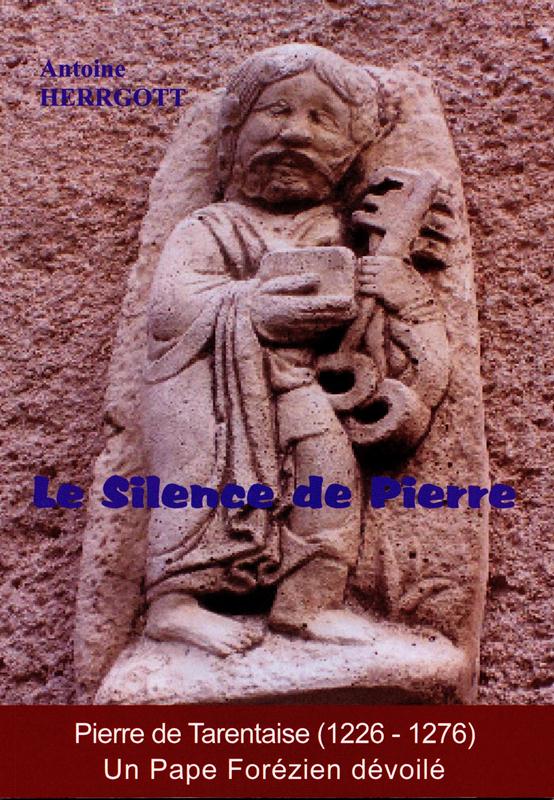
<Retour au Sommaire du Site>
|
Oui il est vrai que, à l'approche de ce
lieu de Prarouet, j'ai tout de suite été très
attiré par cette maison forte
presque cachée, marquée d'une façade simple de
beauté , provoquant
immédiatement l'envie de pousser la porte. Mes promenades
hebdomadaires avec
des amis me poussent à chaque fois par la curiosité
à photographier les pierres
anciennes, et les maisons en pierres de taille assemblées à l'ancienne.
Une
anecdote ou un exemple très contemporain, le chemin
d'Exbrayat, notre écrivain de
Planfoy, village voisin,
passe le long de ce lieu, et ni lui ni les adeptes et adhérents
de l'association
n'ont poussé le regard plus loin sur ce bout de chemin
mentionné "Chemin
du Prieuré".
J'ai
pensé pendant quelques mois avoir trouvé un
inédit. Ce n'était pas tout à fait
le cas et encore aujourd'hui je ne sais pas s'il est bien opportun
d'écrire en
détail sur ce lieu devenu propriété privée.
Mais j'avais déjoué la légende au
profit de l'Histoire de notre Pape Forézien. Le but est atteint. |
|
Vos publications sont réalisées en amateur, naturellement. Le château de La Faÿe fut publié en auto édition et le silence de Pierre par votre toute nouvelle et modeste maison d'édition, l'A.R.T. (Auteurs des Régions et des Terroirs). Pouvez vous nous en dire plus ?
Pris par l'envie
d'Indépendance totale et
pour assurer la pleine responsabilité de ce que j'ai envie de
publier, je n'ai
pas trouver d'Éditeurs qui fasse abstraction de leur envie
personnelle
d'interventions sous le couvert de littérature du moment
où pour faire simple
de la recherche de la vente au détriment de la
personnalité de l'auteur. Ma
première
grande expérience sur l'auto-édition remonte à la
fabrication à six auteurs du
livre "Marlhes au long des Siècles" ouvrages de 500 pages avec
ma
forte implication dans la démarche de l'édition.
Il
vrai que nous
avons monté une structure qui nous assure cette pleine
indépendance et
maintenant nous la mettons au service de celui où celle qui veut
s'assurer un
ouvrage sous toutes ses formes.
Nous
pouvons assurer une partie de
la diffusion par nos sorties, réseaux existants et laisser
à l'auteur sa totale
liberté. Notre structure: A.R.T. Auteurs des
Régions et des Terroirs est
basée 43, rue Gambetta à
St.Just-St.Rambert - art.loire@hotmail.fr avec très
bientôt un site en
construction. |
|
Les difficultés à être distribué et connu lorsque l'on est anonyme, vous ont également et de nouveau collégialement, engagé dans une autre aventure : le salon du livre de Saint Just Saint Rambert dont vous êtes l'un des principaux organisateurs. Qu'en est-t'il exactement ?
Le besoin de sortir de chez soi pour se
faire connaître a provoqué notre démarche; celle-ci
dès le départ s'est appuyée sur et avec "Radio
Plaine" vecteur
important de communication locale jusque sur le territoire de Roanne
mais sans
réseau sur Saint-Etienne. Et puis les interviews
en radio tout le long de
l'année par mon ami Gérard Llilio et que nous avons
initiées sur le salon de
St.Just et au Salon du Château de Bouthéon. Nous
étendons nos sorties pour la
diffusion dans les salons du livre dans les alentours. Le
tout prochain étant
celui de St.Etienne où nous serons présent sous nos
doubles casquettes. |
|
Les marches hebdomadaires, avec
un
petit
cercle d’amis, vous permettent de vous oxygéner. Est-ce comme
cela que vous voyez les choses ?
Oui le premier but
est de marcher
régulièrement pour environ effectuer entre 10 et 15 kms
avec le pique-nique
dans le sac pour un réconfort là où
nous nous trouvons sur le chemin en mi-journée. En
second lieu c'est aussi la découverte
de notre petit patrimoine si riche lorsque l'on prend le temps de le
découvrir
et surtout de l'admirer.
C'est comme cela et entre autre que nous avons parcouru en
neuf étapes
les 44 kms.du canal du Forez; et aussi
beaucoup d'intérêt de découvertes dans le Pilat. |
Pour clore cet échange
convivial, on a envie de vous
demander quels sont vos projets, si vous avez encore une place de libre
bien entendu (sourire), tellement votre vie est
déjà remplie ?
J'ai une chance
immense, la santé, et
c'est elle qui est le moteur de tout; ensuite n'est ce pas un moyen de
combattre le risque du vide au lever du jour, dès lors que l'on
n'est plus en
activité professionnelle.
Mes
projets immédiats, vous allez très certainement sourire ,
sont la préparation
d'un salon des collectionneurs où je vais exposer une petite
partie des
manuscrits anciens récoltés lors de mes recherches sur le
domaine de La Faye et
puis la mise au goût du jour la fabrication
du babeurre suivant la recette de
l'époque, avec le concours
d'un professionnel.
Quant à l'écriture pour l'instant
grâce à notre structure nous avons à
faire imprimer des écrits de personnes qui nous confient leur
oeuvres
manuscrites.
Merci beaucoup pour ce premier exercice de revue
sur mes écrits; de
fouineur d'archives mais certainement pas sous le titre
d'écrivain que je ne
suis pas.
Encore Merci à vous. |
<Retour au Sommaire du Site>
En Mars 2012 sous la plume de Patrick
Berlier vous découvrirez le Dossier :
"Valfleury, trésors et curiosités d'un petit village entre Pilat et Lyonnais" |