Nicolas
Poussin : Au cœur du
Mystère
|
Rubrique Rennes-le-Château Janvier 2015
|
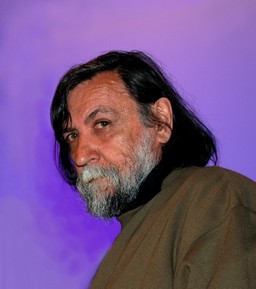 |
Daniel
Dugès
|
L’intrusion de Nicolas Poussin
dans l’affaire de Rennes le château semble irréelle tant
de choses séparant la
vie du peintre de celle du curé. Deux siècles d’abord,
deux lieux :
l’Italie et la France, deux personnalités : un peintre
mondialement
reconnu à son époque et un obscur curé dans la
sienne, enfin deux attitudes un
peintre n’affichant pas une religiosité particulière et
un curé de village. On
pourrait ainsi allonger la liste des oppositions entre ces deux
personnages.
Nous
allons étudier ici le travail de Nicolas Poussin pour voir si
l’on peut trouver
quelque chose qui les rapproche. Bien sûr on a beaucoup
parlé du tableau des
« Bergers d’Arcadie », mais on a fait sur lui
tant d’erreurs. Il
n’indique sûrement pas l’emplacement d’un trésor, il n’est
pas constitué de
lignes et d’angles mesurables en degrés et qui sortent de la
toile pour aller
plonger dans l’imagination la plus fertile de nos contemporains. Non,
un
peintre composait à l’œil et se souciait peu ou pas d’angles
mathématiques.
Voyons
donc comment Poussin préparait un tableau. À cette
époque, le peintre
travaillait en atelier, il ne sortait sur le terrain que pour faire
quelques
croquis qui serviront de décor à ses personnages. Le
paysage en tant que tel
est une notion qui n’existe pas. Il sert de fond au tableau et la plus
part du
temps, il est composé de dessin pris ça
et là. On reconnaît plusieurs fois dans l’œuvre de Poussin
le château Saint
Ange placé dans la nature, alors qu’il est au cœur de Rome.
De même,
l’image des Bergers d’Arcadie n’a jamais existé telle quelle, ce
n’est pas une
photo, c’est une composition. Il arrivait à Poussin de commencer
par modeler
ses personnages en terre pour se faire une idée plus nette de
son projet, puis
il faisait des esquisses de ses personnages. Ensuite il a pu installer
une
grosse caisse dans son atelier pour représenter la tombe, puis
quand son projet
a été clair dans son esprit, il a fait venir ses
modèles, un par un, pour en
prendre la pose afin de les peindre. L’ombre du bras sur la tombe nous
permet
de voir que Poussin avait une source lumineuse dans son dos à
gauche assez
basse, peut-être une fenêtre ou un luminaire devant un
miroir. On notera que
cet éclairage ne correspond pas à celui du ciel qui nous
présent plutôt un
soleil de face. C’est là la preuve absolue qu’il s’agit d’une
œuvre d’atelier.
On ne peut pas
raisonner devant l’œuvre de Poussin sans penser que le mystère
se situe au niveau du symbole des
personnages. C’est là
sa manière de concevoir le symbolisme. Que voit-on ? Trois
bergers et une
femme. Elle est plutôt richement vêtue, rien ne nous dit
que c’est une bergère.
Elle semble méditer. Elle pose la main sur l’un des bergers
comme pour lui
signifier qu’elle le protège. Les trois hommes laissent tous
voir qu’ils ont un
sein découvert ainsi qu’un genou dénudé. C’est le
symbole de l’initié et le
chiffre trois est lourdement porteur de sens. Ils portent tous les
trois une
couronne de laurier sur la tête, récompense, que l’on
donnait en Grèce, aux
hommes qui avaient rendu un grand service à l’état. Une
sorte de légion
d’honneur. En dépit du titre de ce tableau, ces trois
initiés couronnés ne sont
pas des bergers ! D’ailleurs Poussin a la volonté de nous
le faire savoir
en ne peignant aucune bête dans ce tableau. Leurs bâtons
sont aussi ceux du
pèlerin ou du pasteur, celui qui guide. Ce
tableau
représente le symbole d’une société initiatique
protégeant trois gardiens
personnages importants dont le rôle est vraisemblablement de
« garder » une tombe comme les bergers
protègent le troupeau. Ce
n’est pas
le seul tableau de Poussin faisant allusion à une
société ésotérique, dans la
période entre 1636 et 1650, il en peint plusieurs en se servant
d’un artifice
assez unique : l’utilisation des lignes de force. Ainsi,
il
peint pour le cardinal de Richelieu quatre tableaux dont le
« Triomphe
d’Amphitrite » (Vénus). Ce tableau nous montre
Amphitrite sortant de
l’onde sur sa coquille portée par trois dauphins, sous l’œil
admiratif de
Neptune son époux. Dans son génie Nicolas Poussin arrive
à dissimuler un
symbole connu mais visible des seuls initiés. L’ensemble de la
composition
s’articule autour d’un triangle formé par une ligne de force
partant de la
jambe externe du cheval à gauche du tableau pour se prolonger
par le bras de
Neptune, longer le voile rouge, puis le corps du putto (angelot) pour
s’arrêter
au pied du putto le plus haut. La ligne de force symétrique de
celle-ci part du
même pied longe l’autre côté du voile rouge pour
suivre le corps de la nymphe
vers l’angle droit du tableau. La ligne du bas du triangle nous est
donnée par
l’alignement du poitrail des chevaux, puis la tête du putto
central pour
aboutir à droite au pied gauche de la nymphe.
Mais ce n’est
pas tout le voile rouge au centre du tableau possède un dessin
assez étonnant
pour que l’on s’y arrête. Dans les plis, on peut apercevoir assez
facilement un
sourcil et au dessous un œil avec la pupille et l’iris bien
marqué. Les cinq
personnages qui soutiennent ce tissu et jouent de la corne sont
placés en
position rayonnante vers le sommet du triangle. Enfin pour clore le
tout, les
trois dauphins qui soutiennent la conque forment chacun trois cercles
parfaits.
Il y a donc dans ce tableau un symbole ancien, mais utilisé par
nombre de
sociétés initiatiques à cette époque,
symbole appelé souvent « l’œil de
Dieu ». Si
l’on
analyse les détails de ce tableau, on s’aperçoit que
nombreux sont les éléments
groupés par trois : trois tissus, trois personnages principaux,
deux fois trois
puttis dans le ciel, trois dauphins, etc. Poussin
montre
à travers ces exemples et de nombreux autres qu’il a
travaillé ou côtoyé une
société initiatique. Il est possible que cette
société détînt un secret
concernant une tombe, ce qui expliquerait la fameuse phrase de
l’abbé Louis
Fouquet à son frère : « Monsieur
Poussin détient des secrets que
les rois lui envieraient »…
Au XIXe
siècle une société initiatique décide de
faire d’une petite église de village
un temple destiné aux plus hauts grades de leur groupe :
les gardiens.
Tout à fait par hasard ce village se trouve près d’un
autre qui s’appelle
Arques, ces gardiens seraient-ils les bergers d’Arcadie ?
Serait-ce cette
société initiatique qui rapproche le peintre du XVIIe et
le curé du XIXe ?
Enfin,
puisqu’il y a bien un lien entre ces deux hommes, la solution n’est
elle pas
dans le sens de la phrase : « Et in Arcadia
ego » gravée su la
tombe « Maintenant je suis en
Arcadie ». Qui parle, qui dit cela ? On a tout
envisagé une traduction
littérale, un mort nous dit : « maintenant je
suis au paradis ».
La mort elle-même qui dirait « même au paradis,
je suis présente » ce
qui a soulevé de nombreuse adhésion, mais qui à
terme n’a aucun sens. Pourtant
c’est à nos yeux dans cette phrase qu’est le secret de cette
histoire, et c’est
à chacun d’essayer de le trouver.
Enfin
Poussin exécute deux autoportraits pour deux de ses
mécènes. Le premier le
représente souriant un pinceau à la main dans un
décor indéfinissable, le
second le représente dans son atelier devant quelques toiles
à peine entrevues.
Il nous donne là encore un petit bout de la clef. Dans la
seconde toile, il a
remplacé le pinceau qui est l’apanage du peintre, par sa main
décorée d’une
grosse chevalière. Sur celle-ci la pierre est une pyramide et
l’éclat qu’il a
souligné sur cette pierre forme une équerre.
Chacun est à même de réfléchir à ce qu’il nous transmet, à travers ces images. |