Le Songe Merveilleux de Béatrice

******* à travers les textes ******* |

|
Par Eric Charpentier |
Novembre 2008 |

|

|
En
novembre dernier, nous avions abordé le personnage de Béatrice
de la Tour du Pin, fondatrice de la chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez,
en travaillant sur les renseignements biographiques que nous pouvions tirer
des différents documents historiques la concernant. Cette approche
qui jusque là n’avait jamais fait l’objet d’étude attentive,
nous avait permis de déterminer à quelques années près
les grands évènements de sa vie avant son veuvage : famille,
naissance, mariage, enfants. Nous avions alors poussé l’étude
un peu plus loin en nous interrogeant sur les quelques années qu’elle
dû passer seule à Châteauneuf, sa résidence douairière,
pendant que son époux, Guillaume de Roussillon mourait en Terre Sainte
et que se tramait la fondation de la chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez(1).
Les sources susceptibles de nous renseigner sur cette fondation demeurent malgré tout peu nombreuses. Nous disposons en premier lieu de l’acte de fondation passé dans le cloître de Taluyers en date du 24 février 1281 (nst) et en second lieu du récit miraculeux relatant le songe de Béatrice. Quant
à l’inscription qui relatait également le songe de Béatrice
et qui figurait jadis dans la chapelle de Sainte-Croix-en-Jarez, elle nous
est rappelée à nouveau par Dom Nicolas Molin toujours vers
1638 (G), mais encore par Dom Polycarpe de la Rivière en 1621(15)
(E) et Jacques Gaultier en 1609(16) (D).
|

Sainte-Croix-en-Jarez
Vue sur les jardins et la cellule du Prieur
|
1 – La version (M) d’Antoine Vachez en 1904. Antoine
Vachez, éminent érudit qu’il ne convient plus de présenter
dans l’histoire de la chartreuse(20) s’est intéressé très
tôt à la fondation de cette maison puisque c’est en 1865 qu’il
nous livre ses premiers écrits sur le sujet(21) (M’). A cette date,
l’auteur est encore jeune et il ne dispose pour son étude que des
récents écrits de l’abbé Benoît Chambeyron ; aussi
il est tout naturel de retrouver dans ce premier travail les mêmes
éléments que donnait son prédécesseur, à
quelques enjolivures près. On notera d’ailleurs que dans l’un des passages
de la lettre de Béatrice, l’abbé avait traduit « Duc
de Savoie » au lieu du traditionnel « Comte de Savoie »
et que Vachez avait reproduit la même erreur dans son texte. Il est
de fait parfaitement clair que Vachez s’appuie entièrement sur l’abbé
Chambeyron (L) dans cette première publication, auteur qu’il mentionnera
d’ailleurs dans ses sources.
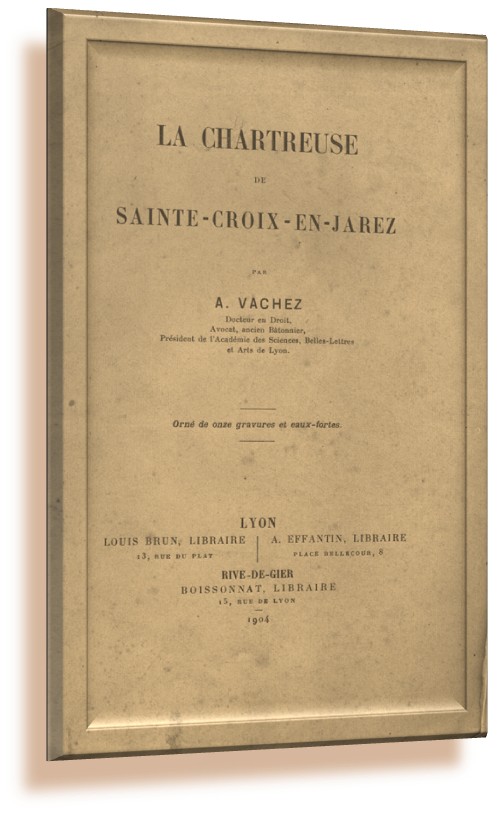
L’ouvrage d'Antoine
Vachez Paru en 1904
|
« Religiosæ
personæ et devotæ in domino nostro J. C. fratri, Joanni, priori
Vallis viridis, propè Parisios, ordinis Cartusiensis. Beatrix de
Turre, conjux quondam nobilis militis, Domini Guillelmi de Rossillione, domini
Annoniaci, domicella, Jesu Christi et gloriosæ Virginis Mariæ,
salutem; et omnibus ejusdem amicis recommendatis orationibus ejus gloriosis,
et fratrum religiosorum virorum in eodem Jesu Christo et gloriosa Matre
ejus.
Nobis igitur iter arripientibus et celeriter alios præcedentibus equitando, ecce Crux et stellæ, quas videramus, antecedebant nos, quousque venientes starent in loco ubi erat dicta domus nostra construenda; in quo quidem loco nos nunquam fueramus ; nulli preterea hominum nostrum propositum de ædificanda domo revelaveramus. Cùm ergo esset dies penitentiæ,
videlicet feria sexta, nostram ibidem corporalem recepimus refectionem.
Casuque fortuito illuc venit ad nos quidam latomus magister, qui tunc serviebat
Comiti Sabaudiæ et à nobis interrogatus quo tenderet, respondit
in hæc verba : Domina mea, ego ad vestram accessi præsentiam,
propter hoc, quod venit mihi in mentem vestræ esse voluntatis unam fundare
domum ordinis Cartusiensis.
Quo audito, quamvis paucas pro tunc haberemus pecunias, nihilominus pactum cum eo fecimus, assignando pro ædificiis ipsius nostræ doinus pecuniarum quantitatem certam. Et licet liberis multisque aliis essemus oneratæ ; tamen reditu et proventu, Deo miserante, abundavimus. Super his igitur gratias Deo agimus quantas valemus, quia dedit nobis velle tale opus aggredi et operari. Ipse enim omnia fecit et perfecit usque in finem et omnium ipse est principium et finis, qui nos ad finem bonum perducat. Amen. » |
|
En outre, Antoine Vachez nous donne les trois références suivantes qui à priori doivent également nous rapporter ladite lettre : Bullioud, Lugdunum sacro-profanum, f°112 D. Le Vasseur, Ephémérides ordinis Cartusiensis, II, p.289. |
2 – La version (L) de l’abbé Benoît Chambeyron – vers 1850. L’abbé
Benoît Chambeyron, à ne pas confondre avec J. B. Chambeyron,
auteur des « Recherches historiques sur la ville de Rive-de-Gier »,
ouvrage publié en 1845, avec lequel il ne partage que le patronyme,
était natif de Longes à quelques kilomètres à
peine du village de Sainte-Croix-en-Jarez. Cette proximité le porta
certainement à s’intéresser de près à l’histoire
de la chartreuse. Il participa vers les années 1850 à la
rédaction de l’ouvrage de Théodore Ogier, « La France
par cantons - Le Pilat - cantons de Saint Chamond et de Rive de Gier , Paveysin
», en étant l’auteur de la notice sur Pavezin et Sainte-Croix-en-Jarez
(Sainte-Croix-en-Pavezin à l’époque) (23).
Dans
sa notice, Chambeyron ne cite que très peu de sources et mentionne
tout au plus : Nicolas Molin, pour l’incendie de la chartreuse, manuscrit
dont nous ignorons la provenance ; Christophe Justel, pour la charte de
fondation, ouvrage imprimé en 1645 et Claude Le Laboureur également
pour la charte de fondation, ouvrage imprimé en 1681. Quant à
la lettre de Béatrice il nous précise simplement qu’il l’a
tire d’un manuscrit (I ou I’) lorsqu’il déclare « Le manuscrit
que j’ai sous les yeux … » sans donner toutefois plus de précision
sur l’auteur de ce fameux manuscrit. A croire sans doute que celui-ci était
anonyme. Nous verrons plus bas qu’il nous sera néanmoins possible
d’attribuer la paternité de ce manuscrit à Dom Charles Le
Couteulx (I).
Nous
donnons ci-dessous le texte de la lettre dont Chambeyron fut le premier
et unique traducteur. Il n’existe encore aujourd’hui, à notre connaissance,
aucune autre traduction que celle donnée par l’abbé. Sans
doute faut-il se fier à Jean Combe qui l’a qualifiait d’excellente,
pour ne pas avoir à la vérifier(24) …

Sainte-Croix au début XXè siècle |
« A religieux et dévôt
personnage, notre frère en Notre- Seigneur Jésus-Christ, Jean
prieur de Val-Vert près de Paris, monastère de l'Ordre Chartreux.
Béatrix de la Tour, épouse de feu noble chevalier Guillaume
de Roussillon, seigneur d’Annonay, servante de Jésus-Christ et de
la glorieuse Vierge : salut.
|
A
priori, la simple traduction de la lettre que nous livre Chambeyron (L) ne
permet pas à elle seule de connaître l’auteur du manuscrit sur
lequel il s’appuie. Il aurait fallu pour cela qu’il nous donne le texte en
latin de manière à pouvoir le comparer avec ceux des chroniqueurs
anciens. En fait, ce n’est pas à partir de la lettre en soit que
nous allons établir la source de l’abbé, mais à partir
de l’organisation générale de sa notice consacrée à
Sainte-Croix. Le texte qui occupe les pages 114 à 128 de l’ouvrage
de Théodore Ogier, soit quinze pages, peut être scindé
en six parties comme suit :
Chambeyron
débute en effet sa narration par la lettre que nous avons donnée
ci-dessus (1) ; il poursuit en donnant la version latine de la charte de
fondation passée à Taluyers en 1281 (2). Il s’attarde
ensuite en un court paragraphe à rappeler que Béatrice avait
reçu de vives actions de grâce de la part de l’Ordre Chartreux
(3). A nouveau en un court paragraphe, il rappelle les bienfaits que la
famille de Béatrice avait déjà eu l’occasion de porter
à l’Ordre Chartreux (4). Il continue sa notice par la liste des bienfaiteurs
de la chartreuse : huit petits paragraphes qui se succèdent pour
chacun des bienfaiteurs : Amédée de Roussillon, Béatrice
d’Anjou, Jeanne de Montluel, Jean de Montluel, Jean Delorme, Isabeau d’Harcourt,
Antoine d’Ars et pour finir Marguerite de l’Estang (5).
L’abbé termine enfin sur cinq pages consacrées à quelques éléments descriptifs ou évènements historiques touchant la chartreuse au cours des XVIIè et XVIIIè siècles (6) ; soit tout de même un tiers de sa notice. Somme
toute, si l’on compare l’organisation de cette notice (L) aux textes des
chroniqueurs anciens, on s’aperçoit immédiatement que celle-ci
est très proche du texte que donne le chartreux Dom Le Couteulx (I)
et dont on parlera plus bas. On y retrouve en effet et dans le même
ordre, quatre des six parties figurant chez Chambeyron : (1), (2), (3),
et (5). La partie (5) est à elle seule très révélatrice
de cette identité puisque la liste des bienfaiteurs de la chartreuse
y est rigoureusement identique.
|
3 – La version (K) de Jean Antoine de La Tour Varan en 1856. Historien
et bibliothécaire de la ville de Saint-Etienne dans la Loire, Jean
Antoine de la Tour Varan est né en 1798 à Les Trois-Ponts
et décèdera en 1864. (25) Nous avons de lui des ouvrages
forts recherchés sur l’histoire locale puisqu’il s’inscrit comme
l’un des tous premiers historiens de la région de l’époque
moderne. Quelques manuscrits inédits de la Tour Varan sont également
conservés aujourd’hui à la bibliothèque de Saint-Etienne
et parmi eux une petite notice sur Châteauneuf nous montre tout l’intérêt
que portait notamment cet auteur à l’histoire de la vallée
du Gier.
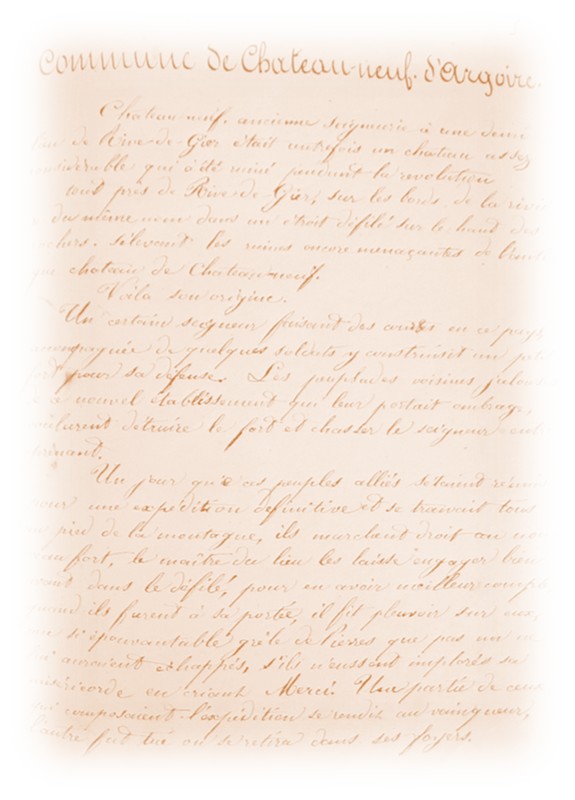
Extrait d’un manuscrit
de Jean-Antoine de la Tour Varan
conservé à la bibliothèque municipale de Saint-Etienne |
En
ce qui concerne notre travail, c’est dans le tome 2 de son ouvrage de référence
« Chronique des châteaux et des abbayes - Etudes historiques
sur le Forez », paru en 1856(26) que nous trouvons l’inscription du
songe de Béatrice (K) figurant sur un tableau de la Grande-Chartreuse
(C). Cette inscription a été également rapportée
par Antoine Vachez dans son ouvrage sur Sainte-Croix (M). Voici donc ce
que nous dit Jean Antoine de la Tour Varan en parlant de la fondation de
la chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez :
« Cette donation a été faite dans une circonstance trop intéressante et le motif qui y donna lieu est si extraordinaire, que la pieuse légende qui la relate mérite d’être connue ; nous la rapportons avec plaisir, persuadé que ce plaisir sera partagé : Anno Domini MCCLXXX. »
Ce
qui se traduit par : « L'illustre et pieuse Dame Béatrix de
la Tour, veuve de noble Guillaume de Roussillon Seigneur d'Annonay, vit
dans une vision merveilleuse, de nuit puis de jour, une croix lumineuse
entourée d'étoiles scintillantes, désignant le lieu
qu'elle jugea voulu par Dieu pour qu'elle y édifie une chartreuse.
La vision se confirma par deux autres miracles, de fait dans ce lieu ostensiblement
défini où la Dame précitée n'était jamais
venue, jusqu'à ce déjeuner. Le propriétaire de ce
lieu s'approcha pour tenir conseil avec elle, désirant lui vendre
sa possession, et un maître maçon de Savoie vint encore exprès
auprès d'elle pour [obtenir la] faveur de l'édification.
Ni l'un ni l'autre n'avait été mandaté, mais les deux
étaient mus par des pressentiments secrets. Ainsi il en fut résolument
fait selon la volonté de Dieu, les possessions achetées, le
contrat signé avec le maçon, et débuta la construction
de la chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez, dans le lieu où maintenant
elle est située. Année de Dieu 1280. » (27)
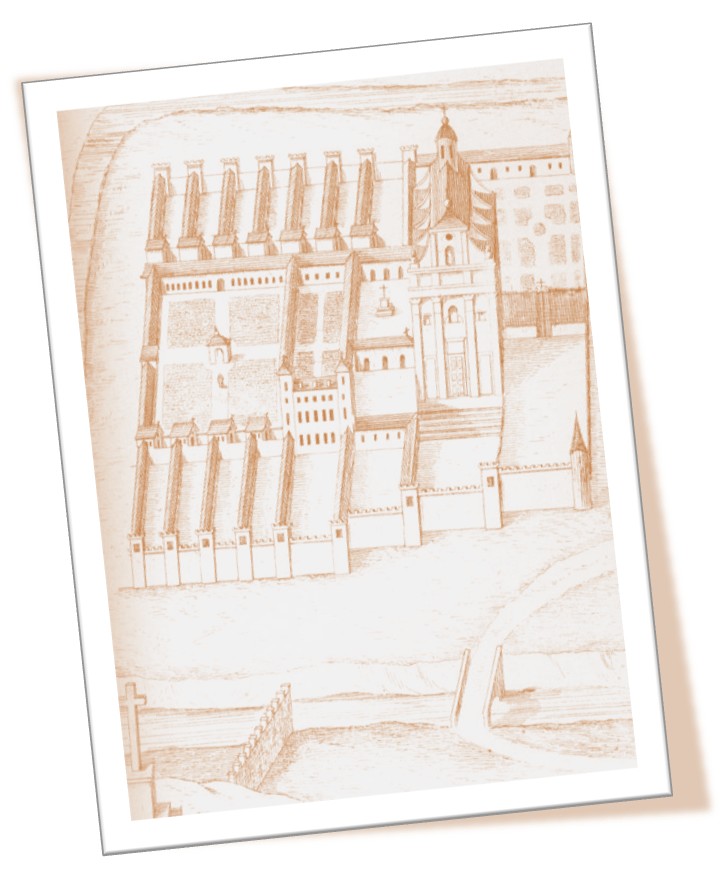
Plan en vue cavalière Conservé à la Grande Chartreuse |
Il
n’est pas précisé non plus quelle source manuscrite ou imprimée
a servi à l’élaboration du résumé du
songe mais il y a fort à parier que l’inscription figurant sur le
tableau avait été tirée d’une chronique du milieu
du XVIIè siècle, chronique que l’on pourrait attribuer à
Dom Nicolas Molin en considérant sa date de rédaction. Compte
tenu de ce manque cruel de renseignements, nous ne nous attarderons pas
plus sur cette inscription qui n’apporte pas plus d’éléments
de compréhension à notre étude.
|
4 – La version (J) de Dom Léon Le Vasseur vers 1690 Dom
Léon Levasseur(29) (ou Le Vasseur) est l’un des anciens chroniqueurs
chartreux qui nous rapporte l’une des versions de la lettre de Béatrice
dans ses « Éphémérides de l’Ordre des Chartreux
», imprimées entre 1890 et 1893. Il était né
à Paris en 1623 et fit profession à la chartreuse de Gaillon
le 23 mars 1643. Successivement vicaire de la maison en 1653 puis prieur
de La Rose près de Rouen en 1669, de Saint-Julien de Rouen en 1679,
et conjointement covisiteur de la province de France.
|
5 – La version (I) de Dom Charles Le Couteulx vers 1687 Dom
Charles Le Couteulx(31) était natif de Rouen. Chartreux, il fit
profession à Gaillon dans l’Eure tout comme son contemporain Dom
Léon Le Vasseur. Comme lui encore, il fut appelé à
la Grande Chartreuse en 1681 pour travailler aux Annales de l’ordre.
|
6 – Le résumé (H) de Dom Jean-Baptiste Maillet en 1678 « Le nom de Jean de Louvoyes,
inconnu de nos anciens chroniqueurs, nous a été révélé
par les Annales de la Chartreuse de Paris, dues à un religieux de
cette maison, dom Maillet, qui les a écrites au commencement du XVIIIème
siècle. Ce travail, encore inédit, a été conservé
pour la plus grande partie jusqu’à nos jours, dans les Archives
de la Grande-Chartreuse; mais le premier volume se trouve encore à
la bibliothèque cantonale de Fribourg (Suisse). » (35)
|
Dans
sa notice consacrée à Dom Jean de Louvoyes, Dom Maillet ne
nous rapporte pas dans son intégralité la lettre que Béatrice
aurait écrite au prieur de Paris. Il en fait néanmoins un
court résumé que nous donnons en extrait ci-dessous :
« … Une autre preuve de la capacité de Dom Jean, est une lettre que l’on voit encore, d’une Damoiselle de condition, qui voulant fonder la Chartreuse de Ste Croix de Jarest en Vivarez, luy decouvert toutes les inspirations que elle avoit eü de Dieu, pour le bon oeuvre. En cette lettre elle l’appelle Religieuse et dévôte personne, et signe Beatrix de la Tour, veuve de feu Guillaume de Rossilion, escuyer, sieur d’Annoniac. Il falloit que Dom Jean fut véritablement homme religieux, puisque cette femme luy escrit de son pays pour luy decouvrir son cœur … » 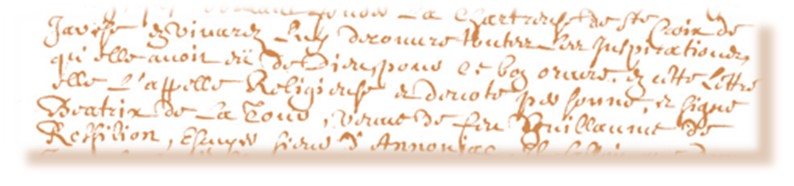
Extrait du manuscrit de Dom Jean-Baptiste Maillet, conservé à la bibliothèque cantonale de Fribourg |
|
Que
nous apprennent ces quelques lignes pour notre étude ? La première
chose et qui n’est pas des moindres, c’est que pour rédiger ce résumé
(H), Dom Maillet utilise la lettre même de Béatrice (A) en précisant
que celle-ci est encore visible à son époque. Enfin un chroniqueur
qui nous apprend que la fameuse lettre existe ! Nous verrons par la suite
qu’un autre auteur l’aura également vue. Toutefois, l’allusion que
fait Dom Jean-Baptiste Maillet à cette lettre demeure trop évasive
pour que l’on sache avec certitude s’il s’agit bien de l’original de la
lettre (A), c'est-à-dire celle écrite de la main même
de Béatrice ou s’il s’agit d’une copie figurant sur un manuscrit.
D’autre part, Dom Maillet ne précise pas non plus où la lettre
est encore visible … Nous reviendrons plus bas sur ces deux points et poursuivons
l’analyse de l’extrait que nous donne notre chroniqueur parisien.
Pouvons-nous
conclure dès cette première partie de notre travail que la
lettre de Béatrice a bel et bien existé ? Il est sans doute
encore trop tôt pour le dire… Il nous faudra encore dans le second volet
de cette étude examiner les écrits de Dom Nicolas Molin (G),
ceux de Pierre Bullioud (F), ceux de Dom Polycarpe de la Rivière (E)
et enfin ceux de Jacques Gaultier (D) pour espérer atteindre cet objectif.
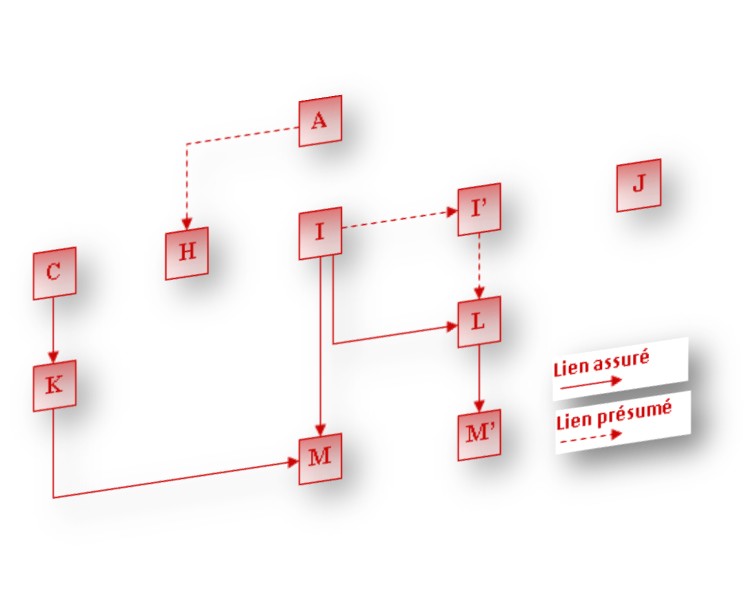
A :
Lettre présumée originale de Béatrice de la Tour-du-Pin
au prieur de la chartreuse de Paris ; C : Inscription donnée au bas
du tableau de la Grande Chartreuse ; H : Version de la lettre donnée
par Dom Jean-Baptiste Maillet ; I : version de la lettre donnée par
Dom Charles Le Couteulx ; I' : version hypothétique de la lettre donnée
par un anonyme à partir de I ; J : version de la lettre donnée
par Dom Léon Le Vasseur ; K : Rapport donné par Jean-Antoine
de La Tour Varan à partir de C ; L : version de la lettre donnée
par l’abbé Benoît Chambeyron ; M : version de la lettre donnée
par Antoine Vachez en 1904 ; M' : version de la lettre donnée par
Antoine Vachez en 1865.
|
Eric
CHARPENTIER
|
NOTES : 1 Eric Charpentier, Béatrice de la Tour
du Pin et la fondation merveilleuse de la chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez.
Article mis en ligne sur le présent site internet « Regards
du Pilat » <http://regardsdupilat.free.fr> en novembre 2007.
2 Dom Charles Le Couteulx, Annales ordinis Cartusiensis,
ab anno 1084 ad annum 1429, Monstrolii : typis Cartusiae S. Mariae
de Pratis, 1887-1891, Tome 4, pages 343 et suivantes.
3 Claude Le Laboureur, Les Mazures de l'abbaye Royale
de l'Isle-Barbe, Paris, Chez Jan Couterot, 1681, Tome 2, pages 533-535.
4 Christophe Justel, Histoire généalogique
de la maison d’Auvergne – Paris, Mathurin Dupuis – 1645 – Page 333.
5 Antoine Vachez, La Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez, Lyon, Louis Brun, 1904 6 Dom Polycarpe de la Rivière, Le Mistère
sacré de Nostre Rédemption, 1621-1623, Lyon, chez Antoine Pillehotte,
Volume 1 – 10è considération, pages 350-351
7 Tout au long de notre étude, nous appliquerons
les repères A, B, C, D, E, F, G, H, I, I’, J, K, L et M à chacune
des versions ou inscriptions ayant attrait au songe de Béatrice de
la Tour-du-Pin. Ce repérage permettra de hiérarchiser chacune
des sources qui nous renseignent sur ledit songe et d’en dresser l’organigramme
à la fin de ce travail.
8 A. Vachez, op. cit.
9 Benoît Chambeyron, in Théodore Ogier,
La France par cantons - Le Pilat - cantons de Saint Chamond et de Rive de
Gier, Paveysin, vers 1856, pp. 114-128
10 Dom Charles Le Couteulx, op. cit., Tome 4, pages
343 et suivantes.
11 Dom Léon Le Vasseur, Ephemerides ordinis
cartusiensis, Monstrolii : Cartusiae S. Mariae de Pralis, 1890-1893, page
289 et suivantes
12 Dom Jean-Baptiste Maillet, Les tombeaux de la Chartreuse de Paris. T. I., 1678 ; T. II., 1702, ms. Paris conservé à la Bibliothèque Cantonale et Universitaire de Fribourg (Suisse), Tome 1- Cote : L 31, I ; Tome 2 -Cote : L 31, II 13 Nicolas Molin, D. Nicolai Molin Historia cartusiana : ab origine Ordinis usque ad tempus auctoris anno 1638 defuncti , Tournai : Cartusiae Sanctae Mariae de Pratis, 1903-1906. 14 Pierre Bullioud, Lugdunum Sacro Prophanum, vers
1647, ms1. Conservé à la bibliothèque municipale de
Lyon, fonds ancien ; ms2. Conservé à la bibliothèque
interuniversitaire de Montpellier
15 Dom Polycarpe de la Rivière, op. cit.
16 Jacques Gaultier, Table chronographique de l'estat
du christianisme... iusque à l'année MDCXXV, 4è édition,
1626, Lyon, chez Pierre Rigaud & associez, col. 717.
17 Jean-Antoine de la Tour Varan, Chronique des châteaux
et des abbayes, II, Saint-Etienne, 1856, p. 336-339
18 André Douzet prétend avoir retrouvé dans un fonds des archives publiques en France, la fameuse lettre avec le seing de Béatrice de la Tour-du-Pin. Il ne l’a malheureusement jamais montré au grand public. 19 Patrick Berlier, Avec les pélerins de Compostelle,
2002, Saint-Etienne, Actes Graphiques, p. 44. A l’appui de nos propres assertions,
notre ami Patrick Berlier est aujourd’hui revenu sur ses premières
affirmations en déclarant que celles-ci lui avaient été
communiquées par M.François Jeanty, membre fondateur et ancien
président de l’association de Sauvegarde de la Chartreuse.
Toutefois, ce dernier, sans doute plus prudent, ne fait aucune allusion aux actes de faussaire attribués à Dom Charles Le Couteulx dans son ouvrage, Sainte Croix en Jarez, la chartreuse du Pilat, histoire et anécdotes, 1276-1899, 2006. Tout récemment, Christian Rollat relance la théorie du « faux » dans son ouvrage, L’affaire Roussillon, Tome II, Le contrat de la Fauconnerie du Temple, septembre 2008, p. 3. Mais ses affirmations, faute d’une argumentation solide, ont du mal à nous convaincre. 20 Eric Charpentier, Antoine Vachez, un historien
hors pair. Article mis en ligne sur le présent site internet «
Regards du Pilat » (http://regardsdupilat.free.fr) en juillet 2007.
25 Annie Monginoux et Michel Achard, in Grande encyclopédie
du Forez et des communes de la Loire, la vallée du Gier, le Pilat,
1984, Le Coteau, Horvath, p. 359-360
26 Jean-Antoine de la Tour Varan, op. cit.
27 Nous devons cette traduction à notre ami Patrick Berlier 28 Unité de Recherche Archéologique Cartusienne (URAC), La montagne, l’ermite et le montagnard, Montmorot, imprimerie Billot, avril 2005, p.57 29 Dom Léon Le Vasseur, op. cit. 30 Eléments biographiques tirés de Albert Gruys, Cartusiana - Un instrument heuristique, Paris, IRHT CNRS, 1976-1978 – Bibliographie générale, auteurs cartusiens, p. 124 31 Dom Charles Le Couteulx, op. cit., Tome 4, pages 343 et suivantes. 32 Cf. infra, note 19 34 Bulletin de l’académie delphinale, 4e série, tome 3e, 1889, page 31 35 Antoine Vachez, op. cit., p. 41 36 Dom Jean-Baptiste Maillet, op. cit. 37 L’analyse du manuscrit de Dom Maillet apporte de précieux compléments quant au personnage de Dom Jean de Louvoyes qui ne revêt pas forcément l’image que nous en avait donné Antoine Vachez. Un article sera consacré à ce personnage dans une publication qui devrait paraître au printemps prochain. 38 Eléments biographiques tirés des tomes I et II du manuscrit de Dom Maillet et continuateurs. |
Voici à présent notre nouvel
invité, Rémy ROBERT, qui est avant tout un enfant du Pays.
Stéphanois de souche et empreint de cette culture industrielle qui
a permis l’essor de la capitale du Forez, il a grandi à la frontière
entre un monde rural et un mode industriel. C’est sur les chemins antiques
traversant le Pilat qu’il a fait ses premiers pas. Aujourd’hui, Conseiller
en Economie Social à Paris, sa vie est partagée par une forte
implication sociale auprès des plus démunis et une passion
pour notre histoire locale le conduisant à des recherches personnelles
dépassant souvent les frontières. Riche de rencontres les plus
variées et inattendues, spécialiste de l’interculturalité,
Rémy a acquis une large connaissance tant historique, politique,
culturelle ou religieuse. Entre Egyptologie et sociologie, entre histoire
et Histoire, il conçoit l’Homme dans sa globalité, l’histoire
comme la culture dans un même maillage. C’est un personnage discret
ou intarissable mais toujours sincère qui aime nous apporter son «
regard sur le Pilat ».
|
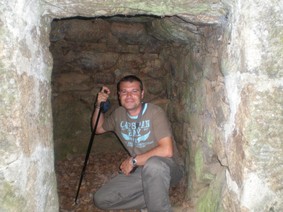
|


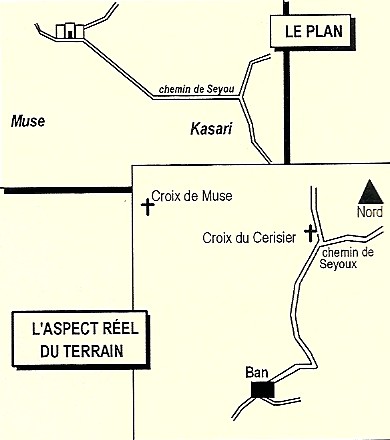


En Mars 2009
un Dossier Exceptionnel

|