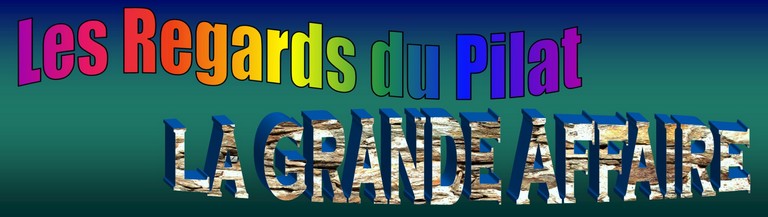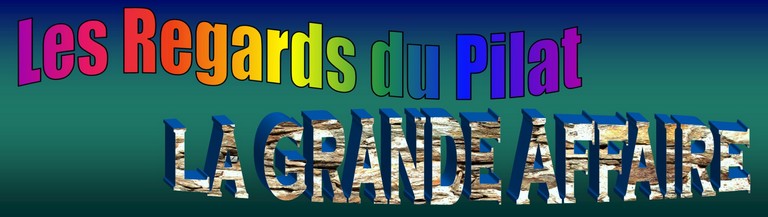
AOÛT 2008
|
Aux origines Antiques du Catharisme |
Doumergue |
 |
Un intervenant privilégié
dans La Grande Affaire |
 |
 |
|
Le
Catharisme, qui, au moyen-âge, a déclenché une des plus violentes répressions
religieuses qui n’ait jamais été (1), n’a rien été d’autre qu’une résurgence, une
résurrection, d’un christianisme attesté dès les premiers siècles. D’un point
de vue dogmatique, il est en effet le calque parfait des mouvements gnostiques
de l’Antiquité. Tout comme ceux-là, il est dualiste. Il pose le monde matériel
comme mauvais et émanant d’une entité dégénérée, le Dieu de l’Ancien Testament qui est encore celui de
l’Eglise de Rome, communément appelé Démiurge dans les écrits gnostiques. A ce
dernier, le Catharisme oppose un Dieu véritable, inconnu des hommes jusqu’à
Jésus. Pour les Cathares, comme pour les gnostiques avant eux, l’âme,
prisonnière du corps, est une part de ce Dieu. Mais le Démiurge et ses
archanges lui ont fait oublier cette nature divine, la condamnant à se
réincarner sans cesse sur Terre. Ainsi, dans un mouvement comme dans l’autre, seule
Les deux mouvements, distants de plusieurs siècles dans le temps, ne sont pas unis seulement par cette ressemblance dogmatique. La structure même des deux « églises » ou certaines de leurs caractéristiques (comme l’égalité entre hommes et femmes) les rapprochent avec plus de force encore. Ainsi, le Catharisme, loin d’être apparu ex nihilo au Moyen-Age, est l’héritier d’une forme de christianisme aussi vieille que le christianisme lui-même, mais, dès les premiers siècles, vivement combattue par l’Eglise de Rome. Cette dernière, tout au long de son histoire, n’a jamais cessé d’imposer, le plus souvent par la force, son christianisme. Cette filiation pose, naturellement, la question des sources du Catharisme. Cette question cherche à déterminer de quelle manière le Catharisme a pu être un calque aussi parfait d’un mouvement qui avait été, du moins sur la « place publique », exterminé aux alentours du IVe siècle par l’Eglise. Se pose ici, pour l’historien, le « problème de la filiation ». La tendance la plus courante est d’expliquer le Catharisme par la prédication bogomile (2), un mouvement dualiste émergeant dans les Balkans vers la fin du IXe siècle avant de connaître une large diffusion évangélisatrice en Italie et en France. Les
connexions entre les deux mouvements existent. Proches, ils connaissent de
nombreux échanges. Les registres inquisitoriaux de Carcassonne conservent ainsi
la trace de l’apport aux Cathares du « secret des hérétiques de Concorezzo »
par l’évêque Nazaire. Concorezzo était une importante communauté bogomile de
Lombardie. De même, le concile « hérétique » de Saint Félix de Caraman,
en Languedoc, (1167) est présidé par un diacre bogomile, Niquinta. Mais si ces
connexions permettent d’établir l’existence d’échanges entre les deux
mouvements, il est tout aussi certain, comme l’a notamment souligné Fernand
Niel (1903-1985), que les missionnaires bogomiles ont trouvé, au moins en
France, un « terrain tout préparé. » (3) |
 |
 |
Ainsi, les connexions entre Cathares et Bogomiles
doivent en réalité être pensées non en terme d’Histoire religieuse mais d’Histoire
géopolitique et militaire (4).
L’implantation
d’un christianisme hérétique en France, et plus particulièrement dans le Sud de
Il ne fait guère de doute que ces groupes, qui, grâce à un contexte favorable (5), ont pu sortir de leur clandestinité, ont été le maillon reliant le Catharisme au gnosticisme antique. Ils expliquent que les Cathares ont eu, entre leurs mains, des évangiles remontant à la plus haute Antiquité. Le fait est attesté par quelques citations de textes données par les Inquisiteurs. Accusant les Cathares de fabriquer des faux, ceux-là en viennent à donner quelques extraits de ces prétendus faux pour mettre en relief leur non-conformité aux évangiles canoniques. Or, les citations données ont pu être identifiées à des extraits d’apocryphes remontant aux premiers siècles chrétiens, comme l’Evangile de Thomas (6). Cette source
Antique est généralement négligée par les « historiens officiels »,
pour une raison semble-t-il idéologique. Cette éviction permet notamment
d’éluder la question du « trésor » des Cathares, qu’il est moins
« problématique » pour l’ « ordre établi » d’identifier
à un trésor monétaire qu’à des écrits sacrés remontant au premier
christianisme. Elle évite aussi de remettre en question les schémas établis
concernant la christianisation de Or, c’est ce à quoi aboutit l’étude du Catharisme dès lors que l’on relie celui-ci aux premiers siècles chrétiens. La
destruction massive des textes qui ont été en possession des Cathares (et
notamment de l’ensemble des évangiles apocryphes circulant dans les communautés
hérétiques) empêche d’avoir une connaissance exacte de la teneur de ceux-ci.
Pourtant, il semble incontestable que certains de ces textes aient accordé une
place particulière à Marie-Madeleine. Cela est décelable dans les écrits de
leurs opposants. Un de ceux-là, Pierre des Vaux de Cernay (c. 1215 – mort après
1248), dans son Histoire Albigeoise,
affirme que les Cathares blasphémaient contre Marie-Madeleine. On reconnaît
dans l’accusation qu’il leur porte de faire de la sainte la
« concubine » du Christ, un écho à l’Evangile de Philippe (IVe siècle), où Marie-Madeleine est présentée
comme la « compagne », au sens spirituel, de Jésus. L’allusion de
Pierre des Vaux de Cernay témoigne donc de l’importance que Marie-Madeleine a
pu avoir pour les Cathares. Plus troublant, l’invention des reliques de la
sainte à Saint-Maximin, en Provence, peut être considérée comme un épisode à
part entière de
Ces différents éléments permettent de conjecturer que les Cathares ont
eu accès à des textes relatifs à Marie-Madeleine remontant probablement à la
plus haute antiquité – et, osons le dire, à la venue de Marie-Madeleine en
Gaule. Contestée par les historiens, cette venue peut pourtant être considérée
comme un événement historiquement advenu (7). Or, les traditions médiévales qui s’y
référent évoquent bien la possession, par Marie-Madeleine et les siens,
d’écrits (soit ramenés d’Orient, soit rédigés en Gaule), dont la description
sommaire, ne correspond à aucun texte canonique. Par définition, cela fait de
ces textes des écrits apocryphes. Leur contenu n’est pas donné par les auteurs
du Moyen-Age, qui, au fil du temps, se sont efforcés d’en minimiser le
caractère non canonique. Par contre, leur milieu rédactionnel, celui des
premiers chrétiens gaulois rassemblés autour de Marie-Madeleine, pousse à les
rattacher à la mouvance gnostique. Les traditions médiévales ont en effet gardé
traces d’indices rattachant le groupe rassemblé autour de Marie-Madeleine à un
christianisme gnostique (8).
|
 |
 |
|
Une partie du
corpus de textes hérétiques constitué autour de ces premiers groupuscules
chrétiens a pu parvenir jusqu’aux Cathares et faire de certains de ceux-là les
détenteurs d’éléments liés de près au périple gaulois de Marie-Madeleine. Ceci
expliquerait la connexion évoquée entre l’invention des reliques de Marie-Madeleine
à Saint Maximin et La négation, ou la tendance à minimiser cet aspect de l’origine des évangiles cathares, de la part des historiens, n’est probablement pas neutre. S’inscrivant dans la continuité du discours de l’Eglise de Rome, elle procède, aussi, du mouvement de « démystification » mené par nombre d’historiens contre les égarements de l’ « histoire rêvée » du Catharisme. Officiellement destinée à palier les contre-vérités, cette « démystification » est, aussi, une formidable machine idéologique, destinée à contenir le Catharisme et son étude dans un cadre bien précis et à lui enlever une grande part de son pouvoir « contestataire » à l’égard de l’histoire officielle, et donc du pouvoir établi.
Forte des grilles de lecture de la sociologie, l’Histoire officielle se
propose ainsi d’expliquer l’idée d’un secret en possession des Cathares par la
seule propension au merveilleux inhérente à tout homme, et encouragée par le
contexte socioculturel qui caractérise l’aube du XXIe siècle. Elle est ici,
comme ailleurs, le vecteur de l’idéologie dominante, le matérialisme. Mais le
matérialisme ne pourra longtemps contenir la force de l’Esprit. Celle qui s’est
exprimée au moyen-âge à travers le Catharisme avant d’être étouffée. Et qui
attend aujourd’hui son Réveil. Qui a commencé à se réveiller… (9)
|
Un nouveau Merci à Christian Doumergue
|
|
(2) Les
bogomiles tireraient leur nom d’un certain Bogomil (« Ami de Dieu »
en slave), dont l’existence n’est pas certaine.
(3) NIEL
Fernand, Albigeois et Cathares, coll.
Que sais-je ?, Presses Universitaires de France, Paris, 1967, p.44.
(5) Celui de
l’« esprit de tolérance inconnu partout ailleurs »
(l’expression est de Fernand Niel) qui caractérisait alors le pays Occitan et
que devait briser l’invasion française.
(6) C’est en
1957 que Charles Puech (1902-1986), le grand spécialiste français des études
gnostiques et manichéennes, a identifié l’usage de certains passages de l’Evangile
de Thomas chez des cathares méridionaux du début du XIVe siècle.
(PUECH Henri-Charles, En quête de la Gnose t. II : sur l’Evangile selon
Thomas, coll. Bibliothèque des Sciences Humaines, NRF-Gallimard, Paris,
1978, p. 51.) L’idée que les Cathares aient eu en leur possession des textes
remontant à l’Antiquité a été émise pour la première fois en 1913 par F. P.
Badham et Frederick Cornwallis Conybeare (1856-1924), professeur de Théologie à
l’Université d’Oxford, à propos des Cathares d’Albi.(7)Voir mes
ouvrages sur le sujet pour la démonstration.
|
 |
 |