 |
 |
RUBRIQUE
Rennes les Bains Septembre 2020
|
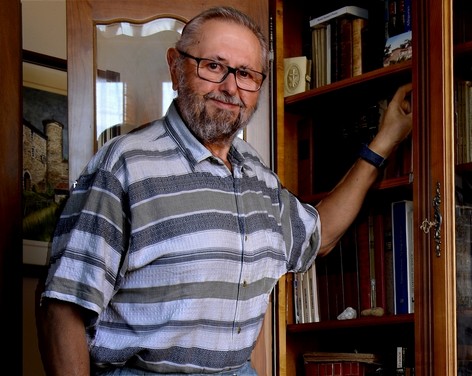 |
Par
Patrick Berlier
|
L'ABBÉ
HENRI BOUDET ET
LA VRAIE LANGUE CELTIQUE À une
quarantaine
de kilomètres au sud de Carcassonne, Rennes-les-Bains (Aude) est
une petite
station thermale située au creux de la verdoyante vallée
de la Sals. Ses
sources étaient déjà appréciées des
Romains, qui y installèrent des thermes
dont les vestiges sont encore visibles. La station connut son heure de
gloire à
la Belle Époque. Le thermalisme était alors à la
mode, et pour la bourgeoisie
de Narbonne ou Carcassonne, il était de bon ton d'aller chaque
année passer
quelques jours « aux eaux », sous le
prétexte de soigner ses
rhumatismes, mais surtout pour se montrer et nouer de nouvelles
relations. Les
cartes postales du début du XXe siècle
montrent les curistes dans
les salons de l'établissement thermal, ou à la terrasse
du Grand Hôtel. Les
dames s'y montraient dans leurs plus belles toilettes, les messieurs
dans leurs
costumes les mieux taillés, et même les enfants
étaient endimanchés. La station
redevint ensuite beaucoup plus modeste, la première guerre
mondiale ayant sonné
le glas du thermalisme chic.
Curistes
attablés à la terrasse du Grand Hôtel (carte
postale ancienne) À
cette époque-là,
entre 1872 à 1914, le curé de la paroisse était un
certain Henri Boudet.
C'était un homme simple et affable, aimé de tous.
Pourtant, érudit et
polyglotte, l'abbé Boudet fut membre de plusieurs
sociétés savantes. Il a écrit
et publié plusieurs livres de linguistique ou de philologie,
dont le plus connu
avait pour titre La vraie langue celtique et le cromleck de
Rennes-les-Bains.
Néanmoins il serait depuis longtemps tombé dans l'oubli,
et son œuvre avec lui,
si le village de Rennes-les-Bains n'était le voisin d'un autre
beaucoup plus
connu, Rennes-le-Château, dont à la même
époque le curé était le fameux abbé
Bérenger Saunière. Les deux prêtres se sont
forcément fréquentés, ils ont tissé
des liens d'amitié, partagé peut-être certains
secrets. Alors l'étrange livre
de l'abbé Boudet prend du coup une autre coloration.
Peut-être même
contient-il, sous une forme codée, le secret de
Rennes-le-Château, qu'il
conviendrait dès lors de requalifier en secret des deux Rennes,
tant la Rennes
d'en bas, celle des bains, possède elle aussi son lot de
mystères, tout comme
la Rennes d'en haut, celle du château.
Le
village de Rennes-les-Bains aujourd'hui Henri Boudet
est né
le 16 novembre 1837 à Quillan (Aude), dans une famille
bourgeoise, catholique
et royaliste. Son père Pierre Auguste Boudet était
régisseur de forges. Il
avait épousé Jeanne Huillet, qui lui avait
déjà donné deux enfants. Après Henri
le couple eut ensuite un autre fils, Edmond qui devint notaire à
Axat. Le jeune
Henri Boudet fut très tôt un bon élève. Il
aurait été remarqué par le riche
abbé de Cayron, curé de Saint-Laurent-de-Cabrerisse, qui
aurait financé toutes
ses études. Doué pour les langues, Henri excellait aussi
bien dans les langues
mortes, comme le latin et le grec, que vivantes, comme l'anglais. Il
parlait
aussi couramment la langue du pays, l'occitan ou languedocien. Bon
marcheur, il
aimait parcourir les nombreux sentiers qui, partant de Quillan,
s'élevaient
vers les collines et les plateaux herbeux dominant la haute
vallée de l'Aude.
Henri Boudet s'intéressait aussi à la botanique, et en
particulier aux plantes
médicinales, il consacrait ses promenades à les
étudier et les reconnaître.
C'est peut-être lors de l'une de ses balades entre terre et ciel
qu'il reçut
l'appel de Dieu. Il faut dire qu'il était issu d'une famille
profondément
catholique. Mais l'abbé de Cayron ne fut peut-être pas
étranger à cette vocation.
Henri Boudet entreprit des études au Séminaire de
Carcassonne. En 1861 il
obtint une licence d'anglais. La même année, le 25
décembre, il fut ordonné
prêtre. Le 1er janvier 1862 il prenait son poste de
vicaire dans la
paroisse de Durban-Corbières. Il y resta jusqu'au 16 juin, puis
fut nommé à
Caunes-Minervois, où il resta jusqu'au 30 octobre 1866. Il fut
alors nommé curé
de Festes-Saint-André, poste qu'il occupa pendant six ans,
jusqu'au 16 octobre
1872. C'est alors qu'il fut affecté à la cure de
Rennes-les-Bains, où il allait
passer plus de quarante ans.
Impasse
accédant à l'église de Rennes-les-Bains Outre le
village,
qui étire ses maisons le long de la rue principale, ou sur les
berges de la
Sals, la paroisse compte plusieurs hameaux isolés. L'abbé
Boudet, toujours bon
marcheur, ne craignait pas de tous les visiter à pied. Cela lui
permettait
d'aller cueillir ces plantes médicinales avec lesquelles il
préparait tisanes,
potions ou onguents, car il était aussi connu pour ses
qualités d'herboriste et
de phytothérapeute, mettant ses connaissances au service de ses
semblables afin
de les soulager de tous leurs petits maux. Curieux d'histoire et
d'archéologie,
l'abbé Boudet mettait aussi à profit ses
expéditions dans la campagne pour
explorer les moindres recoins de sa paroisse, à la recherche des
nombreuses
pierres mystérieuses qu'elle possède.
Intérieur
de l'église de Rennes-les-Bains au temps de
l'abbé Boudet (carte
postale ancienne) Ses anciens
paroissiens décrivaient l'abbé Boudet comme un homme de
taille moyenne, plutôt
replet. Il n'existe apparemment aucune photo authentique de lui.
Quelques unes
ont été publiées, sur Internet ou dans des livres,
mais aucune n'est certaine.
La plus connue, qui a illustré pendant longtemps la page
consacrée à l'abbé
Boudet par une célèbre encyclopédie en ligne,
représente un jeune prêtre. On
sait aujourd'hui qu'il s'agissait en réalité d'un
séminariste de la famille de
Marie Dénarnaud, la servante de l'abbé Saunière.
C'est la raison pour laquelle
cette photo se trouvait exposée dans la salle à manger de
la Villa Bethania à
Rennes-le-Château.
Prétendue
photo de l'abbé Henri Boudet Le seul
document
qui ait une chance de représenter l'abbé Boudet est une
photo prise vers 1896,
représentant cinq prêtres de la région
réunis autour d'une table. On y
reconnaît, de gauche à droite : l'abbé
Bérenger Saunière, curé de
Rennes-le-Château, l'abbé Antoine Malot, curé de
Grèzes, l'abbé Alfred
Saunière, frère de Bérenger, professeur au Petit
Séminaire de Narbonne, probablement
l'abbé Henri Boudet, curé de Rennes-les-Bains, et
l'abbé Jean-Antoine Gélis,
curé de Coustaussa. Cette absence de photographie est d'autant
plus curieuse
que l'abbé Boudet était lui-même photographe. On
lui doit en particulier un
portrait de l'abbé Saunière devant les
célèbres Roulers, un groupe de
« pierres branlantes » au sommet d'une colline
dominant
Rennes-les-Bains, aujourd'hui au milieu des bois.
Réunion
de 5 prêtres vers 1896 – l'abbé Boudet est
peut-être parmi eux En 1886 Henri
Boudet publia à compte d'auteur, chez l'imprimeur Pomiès
de Carcassonne, le
livre qui devait le rendre célèbre : La vraie
langue celtique et le
cromleck de Rennes-les-Bains. L'abbé avait demandé
à son frère Edmond, doué
pour le dessin, de l'illustrer de deux gravures et d'une carte. Le
livre fut
tiré à 500 exemplaires, et son auteur en vendit
très peu en réalité, moins
d'une centaine. Il en distribua gratuitement la majeure partie,
à des sociétés
savantes ou à des personnalités. Comme son titre
l'indique, l'ouvrage est composé
de deux parties, la première consacrée à une
étude très personnelle de la
langue celtique, la seconde aux pierres entourant la commune de
Rennes-les-Bains. En réalité ces deux parties sont aussi
fantaisistes l'une que
l'autre. En effet la thèse défendue par l'abbé
Boudet est qu'une langue
celtique oubliée est à l'origine des noms de lieux, de
rivières, de montagnes,
de personnes, et cette langue n'est pas autre chose que l'anglais
moderne ! Quant au prétendu cromlech de Rennes-les-Bains,
il n'existe que dans
l'imagination de l'auteur, toutes les pierres le composant étant
totalement
naturelles. Aussi l'ouvrage fut-il très vite
considéré comme totalement
farfelu.
Les
Rochers de l'Étang, une partie des nombreuses pierres
entourant la vallée de Rennes-les-Bains (carte postale ancienne) C'est
Gérard de
Sède qui le premier attira l'attention du public sur le curieux
livre de l'abbé
Boudet. Il y consacra un long passage dans son best-seller L'or de
Rennes
paru en 1967. La vraie langue celtique n'était alors
disponible qu'en
bibliothèque, ou dans des collections privées. Dans le
courant des années 70,
les bouquinistes en vendaient des « photocopies
numérotées ». Puis
trois rééditions successives furent proposées aux
amateurs durant l'année 1978.
La première était une belle édition, avec une
reliure soignée. Détail curieux
et peu connu, ce livre fut réalisé à
Saint-Étienne par l'imprimerie Dumas. Puis
il y eut le retirage édité par La Demeure Philosophale
et préfacé par
Gérard de Sède. Enfin les éditions Belfond
proposèrent une nouvelle réédition,
préfacée par Pierre Plantard. L'année suivante, un
quatrième retirage sortit
des presses d'une imprimerie suédoise à Stockholm.
Malheureusement, aucune de
ces rééditions ne respectait ni le format, ni la
pagination, du livre originel.
Il faut attendre 1984 pour que les éditions Bélisane
réalisent enfin une
réédition conforme à l'original. Par ailleurs, on
trouve aujourd'hui plusieurs
versions en PDF du livre, qu'il est possible de
télécharger sur Internet,
divers sites le proposant.
Page
de couverture du livre de l'abbé Boudet La vraie
langue
celtique et le cromleck de Rennes-les-Bains comprend 8
chapitres, eux-même subdivisés en sous-chapitres en nombre
variable, suivis
d'une table des matières, ce qui représente en tout 310
pages numérotées. Mais
elles sont précédées par 4 pages d'observations
préliminaires, numérotées en
chiffres romains. Il y a donc 314 pages numérotées, un
nombre dans lequel on a
vu naturellement une référence au chiffre Pi
3,14. Il est vrai que l'abbé
évoque souvent le cercle dans son livre. Si l'on ajoute la page
de titre,
vierge au verso, les deux pages d'avant-propos, non
numérotées, et les deux
gravures réalisées sur des feuilles blanches au verso,
insérées entre les pages
244 et 245, on aboutit à 322 pages en tout. Curieusement deux
chapitres et un
sous-chapitre portent le même titre, Langue celtique,
reprenant ainsi le
thème général du livre.
Clocher-mur
de l'église de Rennes-les-Bains, dans son
écrin de verdure Les deux
pages de
l'Avant-propos méritent déjà que l'on s'y
attarde, puisque le thème
général est présenté dès les
premières lignes : « Le
titre donné à cet ouvrage semble, au premier abord, trop
prétentieux pour être
rigoureusement exact. Il est facile , toutefois, d'en démontrer
la vérité,
puisque la langue celtique n'est point une langue morte, disparue, mais
une
LANGUE VIVANTE, parlée dans l'univers par des millions
d'hommes. » Ces premiers
mots
expriment déjà la thèse défendue par
l'ouvrage : la langue celtique est
toujours parlée par des millions de personnes, et l'on
comprendra par la suite
qu'il s'agit de l'anglais, que l'auteur considère comme la
langue mère de tous
les langages anciens de l'humanité. Une telle proposition suffit
déjà pour
considérer l'abbé Boudet comme un joyeux hurluberlu, et
on comprend qu'elle a
dû décourager d'emblée un certain nombre de ses
lecteurs. L'Avant-propos
se termine par cette conclusion : « La
langue vivante, à laquelle nous faisons allusion, nous a
puissamment aidé à
découvrir le magnifique monument celtique existant à
Rennes-les-Bains, et, de
son côté, l'étude de ce monument nous a conduit
avec sûreté à des déductions
étymologiques qui nous semblent difficiles à
réfuter. » Le
monument celtique auquel l'abbé Boudet fait allusion est bien
entendu le
cromlech – qu'il orthographie cromleck, selon l'usage de
l'époque – qui fera
l'objet de la seconde partie du livre. L'auteur se rangeait aux
connaissances
des historiens de son temps, qui voyaient dans les monuments
mégalithiques
l'œuvre de ceux que l'on pensait être les premiers habitants de
notre pays, les
Gaulois. On sait aujourd'hui que d'autres peuples ont occupé la
Gaule avant
l'arrivée des Celtes, et que les mégalithes leur sont
bien antérieurs. Mais en
réalité, les pierres que l'on trouve sur les coteaux de
la vallée de la Sals
autour de Rennes-les-Bains, aussi intrigantes soient-elles par leurs
formes ou
leurs noms, ont une origine totalement naturelle et ne sont en rien des
mégalithes. Vient ensuite la phrase finale : « C'est
ainsi que le Cromleck de Rennes-les-Bains se trouve intimement
lié à la
résurrection, ou, si l'on veut, au réveil inattendu de la
langue
celtique. » Beaucoup
d'auteurs
ont tiré des conclusions merveilleuses de cette phrase. Le
problème, c'est
qu'ils ne l'ont citée que partiellement, en négligeant
tout ce qui suit le mot
résurrection, et de fait la phrase ainsi amputée prend
une autre signification.
Or la résurrection à laquelle l'abbé Boudet fait
allusion, ce n'est pas celle
du Christ – même si sa statue orne la façade de
l'église de Rennes-les-Bains –
mais celle de la langue celtique, et cette langue-là selon les
conclusions de
l'auteur n'est pas autre chose que l'anglais.
Statue
du Christ ressuscité en façade de l'église de
Rennes-les-Bains Les Observations
préliminaires font remarquer que tous les peuples de
l'Antiquité ont laissé
des écrits, sauf les Celtes. Les Gaulois ne nous ont
légué aucun texte :
« de toutes parts la nuit profonde » dit
l'auteur, qui poursuit
ainsi : « Où
trouver le « flambeau » qui dissipera ces
ténèbres? N'est-ce pas dans le vieux
langage que nos pères nous ont légué ? ''
Les dialectes , dit J. de Maistre, les noms propres d'hommes et de
lieux me
semblent des mines presque intactes et dont il est possible de tirer de
grandes
richesses historiques et philosophiques. '' » L'abbé
Boudet
insère ici une première citation, extraite des Soirées
de Saint-Pétersbourg
de J. de Maistre, auxquelles l'abbé fera de nombreux emprunts.
Sauf que la
citation est légèrement tronquée par rapport au
texte original. Un mot a été
oublié, le mot « patois ». Ce n'est pas un
simple oubli, chacune des
erreurs que l'on peut relever dans le livre est volontaire et doit
avoir son
importance.
Extrait
du livre de J. de Maistre En
vérité, La
vraie langue celtique n'est pas autre chose qu'une immense
mosaïque de
textes copiés ça et là et mis bout à bout,
même s'il est vrai que l'auteur les
place toujours entre guillemets, et cite scrupuleusement ses sources.
Le
problème, c'est que certaines de ces citations ne sont pas
totalement conformes
au texte original, il y a des oublis ou des erreurs. Des bizarreries
aussi : par exemple, alors que des citations de la Bible
commencent page
23, le lecteur doit attendre la page 38 pour apprendre quelle Bible a
utilisé
auteur, et en l'occurrence il s'agit de la Bible de Carrières.
Ce n'est pas la
plus connue, mais le mot « carrières »
peut sûrement se comprendre de
bien des façons. Henri Boudet
conclut ainsi ses Observations préliminaires : « Lorsque
le flambeau que nous cherchions avec anxiété, s'est
montré à nos yeux, son
premier rayon est tombé sur le nom des Tectosages, et ce rayon
nous a ébloui
[...] dans l'intention de nous convaincre nous-même de la
réalité de cette
lumière, propre à éclairer les temps gaulois, nous
avons tenté de la faire réfléchir
par les miroirs des langues hébraïque, punique, basque et
celtique. Le résultat
nous a paru sérieux, et avant de nous servir du langage des
Tectosages pour
expliquer la signification des monuments mégalithiques de
Rennes-les-Bains,
objet premier de nos recherches, nous l'avons appliqué
à l'interprétation
des noms propres pris dans ces langues diverses. » Les
Tectosages, ce
sont les Gaulois qui occupaient cette région du Languedoc. Leur
nom complet est
Volques Tectosages. Après avoir commencé son chapitre
premier en notant,
références à l'appui, les similitudes entre le
sanskrit, le grec, le latin, le
gothique, au point d'imaginer une origine commune à toutes ces
langues,
l'auteur cite le journal australien The advocate : « Partant
des langues de l'Europe, l'orateur a fait voir que des centaines de
mots
semblables à ceux de la langue Maori se trouvent dans les
langues grecque,
latine, lithuanienne, celte, etc, etc. Mais la partie la plus
intéressante de
son étude était celle qui constatait l'identité du
Maori et de l'anglais, en ne
tenant pas compte des mots Anglo-Maori, mots fabriqués des deux
langues, depuis
la conquête du pays par l'Angleterre. » Il faudrait
pouvoir
vérifier la véracité de cette citation quant
à l'identité entre le maori et
l'anglais, mais on peut l'imaginer parfaitement exacte car elle apporte
de
l'eau au moulin de l'abbé Boudet, qui se risque alors à
proposer l'étymologie
du nom Volques Tectosages : « Volkes
(Volcae) dérive des verbes to vault (vâult),
voltiger, faire des sauts
et to cow (kaou), intimider ; Tectosages est produit par les
deux autres
verbes to take to (téke to), se plaire à..., et to
sack, piller,
saccager. En réunissant les quatre verbes constituant les deux
appellations,
nous constatons dans leurs significations diverses, que les Volkes
Tectosages
effrayaient les ennemis par la rapidité de leurs
évolutions dans le combat et
se plaisaient à dévaster et à piller. » Or là
il n'y a
aucun doute, l'auteur fait appel à l'anglais moderne pour
expliquer, d'une
manière totalement fantaisiste, l'origine des noms Volques et
Tectosages. Le
lecteur qui l'a suivi jusque là commence à comprendre que
pour le savant abbé
la langue des Gaulois n'était pas autre chose que l'anglais.
Pourtant il
n'emploie jamais ce terme, se contentant de parler plus subtilement de
« langue anglo-saxonne », une expression qu'il
remplacera bien vite
par « langue celtique ». L'auteur va ensuite
tenter de consolider cet
avis péremptoire en consacrant plusieurs pages à comparer
le dialecte
languedocien avec cette langue anglo-saxonne. Au passage, il commet
à dessein
quelques erreurs, en modifiant légèrement le sens des
mots anglais pour mieux
les faire cadrer avec sa démonstration. Ainsi par exemple, page
21 : scout
ne signifie pas « espion » mais plutôt
« éclaireur ». Il y
a aussi des anomalies qui peuvent passer pour des erreurs d'imprimerie. Dans la même page 21 l'abbé
écrit sot cour
au lieu de to scour, pourtant clairement signalé
par la
transcription phonétique skaour entre
parenthèses.
L'étrange
sot cour de la page 21 Il est vrai
qu'entre les 78 mots – soigneusement choisis – du languedocien
(l'occitan), et
leur équivalent en anglais, il y a une certaine similitude, mais
en réalité
l'immense majorité des mots occitans ne ressemble en rien
à des mots anglais.
Cela, l'auteur se garde bien de le signaler, au contraire il conclut
ainsi sa
démonstration : « Cette
parenté indiscutable entre les termes languedociens et leurs
correspondants
Anglo-Saxons, démontre mieux que tous les raisonnements que les
Tectosages du
midi Gaulois, émigrés au delà du Rhin, et les
Anglo-Saxons sont bien le même
peuple, et elle conduit à cette conséquence absolue que
la langue Anglo-Saxonne
est bien la langue parlée par la famille
Cimmérienne. » En d'autres
termes : la vraie langue celtique, celle parlée par les
Gaulois, c'est
l'anglais moderne ! Et l'abbé Boudet persiste et signe, en
affirmant
quelques lignes plus loin : « L'identité
de la langue celtique avec celle des Tectosages devient tout à
fait évidente
par la décomposition des appellations données aux
diverses parties du sol
Gaulois et surtout par la décomposition des noms de tribus
transmis par
l'histoire ; ces noms renferment, en effet, en les interprétant
par la langue
Anglo-Saxonne, des indications justes, précises et
confirmées par
l'histoire. » Pour
l'abbé Boudet,
ces dénominations que l'on retrouve identiques d'un bout
à l'autre de la Gaule
– les noms Rennes, Aleth, Condate – n'étaient pas le fait du
peuple mais d'un
corps savant chargé de fixer ces appellation. Pour l'auteur
cette assemblée se
nommait le Neimheid, un nom qu'il explique ainsi : « Neimheidh
n'est point le nom d'un chef Gaulois ; il signifie celui qui est
à la tête,
commande, conduit et donne les dénominations, – to name
(néme), nommer,
– to head (hèd), être à la tête,
conduire, – et il était matériellement
impossible à un seul homme de donner à tout le pays
celtique les noms que
portent les cités, les tribus, les rivières et les
moindres parcelles de
terrain : c'était là l'œuvre d'un corps savant et le
terme de Neimheidh,
appliqué à ce corps d'élite composé des
druides, présente une expression de
vérité indéniable » Très
curieusement,
dans cette page 25 l'abbé Boudet orthographie 5 fois de suite ce
mot Neimheidh
avec un H final, alors que dans tout le reste du livre il emploie
l'orthographe
Neimheid, sauf à la page 166 où l'on retrouvera ce
Neimheidh incorrect. La
disposition de ces 5 mots dans la page 25 semble former une figure, un
signe.
Cette disposition ne doit rien au hasard de la composition
typographique :
le manuscrit retrouvé de son livre Étymologie du nom
de Narbonne prouve
que l'abbé préparait lui-même la manière de
disposer chaque mot de chaque
ligne, et chaque ligne de chaque page. L'imprimeur n'avait plus
qu'à suivre ses
recommandations.
Les
5 Neimheidh de la page 25 semblent dessiner un
symbole L'abbé
Boudet tente
ensuite de démontrer que la langue celtique – comprenez
l'anglais moderne – est
bien la langue mère de tous les langages antiques, que ce soit
l'hébreu, la
langue punique parlée à Carthage en Afrique, la langue
kabyle, ou même la
langue basque. Cette langue punique peut se comprendre à double
sens. Elle
évoque en effet le fameux ouvrage Ars Punica, un livre
de Thomas
Sheridan probablement écrit avec Jonathan Swift, le
créateur de Gulliver. C’est
un manuel expliquant comment crypter un texte par l’art du calembour et
des
jeux de mots, autrement dit l’équivalent anglais de la Langue
des Oiseaux. Ces
méthodes s'appliquent tout-à-fait à La vraie
langue celtique. D'ailleurs
n'est-ce pas ce que veut nous dire l'abbé Boudet lorsqu'il
écrit page 92 : « en
examinant de près le langage actuel des Kabyles, on s'assurera
qu'il est fait
de jeux de mots et par conséquent le seul punique – to pun
(peun) faire
des jeux de mots –. » Quant
à la langue basque,
de l'avis des spécialistes c'est dans ce passage que serait
caché tout le
secret des deux Rennes. En lisant entre les lignes, on comprend qu'il
sera
nécessaire de s'aventurer sous terre, de franchir divers
obstacles et de
vaincre de nombreux dangers.
Au
bord de la Sals, une étrange cavité Le chapitre V
ramène ses lecteurs en France, en Bretagne pour commencer, dont
l'auteur
énumère les différentes tribus gauloises,
s'arrêtant sur celle des
Redones : « Les
Redones formaient la tribu religieuse, savante, possédant le
secret de
l'élévation des monuments mégalithiques
disséminés dans toute la Gaule ;
c'était la tribu des pierres savantes,– read (red)
savant,– hone,
pierre taillée –. » Notons que read,
qui se prononce en fait rid, est en anglais le verbe
« lire »
plutôt que le mot « savant », c'est un
nouveau compromis de l'auteur
avec la réalité linguistique. L'abbé Boudet se
range une nouvelle fois à l'avis
des historiens de son temps qui attribuent aux Gaulois l'origine des
mégalithes.
Mais s'il s'arrête sur les Redones, c'est que cette tribu donnera
son nom à la
ville de Rennes en Bretagne. Or la thèse qu'il développe
ensuite c'est que les
Redones auraient également été l'une des tribus
composant le peuple des Volques
Tectosages, tribu précisément installée dans la
vallée de Rennes-les-Bains. On
comprend que pour lui la Rennes audoise et la Rennes bretonne ont la
même
origine. L'auteur s'attache ensuite à donner une
étymologie aux mots menhir,
dolmen et cromlech. Or l'origine de ces mots est parfaitement connue.
Les deux
premiers viennent du bas-breton, menhir signifiant « pierre
longue» et
dolmen « table de pierre ». Quant à
cromlech, c'est un terme gaélique
signifiant « cercle de pierres ». Ces
explications, l'abbé Boudet les
donne, en citant H. Martin et son Histoire de France, mais
elles n'ont
sans doute pas l'honneur de le satisfaire, car il nous propose ensuite
ses
propres étymologies, totalement délirantes, pages 166 et
167 : « Le
ménir, par sa forme aiguë et en pointe, représentait
l'aliment de première
nécessité, le blé, – main (mén),
principal, – ear (ir), épi de
blé –. » Alors que
dans sa
citation de H. Martin l'abbé Boudet respectait l'orthographe
« menhir », dans son propre texte il
préfère écrire
« ménir », et l'on comprend que ce mot
ainsi orthographié cadre mieux
avec son interprétation. Puis il poursuit : « La
répartition du blé était faite par la main des
Druides, comme les divers
auteurs l'ont bien constaté et comme le témoigne avec
évidence l'expression
attachée au dolmen, qui était, d'ailleurs, construit
comme une table de
distribution, to dole, distribuer, – main (mén),
essentiel
–. » « Le
cercle de pierres, ordinairement de forme ronde, représente le
pain : Cromleck,
en effet dérive de Krum (Kreum), mie de pain et de to
like (laïke),
aimer, goûter. » Une autre
erreur
volontaire est ici à noter. En effet, krum n'existe pas
en anglais, le
véritable mot traduisant « mie de pain »
est crumb, mais
l'abbé n'a pas hésité à le transformer,
remplaçant au passage le C par un K,
pour gommer le B final, qui se prononce et ne se retrouverait pas dans
cromlech. Ce krum incongru est d'ailleurs l'un des trois mots
anglais
qu'Henri Boudet écrit avec un K au lieu d'un C. Il y a aussi kove
au
lieu de cove, et kob au lieu de cob. Ce dernier
mot, il le
traduit par cheval, alors qu'il désigne plutôt un cygne
mâle, entre autres
significations (cob veut dire aussi « épi de
maïs »). L'auteur
relie la
totalité des monuments mégalithiques au thème du
blé et du pain. Or s'il y a un
endroit où il est possible d'associer mégalithe et
blé, c'est à Locmariaquer en
Bretagne (Morbihan), où le support principal du dolmen de la
Table des
Marchands s'orne de gravures représentant des épis de
blés sous le soleil.
L'abbé Boudet en connaissait-il l'existence ? Ce n'est pas
impossible, ces
gravures avaient déjà été relevées
et publiées de son temps.
Gravures
de la Table des Marchands – épis de blé stylisés L'auteur
enchaîne
ensuite : « Dans
tous nos villages du Languedoc, on trouve toujours un terrain auquel
est
attaché le nom de Kaïrolo, – key, clef, – ear
(ir), épi de blé, – hole, petite maison des
champs.– Dans ce terrain,
probablement, était
construit le grenier à blé des villages
celtiques. » Le mot hole
ne peut désigner une petite maison des champs que si l'on
considère que cette
maison forme un lieu isolé, autrement dit, familièrement,
« un trou
perdu ». Car la signification première de hole
est « creux,
trou ». L'abbé Boudet acceptera ce sens-là
lorsqu'il reviendra page 295
sur ce Kaïrolo, en ajoutant que ce grenier peut être un silo
ou un souterrain.
Et si l'on prend le mot blé selon son sens argotique – l'argent,
la richesse –
ce fantaisiste Kaïrolo devient la cache du trésor, la
clé du trou au blé. Et
l'auteur prend la peine de situer précisément cet endroit
par rapport à
Rennes-les-Bains : « la
kaïrolo des Redones était située au sud de
Montferrand tout près du chemin
conduisant au ruisseau de la Coume et aux Artigues. » C'est donc au
nord-est de Rennes-les-Bains, à peu de distance du hameau de
Montferrand, que
se trouverait ce silo ou souterrain abritant le blé, autrement
dit le magot.
Inutile de dire que des générations de chercheurs de
trésor ont tenté de le
localiser, mais en vain semble-t-il. Tout au moins, s'ils ont
trouvé quelque
chose, ils n'en ont rien dit... Mais l'abbé n'emploie-t-il pas
le passé pour en
parler ? Commence
alors la
seconde partie de l'ouvrage, celle consacrée au prétendu
cromlech de
Rennes-les-Bains, qui n'occupe en réalité que le chapitre
VII, le chapitre VIII
en étant séparé comme nous le verrons, bien qu'il
soit consacré lui aussi à
Rennes-les-Bains. L'auteur passe en revue toutes les pierres qui
composent le
cromlech, rochers naturels faut-il préciser, et qui dessinent
une vague ellipse
patatoïde en suivant les lignes de crête des collines
environnant les vallées
de la Sals et de la Blanque, le village de Rennes-les-Bains se trouvant
près de
leur confluent. Il termine sa longue description par les Roulers,
ensemble de
« pierres branlantes » au sommet d'une colline,
des rochers immortalisés
par un dessin d'Edmond Boudet, et que l'on retrouve également
sur les cartes
postales anciennes.
Les
Roulers (carte postale ancienne) Le chapitre
VII
consacre ensuite tout un sous-chapitre au thème de La pierre
de Trou ou
hache celtique. Étrange titre en vérité :
qu'est-ce donc que cette
« pierre de trou » ? L'abbé Boudet
explique : « La
pierre polie, dite hache celtique, faite de jade, de serpentine ou de
diorite,
affecte diverses formes. Le dialecte Languedocien la nomme pierre de
Trou. Elle
représente ce qu'il faut croire, c'est-à-dire, les
enseignements nécessaires
inscrits dans les grandes pierres levées – to trow
(trô), croire
–. » « Croire »
se dit plutôt to believe en anglais, ou to think
dans le sens de
« penser ». C'est peut-être une invitation
à prendre le problème à
l'envers et à traduire « trou » en
anglais. On obtient le mot hole,
auquel l'abbé Boudet donnait précédemment le sens
de « maison ».
Alors cette « pierre de trou » a peut-être
bien un rapport avec la
Kaïrolo, le grenier à blé, et les
« enseignements inscrits dans les
grandes pierres levées », si l'on accepte le
rapprochement avec les
gravures de la Table des Marchands, concernent bien le blé, ce
mot étant sans
doute à prendre dans son sens argotique. Le chapitre
VII se
termine par ce que l'on nomme en typographie un
« cul-de-lampe », un
décor d'entrelacs ou d'arabesques prenant la forme d'un gros
carré. C'est le
seul de tout le livre, même si des entrelacs comparables forment
les frises en
tête de chacune des 11 parties du livres, que ce soit
l'avant-propos, les
observations préliminaires, les 8 chapitres, la table des
matières, ou encore
pour encadrer la date en page de titre. On s'aperçoit d'ailleurs
que seulement
5 frises différentes ont été utilisées –
peut-être les seules dont disposait
l'imprimeur – pour ces 11 parties. La conséquence
inévitable – 11 ne se
divisant pas par 5 – est que l'une des frises n'a été
utilisée qu'une fois. Or
bizarrement, c'est le chapitre VIII qui est ainsi particularisé.
Sachant qu'il
est séparé du chapitre VII par le fameux cul-de-lampe,
cela donne l'impression
que ce chapitre VIII est « à part ». C'est
une bonne raison pour
l'examiner de plus près.
Les
différents motifs d'entrelacs du livre L'auteur
commence
par affirmer que le village celtique de Rennes-les-Bains ne se trouvait
pas à
l'emplacement du village actuel, mais plus en hauteur sur le coteau
oriental,
au sud du hameau de Montferrand, près du ruisseau de la Coume et
des Artigues.
Ce qui correspond exactement à l'emplacement de la Kaïrolo
ou grenier à blé
qu'il évoquait précédemment. L'abbé
explique : « Tout
près des Artigues et au dessus du Bugat, une partie du terrain
porte le nom de scarrajols,
– square (skouère), carré, – rash,
écoulement, – hall (haûll),
maison –. C'est bien là, la tuile carrée à
crochets, qui se trouve en quantité
considérable, sur plusieurs points, dans le cromleck de
Rennes-les-Bains. » Notons que
l'auteur
écrit scarrajols et non pas Scarrajols comme cela
devrait être,
autrement dit sans majuscule et en italiques, comme pour attirer
l'attention
sur ce nom. Il est d'ailleurs étrange que cette fois il fasse
appel à l'anglais hall – qu'il traduit par
« maison »
alors qu'il signifie
plutôt « salle » – pour interpréter
le ols final de Scarrajols,
alors que le mot hole utilisé pour Kaïrolo – avec
le même sens de
« maison » selon l'auteur – aurait aussi bien
convenu. Quant au mot rash,
il signifie plutôt « hasardeux,
imprudent ». Pour reprendre la
méthode de l'abbé, Scarrajols pourrait se
décomposer en square, carré – rash,
hasardeux – hole, trou, soit un trou carré hasardeux. Un
trou dans une
pierre peut-être ? Il y aurait
encore
tant à dire sur cet étrange livre qu'est La vraie
langue celtique. Il
faudrait noter les allusions discrètes à Rabelais,
à Jules Verne, au peintre
Nicolas Poussin et à l'Arcadie. Pour les liens avec Jules Verne,
je ne peux que
renvoyer vers mon livre Jules Verne matériaux
cryptographiques publié
chez Arqa, où ils sont exposés en détails : http://regardsdupilat.free.fr/julesverne.html Mais nous ne
pouvons pas refermer La vraie langue celtique sans jeter un
coup d'œil
sur la carte insérée en fin de volume. C'est un travail
magnifique, dû au
talent de dessinateur d'Edmond Boudet, le frère d'Henri. Il a
dû s'inspirer des
cartes d'État-Major en usage à l'époque, sauf que
sa carte est beaucoup plus
précise en raison de son échelle, environ 1/2600e
contre 1/80000e
pour les cartes d'État-Major.
Partie
centrale de la carte 1:
Rennes-les-Bains - 2: Montferrand 3:
le ruisseau de la Coume - 4: les Artigues – 5 :
Scarrajols Cette carte
est en
trois couleurs : noir, rouge et bleu. Le rouge est utilisé
pour les
constructions, y-compris mégalithiques, le bleu pour les
rivières, tout le
reste étant en noir. Les reliefs sont matérialisés
par des hachures
concentriques, comme c'était l'usage à l'époque.
Pour imprimer la carte, il a
été nécessaire de séparer les couleurs et
de réaliser trois plaques, une pour
le noir, une pour le rouge, une pour le bleu. Chaque carte a donc
été passée
trois fois sous presse afin de superposer les trois couleurs. Pour que
cette
superposition soit parfaite, l'imprimeur a utilisé la technique
bien connue du
symbole en forme de croix, de Lorraine en l'occurrence, placé
sur chacune des plaques
exactement au même endroit, en haut et en bas. C'est ce que l'on
nomme en
typographie des « alouettes ». À
l'impression, les trois croix, une
de chaque couleur, doivent se confondre en une seule. Si ce n'est pas
le cas,
le tirage est mauvais. Normalement le papier est ensuite rogné
pour supprimer
les alouettes. Or cela n'a pas été fait pour la carte
Boudet et les alouettes
sont toujours présentes : un mystère de plus.
Haut
de la carte Les
trois « alouettes » parfaitement
superposées se confondent en une seule Le
titre Cette carte
porte
un titre : RENNES CELTIQVE. Outre l'utilisation du V pour
écrire le U, à
la romaine, on remarque que ce titre est suivi d'un point, ce qui n'est
pas
l'usage habituel pour un titre. Il faut noter cependant que les titres
des
sous-chapitres sont également suivis d'un point, on ne doit donc
peut-être pas
trop en tirer de conclusions. Certains pensent que ce V
matérialise la position
du méridien de Paris, d'autres pensent que c'est plutôt la
cédille du Q. Il est
vrai que le méridien n'est pas tracé sur la carte, autre
anomalie, alors qu'il
est dûment positionné sur toutes les cartes depuis celle
de Cassini. Le
méridien de Paris constitue d'ailleurs l'axe nord-sud autour
duquel
s'articulent toutes les cartes topographiques de la France, encore
aujourd'hui. Un peu au
sud-sud-ouest de Rennes-les-Bains on remarque le lieu nommé
Haum-Moor, sur
lequel l'abbé Boudet s'attarde à plusieurs reprises. Pour
lui ce nom vient de
l'anglais haum, paille et moor, marais. Il ajoute : « Cette
dénomination de haum-moor, appliquée dans la
gaule entière, aux terrains
marécageux, a été partout dénaturée
et travestie jusqu'à devenir un homme
mort. » Haum-Moor est
également le nom donné au ruisseau qui longe ce terrain,
avant de rejoindre la
Blanque. Au confluent du ruisseau et de la rivière, les hachures
de la carte
semblent dessiner sur le coteau l'image d'un visage humain. Est-ce lui,
l'homme
mort ? Certains y ont vu plutôt une tête de diable.
C'est l'une des
bizarreries de la carte.
Détail
de la carte : Haum-Moor et la tête de diable Un mot enfin
sur la
légende, en bas à droite. Elle est écrite en
rouge, ce qui n'est déjà pas
banal. Elle donne la signification des symboles utilisés pour
désigner :
Ménirs debout, Ménirs renversés, Dolmen, Croix
grecques gravées. Les quatre
initiales en majuscules sont superposées et semblent former de
haut en bas
MMDC, soit 2600 en chiffres romains. C'est peut-être une
manière discrète de
donner l'échelle 1/2600e.
La
légende de la carte En 1914,
souffrant,
Henri Boudet fut contraint de démissonner de sa charge de
curé de
Rennes-les-Bains. Il quitta son cher village le 30 avril. Il choisit de
se
retirer à Axat, dans sa famille, chez Céleste la veuve de
son frère Edmond
décédé depuis 1907, qui vivait avec sa sœur
Victorine et son neveu Émile. C'est
là que l'abbé Boudet s'éteignit, entouré de
l'affection des siens, le 30 mars
1915. L'auteur de La vraie langue celtique avait exprimé
le désir d'être
inhumé dans le caveau du cimetière d'Axat où son
frère reposait déjà. Leur
tombe est très discrète : une simple dalle
ornée d'une grande croix en
relief, entre deux monuments funéraires autrement plus
ostentatoires, et qui
plus est en partie masquée par un arbre. L'épitaphe, qui
n'est quasiment plus
lisible aujourd'hui, est ainsi rédigée :
Épitaphe
de l'abbé Boudet (reconstitution infographique) La partie la
plus
étrange de cette inscription est constituée par la
mention E-C-C-I-II. On
dirait une référence biblique, un renvoi vers un verset
particulier. Le
problème, c'est que deux livres de la Bible commencent par les
lettres
Ecc : L'Ecclésiaste et L'Ecclésiastique.
Aussi, et pour qu'il n'y
ait pas de confusion entre eux, on ne les abrège jamais par Ecc.
Le premier
s'abrège par Qo car son autre nom est le Qohêlet,
le second s'abrège par
Sir, car l’autre nom de ce livre est le Siracide. Quant aux
chiffres,
s'agit-il de 1-11, ou de 1-2 en chiffres romains ? Un
élément de réponse
est peut-être apporté par le livre La vraie langue
celtique. On remarque
en effet que L'Ecclesiaste y est cité page 186,
précisément le chapitre
1, versets 9 et 10. Le verset 11, qui pourrait être
signalé par cette mention
E-C-C-I-II, en constitue la suite : « Nul souvenir des
anciens, pas
plus que de leurs successeurs il n’y aura de souvenir chez ceux qui
seront dans
la suite ». Si l'on considère qu'il s'agit
plutôt du verset 2, celui-ci
est lui beaucoup plus connu : « Vanité des
vanités, tout est
vanité ». Mais on ne peut pas dire que cela nous
avance beaucoup !
Cette partie-là de l'épitaphe conservera sa part de
mystère.
Tombe
des frères Boudet dans le cimetière d'Axat En bas
à droite de
la dalle mortuaire est sculpté un petit livre fermé, bien
détérioré
aujourd'hui. Sa couverture s'orne d'une inscription, tournée
dans le sens de la
hauteur. On déchiffre ce qui paraît être les lettres
I X O I E, séparées par
des points, le E ressemblant en fait plutôt à un Sigma
grec. Des photos
anciennes nous montrent que d'autres lettres étaient
grecques : le O
pourvu d'un point en son centre était en réalité
un Thêta, et le I un Upsilon.
Toutes les lettres en fait appartiennent à l’alphabet grec, il
faut lire Iota –
Khi – Thêta – Upsilon – Sigma, soit le mot ICHTUS,
poisson. Le poisson a
été le symbole du Christ pour les premiers
chrétiens, parce que son nom en grec
forme l’acrostiche de la formule Jésus, Christ, de Dieu, le
Fils, Sauveur. Quoi
de plus normal que de le retrouver sur la tombe d'un
prêtre ? Mais
pourquoi le graver sur la sculpture d'un livre ? Ce livre ne
serait-il pas
celui de l'abbé Henri Boudet, La vraie langue celtique ?
Si on
retourne l'inscription IXOIE, elle devient 3IOXI, soit
310, et
11 en chiffres romains. Or La vraie langue celtique comptant
précisément 310
pages, certains ont pensé qu'il y avait peut-être quelque
chose à découvrir sur
la 11e ? Précisément, c'est dans cette
page 11 qu'apparaissent
pour la première fois les mots clef et blé.
Mais que faut-il en
conclure ? La tombe de l'abbé Boudet restera
décidément bien énigmatique.
Le
livre sculpté et son inscription, jadis (en haut) et
aujourd'hui (en bas) Après
son décès, on
trouva dans les papiers de l'abbé un manuscrit d'une vingtaine
de pages dont le
titre était Étymologie du nom de Narbonne.
Resté inédit, ce document a
connu bien des vicissitudes. Il est passé de main en main et a
fait l'objet de
diffusions successives. Une main inconnue colla un papier sur le
premier mot du
titre pour le transformer simplement en Du nom de Narbonne. Ce
petit
livre connut d'ailleurs d'autres transformations, entre autres l'ajout
de
symboles entre certains mots.
L'église
vue du cimétière
C'est
l'abbé Joseph
Rescanières qui succéda à Henri Boudet à la
cure de Rennes-les-Bains. Il devait
décéder subitement moins d'un an plus tard, le 1er
février 1915,
alors qu'il n'avait que 36 ans, ce qui a amené certains à
suspecter un
empoisonnement. La paroisse reconnaissante plaça dans le
vestibule de l'église
une stèle commémorant la mémoire des deux
prêtres. Elle a depuis été complétée
par une seconde plaque, apposée le 6 juin 2015. Cette nouvelle
stèle, évolution
des temps oblige, n'est pas en marbre comme la première mais en
plastique. Ce
matériau certes moins noble offre au moins l'avantage de pouvoir
y insérer une
photographie. En l'occurrence c'est un montage montrant un cromlech
mégalithique, le menhir central étant constitué
par l'étrange livre sculpté de
la tombe d'Henri Boudet.
Les
deux stèles en mémoire de l'abbé Boudet |