
JULES VERNE, MATÉRIAUX
CRYPTOGRAPHIQUES
Tel
est le titre du nouveau livre de Patrick Berlier, qui vient
d’être publié aux
éditions Arqa. Mais quelle est la raison de ce titre ?
Pourquoi " matériaux " ? Pourquoi " cryptographiques " ? Il convient d’abord de
rappeler
la définition du mot matériaux dans le
dictionnaire : « toute
matière de base servant à réaliser des ouvrages
matériels ou intellectuels. »
En l’occurrence, les " ouvrages
intellectuels "
sont les romans de Jules Verne. Mais en quoi seraient-ils
cryptographiques ? Les célèbres Voyages
extraordinaires qui
enchantèrent plusieurs générations d’adolescents,
contiendraient des messages
secrets ? Eh bien oui… On le sait depuis déjà
longtemps, l’œuvre de Jules
Verne est entièrement cryptée. Derrière ses textes
destinés à la jeunesse, s’en
cachent d’autres, qui eux sont destinés aux adultes.

La couverture
du livre
En
1978 Marc Soriano a publié chez Julliard une biographie de Jules
Verne,
malicieusement sous-titrée Le cas Verne. L’auteur
démontrait que Verne
avait usé de jeux de mots phonétiques, d’anagrammes, de
contrepèteries, en
particulier avec les noms de ses personnages. Plaisantin incorrigible,
amateur
de plaisanteries grivoises, Jules Verne a imaginé des noms
masquant des
calembours égrillards.
Mais
déjà dans les années soixante, Marcel Moré
avait publié deux essais chez
Gallimard : Le très curieux Jules Verne en 1960, et
Nouvelles
explorations de Jules Verne en 1963. Ces ouvrages constituaient une
analyse
quasiment psychanalytique de l’œuvre de Jules Verne, démontrant
que l’écrivain
avait mis en scène dans ses romans, sa famille, ses amis, et
surtout lui-même, en
y cachant tous les drames de sa vie intime.
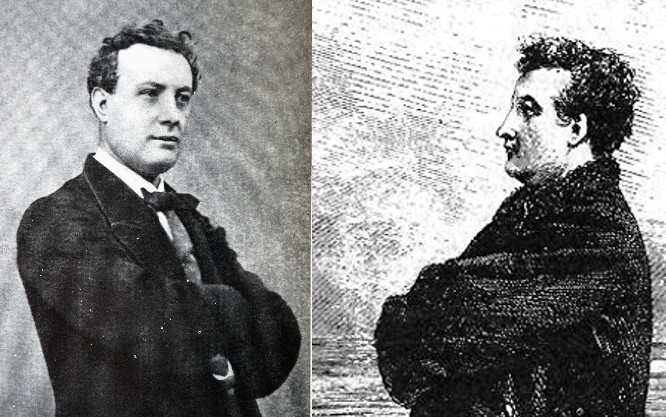
Jules Verne
à l’âge de 25
ans (à gauche) s’est incarné dans le personnage du
professeur Aronnax (à
droite) de « Vingt mille lieues sous les mers »
Mais
il y a encore un autre message bien caché dans certains romans.
Ce fut Franck
Marie, en 1981, qui s’en aperçut en premier, relevant de
singulières
coïncidences entre Clovis Dardentor et l’affaire de
Rennes-le-Château,
dans son livre Le surprenant message de Jules Verne,
publié aux éditions
du S.R.E.S.
Trois
ans plus tard en 1984, Michel Lamy rebondissait avec son
désormais célèbre Jules
Verne initié et initiateur, aux éditions Payot,
pointant du doigt les
allusions de Jules Verne à la Franc-Maçonnerie, aux
Rose-Croix, à l’alchimie, à
la Société Angélique, et aux mystères de
Rennes-le-Château. Michel Lamy
démontrait aussi qu’au-delà de Jules Verne, ce sont
d’autres littérateurs de la
fin du XIXe siècle, comme Maurice Leblanc le
père d’Arsène Lupin,
Gaston Leroux le père de Rouletabille, ou Raymond Roussel
l’auteur de Locus
solus, qui ont été influencés par un certain
courant de pensée occulte.
Michel Lamy souhaitait aussi que le flambeau soit repris par d’autres
chercheurs.
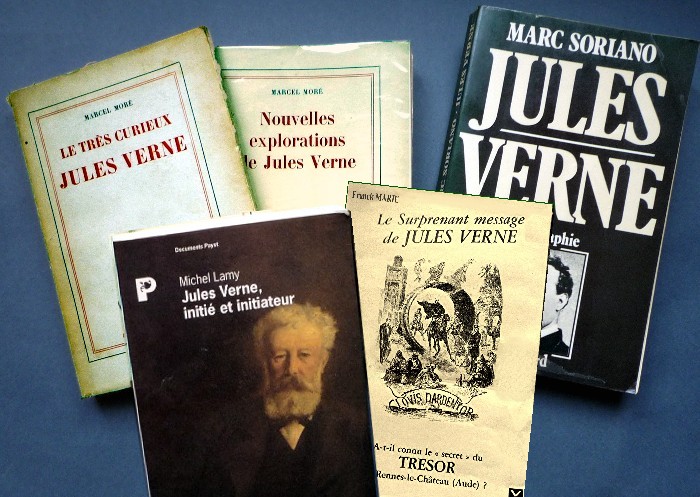
Les
prédécesseurs
Son vœu
est exaucé avec la parution de Jules Verne, matériaux
cryptographiques
de Patrick Berlier. Michel Lamy en a d’ailleurs signé la
préface, texte
magnifique à lire absolument en préambule. Il
écrit par exemple : « Patrick
Berlier n’appartient pas à cette catégorie de personnes
qui s’emprisonnent dans
des théories toutes faites qu’on lui apporterait sur un plateau.
Il prend du
recul, analyse, déduit, vérifie, continue la recherche et
persévère, et il
trouve. Patrick Berlier est un véritable chercheur qui fouille
les textes comme
un archéologue fouillerait un site, patiemment,
méthodiquement. Lorsque vous
aurez lu son livre, vous ne pourrez plus lire Jules Verne avec le
même regard.
Vous saurez ! »
Reconnu
comme spécialiste de la Société Angélique,
Patrick Berlier était aussi, depuis
l’enfance, un fan de Jules Verne. Pour écrire ce livre,
pavé 540 pages, il a dû
lire ou relire chacun des 80 titres composant son œuvre. Dans l’ordre
de
parution, pour mieux saisir l’évolution de la pensée
vernienne. Son livre est
donc le premier prenant en compte l’intégralité de la
production littéraire de
Jules Verne. Et on s’aperçoit qu’il n’y a pas un titre qui
n’apporte pas son
lot de connotations ésotériques.
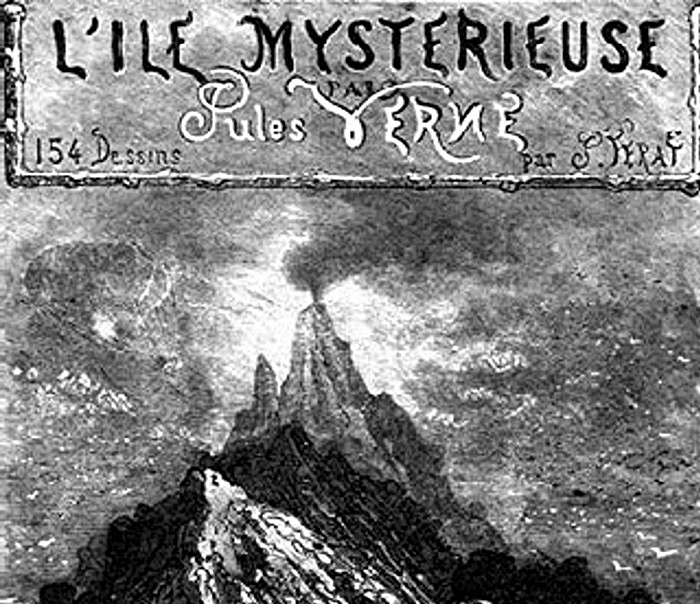
Détail
du frontispice de « L’île
mystérieuse : remarquer le N inversé de VERNE
On
y trouve par exemple de nombreuses allusions voilées à la
Franc-Maçonnerie.
Pourtant Jules Verne n’était pas franc-maçon,
semble-t-il. L’un de ses romans
les plus maçonniques est Voyage au centre de la Terre.
Le héros est un
jeune homme, presque adolescent encore, qui suit on oncle dans un
voyage
extraordinaire dans les entrailles de la terre. En chemin il va subir
les
épreuves traditionnelles réservées à tout
candidat à l’initiation maçonnique. À
la fin de l’histoire, il aura, symboliquement, taillé et poli sa
pierre brute
pour en faire une pierre cubique, autrement dit il sera devenu un
homme. Au
début de leur voyage souterrain, les personnages évoluent
dans une caverne aux parois
entièrement noires, comme les murs d’un cabinet de
réflexion. Pour illustrer ce
passage, Jules Verne a fait réaliser par son dessinateur
Édouard Riou une
gravure faisant apparaître deux arbres fossiles du
carbonifère, des
sigillaires, alors qu’il n’en est pas question dans le texte. Ces
troncs
d’arbres fossilisés ressemblent aux deux colonnes placées
à l’entrée d’un
temple maçonnique. Un calembour particulièrement subtil
dans le texte permet de
découvrir les lettres J et B qui devraient les orner.

La gravure avec
les deux
colonnes
S’il
n’était pas franc-maçon, Jules Verne fut par contre
membre de la Société
Angélique parisienne du XIXe siècle, de
même que George Sand, Eugène
Delacroix, Gérard de Nerval, Alexandre Dumas père et
fils, Anatole France, et
bien d’autres. Il en devint même probablement le Grand
Maître. Les allusions
angéliques sont fréquentes dans son œuvre, en particulier
dans Le tour du
monde en quatre-vingt jours ou dans L’île
mystérieuse. Comme l’ont
révélé George Sand et Maurice Barrès,
l’initié angélique se devait de placer
quelque part dans son œuvre, sous une forme ou sous une autre, la
formule tirée
du célèbre tableau des Bergers d’Arcadie de
Nicolas Poussin : ET IN
ARCADIA EGO (aujourd’hui au Musée du Louvre). C’est à la
fois une signature et
une confession, révélant, à qui peut le
comprendre, l’appartenance à la Société
Angélique. Or Jules Verne n’a pas failli à cette
tradition, et au soir de sa
vie, dans l’un de ses derniers romans, il a dûment
inséré cette citation
latine, en toutes lettres et noire sur blanc. Le plus curieux c’est que
personne ne l’avait vue à ce jour !
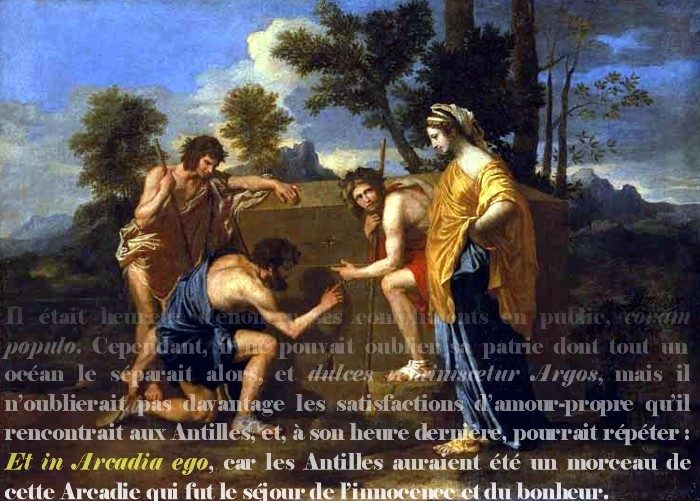
« Les
Bergers
d’Arcadie » de Nicolas Poussin et extrait d’un certain roman
de Jules
Verne, contenant la formule signature « Et in Arcadia
ego »
Mais
l’aspect le plus curieux des « matériaux
cryptographiques » de Jules
Verne est celui qui concerne Rennes-le-Château, ou plutôt
la région des deux
Rennes, puisque ne sont oubliés ni Rennes-les-Bains, ni
Notre-Dame de
Marceille, ni le Pech de Bugarach. Tout commence avec La jangada,
un
roman publié en 1881, quatre ans avant l’arrivée de
l’abbé Saunière à
Rennes-le-Château. Curieusement, comme l’a noté Philippe
Duquesnoy, ce roman
contient le mode de cryptage / décryptage des parchemins que
l’abbé découvrira
dans son église. Selon les théories les plus
récentes développées en
particulier par Franck Daffos, ces parchemins seraient l’œuvre d’un
trio d’ecclésiastiques,
les pères Léopold Vannier et Jean Jourde, des Lazaristes
de N.-D. de Marceille,
et l’abbé Boudet, curé de Rennes-les-Bains. Pour leur
cryptage ils auraient
tout simplement pris modèle sur La jangada. Il est vrai
qu’à l’époque
les romans de Jules Verne étaient des best-sellers traduits dans
le monde
entier, que tout le monde lisait, même les prêtres… et
même le pape ! Mais
en plus, le père Vannier était un ami de Jules Verne, qui
l’a connu lorsque en
1857 il habitait à côté de la congrégation
des Lazaristes à Paris. Quant à
l’abbé Boudet, il semble bien faire une allusion très
discrète à La jangada
et à son auteur dans son fameux livre La vraie langue
celtique, que
Jules Verne a lu et compris, cela semble certain.
Avec
Robur le Conquérant (soit les initiales R L C… et un
titre de 17
lettres…) les choses se précisent. Le roman paraît en
1886, en même temps que
le livre de l’abbé Boudet. L’histoire est subtilement
placée sous l’égide de
saint Nazaire, patron de l’église de Rennes-les-Bains. Et pour
traverser
l’Europe du nord au sud le navire aérien de Robur va suivre
scrupuleusement le
méridien de Paris.
Cela
se corse en 1890 avec César Cascabel, le voyage accompli
par les héros
n’étant pas autre chose qu’une évocation, à une
autre échelle il est vrai, de
la vieille voie romaine entre Rennes-le-Château et Carcassonne.
Une voie dite Route
de César
qui franchissait
l’Aude aux Roches de Cascabel.
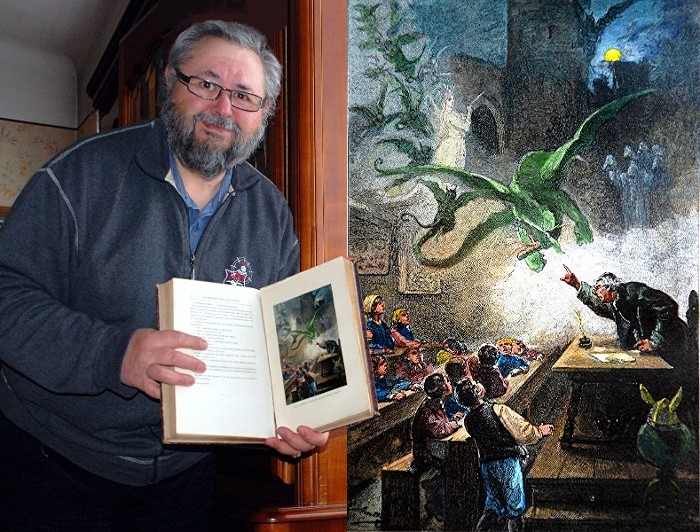
Patrick et
l’édition
originale Hetzel du « Château des
Carpathes »
L’une des
gravures en couleurs
de cette édition
Même
principe pour Le château des Carpathes, publié en
1892. Des allusions
aux Bergers d’Arcadie de Nicolas Poussin, des emprunts au Songe
de
Poliphile l’ouvrage culte de la Société
Angélique, plus curieusement d’autres
emprunts à La vraie langue celtique de l’abbé
Boudet, mais surtout une
évocation de la vallée de la Sals et du secteur
Rennes-les-Bains et Bugarach.
Cette vallée de la Sals devient dans le roman la vallée
de la Sil, en
Roumanie ; or les deux vallées sont très
ressemblantes.
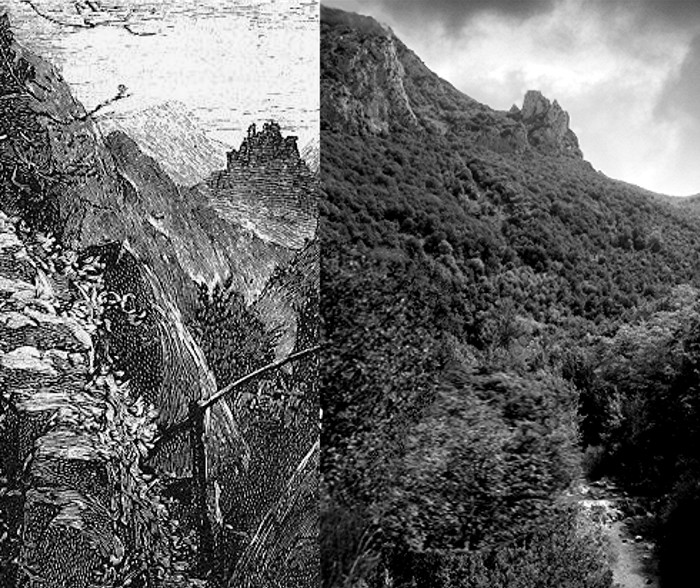
Comparaison entre
la vallée
de la Sil avec son château des Carpathes (à gauche,
détail d’une gravure du
roman)
et la vallée de la Sals, près de Rennes-les-Bains, avec
ses rochers
ruiniformes (à droite)
Au
final, Le château des Carpathes semble nous parler d’un
tombeau souterrain
et monumental, dans les Carpathes ou dans le Razès, où
flottent les souvenirs
éthérés d’un Ressuscité et d’une femme
aimée et amante. Il y a aussi ce passage
où les personnages, en route pour le château des
Carpathes, passent devant un
bloc de rocher en équilibre, bien semblable à la " Pierre du Dé " proche de Rennes-les-Bains,
telle
qu’elle apparaît dans le livre de l’abbé Boudet.
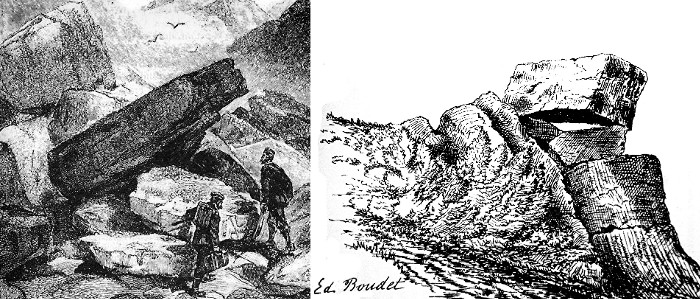
Gravure du
« Château
des Carpathes » (à gauche) et gravure de
« La vraie langue
celtique » (à droite)
Mais
le roman le plus révélateur d’une connexion entre les
œuvres de Jules Verne et
Rennes-le-Château, c’est bien sûr Clovis Dardentor,
publié en 1896, qui
met en scène un capitaine Bugarach, personnage un peu rude dont
les traits de
caractère en font l’incarnation du célébrissime
Pech de Bugarach. Les héros
vont accomplir un voyage en Algérie, mais les " erreurs volontaires " de Jules Verne mettent le
lecteur sur la
piste d’un itinéraire invisible en terre d’Aude, autour du
Bugarach justement.
Un voyage dont les étapes s’inscrivent sur un cercle parfait…
cercle qui
naturellement possède un centre… à découvrir en
lisant le livre de Patrick
Berlier.

Le capitaine
Bugarach (gravure
colorisée du roman « Clovis Dardentor ») et le Pech
de Bugarach,
vu de Rennes-le-Château
En
1904, un an avant sa mort, Jules Verne publia Maître du Monde,
roman un
peu bâclé, révélant la grande fatigue de
l’auteur. C’est la suite de Robur
le Conquérant, et l’action, censée se passer aux
États-Unis, a
principalement pour cadre la montagne du Great-Eyry, inexistante en
Amérique
mais dont les caractéristiques et l’aspect
révélé par les gravures
correspondent au Pech de Bugarach.
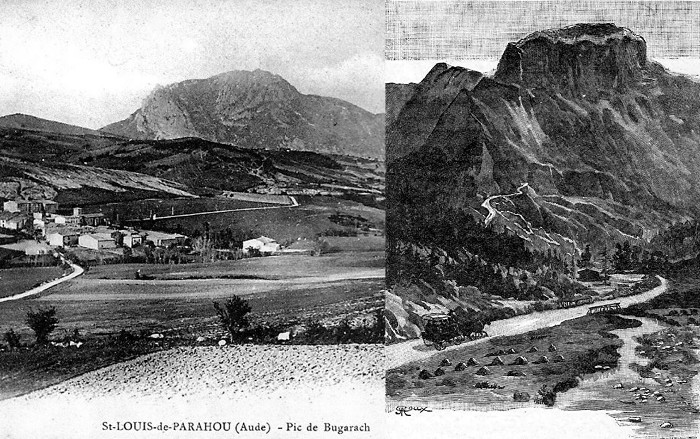
Une carte postale
ancienne
du Bugarach (à gauche) semble avoir inspiré la gravure de
« Maître du
Monde » (à droite) montrant l’imaginaire Great-Eyry
Jules
Verne, matériaux cryptographiques : pourquoi ce titre, outre le
fait, démontré, que l’œuvre
vernienne est un immense cryptogramme ? Patrick Berlier
établit les liens
étroits entre Jules Verne et Claude-Sosthène Grasset
d’Orcet, un érudit auteur
de quantité d’articles qui ont révélé
l’existence de la Société Angélique,
entre autres. Les deux hommes se sont apparemment connus sur les bancs
de
l’Université, et sont restés en contact, Jules Verne
utilisant les découvertes
de son ami, avant même leur publication. Les textes de Grasset
d’Orcet ayant
été rassemblés une première fois sous le
titre Matériaux cryptographiques,
il paraissait normal, en guise de clin d’œil, de donner ce sous-titre
au livre
de Patrick Berlier.
On
peut se procurer le livre Jules Verne, matériaux
cryptographiques de
Patrick Berlier en le commandant directement sur le site des
éditions
Arqa :
Lire
aussi, en cliquant sur le même lien, le n° 17 de la webzine Les
chroniques
de Mars, entièrement consacré à Jules Verne,
avec interviews, études,
photos, extraits du livre de Patrick Berlier.