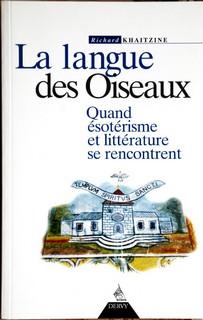|
Dossier Juillet 2007
|
|
Pélasges, Argonautes et Pilat
« RÊVERIES ÉSOTÉRIQUES »
|
<Retour au Sommaire du Site>
CURIOSITÉS ET LÉGENDES DU MONT
MINISTRE
Le Mont Ministre est situé
dans la partie nord-est de la ligne de crête du Pilat, entre le Crêt
de la Baronnette et Mont Monnet. Il en constitue l’un des derniers sommets
significatifs. L’appellation « Mont Ministre » est
récente. Elle n’apparaît pas sur la carte d’état-major
de 1857, où aucun nom n’est attribué à cette montagne.
Le premier à la citer semble être Louis Dugas, dans son « Étude
sur quelques monuments celtiques du Mont Pilat », publiée
en 1927. Il évoque cette montagne nommée par les habitants
des environs « Crêt du Ministre », en souvenir
spécifie-t-il « d’une masure qu’un ministre protestant
y aurait élevé en des temps imprécisés ».
Louis Dugas trouva cette cabane sur la pente sud de la colline. Il en conclut
que ce pasteur, ou ministre du culte protestant, aurait pu trouver refuge
sur les pentes de cette montagne à l’époque des guerres de
religion.

Le Mont Ministre surplombe le tranquille village de Chuyer
<Retour au Sommaire du Site>
Sur les cartes anciennes, en particulier
celle de Cassini (fin XVIIIe siècle) toute la ligne de
crête entre le Col de la Croix de Montvieux et le Col de Grenouze est
nommée « Côte des Pérouses ». Cette
appellation est également répertoriée par le « Dictionnaire
topographique du Forez », publié en 1946. Elle était
donc toujours en usage à ce moment-là, bien que n’apparaissant
pas sur les cartes d’état-major. À noter que ce dictionnaire
ne signale aucun « Mont Ministre ». Pérouse
est un toponyme très fréquent, il vient du latin petra, « pierre ».
Les dérivés de petra sont paraît-il un appellatif géographique
fréquent dans les noms de rochers et de crêtes pierreuses (1).
La Côte des Pérouses, ce serait donc tout simplement la Côte
des Rochers, lesquels ne manquent pas dans toute cette zone.
J’ai raconté dans le premier
dossier comment la Grotte des Fées fut retrouvée dans les années
80, sur le flanc sud du Mont Ministre, par un groupe de passionnés
qui devait devenir l’association Visages de Notre Pilat. Lors d’une séance
de débroussaillage et de nettoyage, était découverte
sur la paroi à droite de la grotte, à hauteur d’homme, l’inscription
énigmatique :
DAΓ
On dirait un mélange de
lettres latines et grecques : un D, un A qui pourrait également
être un Alpha majuscule, un Gamma majuscule. DAG ?
L’étrange inscription de la Grotte des Fées
<Retour au Sommaire du Site>
J’ai expliqué les recherches
de M. Henri Panier, exposées dans la revue « Dan l’tan »
(2). Ce graphiste était parvenu à la conclusion qu’un seul alphabet
utilisait des caractères ressemblant aux lettres G, A et Gamma. Il
s’agit de l’écriture apparaissant sur les « tables Eugubines »,
trouvées en Italie à Gubbio (d’où leur nom), ville d’Ombrie
dans la province de Pérouse. Pérouse ? C’est aussi le
nom que le Mont Ministre portait sur la carte de Cassini ! Étrange
coïncidence. Comme je l’ai signalé, Pérouse est un toponyme
très fréquent. Mais avouez que le hasard fait quand même
bien les choses ! Les tables Eugubines sont attribuées par certains
auteurs au peuple des Pélasges, lesquels sont parfois qualifiés
du nom de Péluziens. « Un nom qui, il faut bien le dire, ressemble
fort à Pélussin », remarquais-je en conclusion du
premier dossier. Allons plus loin
aujourd’hui…
Pélasges et argonautes
La mythologie des Pélasges
était fondée sur une déesse unique, Eurynomé,
qui aurait fait naître le premier homme en Arcadie. Eurynomé
est l’équivalent du sumérien Jahu ou Iahu, nom d’où
serait issu le Iahvé des Juifs. Richard Khaitzine précise encore
dans son livre « La Langue des Oiseaux » (3)
que les Pélasges vouaient un culte au cheveu et au poil, culte
qui se fondit dans celui de l’ergot du coq lorsque la civilisation
Égéenne succéda à celle des Pélasges.
On croit voir dans ces croyances l’origine du culte que certaines sociétés
secrètes corporatistes de la Renaissance, telles que les Gouliards
et surtout les Gilpins, vouaient au dard, à la pointe, à l’épine
et au coq. À noter qu’en ancien français le mot poil
signifiait aussi « poulet, coq ». Je développe
largement tous ces thèmes dans mes livres « La Société
Angélique », tomes I et II (plus de renseignements
à partir du sommaire du site en rubrique Librairie).
Richard Khaitzine donne au chapitre où il aborde le
sujet ce titre étonnant : « Nos ancêtres,
les Pélasges Argonautes ». Il faut lire ce chapitre
soigneusement et à plusieurs reprises pour comprendre le lien. Il
se fait en particulier par l’intermédiaire de Raymond Roussel, un curieux
écrivain adepte d’un club discret — peut-être la Société
Angélique ? — auteur du surprenant roman « Locus solus »
où il met en scène le coq Mopsus. Cet animal qui possède
des pouvoirs de divination semble être un mixage du coq emblématique
des Égéens, descendants des Pélasges, et de Mopsus,
l’un des Argonautes qui accompagna Jason à la conquête
de la Toison d’Or. Mopsus est aussi le nom d’un berger de l’Arcadie poétique
décrite par les Bucoliques de Virgile ; et encore le nom du petit-fils
de Tirésias, le devin qui comprenait la Langue des Oiseaux. Richard
Khaitzine note également que le nom « Égéen »
semble dérivé d’une racine eg désignant le chêne.
Il enchaîne en évoquant les Fendeurs Charbonniers, ces mystérieux
« frères du chêne » rattachés
à la maçonnerie opérative dite du bois ou de la forêt.
Des Charbonniers sont nés les Carbonari dont la branche allemande
se nommait d’Ordre des Mopses…
Il faut ensuite faire appel à
Fulcanelli, évoqué maintes fois par Richard Khaitzine. Fulcanelli
est le pseudonyme sous lequel furent publiés au début du XXe
siècle deux ouvrages de référence essentiels :
« Le mystère des cathédrales »
et « Les demeures philosophales ». Ces livres
contiendraient les clés pour la compréhension du Grand-Œuvre
alchimique. Derrière ce pseudo de Fulcanelli se cachaient plusieurs
hermétistes de la Belle Époque, dont Pierre Dujols, un descendant
des Valois. Le nom Fulcanelli est en fait l’anagramme de « l’écu
final », lequel écu ou blason, apparaissant en effet à
la fin desdits livres, représente un hippocampe. Comprenne qui pourra.
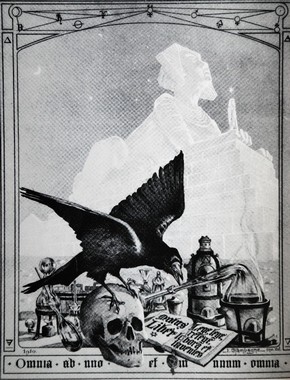

L’écu final de Fulcanelli. Le casque empanaché est le symbole
de l’initié à la cabale ou Langue des Oiseaux. Le mot hippocampe
vient du grec « hippos cambos » signifiant « cheval
courbe » ! Ce cheval ou cabale courbe est bien sûr
une évocation voilée de langue détournée, le
langage oblique, qui doit servir à décrypter le livre.
<Retour au Sommaire du Site>
Fulcanelli considère la
langue des Pélasges comme l’origine de la langue française.
Dans son ouvrage « Le Mystère des Cathédrales »,
il établit un lien entre les Argonautes, le chêne
et le coq. Il se livre pour cela à une analyse du bas-relief
« La Toison d’Or » de l’Hôtel Lallemant
à Bourges, représentant Jason et la toison, sur fond d’une forêt
de chênes. Rappelons que dans la mythologie grecque, ce pelage
merveilleux était celui d’un bélier fantastique, offert en
sacrifice à Zeus. Le dieu de l’Olympe en fut tellement heureux qu’il
promit le bonheur absolu à quiconque détiendrait cette toison,
tout en autorisant chaque mortel à tenter de la conquérir.
C’est Æétès, roi de Colchide, qui possédait la
Toison d’Or, lorsque Jason et les Argonautes partirent à sa conquête.
Notons l’identité, dans la Langue des Oiseaux, entre Pélasges
et pelage…
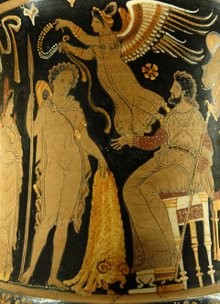
Jason et la toison d’or
<Retour au Sommaire du Site>
Fulcanelli affirme que chêne
et bélier « ne représentent qu’une même
chose sous deux aspects différents ». Certains béliers,
engins de guerre servant à enfoncer les portes, étaient sans
doute en chêne. Mais il faut savoir que dans nos campagnes les anciens
emploient encore l’expression « grand belin » pour
désigner un certain type de chêne, et que ce mot belin
en vieux français signifie mouton, ce qui est à l’origine du
mot bélier. Ces termes désignent une certaine matière
initiale de l’Œuvre, dont le hiéroglyphe céleste est le Bélier,
à laquelle les anciens attribuaient un nom, « un à-peu-près,
dont l’équivalent répond au chêne ». Fulcanelli
s’excuse de ne pouvoir en dire plus sans outrepasser certaines bornes. Les
mentalités ayant évolué, il est possible aujourd’hui
d’aller plus loin sans trop choquer. Lorsque l’on sait que le mot chêne
vient du latin populaire cassanus (lui-même tiré du gaulois)
il est aisé de deviner que cet « à-peu-près »
doit s’entendre casse-anus, ou autre expression équivalente
un peu plus crue. Fulcanelli prend la peine de préciser que « seuls
les initiés au langage des dieux (la Langue des Oiseaux) comprendront
sans aucune peine, parce qu’ils possèdent les clés qui ouvrent
toutes les portes ». Dont bien sûr la porte des latrines.
Fulcanelli poursuit son raisonnement
en évoquant la noix de galle produite par les feuilles des
chênes, terme qu’il rapproche de Gallia, la Gaule, et de gallus,
nom latin du coq, qui de fait est devenu l’emblème de la Gaule
tout en étant l’attribut de Mercure. Le mercure est parfois nommé
en alchimie lait de vierge, et lait en grec se dit gala. Le mercure
des philosophes est l’un des termes désignant la matière préparée.
Il y aurait identité, toujours selon Fulcanelli, entre le kermès,
une variété de chênes, et Hermès nom grec
de Mercure. On pourrait poursuivre longtemps cette digression alchimique
et ésotérique, mais cela nous éloignerait trop loin.
En résumé, voici
un schéma à lire dans le sens des aiguilles d’une montre ou
selon son inverse, en partant de n’importe quel mot :
|
Pélasges |
poil |
poulet |
ergot du coq |
|
pelage |
|
|
Égéens |
|
Toison d’or |
|
|
eg |
|
Argonautes |
|
|
chêne |
|
Mopsus |
|
|
Charbonniers |
|
Charbonniers |
|
|
Mopses |
|
chêne |
galle, Gallia, gallus |
coq |
Mopsus |
On passe ainsi des Pélasges
aux Argonautes, soit par une longue suite d’associations d’idées,
soit très rapidement par jeu de mots. Rebondissons donc sur les Argonautes.
LES ARGONAUTES DANS LE PILAT ?
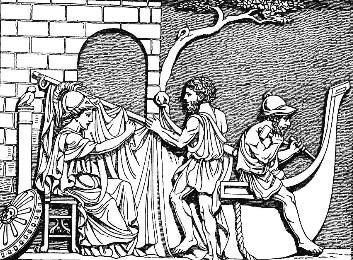
Argos construisant la nef Argo avec l’aide de la déesse Athéna
<Retour au Sommaire du Site>

Les légions romaines traversent le Pilat : passage aux Roches de Marlin ! (photo www.paxaugusta.net)
<Retour au Sommaire du Site>

Carte schématique des bassins de la Loire et du Rhône, au niveau
du Pilat
<Retour au Sommaire du Site>
Quant à Pollux, il serait
à l’origine du nom de la principale bourgade du Pilat, Pélussin,
selon l’une de ses étymologies (4). Sans doute à cet endroit,
à l’époque romaine, s’élevait un temple dédié
à cette divinité. Les jumeaux Castor et Pollux (les Dioscures)
sont des célèbres héros de l’antiquité qui faisaient
partie de l’équipage de la nef Argo. Si Pélussin est Pollux,
à quoi correspond Castor ? Il ne faut pas chercher bien loin pour trouver,
tout près de Condrieu, l’Île du Beurre, nom qui est une déformation
du vieux français bièvre pour « castor ».
Le jeu des mots est facile certes, et il ne serait qu’un trait d’esprit,
si par une curieuse coïncidence les villes de Condrieu et Pélussin,
sur la terre du Pilat, n’offraient la même disposition et la même
physionomie que les étoiles Castor et Pollux dans le ciel...
Dans le même style de curiosité,
notons la présence près de Saint-Sauveur-en-Rue du lieu-dit
Gimel, variante de Gémeau (5) ; ce nom désignait sans
doute des rochers, ou des arbres, jumeaux, mais on ne peut s’empêcher
de penser aussi à la constellation des Gémeaux, dont Castor
et Pollux sont les deux principales étoiles... Le hasard faisant décidément
bien les choses, tout comme les Gémeaux regardent au sud, de l’autre
côté de l’écliptique, les constellations du Grand Chien
et du Petit Chien, Gimel regarde au sud, de l’autre côté de
la vallée de la Déôme, la forêt de Taillard dont
l’un des sommets est le Suc des Trois Chiens...

Puis les premiers colons civils romains découvrent les paysages du Pilat (photo www.paxaugusta.net)
<Retour au Sommaire du Site>
Si nous n’avions que ce genre de
coïncidences, cette étude n’aurait même pas raison d’être...
Mais le dieu Hasard a semé d’autres petites graines qui ne demandent
qu’à germer ! Sur le versant nord de la vallée du Gier,
aux frontières des départements du Rhône et de la Loire,
le charmant village de Dargoire étage ses maisons sur le coteau. Il
doit son nom à une contraction de l’appellation primitive D’Argoire,
elle-même formée à partir du gaulois Argo Durum, « forteresse
d’Argo ». Cet Argo était-il un chef gallo-romain établi
en ce lieu ? Ou faut-il comprendre qu’il s’agissait d’une place dédiée
au souvenir des Argonautes, aux temps gréco-romains ? Car la
coïncidence est trop belle et laisse la porte ouverte à toutes
les rêveries !
On peut faire dire ce qu’on veut
à de telles bizarreries, ou en tirer des interprétations audacieuses,
mais voici que l’archéologie vient nous apporter un nouvel élément !
Le magnifique musée de Saint-Romain-en-Gal conserve une mosaïque
représentant l’enlèvement d’Hylas. Elle fut découverte
à proximité immédiate, sur la commune limitrophe de Sainte-Colombe,
puis exposée pendant longtemps au musée des Beaux-Arts de Grenoble
avant de revenir sur son lieu d’origine. Là il n’est plus question
d’approximations, cette scène est clairement extraite de l’aventure
des Argonautes et montre Hylas, parti chercher de l’eau, tombant sous le
charme de deux nymphes, qui vont l’entraîner vers leur source où
il disparaîtra à jamais.

Scène d’intérieur dans une maison romaine. En arrière-plan, la mosaïque de l’enlèvement d’Hylas (photo www.paxaugusta.net)
<Retour au Sommaire du Site>
Il faut rappeler qu’Hylas est aussi
l’un des personnages du roman « l’Astrée »,
d’Honoré d’Urfé, lequel établit comme principe que le
Forez, nouvelle Arcadie, était une région gouvernée
par les femmes, tout comme la civilisation des Pélasges, depuis qu’Hercule
était venu s’y installer avec son épouse. Revisitant les mythes,
Honoré d’Urfé avait fait de l’enlèvement d’Hylas un
gracieux épisode d’amour. Enfin la présence d’Hercule dans
le Forez était également évoquée par un prêtre
contemporain de Dom Polycarpe de la Rivière, poète à
ses heures, nommé Louis Jacquemin. Son long poème intitulé « Antiquitez
du lieu de Saint-Genez de Malifaut et environs », écrit
en 1623, conte une antique bataille livrée par « Hercule
et ses soldats gaulois » contre les brigands qui infestaient les
bois du Pilat. Cette œuvre sur laquelle il y aurait long à dire, laisse une place de choix à la Langue des Oiseaux.
Que conclure ? Il est évident
que l’épopée des Argonautes a fait l’objet de développements
multiples, et les Romains ont largement puisé dans les thèmes
de la mythologie grecque pour décorer leurs maisons. Tous ces hasards
pris isolément ne signifient rien, mais leur accumulation est troublante
malgré tout. On peut aussi imaginer que le Pilat, pour les civilisations
antiques, offrait l’aspect d’une montagne peu accessible et donc énigmatique.
Au XVIe siècle, Jean du Choul le comparait encore à
un Olympe gaulois et y voyait « le siège de phénomènes
mystérieux qu’il faut voir pour croire » (6).
On dit encore que la déesse
Pallas plaça dans les cieux la nef Argo et tout son équipage,
où ils forment depuis lors plusieurs constellations... Depuis notre
région, si l’on observe les astres par une belle nuit d’hiver, on
remarque vers le sud un certain nombre d’étoiles très brillantes :
les plus élevées sur l’horizon sont Castor et Pollux, de la
constellation des Gémeaux. Au sud-ouest la longue constellation Éridan
déroule ses méandres. Entre les deux passe la voie lactée,
fleuve d’étoiles que l’on pourrait assimiler au Rhône. En la
suivant des yeux, on aperçoit, très bas sur l’horizon sud,
la Poupe de la Nef des Argonautes : telle l’Argo s’éloignant
en descendant le Rhône, elle disparaît à l’horizon, la
majeure partie de la constellation étant « de l’autre côté
». Mais juste retour des choses, son étoile principale Canopus
sert de balise aux engins spatiaux : c’est dans le ciel qu’il faut chercher
aujourd’hui le souvenir des Argonautes...
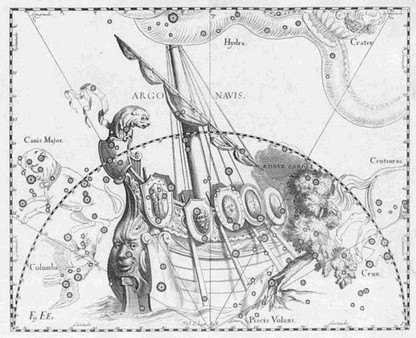
1
2 :
Numéro 5. Cette revue annuelle est éditée par l’association
« Visages de notre Pilat ».
3 : Richard Khaitzine,
« La langue des Oiseaux », chapitre 4, Dervy
1996.
4 : Albert Dauzat,
« Dictionnaire étymologique des noms de lieux en France» .
5 : D’après
Albert Dauzat, op. cit.
6 : Jean du Choul
est l’auteur de la toute première description du Mont Pilat (« De
monte Pylati », 1555). À ce sujet, voir aussi le chapitre
« Des fils du brouillard aux fils de Goulia »,
dans le tome I de « La Société Angélique ».
un spécialiste reconnu, qui intervient dans de nombreuses énigmes, réparties sur un large territoire.
<Retour au Sommaire du Site>
|
Ami de beaucoup plus longue date avec Roger
Corréard, l'archiviste auto-proclamé de Théopolis, et
de Patrick Berlier, le Druide du Pilat, Michel Barbot est entré en
contact avec moi après avoir lu "Le Vieux Secret", mon premier ouvrage.
Avec ce personnage chaleureux, sincère et profondément humain,
ou plus encore, là aussi, humaniste, nous avons échangé
avec implication, sur ces sujets passionnants et attenants au souterrain
de Trèves. Il est progressivement devenu un très grand ami.
Il a éclairé d'un regard nouveau certains pans de cette enquête
pointue et exceptionnelle. Vous pouvez retrouver plusieurs articles sous
sa signature dans les archives "Trèves
et son énigme". A présent, il a complètement intégré
notre équipe rédactionnelle des Regards du Pilat et collabore
également indépendamment avec plusieurs revues nationales dont
le renom n'est plus à faire. On citera particulièrement : Sentinelle
News, Pégase et Atlantis. Précis, réfléchi et
doté d'un esprit novateur, il a régulièrement matière
à proposer d'autres angles pour appréhender des problématiques,
énigmes et investigations plutôt difficiles. Fidèle,
il entretient des amitiés épistolaires dans une atmosphère
conviviale, avec des personnages d'horizons divers, et ainsi contribue solidement,
dans une réciprocité naturelle et de confiance, à avancer
sur bien des sentiers et chantiers, parfois très délicats.
Pour moi il est une très bonne image du chercheur et ceci à
bien des titres. Être en phase, partager un esprit d'approche, ouvert,
tolérant, progressiste, de bonne harmonie, s'assimilent chez Michel
à des réalités extrêmement concrètes, que
j'ai la chance de vivre avec lui, toute l'année, car à ses côtés
en permanence, même s'il vit dans l'Ouest de la France. Il a des compétences
spécifiques dont nous allons prendre connaissance dans l'interview.
Thierry Rollat.
|

|
Michel Barbot : Il apparaît
évident que l’abbé Chavannes de Trèves n’a pas présenté
au lecteur tous les éléments qu’il possédait. Ainsi
que je le développe dans mon article « l’Énigme
de Trèves – Théodore Ogier et l’abbé Chavannes »,
il révéla au travers de mots choisis avec précision,
des clefs permettant de percer, en partie, les ténèbres
protégeant l’accès au souterrain et donc à son ‘’contenu’’.
Ces clefs apparaissent tout à la fois étymologiques et numériques.
On peut penser également que l’historiographe Th. Ogier, conscient
que les sites voisins de la « Croix Saint-Adon », du
château des Chances ou de Tartaras (pour ne citer que ces trois lieux) ne seraient pas étrangers au « Vieux
Secret », se soit rapproché des érudits locaux,
proches de l’abbé de Trèves…
Regards
du Pilat : Doté
d'un esprit d'analyse conséquent, vos connaissances en matière
d'ésotérisme sont importantes. Pensez-vous que dans l'énigme
de Trèves il faille rechercher dans ses directions, quelques précieuses
explications ? Y a t'il eu selon vous des cryptages semés ici ou là
?
Michel Barbot : Il
me paraît certain que les paroles de l’abbé Chavannes relatées notamment par Th. Ogier, comportent quelques cryptages. Lorsque j’évoque
une clef numérique, je fais allusion aux nombres 22 et 14 mis en valeur
dans l’article précité. Le premier
nombre se révélait à partir du mot RUES figuré
par deux fois, tandis que le second apparaissait avec les lettres E P V E
– T O B L (notamment anagramme des mots BÊTE et LOVP ― identité
latine du U et du V…). Si l’adition de ces deux
nombres révèle le nombre 36, nombre important de
André Douzet émet ensuite
une nouvelle hypothèse relative aux ultimes paroles de l’abbé
Saunière. Elles pourraient comporter un aspect prophétique
en rapport avec le pape Jean XXIII qui fut en 1935 l’auteur de prophéties
publiées notamment par les éditions J’ai Lu. À la fin
du livre apparaît la liste dite des 26 noms (26 comme les 26 lettres de notre alphabet).
La dernière, que je nommerai
MARLE
― Tu te reconnaîtras quand tu te verras sur
Cette
prophétie dès plus hermétique est titrée MARLE.
Ce mot apparaît dans les dictionnaires d’ancien français avec
le sens de « mâle ». Ce « MARLE »
est lié à
Regards
du Pilat : Depuis
votre lecture approfondie du Vieux Secret, on peut raisonnablement penser
que vous avez eu en partie le temps de digérer le contenu de cette
enquête. Vos convictions vous portent t'elles à penser que nous
soyons face à une énigme majeure et complexe ?
Michel Barbot : Ma
lecture du « Vieux Secret » et la réflexion
qui en a découlé me donnent effectivement à penser que
nous sommes face à une énigme majeure mais au combien complexe.
Que cette énigme soit de nature royale et trésoraire, ne fait
pour moi aucun doute mais je me garderai bien dans l’immédiat d’épiloguer
sur la nature précise de ce legs. Ainsi que j’ai coutume de le dire :
« À chacun son Graal… ! » La localisation
d’un même trésor varie suivant les auteurs, et même
de livre en livre, pour certains de ces auteurs… alors prudence !
Regards
du Pilat :
Vos premières approches du Pilat, bien antérieure à
l'énigme de Trèves, vous les devez à Patrick Berlier.
En ayant pas mal travaillé avec lui sur plusieurs sujets présentés
dans ses derniers livres, que retenez-vous précisément de ces
colossaux travaux que sont les deux tomes de la Société Angélique
?
Michel Barbot : C’est
vrai que jusqu’à ce jour, Patrick Berlier et moi, nous avons pas mal
travaillé sur les sujets présentés notamment dans ses
deux derniers livres consacrés à
La
devise de
Certains
auteurs ont également rapproché le mot grec ARCADIA de l’araméen
ARQÂ, nom donné suivant le Zohar (grand livre de la tradition
hébraïque) à l’une des sept planètes habitées.
La planète ARQÂ n’apparaît qu’une seule fois dans
Les traducteurs bibliques préfèrent traduirent Arqâ et Aréa par le même mot : « Terre », alors que, suivant le Zohar, il s’agit de deux terres bien distinctes mais complémentaires. Aréa, nom araméen de notre terre, est associée à Arqâ, planète à la double articulation, formée de deux parties, l’une toujours inondée de lumière et l’autre toujours plongée dans les ténèbres. Deux chefs régnaient dit le Zohar, sur Arqâ à la venue de Caïn sur cette planète. Caïn opéra l’union de ces deux « chefs » qui, bien qu’unis possédaient deux têtes… symbole d’un gouvernement bicéphale. Ce verset du Livre de Jérémie évoque une sélection parmi les Elohim, seuls quelques uns d’ente eux, suivant le Zohar peuvent circuler librement, à la fois sur notre Terre et sur celle d’Arqâ.
Les Elohim, les Anges originaires d’Arqâ mais seulement ceux détenteurs de Déah : la « Connaissance » (l’ARQÂ DÉA) peuvent utiliser la « fissure du rocher » permettant suivant le Zohar de passer entre les deux terres. En araméen, les trois premières lettres du mot ARQÂ écrivent le mot ÉRAQ désignant un « clepsydre », soit une horloge à eau…
Les membres de
Regards
du Pilat :
D'une manière générale, les pistes qui mènent
à Rennes-le-Château sont nombreuses et ce au départ de
multiples régions. Justement que vous inspirent les liens présumés
avec le Pilat (Marie-Madeleine, Girart de Roussillon et les Mérovingiens,
Ste Croix, la célèbre Toile Volée, Dom Polycarpe...)
?
Michel Barbot : La réponse à cette
question est loin d’être simple ! C’est vrai que les pistes qui
mènent à Rennes-le-Château, sont nombreuses. Il est un
fait, Marie-Madeleine est venue en Gaule mais la question est : « Dans quelle partie secrète
de
Reste évidemment l’idée du trésor ; est-il un, est-il multiple ? Tous répondent unanimement : « Il s’agit du trésor d’Israël ». Ce qui d’ailleurs semble cohérent. Mais ce trésor fut-il réparti en un seul et unique endroit ? Pour moi la réponse est négative. Il existe à n’en pas douter plusieurs gîtes secrets du Lion répartis en des lieux bien précis à laquelle la « Géographie sidérale » de Guy-René Doumayrou (éd. 10 18) couplée aux travaux de Roger Facon n’est assurément pas étrangère ! De même, le « trésor » est-il rentré en Gaule en sa totalité avec les Wisigoths ? Là encore, la réponse me paraît négative. Des juifs ont pu déjà, bien avant l’arrivée des Wisigoths, pénétrer notre sol avec un « trésor », tout comme les Templiers aux XIIe siècle ont pu pareillement ramener – notamment – l’Arche d’Alliance dans le Royaume de France.
Il m’est difficile d’associer tous les noms
évoqués dans la question, bien qu’il y ait, à n’en pas
douter un lien unissant tous ces personnages ou ces œuvres d’art, qu’il s’agisse
de
Regards
du Pilat :
Non sans lien avec Rennes-le-Château. Pouvez-vous nous parler du Parc
de la Garenne-Lemot, près de Nantes, créé par le sculpteur
lyonnais Lemot, dans lequel est reconstitué le tombeau des Bergers
d'Arcadie de Poussin, un protagoniste qui revient dans les thèses
explicatives du mystère "Saunière" ?
Michel Barbot : Le
Parc de
Au lendemain des guerres de Vendée
en 1798, le peintre Nantais Pierre Cacault (1744-1810), après avoir
poursuivi une carrière artistique à Rome jusqu’en 1793, s’installe
à Clisson. Son frère François (1743-1805), collectionneur
d’œuvres d’art, diplomate alors en poste à Rome, négociateur
du traité de Tolentino entre le Directoire et le Pape et de l’acquisition
par
Au
printemps 1805, Frédéric Lemot, sculpteur Lyonnais d’origine,
sur l’invitation des frères Cacault, fit le voyage de Paris à
Clisson. Grand-prix de Rome de 1790 et déjà artiste parisien
reconnu de tous, F. Lemot fut subjugué par le site clissonnais qui
lui rappelle l’Italie et la campagne romaine autour de Tivoli. Dès
son premier voyage, il acquiert le bois de
Il façonnera
Un
tailleur de pierres de Clisson, d’après un dessin de Mathurin Crucy,
exécute au sommet d’un rocher le tombeau à l’antique,
rectangulaire et surmonté d’un couronnement avec fronton et acrotères
aux angles. Une inscription peinte, aujourd’hui disparue, référence
à Virgile et à Nicolas Poussin, clamait : « ET
IN ARCADIA EGO »… devise de l’Angélique lyonnaise puis
parisienne que le sculpteur F. Lemot Lyonnais de naissance, ne pouvait que
faire sienne. Ce Clissonnais d’adoption resta néanmoins fidèle
à Lyon, cité pour laquelle il sculpta en 1825 l’énigmatique
statue équestre (
F. Lemot, concepteur de l’ensemble de son projet, fait appel pour la mise au net de ses dessins préparatoires, aux talents de l’architecte néo-classique Nantais Mathurin Crucy (1749-1826), grand-prix de Rome de 1774 et auteur de la majorité des édifices et des fabriques du parc. Au cours des années 1820 l’architecte parisien Pierre-Louis van Cleemputte succèdera à Mathurin Crucy. Après la mort de F. Lemot en 1827, ce fut son fils Barthélemy (1810-1883) qui poursuivit l’œuvre de son père dans la seconde partie du XIXe siècle.
Dans
son livre « Arsène Lupin Supérieur Inconnu »,
Patrick Ferté, bien que ne parlant aucunement des frères Cacault,
du sculpteur F. Lemot et du Parc de
Regards
du Pilat :
En chercheur ouvert et curieux, vous avez déjà planché
sur l'énigme qui entoure Rennes-le-Château. Vopus avez donc
quelques idées assez construites. En toute objectivité, pensez-vous
qu'un jour on validera enfin une thèse officielle et presque incontestable
sur la provenance de la fortune du curé Audois ?
Michel Barbot : Affirmer qu’un jour on validera une thèse officielle et presque incontestable sur la provenance de la fortune du curé Audois, est à ce jour encore très hasardeux. Il faudrait dans un premier temps connaître avec certitude la nature du « trésor » de l’abbé Saunière. Pour ma part, le « trésor » me semble – en partie – intimement lié au Pech de Bugarach, thème déjà abordé dans mes articles publiés par Pégase. J’évoque dans un prochain article appelé à paraître dans le Bulletin Pégase, des faits totalement inédits, prolongement de deux précédents articles.
Regards
du Pilat :
Dans vos différents travaux, vous faites fréquemment appel
à la Kabbale hébraïque. Pouvez-vous nous définir
en quoi consiste vraiment celle-ci et d'où vous vient cette attirance
prononcée ? Par la même, comment avez-vous acquis certaines
compétences en ce domaine apparemment très pointu ?
Michel Barbot :
j’ai
découvert
Regards
du Pilat :
Indépendamment vous vous passionné pour une interprétation
bretonne des quatrains de Nostradamus, personnage envoûtant qui a oeuvré
aux quatre coins de France et qui aurait dit-on séjourné occasionnellement
au château de Lupé dans le Pilat. Qu'en est-il de vos travaux
en rapport à ce décryptage breton ?
Michel Barbot : Certains quatrains de Nostradamus concernent
effectivement
Regards
du Pilat :
Vous écrivez pour des revues et magazines, vous collaborez avec des
correspondants à propos d'énigmes diverses, vous intervenez
aussi avec pertinence sur ce site. Vos points de vues demeurent très
appréciés. Peut-on raisonnablement penser qu'un jour vous publierez
un livre ? Avez-vous une idée sur le sujet éventuel ?
Michel Barbot : Publierai-je un jour
un livre dans lequel je développerai quelques unes de mes recherches ?
Dans l’immédiat je répondrais non et ceci par manque de temps.
Un jour, peut-être, lorsque je serai en âge de prendre ma retraite,
pourrais-je raisonnablement penser à écrire un livre. Je n’ai
à ce jour, il faut bien l’avouer, guère de retour sur mes articles.
Alors laissons le temps au temps et comme le disent nos voisins d’Outre-Manche :
WAIT AND
SEE… ATTENDRE ET VOIR !
Regards
du Pilat :
Michel, un grand merci et à bientôt sur ce site, où vous
nous présenterez, ce qui sera un appréciable complément
d'informations, d'études et de recherches, une belle surprise sur
un sujet qui appartient à la Grande
Affaire.
|
En Novembre prochain, avec notre ami Eric Charpentier, un
Dossier exceptionnel en perspective, où
nous étudierons :
La fameuse Fondation de la Chartreuse de Ste-Croix-en-Jarez |
<Haut de page> <Retour au Sommaire du Site> <Imprimer la page>