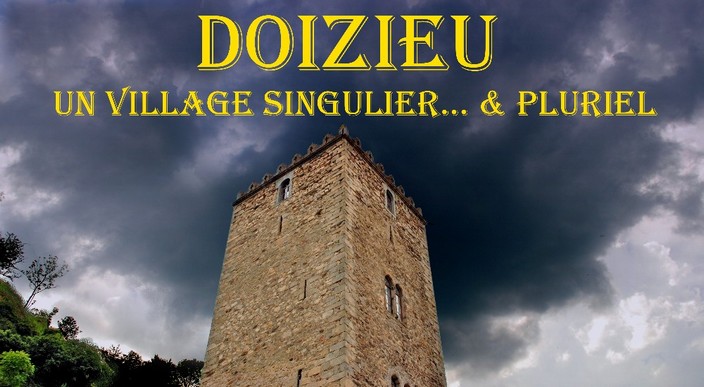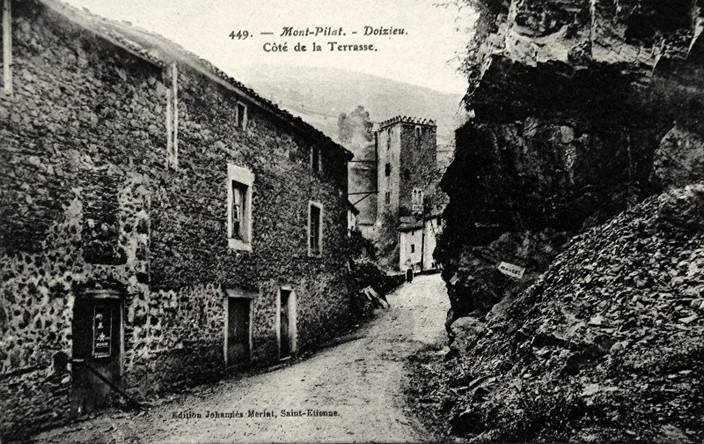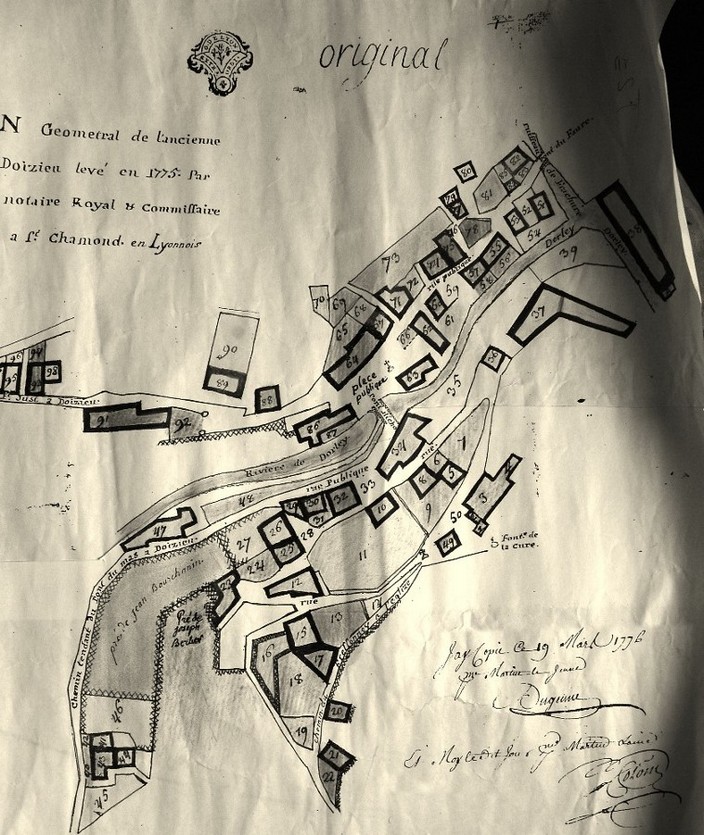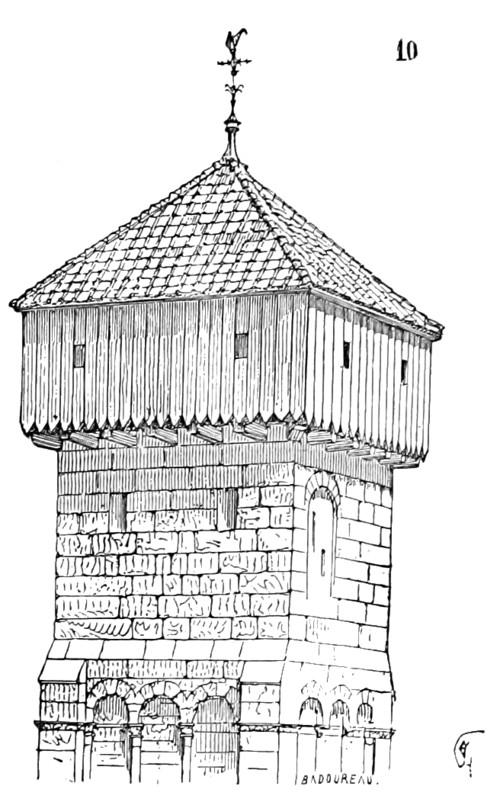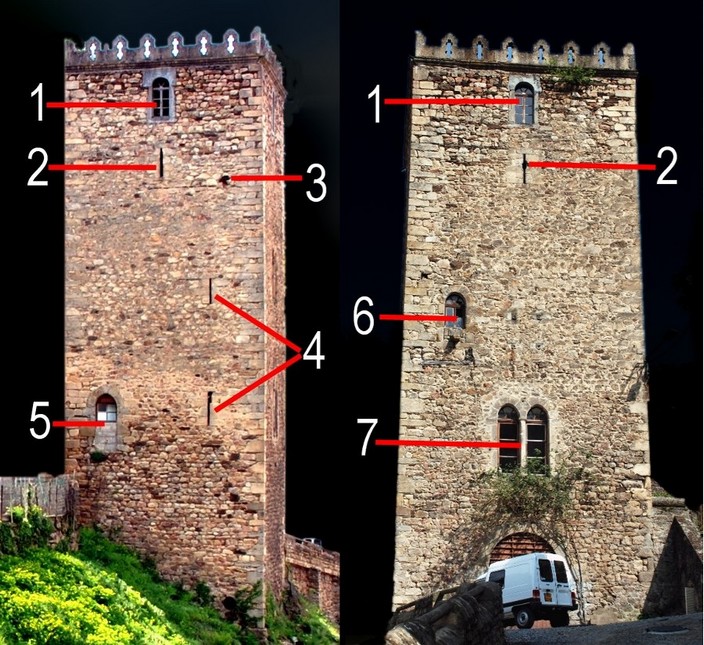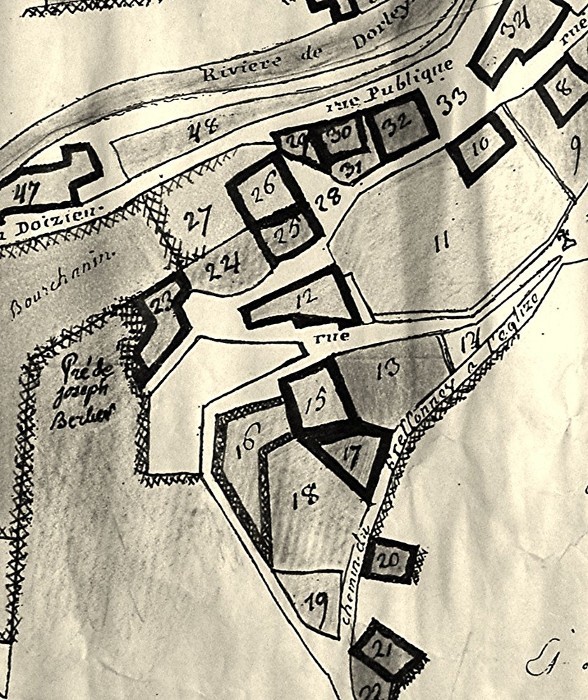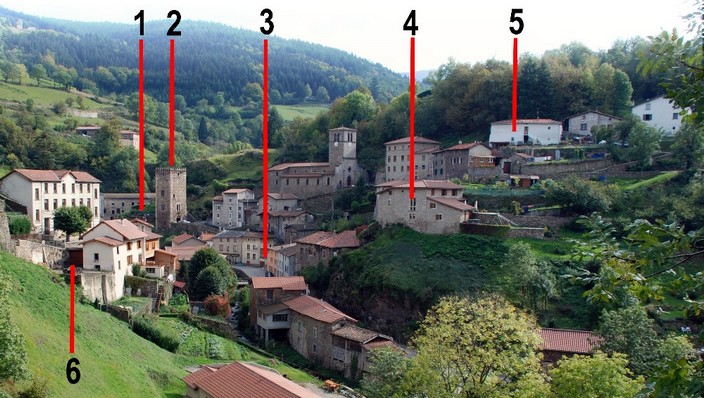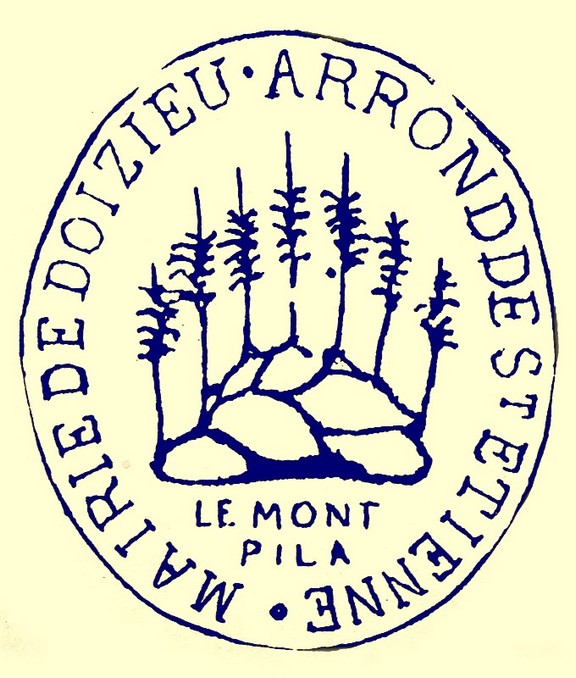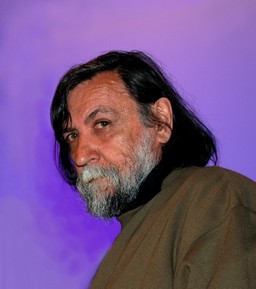Le Dossier de Juillet
2008
|
Par notre ami
Patrick Berlier
|
|
|
Au cœur du Pilat se cache un petit village paisible
et pittoresque, qui a su garder son charme par des restaurations intelligentes.
On le découvre en remontant la vallée du Dorlay depuis la Grand-Croix, par
Saint-Paul-en-Jarez et la Terrasse-sur-Dorlay. On arrive alors au creux d’une
combe encaissée où se rejoignent deux torrents dévalant des montagnes. Ici le
temps paraît s’être arrêté, les maisons qui s’agrippent aux coteaux abrupts ont
conservé leur cachet d’antan, elles semblent être surveillées par une haute
tour carrée crénelée, qui intrigue les visiteurs autant que la boulangerie où un
pain savoureux se cuit encore à l’ancienne, au feu de bois. Bienvenue à
Doizieu, dont le calme d’aujourd’hui cache un passé particulièrement tourmenté.
En digne descendant des Berlier établis ici depuis le Moyen-Âge, je serai votre
guide averti. Suivez-moi par les ruelles escarpées pour en découvrir tous les
vestiges chargés d’histoire.
|
|
UNE POSITION STRATÉGIQUE
La première mention de Doizieu remonte à l’an 812, sous
le nom de Doaciaco. Il est aisé de reconnaître dans ce nom celui d’un domaine
(suffixe –acum = domaine de) ayant appartenu à un gallo-romain nommé
Duatius. Ce patronyme est lui-même formé sur une vieille racine celtique ayant
donné le latin dux et le vieux français doit, désignant en
hydronymie un « conducteur », c’est-à-dire un canal, un bief
d’alimentation. À l’époque gallo-romaine, sur le site de Doizieu devaient déjà
être implantées un certain nombre de meuneries ou scieries actionnées par la
force motrice de l’eau. De même, le nom Dorlay est lui aussi composé à partir
d’une vieille racine celtique Dor- qui a donné bon nombre de noms de
rivières en France et en Europe. Mais le lieu constituait surtout un carrefour où
s’embranchaient plusieurs voies antiques. L’une allait en direction de Pélussin
par le Collet de Doizieu, une autre montait vers le Col du Planil, franchissait
à gué le Gier un peu en dessous de sa cascade, et se dirigeait vers le Vivarais
par la Croix de Chaubouret. L’alternance de cols et de gués est la
caractéristique classique d’une voie romaine, ainsi qu’il est expliqué dans
notre dossier « Pilat Romain », consultable en rubrique Archives. Une
troisième voie antique se dirigeait vers la grande route de Saint-Chamond à
Pélussin et Condrieu, au niveau de la Terrasse, et la dernière grimpait vers la
montagne pour franchir le Pilat quelque part entre la Perdrix et l’Œillon et se
diriger ensuite vers la vallée du Rhône par Maclas. De ce passé ancien, il ne
reste que très peu de vestiges, en particulier rien qui permette d’affirmer
l’existence d’un habitat gallo-romain à ce carrefour.
|
|
L’arrivée très étroite sur Doizieu par la route de la
Terrasse, ancienne voie romaine
(Carte postale début du XXe siècle)
|
<Retour
au Sommaire du Site>
|
Le document de l’an 812 est conservé à la Bibliothèque
Nationale. Il s’agit d’une transaction concernant une église située « sur
la côte de Doizieu », probablement l’église de Saint-Just. Position
stratégique à l’époque romaine, Doizieu conserva naturellement ce rôle dès le
haut Moyen-Âge. La région était alors sous l’autorité des comtes de Lyon, qui
en ces temps-là commençaient à se faire appeler comtes de Forez. C’est à cette
époque que s’éleva un différend entre les comtes et les archevêques, les
premiers contestant l’autorité des seconds dans le domaine du temporel. La
controverse finit par dégénérer en lutte armée, les comtes ignorants de l’issue
du conflit se réservant la possibilité de se retirer sur la partie occidentale
de leurs terres. C’est ainsi que naquit le comté de Forez, d’abord purement
virtuel, ne prenant consistance que lors du traité de Tassin en 1173, signé
entre Guy II de Forez et l’archevêque de Lyon. Par cet acte, qui n’était pas
autre chose qu’un contrat de vente, Guy II cédait une partie de ses terres à
l’Église. Discuté parcelle par parcelle, le traité aboutit à des situations
curieuses : c’est ainsi que le village de Doizieu, littéralement pris en
otage, se retrouva coupé en deux, une partie restant aux mains du comte de
Forez, l’autre passant dans l’escarcelle de l’Église de Lyon. Situation
complexe, car le Lyonnais appartenait alors au Saint Empire romain germanique,
et le Forez était une terre féodale alliée du roi de France. Non content d’être
partagé entre deux comtés, Doizieu se retrouvait divisé entre deux états ! La situation est
parfaitement résumée par le Dictionnaire Topographique du Forez qui
signale que le village dépendait de deux mandements : « Celui de
Doizieu appartenant au chapitre de Lyon, et celui des Farnanches à la famille
de Lavieu. Ils étaient tous deux pourvus d’un château fort. »
L’ensemble de la paroisse restait cependant sous le pouvoir spirituel du
diocèse de Lyon : deux châteaux forts, mais une seule église !
|
|
À la recherche
des châteaux perdus
Pour établir l’histoire féodale de Doizieu et
reconstituer la liste des seigneurs qui s’y sont succédés, il convient donc de
distinguer les deux châteaux. Du côté forézien des Farnanches, les Lavieu
formèrent plusieurs générations de seigneurs. Du côté lyonnais de Doizieu, se
succédèrent les Guidon de Laire et les Mitte de Chevrières. En 1597 les deux
seigneuries furent finalement réunies en une seule, Jacques Mitte de Chevrières
ayant acheté les Farnanches pour 3000 écus d’or. En 1768, ses descendants
vendirent la seigneurie de Doizieu au marquis de Mondragon. De ce château il
subsiste une belle tour carrée, du début du XIVème siècle, qui domine
toujours le village. Ancien donjon, ou plutôt tour-réduit, plus récemment elle
servit longtemps de mairie, avant que la municipalité ne l’abandonne au profit
d’un bâtiment plus vaste et plus fonctionnel, sur la place centrale du village.
Du corps principal du château de Doizieu, il ne reste rien. Son existence et sa
situation ne nous sont connues que par un plan géométral levé en 1775, conservé
en mairie. Il s’élevait à l’emplacement de deux terrasses, aujourd’hui occupées
par un chenil et un jardin, à côté de la tour. Le plan représente à cet endroit
un bâtiment en L portant sur la légende l’appellation « masures du
château du seigneur de Doizieu ou Delaire. » On ignore tout de son
aspect. Ses pierres furent sans doute récupérées pour être réutilisées
ailleurs.
|
Détail du plan : le n° 36 correspond à la tour, le n°
37 aux « masures » du château de Doizieu

Emplacement du château (1 – en clair) et la tour (2)
|
|
La tour aujourd’hui désaffectée est l’objet de plusieurs
projets de réhabilitation, visant à lui redonner son aspect primitif. Les
« créneaux d’opérette » qui la couronnent ne sont évidemment pas
d’origine. Une discussion s’élève pour savoir si on doit reconstituer ce donjon
avec des créneaux, ou simplement coiffé d’un toit. Le Forez pittoresque et
monumental, ouvrage de référence de Félix Thiollier, donne cette précision
importante : « à l’étage supérieur… les quatre ouvertures jadis
carrées, servant à passer sur les hourds, ont été converties en fenêtres plein
cintre modernes. » Apparemment, le donjon ne possédait donc pas de
créneaux, mais seulement une ouverture sur chaque face pour passer sur les
hourds. Comme l’explique Eugène Viollet le Duc (1), le hourd « est un
ouvrage en bois, dressé au sommet des courtines ou des tours, destiné à
recevoir des défenseurs, surplombant le pied de la maçonnerie et donnant un
flanquement plus étendu, une saillie très favorable à la défense. »
Les hourds étaient faciles à mettre en place en quelques heures en cas de
troubles, et démontables tout aussi rapidement une fois le calme revenu. On
peut en voir encore à Carcassonne, en particulier. Généralement, les tours
destinées à être équipées de hourds étaient coiffées d’un toit, les toits des
hourds en constituant le prolongement.
|
Un exemple de hourd sur une petite tour carrée :
Le donjon de Doizieu devait offrir à-peu-près cet aspect
|
|
Les
hourds réclamaient que soient aménagés des trous
dans la maçonnerie, destinées à y insérer
les poutres porteuses. À Doizieu, presque
tous les trous de hourds ont été rebouchés, mais
il en subsiste encore quelques
uns, qu’un un œil exercé peut remarquer, au même niveau
que de la base des
meurtrières du haut. Car la tour conserve toujours, sur ses
quatre faces, les
étroites archères qui assuraient sa défense. Les
élégantes fenêtres à baies
géminées ont par contre été percées
postérieurement. Côté sud-est, au levant, on
observe que si la meurtrière du haut est bien au centre de la
face, les deux
situées en dessous sont déportées vers la droite,
leur axe de tir s’en trouvant
dès lors décalé. En fait, le donjon se trouvait
dans le prolongement du château
proprement dit. Ainsi ces meurtrières avaient-elles
été décalées pour s’écarter
de la masse du château et en même temps protéger sa façade. Les portes
actuelles de la tour sont récentes, mais on remarque encore la petite porte
d’entrée d’origine, de forme ogivale, placée à une certaine hauteur et
décentrée. Le plan de 1775 montre que le château n’était pas accolé au donjon,
on devait accéder de l’un à l’autre par une passerelle amovible, au niveau de
cette porte. Une fois la passerelle retirée, le donjon protégé par ses hourds
devenait quasiment imprenable. Sur la face nord-ouest, au couchant, on remarque
une autre ouverture décentrée, au niveau du deuxième étage, qui était peut-être
une porte ouvrant sur le chemin de ronde des remparts. L’observation attentive,
alliée à la logique, permet d’envisager ces éventualités.
|
Quelques détails significatifs du donjon de Doizieu
1 : anciennes ouvertures servant à passer sur les
hourds
2 : meurtrières
3 : trou de hourd
4 : meurtrières décentrées
5 : ancienne porte d’entrée, accessible par une
passerelle depuis le château
6 : ancienne porte donnant sans doute sur le chemin de
ronde
7 : baies géminées ouvertes postérieurement
|

|
L’emplacement du château des Farnanches semble encore
plus incertain pour la plupart des historiens, qui le situent très vaguement
« de l’autre côté du Dorlay. » Il n’en est rien en réalité, le plan
de 1775 positionne précisément deux bâtiments de Doizieu, une grange et une
maison, édifiées « sur les masures du château des Farnanches. »
De la grange il ne reste que quelques murs et le portail, mais la maison existe
toujours, c’est la plus élevée de Doizieu, tout en haut du raide chemin du
Fressonnet. Elle est facilement repérable car elle est peinte en blanc, et elle
a conservé une allure massive, soulignée par sa façade quasiment aveugle. On se
rend compte que les deux châteaux étaient en vérité à une portée d’arbalète
l’un de l’autre !
|
Détail du plan ancien : les n° 15 et 17 correspondent à
l’ancien château des Farnanches

Le donjon et le village vus de l’ancien château des
Farnanches
|
|
Malgré la double nationalité, plus théorique que réelle,
la vie quotidienne ne devait pas offrir beaucoup de différences entre les
habitants foréziens ou lyonnais. La cité était alors entièrement confinée entre
la rivière et la colline contre laquelle elle s’adossait. Du côté de la rivière
il existait sans doute une ligne de remparts, entourant l’ensemble du village. Difficile
d’en tracer les contours, le temps a fait son œuvre. On peut imaginer que la
muraille allait du donjon, côté Doizieu, à cette maison, côté Farnanches, posée
sur des rochers et formant une avancée surplombant le Dorlay. Ce bâtiment, où
des créneaux semblent encore visibles, peut être imaginé comme une sorte de
barbacane, un poste avancé et fortifié. De là, le rempart devait remonter en
direction du château des Farnanches. Quant à la porte, elle se situait sans nul
doute près de la rivière : en en devine encore l’emplacement, entre la rue
du Moulin et la place de la Platière, où une courte voie en pente, formant
aujourd’hui encore le seul accès au vieux village de ce côté-là, se subdivise
en deux ruelles, la rue de la Tour à gauche et la montée de la Pichelière à
droite.
|
|
Panorama de Doizieu et ses points importants
1 : emplacement du château de Doizieu
2 : donjon
3 : emplacement de la porte
4 : ancienne barbacane
5 : bâtiment sur l’emplacement du château des
Farnanches
6 : soubassements de la maison forte de Jean Pierrefort

Emplacement de la porte, toujours entrée du village ancien
Enfin il faut noter que le plan de 1775 signale également
qu’un bâtiment fut jadis la maison forte de Jean Pierrefort, lieutenant et juge
de la juridiction de Doizieu. Cette maison était bâtie de l’autre côté du
Dorlay, sur le coteau opposé au village, au bord de la route de Saint-Just.
Mais on ignore à quelle époque elle remonte. Il n’en reste aujourd’hui que les
soubassements.
|
<Retour
au Sommaire du Site>
|
LA DESCRIPTION DE JEAN DU CHOUL
Publié en 1555, le livre de Jean du Choul constitue la
toute première description du Pilat, bien que très partielle. Partant de sa
maison de Longes, l’auteur montait sur les crêtes, allant jusqu’au Bessat et
même s’aventurant dans le Grand Bois, et rentrait par Doizieu, la Croix du
Mazet et Sainte-Croix-en-Jarez. S’il ne dit rien sur cette dernière étape, il
est par contre fort bavard sur Doizieu et ses habitants, qu’il décrit avec une
pointe d’humour caustique.
Les eaux de la Doyse
baignent le pied de cette montagne boisée. Ce ruisseau, grossi par ses
affluents, se jette dans le Rhône, après avoir réuni ses eaux à celles du Gier.
Quand la Doyse est enflée par la fonte des neiges, elle mugit en descendant du
Pilat, et s’élance comme un torrent furieux, en inondant ça et là les
campagnes.
Les habitants les plus
rapprochés de ces forêts sont ceux de Doyzieux. Ce village tire son nom des
eaux qui baignent ses murs. Ces montagnards sont remarquables par leur esprit
religieux et par la pénurie de leurs ressources ; mais la pauvreté, chez
eux, n’est pas un déshonneur ; de là vient leur âpreté au gain et leur
parcimonie dans la dépense. Ces vastes forêts leur offrent de grandes
ressources. Au lieu de rester inoccupés, ils confectionnent des ustensiles en
bois que leurs enfants vont vendre à la ville. Le manque de blé et d’argent les
force à être laborieux.
Quant à la nourriture de ces
paysans, les plus pauvres vivent principalement de fruits ; ils touchent
rarement à leurs troupeaux ; mais on les dit moins sobres à la table
d’autrui.
Les jours de fêtes, après
les saints offices, ils ont coutume, suivant l’usage de leurs ancêtres, de
s’inviter mutuellement à dîner ; puis, après le repas, de s’amuser à
divers jeux, à la danse et à la lutte.
Ces campagnards portent
toujours le même habit, pour se défendre des chaleurs de l’été ou des rigueurs
de l’hiver. Leurs souliers sont garnis d’une centaine de clous, pour ne pas
s’user facilement ; mais, à vrai dire, leur esprit est moins grossier que
leur vêtement.
Les femmes ont des formes
assez belles. Elles aiment à chanter dans les bois, à sauter en se tenant par
la main et, suivant la coutume du pays, elles savent aussi danser au son de la
voix et du chalumeau, en portant les mains et les pieds en avant ; toute
leur danse est très animée.
(Traduction
d’Étienne Mulsant)
Jean du Choul est sans doute le seul à donner au Dorlay
le nom de Doyse. En ancien français, dois ou doiz désigne une
conduite d’eau, le mot vient du latin ductum. On se rend compte que
cette Doyse n’est qu’une variante mâtinée de latin de l’hydronyme celtique Dor
déjà évoqué.
|
|
LÉGENDES ET CURIOSITÉS
On ne peut pas parler de Doizieu sans évoquer la terrible
légende de la Roche du Suaire, escarpement rocheux à pic faisant face au
village, de l’autre côté du Dorlay, près du confluent avec le ruisseau de la
Frachure. L’histoire se passe à l’époque où commence la croisade contre les
Albigeois, c’est-à-dire au début du XIIIème siècle. Le seigneur de
Doizieu, un nommé Roger Plantevelu, décide d’y participer, sans doute croyant y
sauver son âme. Il part avec son host, ne laissant au château que quelques
domestiques, un écuyer, le chapelain, et surtout sa fille Blanche, promise au
fringant Renaud de Malleval. Il la place ainsi que son fief sous la protection
du sire de Saint-Paul, le seigneur des Farnanches. Mauvaise idée, car le sire
que l’on peut qualifier de triste a bien caché son jeu. Roger n’est pas encore
arrivé en terre occitane, que Saint-Paul, profitant de sa position de
protecteur désigné, prend possession du château de Doizieu, comptant bien aussi
par la même occasion posséder la fille. Le chapelain s’interpose, offrant son
corps en rempart, le sire des Farnanches le trucide sans état d’âme. Blanche se
présente dès lors comme une proie facile, mais la damoiselle, qui paraissait si
frêle, défend sa vertu avec tout le courage de son innocence, et le félon ne
parvient point à ses fins. Saint-Paul se résout alors à se contenter du
château, et il fait enfermer Blanche dans une geôle de bas étage.
Le temps passe… Un jour, un fidèle écuyer de Roger
Plantevelu parvient à déjouer la surveillance des soldats des Farnanches, il va
prévenir Renaud de Malleval. Le beau seigneur, comme le Prince charmant des
contes de fées, vole au secours de sa belle. L’amour rend aveugle, et dans le
cas présent inconscient, car le fougueux Renaud parti attaquer seul le donjon
de Doizieu s’y retrouve piégé comme un débutant, et va lui aussi faire
connaissance avec la paille humide des cachots. L’écuyer décide alors d’aller
rejoindre son maître Roger dans le lointain pays des Cathares, priant Dieu de
l’y retrouver avant qu’il ne soit trop tard. Dieu entend ses prières sans
doute, car au bout de quelques jours de chevauchée son chemin croise celui de
Roger. Le seigneur de Doizieu s’en revient de la croisade : à peine
était-il arrivé en Occitanie qu’il a fait une mauvaise chute de cheval, et il
se serait sans doute brisé les reins dans un ravin si un solide gaillard du
crû, que la Providence avait placé là, ne l’avait retenu dans sa chute. Roger a
pris cela comme un signe du Ciel, il a abandonné toute idée de croisade et il rentre
avec son sauveur, qu’il a pris à son service. Lorsque son écuyer le rejoint c’est
pour lui apprendre l’affligeante nouvelle.
Roger Plantevelu et son host franchissent à marches
forcées la distance les séparant de Doizieu. En moins de temps qu’il ne faut
pour le dire, l’armée d’occupation est défaite, Roger se fait reconnaître comme
le seul maître des lieux, Blanche et Renaud sont libérés, et le traître est
ligoté sur un cheval. Roger va lui appliquer le châtiment réservé aux félons.
On bande les yeux de la monture, on la fait monter sur le coteau opposé, on la
dirige vers la falaise, qui servira de Roche Tarpéienne… Un coup de fouet sur
sa croupe et le cheval, entraînant le traître ligoté, chute dans le vide. L’homme
et sa monture s’écrasent sur les rochers, l’animal est tué sur le coup, mais le
sire des Farnanches agonisera pendant trois jours, le corps brisé emprisonné
dans son armure. Une âme sensible finira par recouvrir sa dépouille d’un suaire
de drap noir. Pendant ce temps Roger Plantevelu festoie avec sa fille retrouvée
et son fiancé. Il n’oublie pas son sauveur, qui a pris une part ardente à la
bataille. Il a décidé de l’installer sur ses terres, lui donnant en mariage
pour l’occasion une suivante de sa fille. Dans son lointain pays, l’homme
cultivait une plante comestible, la berle, il exerçait donc le métier de
berlier. Ce nom deviendra son patronyme. C’est ainsi que les Berlier ont fait
souche à Doizieu, en un lieu toujours nommé La Berlière. Ils ont depuis bien
essaimé dans la région…
|
La légendaire Roche du Suaire
|
<Retour
au Sommaire du Site>
|
Les légendes ne sont que ce qu’elles sont… Mais l’on ne
peut s’empêcher de trouver bien curieux le nom du seigneur de Doizieu, seigneur
imaginaire certes, mais la mémoire collective a peut-être renvoyé par ce nom
quelque reflet d’un passé oublié. Plantevelu ne doit pas se comprendre
« plante velue », il y aurait un E à la fin dans ce cas.
« Plante » est à prendre comme la forme conjuguée du verbe planter,
c’est un homme réputé pour « planter velu », c’est-à-dire engendrer
des enfants poilus. Dès lors tout un relent de croyances relatives aux
Mérovingiens refait surface… Les « rois velus », reconnaissables à
leur forte pilosité… Mais c’est peut-être attacher trop d’importance à un
personnage de conte de fées…
Terre de légendes, Doizieu se distingue aussi par
quelques originalités. Pendant des décennies, à l’époque où la mairie occupait
l’ancien donjon, Doizieu offrit la particularité d’être la seule commune de
France dont le cachet officiel ne représentait pas la République, mais un
chirat (2) planté de sept pins, droits comme des cierges. L’image du chandelier
à sept branches, la Ménorah, visible sur un vitrail pilatois (voir le dossier
« un bien curieux vitrail à Véranne » en rubrique Archives),
s’y décalquerait parfaitement… Sous le chirat de grosses pierres entassées apparaissait
la mention « Le Mont Pila ».
Sans T final… La commune finit par rentrer dans le rang, et adopta comme tout
le monde le tampon républicain. L’ancien cachet est cependant précieusement
conservé par la mairie, ce qui nous permet d’en montrer ici l’image, témoin
d’un temps révolu.
|
Exemplaire de l’ancien cachet de la commune
|
|
Et puis promenons-nous dans le village… Au pied de la
croix dont le socle sert également de fontaine, sur la place de la Platière, apparaissent
des étoiles sculptées… et des croix basques, assez inattendues en ce lieu… Le
plus étonnant, c’est que l’on retrouve la même croix basque sur un linteau de
porte, récupération probable d’un ancien linteau de cheminée, au début de la
ruelle montant vers la tour.
|
Les Croix basques
Socle de la
croix

Linteau rue de la Tour
|

|
L’ÉGLISE… ET SES CURÉS DÉMISSIONNAIRES
Le premier lieu de culte chrétien de Doizieu fut sans doute la chapelle
du château. Une première église paroissiale fut construite apparemment au XVIème
siècle, son abside a subsisté dans l’église actuelle qui date de 1804. Elle est
dédiée à saint Laurent, dont on peut voir la statue sur le parvis. On récupéra
pour l’occasion l’horloge de l’ancienne chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez,
qui avait cessé son activité peu de temps avant. Le mécanisme, mû par un
système de contrepoids, possédait trois cloches d’inégales grosseurs, sonnant
les quarts, les demies, et les heures. Puis au début du XXème siècle
on la remplaça par une horloge plus moderne, avec des cadrans placés sur deux
des faces du clocher. La commune de Sainte-Croix-en-Jarez réclama sa vieille
horloge, mais en vain. Pendant longtemps, l’un des contrepoids, un cube en
pierre, fut déposé sur le parvis, on pouvait y voir diverses inscriptions sur
ses deux de ses faces.
|
|

Deux photos anciennes du contrepoids de l’horloge de
Sainte-Croix-en-Jarez,
qui fut récupérée pour l’église de Doizieu puis abandonnée.
ci-dessus inscriptions 1631 A – P
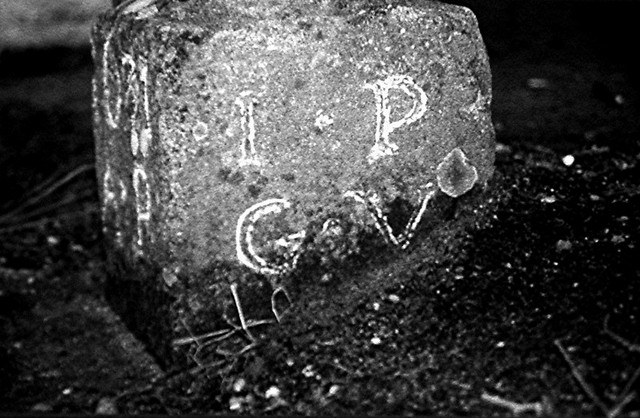
ci-dessus inscriptions I – P - G – V
|
La cure de la paroisse de Doizieu était installée
dans un gros bâtiment proche de l’église. Curieusement, entre 1582 et 1700,
plusieurs prêtres de Doizieu ont démissionné, remettant leur cure entre les
mains de l’archevêque de Lyon dont ils dépendaient, à charge pour lui de
désigner un successeur. Ces démissions furent enregistrées par des actes
notariés, conservés aux Archives Départementales de la Loire. En 1631 par
exemple, Messire Jean Clère, curé de Doizieu, se déclare résigné « à
remettre purement et simplement entre les mains d’éminentissime et
révérendissime Monseigneur Alphonse Louis Duplessis de Richelieu, Cardinal
Archevêque de Lyon, patron et collateur de la cure dudit Doizieu, ou de son
vicaire général, à savoir laditte cure ou église Parochialle dudit Doizieu avec
ses annexes droits revenus appartenances et dépendances d’icelle .» Le
curé ne précise pas les raisons de sa démission, se bornant à dire qu’il
« ne peut plus vaquer comme il est dit à desservir laditte cure ou
église paroissiale dudit Doizieu .» Selon une rumeur persistante, les
curés de Doizieu logés dans une cure adossée à la colline, donc humide, tournée
au nord, ne voyant jamais le soleil en hiver, jalousaient leurs collègues de la
nouvelle paroisse de Saint-Just, installés dans une cure bien exposée et agréable
à tous points de vue…
|
L’église de Doizieu aujourd’hui
|
<Retour
au Sommaire du Site>
|
De la ferveur religieuse des Doizerains, notée par Jean
du Choul, subsistent plusieurs croix. Sur la place de la Platière, une croix
moderne a remplacé la haute croix de 1547, haute de quatre mètres, offerte par
Louis de Laire, seigneur de Doizieu. On y voyait sur le croisillon, d’un côté
un Christ nimbé et de l’autre la Vierge, et sur le fut plusieurs statuettes
dont celles de Notre-Dame des Douleurs et de saint Laurent, patron de la
paroisse. Encore visible sur les cartes postales du début du XXème
siècle, cette croix, que l’on dit avoir été brisée par la manœuvre malheureuse
d’un camion, a disparu. Une autre croix orne le chemin du cimetière, elle date
de 1621 et on y retrouve le Christ, la Vierge et saint Laurent. On peut
signaler aussi sur la route de la Terrasse, un peu avant le pont sur le Dorlay,
la « croix de la quinarde », ainsi nommée parce qu’une femme y venait
tous les jours pour pleurer son fils décédé (en patois quinarde = pleureuse).
Sur le socle de cette croix on remarque une zone rectangulaire plus
claire : c’est tout ce qu’il reste de l’affiche annonçant la mobilisation
générale à la veille de la seconde guerre mondiale… à noter qu’un itinéraire pédestre balisé, au départ de
Doizieu, permet de voir par une randonnée facile l’ensemble des croix
intéressantes du secteur. Dépliant disponible en mairie.
|
Le donjon et la croix de 1547, au début du XXe
siècle
|
|
NOTES
(1) L’architecte Eugène Viollet le Duc, qui restaura la
cité de Carcassonne, est l’auteur du monumental Dictionnaire raisonné
d’architecture médiévale, un ouvrage de référence d’une rare érudition,
entièrement consultable sur Internet <ICI>.
(2) Pour les internautes étrangers à notre région,
précisons qu’un « chirat » est un vaste éboulis de pierres remontant
aux époques glaciaires. Les chirats sont caractéristiques du Pilat, ils se
distinguent des éboulis d’autres régions par leur nature géologique, composée
essentiellement de gneiss.
|
Nous présentons de vives félicitations à Patrick
pour avoir réalisé un Dossier à la fois copieux et
inédit. Il est temps à présent de retrouver notre
nouvel invité, l'audacieux Daniel Dugès.
|

|
Daniel Dugès est un peu un
touche-à-tout. Professeur d’arts plastiques, il se lance tout naturellement
dans la peinture, très influencé par les surréalistes, et présente plusieurs
expositions en diverses régions de France. Son goût pour les arts se développe
aussi dans le domaine musical : il écrit de nombreuses chansons,
enregistre trois disques, et se produit sur scène avec des amis musiciens
pendant plus de vingt ans. Sportif, il goûte au golf, au pilotage d’ULM, mais
surtout au tennis dont il deviendra professeur et joueur professionnel.
Passionné par l’aventure cathare, en enfant du pays (il est natif de
Montauban), il passe dans sa jeunesse toutes ses vacances sur les traces des
Parfaits. Cela ne fait que renforcer son attrait pour le mystère. Aussi se
passionnera-t-il pour l’affaire de Rennes-le-Château, lorsque le hasard
l’amènera en 1989 sur la célèbre colline du Razès.
Daniel Dugès se lance
aussitôt, à son tour, dans la recherche du secret de l’abbé Saunière. En homme
de terrain, il n’hésite pas à parcourir la région en tous sens, crapahutant
pour en découvrir les moindres recoins cachés. Son goût pour l’enseignement le
pousse à présenter de nombreuses conférences, et ses compétences
professionnelles l’amènent à s’intéresser plus particulièrement aux liens entre
Rennes-le-Château et Nicolas Poussin. Il publie le résultat de son travail dans
une brochure, Le secret de Nicolas Poussin, rééditée en 2006.
Parallèlement, avec un œil averti de peintre percevant peut-être ce que le
commun des mortels ne voit pas, il jette un regard neuf sur l’église de
Rennes-le-Château, son décor, et entrevoit alors une vérité cachée… Mais il est
temps de lui laisser la parole.
|
|
REGARDS DU PILAT : Bonjour Daniel. Demain est un autre jour, mais Bérenger
Saunière aura marqué votre existence et « usé », ou encore consommé de vos
cellules grises. Comment pouvez-vous expliquer l’engouement et son
exceptionnelle massive attirance en comparaison à tant d’autres énigmes
nationales ou encore internationales ?
DANIEL DUGES : Je pense qu’au départ il y a eu deux phénomènes,
l’attrait du trésor et le goût pour le “caché” ,le mystère. Avec le temps, le
trésor a perdu un peu de son aura, quoique certains le cherchent encore. En
revanche le goût de l’homme pour le mystère est quelque chose d’éternel, c’est
ce qui fait le fondement des religions. Comprendre l’incompréhensible est le
paradoxe à l’origine de toute quête. Tous les gens fascinés par cette histoire,
dans le monde entier, se retrouvent par leur goût naturel pour le mystère,
entraînés dans le tourbillon de la découverte du secret. Il y a toujours eu des
mystères fascinants, l’île de Pâques , le triangle des Bermudes, la construction
des pyramides etc. Mais cette histoire ici est plus forte car elle révèle
aujourd’hui une crise identitaire de notre société, puisqu’elle remet en
question le Christianisme qui est la base de notre civilisation. A travers
l’affaire de Rennes, et c’est ce qui a fait la force du Da Vinci Code, l’homme
du vingt et unième siècle cherche à savoir qui il est, en revenant sur son
histoire, sur celle de son art et en essayant de découvrir ce que l’on a pu ou
voulu lui cacher.
REGARDS DU PILAT : Il n’existe pas « une » manière de s’impliquer dans
l’affaire de «Rennes-le-Château ». Nicolas Poussin sera votre approche première,
tout au moins une publication personnelle en 2006, pour aller au-devant du grand
public. Aujourd’hui, comment pourriez-vous nous résumer l’importance de ce
personnage dans l’énigme castelrennaise ?
DANIEL DUGES : Effectivement tous ceux qui sont entrés en
recherche dans l’affaire de Rennes ont eu une accroche différente. Pour ma part
ce fut Poussin, sans doute pour des raisons professionnelles, je ne voyais pas,
à priori, pourquoi on mêlait ce peintre, assez austère de caractère, à cette
histoire. J’ai appris à apprécier ce personnage en travaillant sur son œuvre, et
sur sa vie. Le sérieux exemplaire dont le caractérisent ses contemporains fit
qu’on l’appela après sa mort le “peintre philosophe”, il fallait donc prendre au
sérieux son implication éventuelle dans l’affaire. Aujourd’hui on peut dire
qu’il est le premier à laisser filtrer un peu du secret. Grâce aux “Bergers
d’Arcadie” mais aussi à une grande partie de son œuvre nous entrevoyons une
vérité diffuse, qu’il a su protéger, derrière le voile de l’art. Mais il est
indispensable dans la recherche, car il est la caution du sérieux de
l’entreprise. Sans sa présence, l’affaire de Rennes n’aurait pu rester, pour
moi, que le dérapage d’un petit curé du XIXe.
REGARDS DU PILAT : A la fin des années 1980, vous avez posé votre premier
orteil sur la jolie colline du Razès, en tous les cas, la plus célèbre. Gérard
de Sède et Henry Lincoln, en ces époques qui certes s’éloignent, ne peuvent vous
avoir été indifférents. Avec ce recul, jugez-vous positives ou efficaces, les
évolutions des hypothèses, les développements postérieurs aux travaux respectifs
de ces deux personnages notoires que nous venons de vous citer ?
DANIEL DUGES : Il n’y aurait peut-être pas d’affaire de Rennes
sans les livres de Gérard de Sède, même si nous savons aujourd’hui, dans quelles
circonstances et sous quelles influences le premier livre a été écrit. Il a été
l’élément déclencheur de l’enthousiasme pour ce petit village de l’Aude, et son
livre “l’or de Rennes” est un élément fondamental que tout chercheur se doit
d’avoir lu. On a beaucoup critiqué le travail de Gérard de Sède au fur et à
mesure que des nouvelles hypothèses apparaissaient, pourtant à la relecture, on
se rend compte qu’un certain nombre d’informations qu’il détenait, même quand il
ne donnait pas ses sources, se sont avérées exactes. Dans son dernier ouvrage :
“Le dossier, les impostures, les fantasmes, les hypothèses”, il remet en
question une partie de ses travaux précédents et il touche de très prêt ce qui
sera pour lui une hypothèse et qui devient dans mon dernier ouvrage, pour moi,
une réalité. D’ailleurs je tenais à lui rendre hommage, car au milieu des
hypothèses farfelues une partie des siennes, en particulier dans son dernier
livre, nous paraissent maintenant bien solides. Quant à Henry Lincoln, il est
avec “l’énigme sacrée” un des moments incontournables de cette affaire. Même en
sachant aujourd’hui l’influence néfaste qu’a eu le pseudo “Prieuré de Sion” sur
son travail, il a soulevé par ce livre les enthousiasmes et provoqué sans nul
doute un grand nombre de vocation de chercheurs. Pour comprendre cette histoire
il n’est pas nécessaire d’avoir lu beaucoup de livres, peut être moins d’une
dizaine, ceux de Gérard de Sède et « l’Enigme sacrée » en font incontestablement
partie. Après eux, les choses se sont précisées, soit par leur contestation,
soit au contraire en contribuant à démontrer la justesse de certains détails,
mais on peut dire qu’ils ont été les catalyseurs de l’aventure castelrennaise.
Le bouillonnement culturel qu’a généré cette recherche a évidemment provoqué
l’apparition de théories qui ne me paraissent pas solides ou peu crédibles, mais
il n’y a pas de recherche sans fausses pistes, et on ne peut nier que la force
de l’imagination créatrice préside souvent à l’élaboration des hypothèses. La
seule chose que je déplore, dans le travail de certains chercheurs, est de
passer plus de temps à démolir les hypothèses des autres qu’à apporter de vraies
solutions. Ce n’est pas la peine de perdre du temps à dire ou à essayer de
prouver que tel ou tel chercheur a dit une bêtise, d’abord parce que ces
démonstrations sont souvent aussi ridicules que les hypothèses qu’elles
prétendent démonter, mais aussi, parce que devant la progression des travaux,
les idées erronées s’effondrent toutes seules, et la recherche
continue.
REGARDS DU PILAT : Vous êtes l’un des quatre auteurs principaux de l’ABC de
RLC, la première encyclopédie de Rennes-le-Château publiée au printemps dernier.
Comment avez-vous été amené à travailler à ce projet, que lui avez-vous apporté,
et que vous a apporté cette expérience ?
DANIEL DUGES
: C’est Christian Doumergue que je connais depuis quelques
années et avec qui s’est établie une relation
d’amitié, qui travaillait déjà sur le projet et
qui m’a présenté à Thierry Garnier. Celui-ci m’a
intégré à l’équipe et m’a
présenté à son tour à Patrick Berlier, avec
qui j’ai rapidement sympathisé. Je suis surtout intervenu dans
deux domaines : la géographie des lieux et des sites que je
connais bien, pour les avoir parcourus pendant vingt ans, et la
cryptographie qui est un domaine qui me passionne. Mais je suis loin
d’avoir fait toutes les “entrées” dans ces domaines, d’ailleurs
chacun de nous, s’il avait une couleur dominante dans ses
responsabilités, a travaillé sur des entrées
particulières dans lesquelles il s’avérait détenir
plus de connaissances. Je crois qu’aucun d’entre nous n’aurait
été capable de faire ce travail tout seul, l’ABC de RLC
est le fruit de l’affrontement de nos connaissances et de nos
spécialités. Sur beaucoup de sujets, nous étions
d’accord, mais pas sur tous, il a fallu gratter, aller chercher les
preuves et les références de ce que nous avancions avant
de pouvoir les intégrer dans l’ABC. En cela je crois que chacun
d’entre nous a appris des autres beaucoup de choses, et tout en
écrivant l’ABC nous avons fait avancer la recherche en
général, mais aussi nos propres connaissances, car la
vérification de certains éléments nous a
apporté bien des surprises. C’est pourquoi l’ABC n’est pas
seulement un livre de compilation mais c’est aussi un ouvrage de
recherche qui permettra à tout un chacun de faire un pas en
avant dans la connaissance de cette histoire. Je voudrais ici rendre
hommage à Thierry Garnier qui a su ménager les
sensibilités, et organiser le travail de chacun de nous et
nous demander d’aller toujours plus loin au fond de nos
ressources. Sans parler du travail de gestion des informations, car
s’il y a quatre auteurs principaux, il y a en fait douze
collaborateurs. Imaginez sur l’ensemble des sujets traités, la
masse incroyable d’informations que notre homme a du orchestrer. Il
fallait toute sa persévérance et son talent pour aller au
bout de l’entreprise. Mais il y est arrivé le diable et avec
ça nous, les auteurs, non seulement sommes toujours amis mais
sans doute plus près que nous ne l’avons jamais
été.
REGARDS DU PILAT : Après cette collaboration, et la publication de votre
propre livre sur les liens entre Nicolas Poussin et Rennes-le-Château, il est
clair que vous faites partie des spécialistes de ce mystère, ce que confirme
votre engagement au sein de l’association Terre de Rhedae. Quelle est votre
vision personnelle de l’énigme de Rennes-le-Château ?
DANIEL DUGES : Personnellement ayant abordé l’histoire par le
biais de Nicolas Poussin je n’ai jamais été vraiment attiré par l’idée d’un
trésor, même si trésor il y a ou si trésor il y eut. D’abord parce que l’idée
d’un trésor ne me “branche” pas tellement, et surtout parce que l’attitude de
Béranger Saunière ne m’a jamais paru être celle d’un inventeur de trésor. Assez
rapidement je me suis orienté vers un secret qui aurait concerné le Razès, et en
particulier d’un secret religieux. j’ai eu l’occasion d’avoir en main des
documents privés qui se rapportaient à cette affaire et qui confirmaient
l’hypothèse de ce secret, dont la région de Rennes-les-Bains aurait été
l’épicentre. Ce que confirme le livre incontournable, mais difficile d’accès, de
l’abbé Boudet. Mais les propriétaires de ces documents ne souhaitant pas qu’il
soit fait de la publicité autour d’eux, je ne peux en parler plus. j’ai toujours
essayé de traiter cette affaire en historien, c’est-à-dire de ne pas avoir
d’idées préconçues. Si l’idée du trésor ne m’intéressait pas, je n’ai jamais
exclu l’idée qu’il pouvait y en avoir un. Certains éléments me laissent à penser
qu’il y a effectivement un dépôt d’objets anciens et précieux, mais auxquels
l’abbé Saunière n’aurait jamais eut accès. En revanche toutes mes recherches me
portent à penser qu’il y a un secret, dans le Razès, lié à la tombe de Marie
Madeleine et à l’éventuel dépôt du corps du Christ. Je rejoins en cela les
hypothèses de mon ami Christian Doumergue. Ceci dit, j’avance posément sans
essayer de soutenir une hypothèse contre vents et marées, ce qui m’a amené
parfois sinon à changer de cap mais du moins à nuancer mes pensées. ”Errare
humanum est sed perseverare diabolicum est.” Certaines choses se sont décantées,
aujourd’hui on peut envisager l’histoire d’une manière qu’il était impossible de
soutenir dans les années soixante. Par exemple on sait maintenant que Bérenger
Saunière n’est pas le centre de cette histoire et qu’il n’est pas un grand
mystique qui réalise une église à sa démesure. On a découvert pas mal de choses
sur lui qui le placent un peu au second rang. Lorsque je faisais mes premières
conférences, il y a plus de quinze ans, et que je disais qu’il était
probablement un “second couteau”, je voyais bien des visages se fermer comme si
j’avais commis un sacrilège. L’approche de l’histoire évolue, on a vu apparaître
quelques chercheurs consciencieux, et peu à peu quelques vérités se font jour.
REGARDS DU PILAT : Vous venez de publier un nouveau livre sur ce sujet
brûlant “Entre la rose et l’équerre”, avec une approche totalement nouvelle de
l’affaire, fondée entre autres sur une lecture inédite de l’église de
Rennes-le-Château. Pouvez-vous nous en dire plus et nous donner envie de lire
cet ouvrage sûrement passionnant ?
DANIEL DUGES : Mes recherches m’ont amené à travailler plutôt sur
la région de Rennes-les-Bains pendant des années, et j’avoue que j’avais un peu
délaissé Rennes-le-Château et l’abbé Saunière lui-même. Pour moi, on ne savait
que très peu de choses de sa véritable vie, et on lui a fait dire et faire
tellement de choses que le personnage m’échappait et pour tout dire m’agaçait un
peu. En revanche la mode consistant à dire : “Il ne s’est rien passé de spécial
à Rennes-le-Château” m’irritait grandement. On a vu un certain nombre de
personnalités des médias prendre de haut les “pauvres fous” qui cherchaient à
comprendre cette énigme, et je trouvais cette suffisance et ce “politiquement
correct”, un rien déplacé, quand, au même moment, personne n’était capable de
dire ce que représentait le “Grand Bas Relief” du fond de l’église. Car, à mes
yeux, nul doute qu’il ne s’agissait pas du “Sermon sur la montagne,” comme on le
dit volontiers, la phrase l’illustrant n’étant pas dans ce fameux discours. Or
aucun religieux n’aurait pu faire une telle faute. J’ai donc cherché la
signification de cette œuvre en repartant de zéro. J’ai surtout abandonné l’idée
qu’elle pouvait être une indication de nature à orienter un éventuel chercheur
vers un trésor. Après deux ans de recherches, j’ai fini par trouver sa
destination exacte. Elle n’est pas conçue pour éclairer quelqu’un qui cherche,
mais pour illustrer le savoir de quelqu’un qui sait déjà. En fait il s’agit de
personnage exécutant des signes appartenant tous à la tradition maçonnique. Je
ne donnerai qu’un exemple : le personnage de droite en haut qui semble présenter
quelque chose à Jésus est en réalité en train de lui montrer qu’il pose son
pouce sur la phalange de son doigt. C’est là un attouchement maçonnique au grade
de compagnon. Le bas-relief est donc dans son ensemble une exposition de la
tradition maçonnique. Ayant ce fil en main j’ai tiré la bobinette et l’ensemble
du décor de l’église a chut. L’église paroissiale de Rennes le château est un
temple maçonnique ! Cet édifice a été réalisé par des gens qui étaient proches
de l’Eglise mais qui revendiquaient la tradition maçonnique comme leur
appartenant, en s’opposant par là à la Franc-maçonnerie régulière que nous
connaissons. Il fallait en fait replacer la construction de ce lieu dans le
conteste politico-religieux de l’époque. Au début du XIXe les loges maçonniques
sont constituées de personnes plutôt monarchistes et proches de l’église, à la
fin du XIXe tout a basculé, les loges sont devenues républicaines et laïques.
Dans cette fin de siècle, une guerre souterraine s’est déclarée entre deux
visions maçonniques. La Franc-maçonnerie ayant pris la tête du combat laïc en
contribuant largement à faire voter la loi de 1901 sur les associations et celle
de 1905 sur la séparation de l’église et de l’état. On trouve dans un bon nombre
de régions de France des traces discrètes de ce combat, et plus la région est
marquée par la Franc-maçonnerie moderne, plus une réaction de tradition
maçonnique s’installe dans les églises. Mais officiellement il n’y a pas de noms
pour ces associations, elles sont restées totalement secrètes, face à la
Franc-maçonnerie qui, elle, est devenue une organisation “discrète”,
c’est-à-dire dont on connaît quelque peu l’histoire. Ainsi dans l’église de
Rennes-le-Château tout a un sens, du Grand Bas Relief au diable de l’entrée. Je
vous invite à lire mon livre pour en savoir plus, j’y apporte des preuves
irréfutables et j’ouvre quelques portes, par lesquelles j’espère bien découvrir
d’autres vérités dans l’avenir.
REGARDS DU PILAT : Parallèlement, vous nourrissez un véritable amour pour
la terre cathare, pour ses traditions, son histoire, pour la langue occitane,
amour sans doute attisé par votre âme d’artiste. Pouvez-vous nous parler, en
quelques lignes, de cette autre passion ?
DANIEL DUGES : Effectivement, j’ai passé toutes mes vacances à
l’âge de vingt ans au pied du château de Montségur, à Serrelongue. J’ai parcouru
le “pog” dans tous les sens pour vivre l’histoire de ces hommes qui ont connu là
une aventure si courte (40 ans) et si définitive en même temps. C’est là que
j’ai rencontré les personnages qui figurent dans mon roman :”Le temps du
laurier”. Ils sont nés de mes souvenirs de promenade dans les “chemins secrets”
jalonnant le pog. Je me souviens de sortie sur le terrain avec le livre de
Fernand Niel “Les cathares de Montségur” à la main, pour voir tout ce dont il
parlait, pour chercher la nécropole jamais trouvée, comme plus tard je
crapahutais dans le “cromlech” de l’abbé Boudet sur les traces de la vraie
langue celtique. Ce plaisir-là de lire et de vivre ensuite ce qu’on a lu est une
sensation pour moi inoubliable, et un plaisir inégalable. C’est encore là que
j’ai rencontré la langue occitane pour laquelle je me suis enflammé, et c’est
une rencontre avec Claude Marty, le barde de l’Occitanie qui m’a poussé à écrire
mes premières chansons en occitan. Avec un de mes amis nous avions fait un film
et notre idée fut de tourner les jours où les événements se sont produits. Nous
étions donc au château un 16 mars très tôt le matin, et là nous avons ressenti
ce que les parfaits ont pu percevoir en descendant vers le bûcher, il faisait
froid et il neigeait. Jamais nous n’aurions pu imaginer qu’il y eut de la neige
ce jour-là et pourtant... Je suis plutôt un solitaire, mais, partager ces
moments-là est sans doute une des plus grandes joies de ma vie. C’est ainsi
qu’il y a plus de quarante ans, j’ai découvert Quéribus, Peyrepertuse,
Puylaurens etc. A l’époque, il n’y avait pas de route, il fallait une heure
pour monter à Peyrepertuse , et l’on s’y retrouvait seul, mais quelle récompense
après l’effort ! Quand on est à Montségur, on est devant le mythe, on ressent
les mêmes choses qu’à Rennes-le-Château, on se dit je vais tout comprendre et on
ne comprend pas. Et cette envie de savoir vous tenaille et vous pousse à venir
et à revenir sans cesse. C’est sans doute cela le sens de la quête, cette
recherche de l’absolue vérité.
REGARDS DU PILAT : L’heure de la retraite ayant sonné depuis peu,
envisagez-vous à présent de consacrer un temps beaucoup plus conséquent, pour
par exemple, vous efforcer de valider un cap ou des résultats vous semblant à
portée de main, de pioche ou de tout autre moyen, informatique aussi, et visant
à résoudre en partie, voir significativement l’affaire de RLC ?
DANIEL DUGES : J’aurai sans doute beaucoup plus de temps à
consacrer à des conférences pour partager mon plaisir, à écrire, à réfléchir,
mais je n’ai pas la prétention de résoudre l’énigme de Rennes, je prendrai ce
qui viendra ! Cette affaire est tellement compliquée et tant de gens ont
brouillé les pistes, que nul ne peut avoir la prétention de débrouiller cet
écheveau, et ceux qui disent : “c’est tout simple” sont, en fait, noyés dans
leur propre rêve. En revanche j’espère aller le plus loin possible dans la
découverte de la vérité historique. Il reste bien des questions en suspend, qui
paraissent des points de détail mais qui peuvent faire basculer toute
l’histoire.
REGARDS DU PILAT : Envisagez-vous parfois sérieusement de tourner un jour
définitivement la page, que l’affaire soit d’ailleurs ou non résolue, par
conséquent passer à tout autre chose, en passionné caractéristique que vous
êtes, se laissant porter par des ressentis qui ne se contrôlent pas forcément
?
DANIEL DUGES : J’ai passé ma vie à sauter de passions en
passions, qu’elles soient sportives ou culturelles, donc, j’ai peur de continuer
encore comme ça... Je fais les choses dans la mesure où j’y prends du plaisir.
Pour l’instant je dois dire que j’en prends beaucoup sur la piste des prêtres de
l’Aude. Ceci-dit, si le poids des joies venait à être contrebalancé par les
inconvénients, je passerais certainement à autre chose. Parallèlement à mes
recherches, j’écris des romans, j’en suis à mon troisième. Ils sont teintés bien
sûr de tout ce que j’ai appris dans mes recherches sur l’affaire de
Rennes-le-Château. Je trouve dans ce travail un plaisir sans cesse grandissant
et si je décidais de tourner la page de l’affaire de Rennes peut être
m’orienterais-je vers le roman. J’affectionne particulièrement le style
polar-ésotérique. A moins qu’une nouvelle passion ne vienne me surprendre entre
temps, sans que je n’y prenne gare !
REGARDS DU PILAT : Aurons-nous un jour le bonheur de vous accueillir dans
le Pilat, dont vous avez semble-t-il apprécié les « Regards » ?
DANIEL DUGES : Je ne connais pas du tout la région de Lyon, mon
histoire personnelle ne m’ayant jamais entraîné jusque là. Mais, à la lecture du
livre de Patrick Berlier et à sa fréquentation, je sens confusément que l’on
trouve bien des points communs entre ce coin de France et l’affaire de Rennes.
Ne serait-ce que l’éventuel déplacement de Saunière à Lyon. Le site des “Regards
du Pilat” semble m’inciter à considérer l’histoire de cette montagne et celle de
Rennes comme celle d’une “Grande Affaire” c’est pour moi une incitation à venir
renifler un peu de ce mystère. Il y a donc de grandes chances pour que je vienne
dans votre région un beau matin.
REGARDS DU PILAT : Grand merci et bonne route Daniel. Retrouvez son dernier livre en notre <Librairie>.
En Novembre
2008 avec Eric Charpentier,
nous étudierons, donc avec lumière douce :

Le Songe merveilleux de Béatrice
|