JUILLET 2022
|
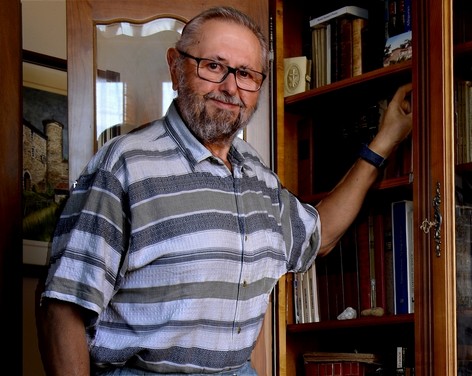 |
Patrick Berlier |
LES
GÉANTS DU PILAT Ce titre
surprend
sans aucun doute. Des géants dans le Pilat ? Oui, il y a
bien ces
arbres, les sapins géants du Grand
Bois
ou de la forêt de Taillard, mais pourtant les géants dont
il va être question
étaient bien des hommes. En effet dans les croyances populaires
il ne manque
pas de traditions relatives à des géants. La Bible les
évoque, ce sont les Nephilim
de la Genèse, les enfants que les fils de Dieu ont eu
avec les filles
des hommes, ou encore Samson à la force surhumaine. Gargantua et
Pantagruel ont
été rendus célèbres par les œuvres de
Rabelais, et les carnavals des régions du
Nord perpétuent encore le souvenir légendaire des
géants. On le sait moins,
mais des traditions analogues existent dans le Pilat, et nous allons
tenter d'en
faire le tour. Il convient de commencer par cet endroit, proche de
Saint-Régis-du-Coin, où furent découverts des
ossements humains qui de toute
évidence appartenaient à des personnes d'une taille
imposante.
Vue du village de
Saint-Régis-du-Coin au
début du XXe siècle LE CHAMP DES
FUSTS Ce nom est
celui
d'un lieu où sont encore visibles les vestiges d'un dolmen, ou
petite allée
couverte, aujourd'hui considéré comme authentique. Quelle
est l'origine de ce
nom d'apparence bien intrigante ? Il faut voir pour le premier
terme la
déformation de « chant » dans le sens de
« côté le plus étroit
d'un objet ». Le mot désigne
généralement une pierre « de
chant », posée sur sa plus petite face. Quant
à « fust » (sans E
final), en ancien comme en moyen français ce mot est en rapport
avec le bois,
et peut désigner en particulier une « forêt de
grands arbres ». Par
Champ des Fusts il faut donc comprendre
« « pierres levées dans la
forêt ». Commençons par évoquer les
publications successives, et parfois
contradictoires, qui en ont parlé, dans l'ordre chronologique.
Jean-Antoine
de la Tour-Varan Ce site
mégalithique fut découvert durant les premières
décennies du XIXe
siècle. C'est le propriétaire du lieu à
l'époque, M. Joseph-Antoine Colomb de
Gast, qui en 1841 envoya un courrier à Jean-Antoine de la
Tour-Varan,
bibliothécaire de la ville de Saint-Étienne et grand
amateur d'histoire
régionale, pour lui signaler diverses pierres antiques qu'il
avait inventoriées
ou découvertes dans son secteur. Il commença par
évoquer la Pierre des Trois
Évêques, puis il en vint à ce monument situé
sur ses terres, qu'il avait dégagé
peu de temps auparavant, et qu'il considérait comme une petite
allée couverte.
Cette lettre sera rendue publique en 1910 par le Bulletin de la
Diana. Voici
en quels termes M. Colomb de Gast contait sa découverte : « Le
monument druidique se compose de deux rangées de grosses pierres
brutes, non
taillées, mais évidemment placées à
dessein, dans ma propriété. Ces deux
espèces de murs sont recouverts de grosses dalles
également brutes, ce qui
forme une espèce de petite cabane en pierre d'un gros volume. Je
la connaissais
depuis longtemps, mais j'avais négligé de l'examiner
attentivement lorsque cet
été la lecture d'un précis d'archéologie me
fit trouver des ressemblances si
grandes avec la description d'un dolmen que je fus curieux de faire
fouiller et
de découvrir le pavé de ce monument qui est
également formé de pierres brutes
assez grosses et allant en pente d'un bout à l'autre pour
arriver à une rigole
qui se termine au fond du monument. Sous un gros rocher, avant
d'arriver au
pavé, nous avons trouvé une assez grosse quantité
d'ossements, surtout un grand
nombre de tibias et deux petits morceaux de vases qui paraissent
antiques. J'ai
fait examiner ces ossements par un médecin, il a reconnu qu'il y
avait mélange
d'ossements humains qui paraissent avoir appartenu à des hommes
plus forts que
nos habitants actuels et mélange d'ossements de taureaux et
d'autres animaux,
il a même reconnu qu'il y avait quatre os appartenant tous
à la jambe droite,
ce qui annonce que plusieurs corps ont été
là. » À
l'époque, on
attribuait les mégalithes à ceux que l'on pensait
être les plus anciens
habitants du pays, les Celtes ou Gaulois, et plus
particulièrement aux druides
tant ces monuments paraissaient présenter un caractère
religieux. On sait
aujourd'hui que les mégalithes étaient déjà
là, depuis au moins mille ans,
lorsque les Celtes sont arrivés dans notre pays vers l'an 600
avant notre ère.
Le plus surprenant, dans ce que rapporte M. Colomb de Gast, est
évidemment la
remarque du médecin ayant reconnu des « ossements
humains qui paraissent
avoir appartenu à des hommes plus forts que nos habitants
actuels » ?
Le Pilat en ces temps anciens aurait-il servi d'habitat à des
géants ? Le
mot est peut-être un peu fort, encore que les légendes,
attachées à certains
sites curieux, se chargent de l'entériner, comme nous le verrons. Quelques
années
plus tard Théodore Ogier entreprit la publication d'une œuvre
majeure, La
France par cantons et par communes, dont l'ambition était de
dresser pour
chaque commune de France un inventaire de ses richesses patrimoniales.
C'est en
1848 que parut le premier volume consacré au département
de la Loire. À
l'époque la commune de Saint-Régis-du-Coin n'existait pas
encore, aussi est-ce
l'article consacré à la commune de Marlhes qui
évoquait, pour la première fois
mais sans le nommer, le site du Champ des Fusts : « En
visitant la propriété de M. Coulon, nous avons
remarqué les restes d'un temple
druidique dont la forme est parfaitement conservée. A travers
ces ruines on a
découvert une espèce d'ossuaire, dont les débris,
quoique en partie calcinés,
permettent encore de distinguer les divers âges des
victimes ; nous ne
saurions trop encourager le digne propriétaire à
persister dans son louable
projet, de rétablir autant que possible ce monument dans sa
forme
primitive ; de nouvelles fouilles lui fourniront probablement les
ornements rustiques qui étaient le caractère de cette
époque barbare. » Il est bien
évident
que Théodore Ogier, qui ne tarissait pas d'éloges dans
son article sur
« la propriété de M. Coulon », ne
s'est pas lui-même déplacé, sans
quoi il aurait correctement écrit le nom de ce
propriétaire, M. Colomb de Gast.
En réalité l'auteur a fait appel pour chaque commune aux
services du curé de la
paroisse, qui était souvent le personnage le plus lettré
et le plus érudit de
la commune. Il faut croire que c'est lors de la copie de ces notes que
le nom
Colomb s'est transformé en Coulon. Pendant ce
temps,
J.-A. de la Tour-Varan préparait l'œuvre qui allait le faire
passer à la
postérité, les Chroniques des châteaux et
abbayes, en deux volumes, dont
il commença la publication en 1854. C'est dans le chapitre du
tome I consacré à
l'abbaye de Valbenoîte, et alors qu'il racontait comment les
moines eurent à
cœur de faire disparaître toute trace de la religion celtique qui
fut jadis
vivace à cet emplacement, que l'auteur évoquait
brièvement, sans le nommer, le
dolmen du Champ des Fusts, par une note de bas de page consacrée
aux monuments
druidiques de notre région : « A
Saint-Sauveur-en-Rue, dans la forêt de Taillac et dans la partie
qui est à M.
Colomb de Gast, on a trouvé, il y a quelques années, un
monument celtique fort
curieux, et en très-bon état : c'est l'une de ces allées
couvertes
qui portent, en plusieurs endroits, le nom de chambres des
fées. Les
parois sont en longues pierres brutes contiguës et posées
verticalement ;
le toit est formé de dalles larges et épaisses. Ailleurs
nous en reparlerons. » Ce petit
texte, un
simple paragraphe, appelle évidemment plusieurs remarques. La
commune de
Saint-Régis-du-Coin n'existait toujours pas, aussi l'auteur
localisait-il la
propriété de M. Colomb de Gast sur la commune de
Saint-Sauveur-en-Rue, dans « la
forêt de Taillac », ce qui paraît être une
coquille : il faut sans
doute comprendre « forêt de Taillard », le
bois Panère, dans lequel
est situé le Champ des Fusts, étant peut-être une
partie détachée de cette
forêt. En 1872,
L.-Pierre
Gras publia son Essai de classification des monuments
pré-historiques du
Forez. C'était un premier inventaire du patrimoine
mégalithique de notre
région, un document précieux car malheureusement beaucoup
des monuments décrits
ont aujourd'hui totalement disparu. Le chapitre IV, consacré aux
dolmens,
commençait par évoquer une allée couverte que l'on
reconnaît être celle du
Champ des Fusts, bien que ce nom n'apparaisse pas. L'auteur se
contentait en
fait de reprendre sous forme de citations les textes de ceux qui
l'avaient
précédé, La Tour-Varan et Théodore Ogier.
Il ajoutait cependant une remarque en
note de bas de page : « Les
ossements trouvés sous les dolmens sont les restes des victimes,
dans l'opinion
des archéologues qui pensent que ces monuments sont des autels.
''Pro victimis
homines immolant'' dit Cæsar : Comm. VI Cap. 16 » Cette
opinion,
basée sur ce que disait Jules César, était
évidemment erronée : les
Gaulois n'ont jamais immolé d'hommes sur les dolmens. Même
si on sait que
ceux-ci servaient probablement de sépultures, selon les
croyances complexes
d'une religion, bien antérieure à celle des Gaulois, qui
reste très mal connue. En 1889,
Félix
Thiollier publia son Forez pittoresque et monumental, un
ouvrage de
référence incontournable, aussi monumental que son titre.
L'auteur s'est livré
à une description minutieuse de cette région qu'il
connaissait bien, canton par
canton et commune par commune. Il s'était pour cela
entouré d'un certain nombre
de collaborateurs. Parmi eux, Messieurs Eleuthère Brassard et
Paul Tardieu, qui
se chargèrent de la rédaction de la partie concernant les
communes du canton de
Saint-Genest-Malifaux, dont celle de Saint-Régis-du-Coin,
créée en 1858. Après
avoir parlé des pierres Saint-Martin de Chaussitre, les deux
auteurs évoquaient
l'allée couverte du Champ des Fusts : « A
l'ouest du bois Panère, à 250 mètres environ au
nord du château de
Saint-Régis-du-Coin, en suivant le chemin d'intérêt
commun n° 28, du Tracol aux
Trois-Croix, au territoire appelé le Champ des Fusts,
à 100 mètres à
l'est dudit chemin, est une allée couverte complètement
enfouie dans terre,
orientée de l'est à l'ouest, ayant environ un
mètre de large à
l'intérieur ; la partie encore couverte est longue
d'environ deux mètres,
l'élévation est impossible à déterminer, le
sol étant exhaussé par des
éboulements ; les murs latéraux sont construits en
matériaux de toutes
dimensions et calés entre eux avec des petites pierres, sans
mortier d'aucune
sorte ; c'est tout à fait le système gaulois ;
les dalles servant de
couverture sont brutes et d'épaisseurs diverses. D'après
les dires de la
propriétaire, Mme de Bonneville, née Colomb de Gast, lors
de la découverte,
cette allée était fermée, à l'est, par une
dalle percée d'un trou et on aurait
trouvé à l'intérieur des débris de poteries
et des ossements d'homme et
d'enfant. » L'emplacement
du
Champ des Fusts paraissait décrit avec une précision que
l'ouvrage de Félix
Thiollier était le seul à donner. Le château de
Saint-Régis-du-Coin est dans le
centre du village, face à l'église. Mesurer 250 m est
facile, c'est pile 1 cm
sur la carte IGN 1:25000. Pourtant à l'endroit indiqué...
il n'y a rien. C'est
à se demander si les auteurs n'ont pas, volontairement,
cherché à brouiller les
pistes : il faudrait ajouter les deux distances indiquées,
250 et 100 m,
pour trouver la bonne mesure. Car le site est en réalité
à 350 m (et non 250)
au nord du château de Saint-Régis-du-Coin, et à
quelques mètres seulement de la
route D. 28 (et non à 100 m). Félix
Thiollier a lui-même réalisé un dessin
du monument, d'après un document fourni par M. Favarq, un membre
éminent de la
Diana, la célèbre société savante
forézienne. Pourtant ce dessin, le seul
existant semble-t-il, n'est pas inséré à la suite
de la description précédente,
comme si les auteurs avaient voulu embrouiller quelque peu les
lecteurs. En
fait il faut parcourir l'ensemble de l'ouvrage pour le
découvrir, en
illustration de l'article sur la commune de Luriecq, canton de
Saint-Jean-Soleymieu, rédigé par Paul Tardieu, qui s'en
justifie en disant
avoir voulu établir le parallèle avec le
célèbre dolmen que l'on peut voir dans
cette commune : « Ce
genre de monument est des plus rares en Forez ; nous avons eu
l'occasion
d'en signaler un à Saint-Régis-du-Coin qui paraît
absolument authentique et
dont nous avons donné le dessin à la page
précédente, préférant rapprocher ces
monuments pour permettre de les comparer. »
Le
dolmen du Champ des Fusts – dessin de Félix Thiollier Une vingtaine
d'années plus tard, la découverte finit par attirer
l'attention d'un éminent
préhistorien, M. Joseph Déchelette. Né à
Roanne, fils d'industriel, il commença
par succéder à son père à la tête de
l'usine familiale, tout en se passionnant
pour l'archéologie. Joseph Déchelette fut un des piliers
de la Diana, puis il
finit par abandonner ses fonctions pour se consacrer à sa
passion, publiant
plusieurs ouvrages toujours considérés comme des
références. Le savant vint de
Roanne, le lundi 24 octobre 1910, trois mois seulement après
avoir été chargé
par le ministre de l'Instruction publique d'une mission
archéologique
consistant à étudier les monuments préhistoriques
de la région. Il examina le
dolmen du Champ des Fusts, et le soir-même il écrivit une
lettre à Eleuthère
Brassard dans laquelle il lâchait ces mots sans appel, reflets de
sa déception : « J'ai
pu constater que la prétendue allée de
Saint-Régis-du-Coin n'a rien de
préhistorique. C'est une galerie récente et plutôt
moderne. »
Joseph
Déchelette Tous ceux qui
avaient examiné le monument se seraient-ils à ce point
trompés ? Que faut-il
comprendre par « galerie récente et plutôt
moderne » ? Joseph
Déchelette publia ensuite ses conclusions, un peu plus
argumentées, dans le Bulletin
archéologique de 1912, par une communication
consacrée aux cases en pierres
sèches de l'Auvergne. Voici en quels termes : « Il
existe dans le département de la Loire, sur la commune de
Saint-Régis-du-Coin,
lieu-dit Le Champ-des-Fusts, un monument qui est
considéré comme une galerie
couverte mégalithique. Or j'ai reconnu récemment qu'il
fait partie d'un groupe
de cases rectangulaires dont les substructions se distinguent nettement
sous le
gazon. Des fouilles permettraient sans doute d'en reconstituer les
dispositions
exactes. Entre deux des compartiments s'ouvre le prétendu
dolmen, sorte de
couloir ou de galerie large d'environ 1 m 50 et long de 4 à 5
mètres. Il est
formé par les murs en pierres sèches de ces deux maisons
et recouvert de
grandes pierres brutes, plates à l'intérieur, dont trois
sont encore en place.
Les autres, à la partie antérieure de l'allée, ont
disparu. « Au
premier examen en prendrait facilement cette galerie pour une
allée couverte
dolménique ; aussi tous les archéologues qui l'ont
décrite lui ont-ils
donné cette dénomination. Mais pour qui connaît les
cases de Villars il ne peut
y avoir aucun doute : ce sont les restes d'une galerie de
communication
tout à fait semblable aux précédentes. « Des
fouilles y ont été exécutées vers 1860 par
M. Colomb de Gast, puis plus tard
par M. Favarq, mais elles ont donné des résultats
absolument négatifs. » L'avis de ce
spécialiste reconnu était pour le moins
péremptoire ! Pour lui, la
prétendue allée couverte n'était qu'un passage
entre deux cases en pierres
sèches. Il se référait aux cases de Villars en
Auvergne (commune d'Orcines,
Puy-de-Dôme), dont deux communiquent entre elles par un long
couloir à peu près
souterrain. On pourrait se ranger à cet avis, s'il n'y avait pas
eu la
découverte des ossements. Enterrait-on les morts dans un couloir
de
communication entre deux cases ? Il est permis d'en douter... Mais
en
fait, Joseph Déchelette contourna le problème en passant
cette découverte
totalement sous silence : évoquant seulement les fouilles
de 1860, il
affirmait qu'elles avaient donné « des
résultats absolument
négatifs ». C'était peut-être vrai pour
ces fouilles-là, mais sûrement pas
pour celles de 1841, que Déchelette ne mentionnait même
pas. Il se murmure
cependant que le préhistorien aurait
récupéré les ossements, bien embarrassé en
effet par leur taille. Joseph Déchelette devait trouver la mort
sous les balles
allemandes en 1914. Quant aux ossements, on dit qu'ils se trouveraient
toujours
dans les réserves du musée Joseph Déchelette
à Roanne. Mais rien ne permet de
vérifier la véracité de cette rumeur. Cette
publication
ayant relégué le dolmen du Champ des Fusts au rang d'un
simple tas de cailloux,
personne ne s'avisa à tenter de le protéger. Aussi les
plus grandes dalles
servirent de matériau d'empierrement dans les années
trente, pour combler les
nids de poule de la route en contrebas. Sans doute sont-elles toujours
là, sous
le goudron... En 1946 J.-E.
Dufour publia son Dictionnaire topographique du Forez. Cet
ouvrage,
monumental lui aussi, recensait tous les noms de lieux du Forez, avec
leurs
formes anciennes, et un petit aperçu historique
complétait les articles
consacrés aux communes. Concernant Saint-Régis-du-Coin,
Dufour – qui au passage
écrivait Fustes, avec un E final, orthographe qui allait ensuite
prévaloir -
annonçait, en se rangeant à l'avis de
Déchelette : « On
signale sur le sol de cette commune, au Champ des Fustes, des groupes
de
pierres, qui ont fait penser à une allée couverte. En
réalité il ne s'agit que
d'un épierrement. » Cet avis
perdurait
encore lorsqu'en 1964 Jean Combe publia son Histoire du Mont Pilat
des Temps
Perdus au XVIIe siècle. Si l'auteur
méthodique ne pouvait pas
ignorer le site du Champ des Fustes, citant ce qu'avaient écrit
ses
prédécesseurs, il se contentait d'entériner l'avis
de Joseph Déchelette et de
J.-E. Dufour. Depuis les
archéologues semblent avoir révisé leurs
positions : pour la thèse de
Myriam Philibert Le mégalithisme dans la Loire,
publiée en 1986, le
monument du Champ des Fusts est bien un authentique dolmen, et
concernant le
Pilat c'est même le seul véritable
mégalithe recensé par cette publication : « Champ
des Fusts. Allée couverte ou dolmen disparu, orienté
est-ouest, large de 1 m et
longue de 2 m, fermée à l'est par une pierre
percée d'un trou, constituée par
une double rangée de montants bruts couverts de dalles. Une
fouille faite au
siècle dernier a permis de mettre au jour des ossements humains,
de la faune
(bovidé), des charbons de bois. Le monument a été
détruit vers 1940 et nous est
seulement connu par des dessins. » L'étude
de Myriam
Philibert suivait de peu la publication de la série de brochures
Le guide du
Pilat et du Jarez dont je suis l'auteur. C'est volontairement que
je n'ai
pas situé le Champ des Fustes au bon endroit, mais beaucoup plus
au nord. À
l'époque, personne n'avait encore publié la localisation
précise du monument,
et je n'ai pas voulu être le premier à attirer l'attention
sur un lieu privé.
Car le dolmen n'a pas entièrement disparu, il subsiste encore
plusieurs pierres
verticales. En 1998 parut
le
livre de Jeanne et Marcel Sève Saint-Régis-du-Coin
aux confins du Forez et
du Velay, constituant le premier ouvrage consacré à
l'histoire de cette
commune. Naturellement il évoquait le site qui nous
intéresse, et avec une
description constituant la plus complète publiée à
ce jour : « Le
''champ des Fustes de Saint-Régis''. Il n'est pas possible de ne
pas le
mentionner ici, car il a déjà fait couler beaucoup
d'encre. À l'heure actuelle,
on ne sait pas s'il a livré tous ses secrets... ni s'il les
livrera un jour. Il
est situé au-dessus de la D. 28, sur un terrain privé,
à gauche avant l'entrée
du bourg. « L'étymologie
du nom semble en rapport avec la présence du ''monument'' et
serait une
modernisation de l'ancien mot ''chant'' (il a donné ''enchant''
au XVIIIème).
Il signifiait ''grosse pierre''. ''Fustes'' serait un ancien mot celte
qui
aurait désigné une embarcation à fond plat,
capable de contenir quelque chose.
Il est à rapprocher de ''futaille'' que certains dictionnaires
définissent
comme des ''vaisseaux à tenir le vin''. « En
1841, J. A. Colomb signale la présence de ce ''monument''
à Monsieur A. de la
Tour-Varan et fait entreprendre des fouilles. Au XIXème
siècle, on
reconnaissait encore nettement dans cette construction une
''allée couverte''
(chambre funéraire) de 1m50 de large et de 4 à 5 m de
long, en partie enfouie
sous terre et recouverte de plusieurs grandes dalles plates dont 3
étaient
encore en place en 1910 (aujourd'hui, elles sont toutes
tombées). Ce dolmen
contenait, en 1841, une grande quantité d'ossements humains
ayant appartenu à
des hommes plus grands qu'aujourd'hui. Il y avait aussi des os
d'animaux
(taureaux), de la terre imprégnée de charbon de bois et
deux petits morceaux de
poterie. « Vers
1860, il y a de nouvelles fouilles. « Le
24 octobre 1910, par un soir de pluie, l'éminent
préhistorien, Joseph
Déchelette fait une visite rapide des lieux et conclut,
peut-être un peu vite,
que cette prétendue allée couverte n'a rien de
préhistorique : il passe
sous silence la découverte des ossements. « En
1920, Monsieur Salomon fait, à ce sujet, une déclaration
à la Diana de
Montbrison. « Vers
1930, on aurait utilisé quelques ''cailloux'' pour
l'empierrement de la D. 28
(goudronnée vers 1950). « Vers
1955 et 1968, d'autres fouilles, entreprises par des amateurs, ne
donnent pas
de résultats, mais elles n'ont peut-être pas
été menées avec tous les moyens
nécessaires. « Malgré
l'absence de conclusions évidentes, le Père Granger,
décédé en 1983, et, plus
récemment, quelques érudits, interrogés à
ce sujet, croient en l'authenticité
du ''champ des Fustes''. » Il a fallu
attendre
2015 pour que fût enfin rendue publique la situation exacte du
site grâce à
l'édition du Patrimoine du département de la Loire,
Canton de
Saint-Genest-Malifaux, ouvrage collectif réalisé par
la LIGER sous la
direction de Jacques Laversanne. Voici en quels termes le Champ des
Fustes
était évoqué : « .À
proximité de la croix, un couloir de grandes pierres
dressées, d'un mètre de
large environ, fut un sujet de controverses chez les
préhistoriens. Le père
Granger, historien local, le considérait comme le seul dolmen
authentique du
Pilat alors que Joseph Déchelette n'y voyait qu'un passage
couvert entre des
maisons. Situé sur un terrain privé, on peut s'en faire
une idée avec le dessin
de Félix Thiollier […] Depuis, les pierres de couverture ont
été récupérées pour
remblayer une route voisine et le couloir en partie comblé. Il
ne reste plus,
visible de la route, que les derniers piliers de l'allée
autrefois jonchée de
tessons et d'ossements, couverte et fermée par une dalle
trouée ! » Ce petit
descriptif
était accompagné d'une photo des vestiges encore visibles
aujourd'hui. La croix
dont il est question est la croix de mission de 1907 qui
s'élève au bord de la
route départementale, à l'orée du bois et à
350 m au nord du village de
Saint-Régis-du-Coin. Elle constitue un bon point de
repère, il suffit ensuite
de lever les yeux pour découvrir, de l'autre côté
de la route et légèrement
au-dessus, ce qu'il reste du dolmen.
Vestiges
du Champ des Fustes en 2015 Photo
publiée par le livre de Jacques Laversanne Un mot, pour
conclure,
sur son orientation. Les dolmens étaient
généralement tournés vers le sud-est,
vers le point de l'horizon où se levait le soleil le jour du
solstice d'hiver.
Ce jour marquait la renaissance du soleil, on en a fait la fête
de Noël qui a
été adoptée par la religion chrétienne pour
marquer symboliquement la naissance
de Jésus. On peut imaginer que la lumière solaire,
pénétrant seulement ce
jour-là jusqu'au fond du dolmen, pouvait aller chercher
l'âme du défunt enterré
là, et la conduire vers une renaissance, autrement dit une
nouvelle
incarnation. Le dolmen du Champ des Fustes fait partie de ceux, rares,
qui sont
tournés différemment, ce qui ne fait qu'accentuer ses
singularités. LES
GÉANTS DES
LÉGENDES PILATOISES Maintenant
revenons
sur le dessin de Félix Thiollier. Est-ce un hasard ? La
pierre de droite,
dressée contre le dolmen, paraît dessiner un visage
humain. On distingue les
deux yeux, le nez et la bouche ouverte. Sauf que cette tête, par
rapport aux
dimensions du monument, serait gigantesque, plus d'un mètre de
hauteur. Une
tête de géant de pierre, c'est ce que l'on peut voir, et
il n'est pas
nécessaire d'avoir beaucoup d'imagination pour cela.
Détail
du dessin de Félix Thiollier et son interprétation
possible : Alors revient
le
souvenir de la légende contée par Cyril, le berger du
Pilat... Trois géants de
pierre vivaient autour du Crêt de la Chèvre. Deux d’entre
eux avaient charrié
des pierres pour former des chirats, chacun sur un versant. Mais il
étaient
jaloux l’un de l’autre, chacun reprochant à son frère
d'avoir copié son chirat
pour construire le sien. Il est vrai que rien ne ressemble plus
à un chirat
qu'un autre chirat. Alors ils ont fini par se battre. Le
troisième frère, qui
vivait au Crêt de l’Airellier, a voulu intervenir, les
séparer. Ses frères lui
ont donné une bourrade qui l’a renversé, il est
tombé sur la vieille auberge
entre les crêts de la Chèvre et de l’Airellier, et il l’a
écrasée. Depuis, on
parle de l’auberge perdue, mais plus personne ne sait où elle
était. Quant aux
deux frères, leur combat à mort s’est soldé par
leur éclatement en mille
morceaux. Chacun s’est transformé en un éboulis, qui
s’est ajouté aux pierres
des chirats. On dit que leurs têtes sont toujours là, pour
qui sait les voir.
La
tête du géant de pierre, sous le Crêt de la
Chèvre Parmi les
géants
légendaires du Pilat, Gargantua célébré par
Rabelais a naturellement sa place.
Tout d'abord son nom est forgé sur la racine GAR
(« pierre, lieu
pierreux » dans les langues anciennes) qui a aussi
formé les noms du Gier
et du Jarez. On a vu Gargantua un peu partout en France, et pour le
Pilat c'est
le Crêt de Thorée qui est désigné comme son
lieu de résidence. On dit que le
géant s'y tenait assis, et pour passer le temps il s'amusait
à jeter des
cailloux dans le Rhône, au niveau de Saint-Pierre-de-Bœuf. Les
pierres, qui
pour Gargantua n'étaient que des cailloux, étaient des
rocs énormes, lesquels
en s'écrasant dans le Rhône auraient formé
l'Île de la Platière.
Le
Crêt de Thorée, vu du hameau de Peyssoneau L'autre
célèbre
géant légendaire du Pilat est le héros biblique
Samson, qui aurait laissé la
trace de son pied sur un rocher au-dessus de Chuyer. Il faut aller
jusqu'au
hameau de Bonne-Bouche, puis prendre à gauche la route
goudronnée qui rejoint
le lacet de la D 30. À peu près à mi-chemin, un
sentier balisé grimpe à droite
sur le coteau. On passe d'abord par un rocher creusé d'un
siège (peut-être la
trace de l'enlèvement d'une meule), dans lequel les anciens
voyaient s'asseoir
le géant, et auquel ils donnaient le nom
irrévérencieux de « Cul de
Samson ». Le sentier poursuit sa grimpette et finit par
arriver sur une
grande dalle de pierre, dans laquelle on observe ce qui ressemble
à la trace
d'un pied, géant en effet car il ne mesure pas moins de 43 cm de
long. C'est le
célèbre « Pied de Samson ».
Le
Pied de Samson La
légende dit que
le géant aurait laissé cette empreinte en se baissant
pour boire l'eau du
Rhône. Il y aurait donc en toute logique un second
« Pied de
Samson ». Georges Pétillon, qui fut l'un des
dirigeants du Parc Naturel
Régional du Pilat à sa création en 1974, nous
apprend par ses fameuses Fiches
archéologiques que ce deuxième pied se trouvait sur
un rocher près du
hameau de Pilherbe, toujours dans la commune de Chuyer. Il n'est plus
visible
aujourd'hui car c'est sur ce roc que l'on a implanté la Croix de
Pilherbe, en
1876.
Croix
de Pilherbe Samson
aurait-il
également laissé la trace de sa main gauche, lorsqu'il se
baissa pour prendre
de l'eau dans la Rhône avec sa main droite ? Une telle
empreinte existe
pourtant, près du hameau du Gonty, commune d'Échalas, sur
ou plutôt sous une
roche à cupules bien connue nommée « Pierre
Blanche » ou
« Pierre Guittard ». Cette empreinte en creux
apparaît quand le
soleil couchant vient en souligner les reliefs, et cette main
géante pourrait
bien être celle de Samson, même si aucune tradition
légendaire ne le signale.
Main
géante sous la Pierre Blanche (photo 1980) LES FAUTEUILS
DE
GÉANTS En divers
endroits
du Pilat on remarque des rochers paraissant creusés d'un
siège, mais d'une
taille digne d'un fauteuil pour géant. Outre celui proche du
« Pied de
Samson » qui vient d'être évoqué, on
peut citer celui du Crêt de
Quatregrains, près de Pavezin, peut-être d'origine
naturelle, ou celui qui se
trouvait au hameau de la Roche près de Pélussin. Ils ne
sont plus visible
aujourd'hui, le premier parce qu'il est situé dans un espace
clôturé désormais
interdit aux randonneurs, le second parce qu'il a disparu au
début du XXe
siècle lors de l'élargissement de la route. Louis Dugas
en donne une
description dans son Étude sur
quelques monuments celtiques du Mont Pilat publiée en 1927,
expliquant que
l'un des accoudoirs était décoré d'un svastika.
L'auteur est sans doute l'un
des derniers à l'avoir vu. Fort heureusement, on peut encore
voir un beau
« fauteuil de géant » près de
Saint-Sauveur-en-Rue. Il est juste
au-dessus de la D 22, dans un tournant, un peu au nord du hameau de Ru.
Cet
impressionnant rocher est tourné vers le soleil couchant.
Le
fauteuil du géant de Saint-Sauveur-en-Rue UN
GÉANT AU XVIe
SIÈCLE ? On ne peut
pas
clore ce dossier consacré aux géants du Pilat sans
évoquer le « personnage
d'une exceptionnelle stature » que l'humaniste lyonnais Jean
du Choul
rencontra lors de son exploration du Pilat au milieu du XVIe
siècle.
Voici en quels termes il en parle dans son ouvrage publié en
1555 : « Cet
être, qui n'a rien d'humain, a l'œil ardent, les cheveux en
désordre, la barbe
longue, l'aspect crasseux ; il est en haillons et sa poitrine,
toujours
nue, est couverte de poils ; c'est à peine si on peut le
distinguer des
sapins. Il est très bavard, il a une physionomie plus
étrange que douce et
bienveillante, et il est renfrogné ; il provoque des
passants à la lutte
en engageant des paris. Cet athlète est si vigoureux qu'à
ce qu'on dit il est
capable de lancer des pierres avec une force telle qu'elles restent
incrustées
dans l'écorce des arbres les plus durs. Atlas connaît seul le poids dont ses épaules peuvent
se
charger, et Bacchus le vin qu'il ingurgite en un repas. Une faim
permanente,
qui semble prête à dévorer les mets les plus
grossiers, est pour lui le
meilleur assaisonnement. » (Traduction
proposée par Claude Longeon) Alors, des
géants
ont-il vraiment vécu dans le Pilat en des temps plus ou moins
anciens ? Ou
s'agit-il seulement de traditions fondées sur les croyances
populaires et les
légendes ? À chacun de se faire son opinion... |
Bernard
Etlicher
|