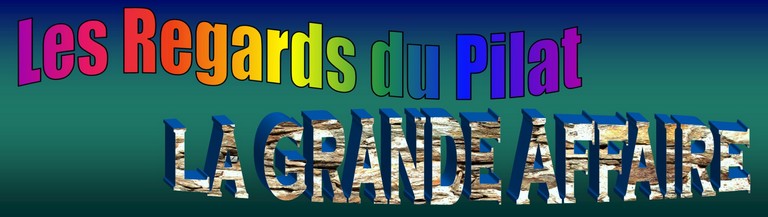
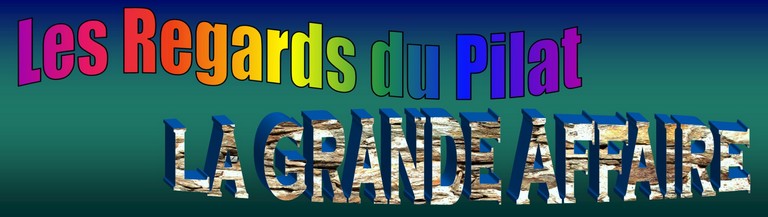 |
Février
2012
|
 |
 Par Michel Barbot
|
 |
|
Notre « Poisson Nourriture de Vérité », tel le poisson « girouette » du clocher de quelques églises bretonnes, poursuit depuis février 2009 (et même bien avant), date de la mise en ligne de l’article, sa navigation céleste. Les Fils de Noé prolongent la longue pérégrination qui bientôt, les fera passer des eaux initiatiques des Poissons aux eaux baptismales du Verse-Eau. Au
détour d’une vague maligne, de
saintes vigies protègent et orientent ces pèlerins de
l’Océan vers la Lumière de
ce Port Espérance dont le guetteur en terre du Pilat n’est autre
que Marie-Madeleine. |
Le
mot DAG inscrit dans la pierre de la grotte des
Fée du mont Ministre, dirige le pèlerin pilatois vers
cette énigmatique DAGA
(la tombe immergée) qui prend toute son importance à la
lumière du… ou plus
justement de…
|
|
Désireux
de pouvoir donner une
certaine crédibilité à son hypothèse, A.
Péan écrit : « Vous
allez me demander sans doute
pourquoi le nom de certaines montagnes, dans notre vieille Europe,
s’est plutôt
revêtu de la forme sémitique pil que
des formes aryennes bal, pal,
etc ? Ah ! » L’auteur
de cette lettre sitôt posée sa
question, répond : « Le peuple, quel
qu’il soit, qui laissa ce pil ou phil comme
une
marque ineffable de son passage en Gaule, eut une de ses stations
primitives
non loin du Taurus et du Caucase, à l’ouest des grands empires
araméens du
bassin de l’Euphrate et du Tigre ; et sa langue, alors,
reçut l’appellatif
de ‘’montagne’’ usité dans ces empires, en même temps que
beaucoup d’autres
appellatifs des façons d’être de la nature
extérieure. » Face à la longueur de son développement, l’auteur préfère remettre à plus tard la besogne qui consisterait à « détailler, par le menu, le nom et l’origine du peuple » dont il parle. Les propos
de M. A. Péan, bien
que datés de 1867, peuvent trouver prolongement dans les
allégations de F.
Gabut datées de 1901 (ETUDES
D’ARCHEOLOGIE PREHISTORIQUE, parues à Lyon, aux
éditions A. Storck & Cie. Imprimeurs – Editeurs) : « Au
crêt de F.
Gabut donnait à ce peuple postdiluvien
du Pilat le nom de Philolithe : soit les Amis de Ce Pilat que F. Gabut écrit
sans T, nous
apparaît comme la Piste de l’Eléphant ; piste
jalonnée par ces arbres
séculaires prenant la forme des imposants pachydermes. |
 L’éléphant du tableau de la chapelle Sainte-Madeleine À gauche : photo du tableau original. À droite : les traits de l’éléphant, tel que l’on peut l’imaginer. |
|
Le
roi Salomon et les défenses ivoirines de l’éléphant Cantique
des cantiques VII - 5 : Ton
cou est
comme une tour d’ivoire (Shen), Tes yeux
sont comme les viviers
d’Eshbon, Près de la
porte de Bath-Rabim : Ton
nez est
comme la tour du Liban qui
regarde
Damas. I Rois 10 – 22 : « De fait,
le roi avait une flotte à
destination de Tarshish, naviguant avec la flotte de Hiram, et qui
revenait
tous les trois ans avec une cargaison d’or et d’argent, d’ivoire (ShenHabîm), de singes et de
paons. » Cantique
des Cantiques 5 – 14 : Ses
mains,
des sphères d’or remplies d’émeraudes (Tarshish) ; Son
ventre,
un bloc d’ivoire
(Shen) évanoui
dans des saphirs. Sur
le tableau de la chapelle de Dans ce livre, l’ivoire est
appelé SHEN
soit la « dent ». La tour d’ivoire que le roi
poète nomme aussi tour
du Liban (Lebanon = « blanc », couleur de
l’ivoire), « regarde Damas la Rouge »,
jadis
étape importante sur La
« vision
de Damas » est matérialisée dans le verset
par les « viviers
d’Eshbon ». Le vivier ou parc à poissons
apparaît comme un élément
hautement symbolique dans cette Route de l’Ivoire ou Piste des
Eléphants. Le
mot hébreu « Brakoth » :
« viviers » est aussi
« bénédictions »,
« présents »,
« dons » de Dieu. Louis
Charbonneau-Lassay dans « Le
Bestiaire du Christ » (Editions Albin Michel), évoque
le temple de la
déesse poisson Atargatis-Derceto de Hiérapolis en Syrie
dont la statue était
couverte d’or et de gemmes éblouissantes, de toutes couleurs,
apportées
d’Egypte, d’Ethiopie, d’Arménie, de Phénicie,
Médie et Babylonie. Le grec
Lucien (La Déesse syrienne),
écrivait, environ deux siècles avant notre
ère : « Dans le vivier sacré
qui touchait à son temple, on élevait en
son honneur des poissons vénérés qui venaient,
à l’appel des prêtres, manger
dans leurs mains. Corseletés d’or, ils portaient aux ouïes,
aux nageoires et
parfois aux lèvres, de riches joyaux où rutilaient les
pierres les plus
précieuses. A Rome, un bassin semblable, un temenos fut
établi prêt du temple
de la ‘’déesse syrienne’’, sur le Janicule ; il ne fut
détruit que sous
Constance II, mort en 361. » Des
auteurs, tel Louis Charpentier dans « Les
Mystères Templiers » (Editions J’ai Lu) ont
évoqué les caches trésoraires
que les Templiers possédaient au fond d’un vivier ou d’un
étang (la forêt
d’Orient…) situé près de la commanderie. Il
paraît intéressant de mentionner à
présent la découverte que fit Léon Mizelles dans
l’Yonne à Flacy, dans le bois
de Léon Mizelles ne put
pénétrer que dans
la salle, haute de trois mètres, où il découvrit
avec l’ami qui l’accompagnait,
des graffiti templiers.  Pour
obtenir de plus amples informations
au sujet des graffiti templiers de Flacy, il convient de lire
également mon
article « Retour sur les découvertes
archéologiques traditionnelles de
Léon Mizelles » (ATLANTIS 445 – 2e
trimestre 2011). Les
Viviers, en hébreu « Barékoth »,
sont associés dans le verset du Cantique, au mot Eshbon dont la
signification
est : « compte, calcul, combinaison » mais
aussi
« pensée »… Il
appert que pour percer le secret de
ces viviers et de leur Daga, il convient d’en découvrir le calcul, la combinaison… Suivant
le Targoum l’expression
« viviers d’Eshbon » s’applique aux scribes « remplis de sagesse comme la piscine d’eau. Ils
savent calculer
les embolismes et les années intercalaires, ils fixent le
commencement des
années et des mois, et affichent la date à la porte du
grand conseil. » Salomon,
le roi poète situe les
« viviers d’Eshbon » près de Cet
Habim (pluriel de majesté), aurait, bien
qu’inusité dans la Bible, un singulier, en Hab, mot dit-on
d’origine hindou,
mais connu également en Egypte. Ecrit avec un Hé, de
valeur 5 et un Beth, de
valeur 2 (soit une guématrie totale de 7), Hab apparaît
ainsi identique par sa valeur
numérique au mot Dag, le « poisson » du
vivier, inscrit sur la pierre
de la grotte de la Dame : Marie-Madeleine qui se présente
à nous comme la Fille
de Habim ou Fille de l’Eléphant.... Le
verset 5 – 14 du Cantique des
Cantiques permet d’avancer plus encore dans cette quête pilatoise
: « Ses mains,
des sphères
d’or remplies d’émeraudes; son ventre, un bloc d’ivoire
évanoui dans des
saphirs » (5:14). Dans le texte hébreu du
verset le
mot SHEN, « dent »,
« ivoire », est précédé par
le mot ÉCHET
qui désigne un objet bien poli, chef-d’œuvre d’ivoire vert,
ingénieusement
travaillé. Le dictionnaire Hébreu-Français
Sander/Trenel rappelle que le mot
ÉCHET signifie tout d’abord : « penser, se
souvenir ». Le chef-d’œuvre
est-il pensé ou pense-t-il lui-même ?
Ce chef-d’œuvre n’est assurément pas banal, mais a-t-il sa place
dans un
commentaire consacré au tableau de Ce
bloc d’ivoire, ivoire qui
pense (?) correspond au « ventre » du
Bien-aimé. Le mot hébreu ici
traduit par « ventre » est
Méï : l’intestin. Le Méi ici
chef-d’œuvre en ivoire, évanoui ou serti de saphirs, devient
lorsqu’il est
prolongé par un Lamed ou L, un vêtement jadis porté
par les nobles et les
princes. Dans les communautés Achkénazes, le rouleau est
attaché par une
« ceinture » et recouvert d’un manteau : le
Méïl. Certains
Kabbalistes rappellent que le mot hébreu SAPIR (pluriel Sapirim)
qui clôt le
verset, est apparenté par sa racine au mot Sépher :
le
« Livre ». L’objet
évoqué dans le verset paraît comme le support de
l’écriture qui fut jadis peau de bête, os, tablette,
intestin ou bien encore
rouleau de parchemin. Le verset pourrait évoquer un rouleau
soutenu aux
extrémités par des baguettes ou manches de bois ou
d’ivoire, appelés en hébreu « Atsé
hayyim », soit : « arbres de
vie ». Ces « arbres de
vie » qui, dans l’Antiquité pouvaient être
d’ivoire, nous rappellent les
arbres/éléphants du Pilat qui eux même nous
rappellent la parabole rabbinique
des cinq aveugles. Les aveugles n’ayant jamais vu un
éléphant, en auront une
approche différente les uns des autres. Pour
le cinquième, alors qu’il s’accrochait à
l’éléphant à genou, l’animal
lui apparaissait comme un tronc d’arbre en mouvement. Le rabbin affirma
que
tout en ayant tort, les aveugles avaient raison et qu’il en
était de même pour
Dieu, chaque homme se le représentait de façon
différente et pourtant Dieu
était bien réel.
|
|
La
bibliothèque secrète du Pilat ou la bibliothèque
de Zerobabel L’un des
mots clefs inhérent à l’histoire ésotérique
du Pilat, serait précisément le mot
« vivier». Louis Charbonneau-Lassay une
fois encore nous révèle des éléments
d’importance sur les viviers
sacrés : « On
trouve
encore aujourd’hui des viviers sacrés en Asie : A
Saravanne, dans le Laos
indochinois, la bibliothèque bouddhique est établie sur
pilotis au-dessus d’une
pièce d’eau ‘’où grouillent des poissons sacrés’’
– Alix Amé, Une française au Laos, 1932. L’idée
de viviers sacrés associés à
l’éléphant ou à
son ivoire évoque à n’en pas douter la notion de
livre(s), de
bibliothèque ; une bibliothèque dans laquelle
seraient entreposés notamment
des « Elépantini Libri »
ou
Livres d’Ivoire. L’auteur de l’excellent blog « DICTIONNAIRE
DU LIVRE DE
TITIVILLUS », indique : « Une
édition ancienne du manuel ‘’Roret’’ de la reliure distinguait
les ivoires
blancs déjà un peu anciens des ivoires verts provenant des bêtes récemment abattues et des
ivoires bleus
préhistoriques provenant de l’un des mammouths
fossiles. » L’hébreu
Pil (Eléphant) est apparenté à l’arabe Fil qui
nomme la sourate AL FIL l’Eléphant
du Coran. Cette sourate de 5 versets se présente ainsi
traduite par André
Chouraqui : 1. Ne
vois-tu pas comment ton Rabb (Seigneur) à
traité les Compagnons des Elephants ? 2. N’a-t-il
pas fait de leur fourberie un fourvoiement ? 3. Il a
envoyé contre eux les oiseaux Abâbîl 4. leur
jeter des pierres empreintes, 5
qui les a mis en fauches fanées. Cette
Sourate évoque l’expédition réduite à
néant,
conduite en 570/571 contre le temple de Des auteurs
tels Michel Louis Lévy « La Tour de
l’Eléphant » (site Midrach) ainsi que cet auteur
anonyme du site le « Champ
du Midrash » (Les Eléphants), ont
démontré que cette sourate serait en
partie inspiré par un épisode du Livre des
Macchabées ; épisode lui-même
inspiré de celui de la Tour de Babel. L’auteur
anonyme rapproche également le verset 1 de
la Sourate du verset 29, chapitre 50 de Jérémie
annonçant la chute de
Babel : Payez-la
selon
ses œuvres (shalmu la ke-pe’ala) tout ce qu’elle a
fait, faites-le lui.
En effet,
le mot hébreu pe’ala :
« œuvres », est le même mot que l’arabe
fa’ala :
« faire », « œuvrer » qu’A.
Chouraqui traduit par
« traiter ». Et ce mot se présente, de par
les lettres qui le composent
comme une évocation du Pil ou Fil : l’Eléphant. Dans la Sourate ABABIL évoque
BABEL. Les oiseaux
Abâbîl, d’après la tradition, avaient la tête
comme celle d’oiseaux voraces et
ne furent jamais plus observés dans la région. Les
pierres empreintes ou
pierres portant des marques faites au ciel, jetées
par les oiseaux
étaient des pierres brûlantes. Elles rappellent les
pierres se détachant de la
Tour de Babel. Les empreintes ou marques célestes gravés
sur les pierres ont
mis en fauches fanées (expression associée à
la destruction de Babel ou
Babylone dans les prophéties), les Compagnon de
l’Eléphant. Cette
expression, suivant certains commentaires, peut aussi se traduire par papiers mâchés. L’idée de papier
apparaît intéressante au vu des empreintes ou marques
célestes… lettres de
feu ! L’année
570 durant laquelle naquit Mahomet, est
traditionnellement appelée « l’année de
l’éléphant » ou
« l’année Aleph » en
référence aux évènements qui s’y seraient
déroulés. M.-L. Lévy en vient à se demander
si le nom de la lettre Aleph
pourrait-être à l’origine de celui de
l’éléphant qui nous est connu par le grec
ancien. Bien que les Arabes n’aient connu le secret chinois du papier
qu’après
la bataille de Talas en 751, le procédé était
connu en Chine depuis
l’Antiquité. L’auteur
anonyme rappelle qu’en hébreu, l’éléphant
(fil) évoque phonétiquement un prodige (fele, niflaot) et
aussi une chute
(nfl). « Or c’est par ces prodiges
que Dieu va permettre aux Juifs de vaincre des armées grecques.
Les Empires
tomberont, et notamment Babel (nafela babel) d’où sans doute la
référence
coranique à Babil, Babel. » Le
nom de Babel ( Mon berceau
s’adossait à la
bibliothèque, Babel sombre
où roman, science,
fabliau, Tout, la
cendre latine et la
poussière grecque, Se
mêlaient. J’étais haut comme
un in-folio. Plus
récemment, R. Musil dans L’Homme sans
qualités (Seuil, 1995) s’inspira de cette
bibliothèque
de l’absurde : science sans
conscience : « Ainsi
je
me trouvai réellement dans le Saint des Saints, de la
bibliothèque. J’avais
l’impression, je t’assure, d’être entré à
l’intérieur d’un crâne. Il n’y avait
rien autour de moi que des rayons et leurs cellules de livres, partout
des
échelles pour monter, et sur les tables et les pupitres rien que
des catalogues
et des bibliographies, toute la quintessence du savoir, nulle part un
livre sensé, lisible, rien que des livre sur des
livres. » |
|
Suivant
la tradition l’Arche de Noé plus qu’un zoo, était une
bibliothèque. Le nom même
de l’arche en hébreu : «
Tébah », signifie aussi
« mot » ce qui confirmerait que l’arche fut plus
dictionnaire,
qu’animalerie. C’est aussi pour cette raison que dans les synagogues,
l’arche
dans laquelle les rouleaux de la Torah étaient placés
était appelée Thébah. Depuis
quelques années, Alain-Abraham Abehsera, s’évertue au
travers de différentes
langues, dont l’hébreu ou le français – mais pas
uniquement – à démontrer que les
différentes langues de la terre ont eu un tronc commun. Dans son
dernier livre
« BABEL La Langue Promise » (éditions
Dora), il écrit dans son
avant-propos : « Avec
Babel, on
entrera, tout éveillé, dans le chaos. Dans le tohu-bohu
des débuts où rien ne
se distingue. Pas même le temps qui passe et
sépare. » C’est
cette entrée dans le tohu-bohu des origines qui permettra
à l’auteur de
découvrir que : « Il n’existe
qu’une seule parole humaine, un vaste hologramme dont les langues ne
sont que
les morceaux brisés. » L’auteur
résume à la fin de son livre, sa quête au cœur des
langues, à un rêve : « (…) je
fus emporté dans une ville
cachée par les brumes. Ma confusion était absolue, et je
ne peux vous dire s’il
s’agissait de Jérusalem, Babylone ou mille autres villes
connues. A peine
arrivé, j’ai entendu une voix appeler : ‘’ Zerubabel !
Zerubabel ! ‘’ (…) De loin, j’aperçus un amoncellement de
cristaux carrés,
morceaux d’une Tour brisée qui avait dû être bien
haute. De près, ces carrés
semblaient durs comme la pierre et fluides comme l’eau. Sur le premier
cristal,
je reconnu mon visage, sans traits, entremêlé de mon nom,
sans lettres. Je ne
m’étais jamais perçu ainsi. (…) j’ai vu,
en ma pierre, toute la création se refléter,
de tous les points de vue.
C’était beau. La voix revint et m’intima de construire avec ces
pierres une
maison à hauteur d’homme, pas une tour. » Si
Babel était sombre, Zerubabel ou Zorobabel (Semence – Dispersion
– de Babel) se
veut lumière. Ce fut Zerubabel, fils d’exilés juifs,
natif de Babylone qui, suite
à un édit de Cyrus, construisit le 2e Temple
de Jérusalem. Zerubabel
est présenté avec le prêtre Josué comme l’un
des deux Oliviers, Fils de l’huile
(Zacharie IV – 11 et 14). L’image de ces deux « Fils de
l’huile » fut si
importe qu’ils réapparaissent avec les deux témoins de
l’Apocalypse de Jean au
chapitre 11. Ils prophétisent dans Ainsi
que les commentateurs du Livre des Macchabées
rédigé en grec, on pu le noter, l’éléphant
y est essentiellement appelé la Bête. Dans l’Apocalypse de
Jean, la Bête monte
de l’Abîme, un mot qui nous rappelle curieusement le second nom
hébreu de
l’éléphant ! Il
convient à présent de retrouver le Mont Pila(t) que nous
n’avons en fait pas
quitté. Sur le Pila(t) et donc sur l’Eléphant plane
l’ombre de la Société
Angélique dont Le Songe de Poliphile était le livre par
excellence. L’éléphant
tient dans le Songe une place importante. Poliphile découvre « le monstre en manière
d’éléphant (…) avant que de trouver le dragon :
car il a été formé de pierre en
une grandeur excessive… » (Page
130 – l’Imprimerie nationale Editions 1994) L’éléphant de
pierre surmonté d’un
obélisque se dresse sur un soubassement entaillé de
caractères égyptiens hiéroglyphiques.
Dans l’un des côtés, une porte permet à Poliphile
de monter en la concavité de
l’éléphant (pages 43 à 45). Il y trouve deux
sépulcres sur les couvercles
desquels se dressent les images d’un homme nu couronné et d’une
femme nue
pareillement couronnée rappelant Adam et Eve. Chaque
sépulcre était éclairé par
une lampe perpétuelle. L’homme tient un sceptre de la main
droite et de « la main gauche reposée
sur un
écusson, courbé en forme de carène de
barque et taillé autour à la semblance d’une tête de cheval, auquel était écrit de
lettres hébraïques, grecques
et latines. » C’est, partant de ces inscriptions hébraïques, que j’avais rédigé un texte, inédit à ce jour, il y a de cela environ six années. « De l’éléphant au « maître de l’abime », tel était le titre que je donnais à ce texte. Je me rends compte aujourd’hui combien il était approprié au vu de ma présente étude. Il convient également de relire tout particulièrement les chapitres 37, 38 et 39 du roman « Le voyage au centre de la terre » de Jules Verne où l’on pénètre, s’emble-t-il certains mystères inhérents à cet Abîme du Pila(t), de l’Eléphant car en ce lieu se trouve peut-être cette Bibliothèque de « Zerubabel » dont Marie-Madeleine sous le regard bienveillant de l’éléphant de pierre, étudie l’un des rouleaux dont les 17 lignes originelles peuvent nous rappeller le Déluge biblique.  Reconstitution
du tableau original faite par Patrick Berlier
À
suivre…
Michel Barbot
|
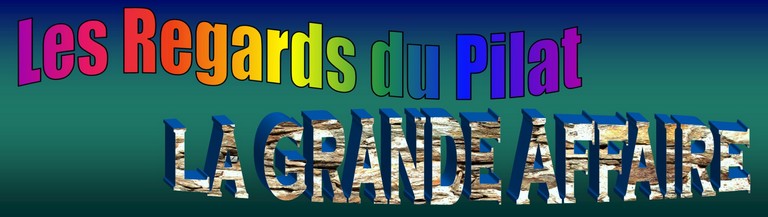 |