
 |
RUBRIQUE
Sociétés Secrètes |
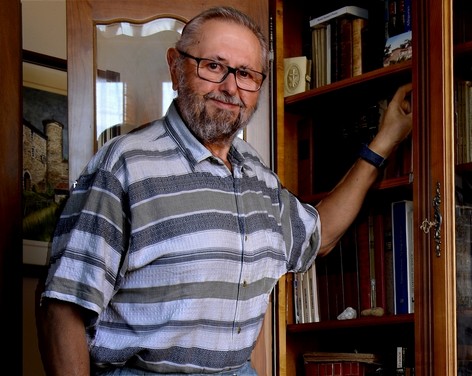 |
Patrick
Berlier
|
AUX ORIGINES
DE LA SOCIÉTÉ ANGÉLIQUE, À VENISE Au milieu du
XVIe siècle à Lyon, le
riche magistrat et collectionneur Nicolas de Lange fonda un
cénacle très
fermé : la Société Angélique.
C'était une société secrète ou plutôt
discrète, composé d'humanistes, d'imprimeurs, d'artistes,
d'hommes de lettres,
de loi ou d'Église. Son nom reprenait celui du domaine de
Nicolas de Lange sur
la colline de Fourvière : l'Angélique. En
réalité l'érudit Nicolas de
Lange n'a fait que ranimer et rassembler divers groupuscules qui
existaient
déjà depuis une cinquantaine d'années dans
l'ancienne capitale des Gaules, dont
l'Académie de Fourvière, mythique en tant
qu'académie au sens moderne du terme,
mais pourtant bien réelle, sur le modèle des
académies antiques. Nous n'allons pas
revenir sur l'histoire de cette société, à
laquelle j'ai consacré un livre en
trois tomes (voir en rubrique Librairie) –
même si je reprends ici à propos du Songe de Poliphile
quelques passages du tome II – mais plutôt sur ses origines
profondes, qui ne
sont pas à chercher en France mais plutôt en Italie,
à Venise plus précisément.
Ce
qu'il reste aujourd'hui du domaine de l'Angélique MYSTÉRIEUX
GILPINS La
Société Angélique avait pour
« bible » l'ouvrage le plus renommé de la
Renaissance, Hypnerotomachia
Poliphili, imprimé à Venise en 1499, puis à
Paris en 1546 dans une version
française et sous le titre Discours du songe de Poliphile.
Livre codé,
ésotérique, cet ouvrage connut un succès
extraordinaire, tant pour sa
typographie innovante que pour ses somptueuses gravures dues aux plus
grands
artistes. La corporation des peintres, graveurs et sculpteurs,
était alors très
puissante ; on les nommait Gilpins, Saint-Gilpins, Saingilles,
Guilpains,
Glypains, etc. Très introduits dans les milieux des imprimeurs,
ils se
servirent du Songe pour véhiculer, de manière
cryptée, leur enseignement
et leur organisation. Et en réalité, la
Société qui deviendra l’Angélique a
été
fondée dans l'ombre par les maîtres Gilpins, Nicolas de
Lange en étant surtout
l'hôte fortuné. On comprend que dans ces conditions ce
livre soit devenu une
référence incontournable.
Portrait
de Nicolas de Lange L'imprimeur
et éditeur de l'édition originale
italienne était le célébrissime Aldo Manuzio. En
même temps que son imprimerie,
il dirigeait à Venise une Académie, elle aussi sur le
modèle des académies
antiques. On peut la considérer, ainsi que son homologue
l'Académie de
Fourvière, née en même temps, comme
l'archétype de la Société Angélique.
D'autant qu'un certain personnage lyonnais fréquenta Aldo
Manuzio avant de
devenir l'un des piliers de l'Angélique. Nous allons
donc nous intéresser à cet imprimeur,
à son Académie, à son livre le plus fameux, et
à Venise, ville fastueuse où il
fait bon flâner, et où les Gilpins ont semé des
indices, pour le promeneur peu
pressé qui les découvrira, s'il sait regarder en levant
un peu les yeux, et
s'il n'hésite pas à s'écarter du centre-ville
touristique. « LE
MICHEL-ANGE DU
LIVRE » Aldo Manuzio
est né vers 1450 à Bassiano près de
Rome. En même temps donc que l'imprimerie, qui allait devenir son
métier. Après
ses humanités à Rome, il poursuivit brillamment ses
études à l'université de
Ferrare, dont il finit par devenir l'un des professeurs, enseignant le
grec,
une langue et une culture pour laquelle il se passionnait. Un peu avant
1480 il
fit la connaissance de Jean Pic de la Mirandole (1463-1494), qui
malgré sa
jeunesse était déjà un illustre humaniste,
philosophe et kabbaliste chrétien,
et qui allait lui ouvrir les portes des milieux les plus savants.
Pic
de la Mirandole En 1482, une
guerre entre Ferrare et Venise
obligea les deux hommes à s'enfuir. Ils se
réfugièrent à Carpi, dans l'actuelle
Émilie-Romagne, dans le château des Pio, où vivait
la sœur de Pic de la
Mirandole. Veuve depuis peu du prince de Carpi, elle administrait le
domaine,
tout en élevant ses deux enfants, Alberto et Lionello Pio. Aldo
Manuzio devint
leur précepteur, et Alberto Pio conserva sa vie durant une
infaillible amitié
pour son maître.
Le
château des Pio à Carpi (photo Pollabarca) En 1490,
Manuzio quitta Carpi pour s'installer à
Venise, alors capitale italienne de l'imprimerie. À quarante
ans, il avait
choisi de changer de vie et de devenir imprimeur, pour pouvoir diffuser
les
textes antiques, grecs en particulier, qu'il considérait comme
le fondement
indispensable de la culture. Il apprit son métier auprès
d'Andrea Torresani, un
imprimeur réputé, qui avait sa maison et son atelier sur
le Campo San
Paternian (aujourd'hui Campo Manin), dans le centre de
Venise. Aldo
Manuzio devint rapidement son associé, et dès 1493 il
édita son premier livre,
une grammaire latine, suivie en 1494 d'une grammaire grecque. À
l'époque, les
imprimeurs étaient en même temps éditeurs et
libraires, et leurs
boutiques-ateliers étaient de véritables foyers
culturels. Peu
après Manuzio trouva le financement
nécessaire pour installer sa propre imprimerie sur le Campo
Sant'Agostin,
dans le quartier de San Polo, de l'autre côté du
Grand Canal. Il y était
dès 1496. Comme la plupart des places de Venise, le Campo
Sant'Agostin
doit son nom à l'église éponyme qui s'y
élevait. La vue de Venise en
perspective, dressée en 1500 par Jacopo de Barbari, permet
d'avoir une idée de
la physionomie des lieux à l'époque où Aldo
Manuzio y habitait.
Vue
de l'église Sant'Agostin sur le Campo du même nom, en
1500 C'est
là qu'il imprima son édition des œuvres
complètes d'Aristote, en grec naturellement, grâce aux
caractères élégants spécialement
créés pour lui par son collaborateur Francesco Griffo. On
doit à Aldo Manuzio
de nombreuses innovations dans l'art du livre, comme l'invention des
caractères
italiques inspirés de l'écriture cursive, certaines
ponctuations, et l'emploi
du format in-octavo, celui de nos actuels livres de poche. Il fut aussi
le
premier, à Venise, à publier des ouvrages en
hébreu. Rapidement sa réputation
fut telle que son atelier devint un lieu très prisé pour
tous les Vénitiens
érudits, attirant même des visiteurs étrangers. En 1498 la
peste se déclara et Aldo Manuzio fut
atteint par la maladie. Très inquiet, il promit à Dieu de
se faire prêtre si
jamais il en réchappait. Il guérit effectivement, mais il
implora le pape
Alexandre VI de le relever de ce vœu, expliquant qu'il l'avait fait
dans un
moment d'égarement dû à la terrible maladie. Le
souverain pontife y consentit,
lui demandant en contrepartie d'imprimer désormais
également des livres pieux.
Manuzio commença donc par éditer les Lettres de
sainte Catherine. Ce fut
le premier auteur féminin publié à Venise. L'année
1499 fut marquée par l'édition de l'Hypnetoromachia
Poliphili, livre dont il sera question plus en détail un peu
plus loin.
C'est dans cet ouvrage qu'apparut pour la première fois la
marque d'imprimeur
d'Aldo Manuzio, un dauphin enroulé autour d'une ancre, avec pour
devise latine Festina
lente, que l'on peut traduire par « hâte-toi
lentement ». Le
dauphin est symbole d'agilité et de rapidité, tandis que
l'ancre symbolise la
lenteur et l'enracinement. La marque apparaissait à la fois sur
la page de
titre et parmi les gravures du livre.
L'ancre
et le dauphin, marque d'imprimeur d'Aldo Manuzio, Déjà
lors de son séjour à Carpi, Aldo Manuzio
avait caressé l'idée de fonder sa propre Académie.
Il avait à l'époque renoncé
provisoirement à ce projet. Mais après l'édition
de son fameux Hypnetoromachia
Poliphili, la célébrité et la fortune aidant,
il se décida en 1502 à créer
l'Accademia Aldina (Académie Aldine en français).
Son but était le
diffusion de la langue, de la culture et de la littérature
grecque, la base de
la Connaissance selon l'imprimeur. Ce n'était pas une
académie au sens strict,
c'est-à-dire une institution officielle avec un règlement
précis, mais plutôt
un groupe informel sur le modèle des académies
platoniciennes. C'était
d'ailleurs très en vogue dans toute l'Europe. On peut citer
l'Académie rhénane,
l'Académie bavaroise, et à Lyon l'Académie de
Fourvière, née à la même époque. L'Accademia
Aldina se réunissait dans la
maison d'Aldo Manuzio. Elle fut fréquentée par les plus
grands intellectuels
vénitiens, ou par des hôtes de passage, italiens ou
étrangers. On y vit aussi
des exilés grecs, dont la communauté était
importante à Venise. Ils
contribuèrent à choisir les auteurs grecs qui seraient
imprimés par l'atelier.
Seule la langue grecque devait être parlée pendant les
réunions, où l'on
débattait durant des heures de sujets grammaticaux,
littéraires ou
philosophiques. Celui qui oubliait cette obligation devait verser une
obole
dans une cagnotte, laquelle servait ensuite à financer un
banquet. L'Académie
acceptait aussi les dames, comme Isabelle d'Este, l'épouse du
duc de Mantoue,
ou même Lucrèce Borgia, si sulfureuse dans sa jeunesse,
mais qui sut s'assagir
après son mariage avec Alphonse d'Este, duc de Ferrare.
L'atelier Manuzio
servait aussi de boîte aux lettres pour la correspondance entre
les membres de
l'Académie, un principe que l'on allait retrouver plus tard avec
la Société
Angélique. En fait tous les ferments de la future
société lyonnaise existaient
déjà dans l'Accademia Aldina.
Portrait
d'Aldo Manuzio En 1505 la
vie d'Aldo Manuzio prit une nouvelle
orientation, grâce à son mariage avec Maria Torresani, la
fille de son maître
et associé. À son arrivée à Venise, elle
n'avait que dix ans, il la vit grandir
et se transformer en femme, si bien qu'il finit par éprouver
à son égard un
sentiment bien différent. Quinquagénaire fringant, Aldo
épousa Maria, de trente
ans sa cadette, mais le fait était courant à
l'époque. Le mariage fut célébré
dans l'église Santa Maria dei Miracoli, une petite
merveille de la
Renaissance construite quelques années plus tôt tout
près du pont du Rialto.
Cette église est encore de nos jours la
préférée des Vénitiens pour les
cérémonies nuptiales.
L'église
Santa Maria dei Miracoli (Tableau
de Bernardo Belloto - 1740) Le jeune
couple s'installa dans la vaste maison
des Torresani, sur le Campo San Paternian, voisine de
l'église du même
nom, laquelle se remarquait par son campanile pentagonal, le seul de ce
type à
Venise ; église et campanile ont disparu aujourd'hui.
L'imprimeur
changeait de paroisse, il abandonnait le Campo Sant'Agostin et
installait son atelier à côté de celui de son
beau-père. C'est là aussi
désormais que se réunirait l'Accademia Aldina. Jusqu'alors
Aldo Manuzio n'avait vécu que pour
son travail. Mais en ayant trouvé l'amour il trouva aussi
d'autres sens à sa
vie. Pendant une longue période il se consacra à sa
famille et ralentit considérablement
ses publications. Il faut dire que sa femme connut plusieurs grossesses
successives, et le couple eut cinq enfants, trois fils, et deux filles
jumelles. En 1503 son ancien élève et ami Alberto Pio
avait autorisé
l'imprimeur à ajouter à son patronyme le nom prestigieux
des Pio. Il prit donc
désormais le nom d'Aldo Pio Manuzio. En 1507
arriva un visiteur étranger, Érasme de
Rotterdam (1467-1536), qui allait se faire connaître quelques
années plus tard
par son livre Éloge de la folie. Après avoir
voyagé en Angleterre,
Érasme était arrivé en Italie en 1506. Son souhait
le plus cher était de faire
imprimer par Manuzio sa traduction d'Euripide ainsi qu'une nouvelle
édition de
ses Adages. Il envoya une lettre élogieuse à
l'imprimeur, et celui-ci
lui fixa un rendez-vous. Érasme se présenta au jour dit
dans l'atelier
vénitien, et rapidement le courant passa si bien entre les deux
humanistes
qu'ils devinrent des amis inséparables. Érasme,
accepté par l'Accademia
Aldina, était hébergé dans la maison du Campo
San Paternian ;
il y resta près d'un an.
Portrait
d'Érasme Érasme
était encore là lorsqu'en 1508 un autre
visiteur étranger se présenta. Il s'agissait d'un
Français, Jean Grolier. Né à
Lyon en 1479, cet érudit avait comme beaucoup d'autres à
l'époque voyagé
jusqu'en en Italie, où il avait fréquenté
plusieurs savants. Il acheta à Aldo
Manuzio plusieurs volumes qui allaient compléter grandement sa
prestigieuse
bibliothèque. Lorsqu'il rentra en France, Jean Grolier fit
relier ses livres,
au dos desquels était apposée en lettres d'or cette
mention : « Grolierii
et amicorum – à Grolier et ses amis ». Il avait
en effet réuni autour
de lui un groupe d'érudits, dont certains avaient appartenu
à l'Académie de
Fourvière, et qui était l'un de ces cercles
fédérés plus tard par la Société
Angélique. Jean Grolier en deviendrait un membre assidu,
jusqu'à son décès en
1565. Nul doute que ses conversations entre Jean Grolier, Érasme
et Aldo
Manuzio ont dû être instructives.
Page
avec la marque d'imprimeur d'Aldo Manuzio sur l'un
des ouvrages acquis par Jean Grolier, et mention au dos de la reliure L'année
1508 vit la création de la Ligue de
Cambrai, coalition entre le pape Jules II, le Saint-Empire romain
germanique,
la France, l'Aragon et le duché de Florence, dans le but
d'abattre la
république de Venise. Par son origine romaine, Aldo Manuzio
devenait suspect
aux yeux des Vénitiens, qui ne voyaient déjà pas
d'un très bon œil ses
relations avec des savants étrangers. Il dut s'enfuir avec femme
et enfants, et
se réfugia à Ferrare auprès de son amie
Lucrèce Borgia, laissant son imprimerie
aux bons soins de son beau-père. Érasme quitta Venise lui
aussi, et retourna en
Grande-Bretagne. Manuzio séjourna à Ferrare pendant plus
de quatre ans. Pendant
ce temps, les alliances se défaisaient et d'autres se nouaient,
au gré des
batailles. Tout changea lorsqu'en 1513 fut élu un nouveau pape,
Jean de
Médicis, sous le nom de Léon X. Très favorable
à Venise, le nouveau souverain
pontife implora Manuzio de rejoindre sa ville d'adoption et d'y
reprendre ses
activités. L'imprimeur
se remit donc à la tâche. Mais
l'année suivante il tomba malade, et il mourut le 6
février 1515, laissant une
œuvre colossale et innovante, lui valant à titre posthume le
surnom de
« Michel-Ange du livre ». Son fils Paolo lui
succéda, suivi par le
fils de celui-ci, Aldo II dit le Jeune. Mais l'Accademia Aldina
s'était
éteinte avec son créateur. LE SONGE DE
POLIPHILE, OU LES
SECRETS D'UN LIVRE CULTE C'est en 1498
qu'Aldo Manuzio reçut la visite du
protonotaire apostolique Leonardo Grasso, venu de Vérone pour
lui apporter un
manuscrit bien étrange, au titre alambiqué : Hypnerotomachia
Poliphili.
Ce texte, qui semblait être au premier abord un récit
d'amour, avait été écrit
en 1467 à Trévise par un certain Francesco Colonna. On a
pensé pendant
longtemps qu'il s'agissait d'un moine dominicain, menant une vie pour
le moins
dissolue. On penche plutôt aujourd'hui pour un autre Francesco
Colonna, prince
de Palestrina, un érudit féru d'architecture, ce qui
expliquerait certains
passages du livre. La ville de Palestrina, proche de Rome, est
l'ancienne Præneste
romaine, célèbre pour son temple de
Fortune, que Colonna fit restaurer. L'Hypnetoromachia
s'en
inspire clairement. Avec l'aide financière de Grasso, Manuzio
accepta de
publier cet ouvrage curieux, mais l'imprimeur et son commanditaire
comprirent
qu'il était obligatoire d'y inclure de nombreuses illustrations
pour éclairer
le texte. Ils firent donc appel aux ateliers des peintres Andrea
Mantegna ou
Giovanni Bellini, et il n'est pas impossible qu'Albrecht Dürer y
ait aussi
travaillé. Leurs dessins furent ensuite retranscris sous la
forme de gravures
sur bois, seule possibilité d'illustrer un livre à
l'époque. C'était
précisément le travail des Gilpins. L'affaire fut
menée rondement, et l'ouvrage
orné de 172 gravures fut imprimé dès
l'année suivante. Il allait devenir sans
doute le plus beau livre de la Renaissance italienne, et assurer la
célébrité à
son imprimeur. Son influence a été considérable
dans les milieux érudits, où il
était de bon ton de savoir « lire » l'Hypnerotomachia
Poliphili.
Un
exemplaire de l'édition originale de l'Hypnerotomachia
Poliphili Le titre
assez rébarbatif est tiré du grec. Le
premier mot, Hypnerotomachia, contient hypne pour
songe, eroto
pour amour, machia pour combat. Le second mot, Poliphili,
est un
mot grec décliné en latin. C'est le nom du personnage
principal,
Poliphile ; il est composé de Polia, nom de
l'héroïne, et de phile,
qui aime. Ce livre célèbre pour sa typographie et ses
gravures, contiendrait de
manière cryptée l'organisation de toutes les
sociétés secrètes de l'époque. On
y découvre en particulier les neuf grades,
révélés par les neuf gravures
contenant des anges, d'une organisation évidemment
angélique, ce qui suffit à
prouver qu'une telle société existait déjà
à Venise vers la fin du XVe
siècle. L'identité
de l'auteur est délivrée par les
lettrines en tête de chaque chapitre, formant une phrase en
latin : Poliam
frater
Franciscus Columna peramavit Soit :
« Frère Francesco Colonna aime
Polia d’un grand amour ». C'est le qualificatif de
« frère » qui
fit pencher pour un auteur ecclésiastique, mais en fait le terme
peut se
comprendre de bien des façons. Leonardo Grasso plaça un
avertissement en préambule,
prévenant que ce qui se trouve dans le livre est exprimé
dans un langage
magnifique et n’est pas fait pour être dit dans les carrefours.
L’ouvrage était
rédigé dans un italien mêlé de latin, avec
des mentions en grec, en hébreu et
en arabe. Il était donc destiné à un public
restreint d'érudits. De plus, selon
les règles du « Grimoire »,
procédé cryptographique variante de la
Langue des Oiseaux, ses somptueuses gravures qui ont fait sa
renommée étaient à
décrypter en langue vulgaire, c'est-à-dire en
français. Même si c'était
alors la langue des intellectuels, seule une certaine élite du
peuple italien
était capable de lire le livre et d'en déchiffrer les
images. La version
française a été publiée à Paris en
1546 par l'atelier de Jacques Kerver, sous le titre Discours du
songe de
Poliphile. La traduction est attribuée à Jean
Martin, secrétaire du
Cardinal de Lenoncourt. Si le cardinal en était sans doute le
commanditaire, le
livre fut rapporté d'Italie par le chevalier de Malte Georges de
Vauzelles,
issu d'une grande famille lyonnaise. Son frère Jean allait
devenir l'un des
piliers de la Société Angélique ; on pense
qu'il fut le véritable
traducteur du livre, Jean Martin n'étant qu'un prête-nom.
Comme le seul moyen
de reproduire les gravures était de les redessiner, ce travail
fut confié aux
plus grands artistes du temps, qui s'appliquèrent à les
rendre encore plus
belles que les originales. Cette édition connut elle aussi la
célébrité.
Frontispice
de l'édition française L’histoire du
Songe peut se raconter en
quelques lignes. L’ouvrage est composé de deux livres. Dans le
Livre premier,
Poliphile recherche en rêve sa bien-aimée Polia dans un
monde peuplé de nymphes
et de déesses. Il sera conduit vers une falaise percée de
trois portes, ouvrant
chacune sur un univers différent, et il devra choisir de
poursuivre sa quête
dans l’un d’entre eux. Là seulement il trouvera sa Polia, et
pourra enfin
s’unir à elle. Puis les deux amants s’embarqueront pour
Cythère où ils
obtiendront la bénédiction des dieux. Commence alors le
Livre second, dont
l'action est en réalité antérieure au premier, et
raconte l’histoire de Polia,
jeune femme glaciale qui s’est vouée au temple de Diane et
rejette l’amour de
Poliphile, jusqu’à ce que Vénus ordonne à son fils
Cupidon de décocher une
flèche vers elle. Poliphile et Polia s’aiment enfin, mais le
rêve cesse et
Poliphile se réveille seul. Parmi les
érudits qui se sont penchés sur le
décryptage du Songe de Poliphile, il convient de citer
particulièrement
Claude-Sosthène Grasset d’Orcet, qui a la fin du XIXe
siècle écrivit
plusieurs centaines d’articles pour la Revue Britannique.
L’œuvre de
Grasset d’Orcet repose sur le postulat affirmant que le monde a
toujours été
partagé en deux factions opposées, qui ont tenté
de le gouverner dans l’ombre
par l’entremise de sociétés secrètes. Ces factions
eurent pour noms
Bourguignons et Armagnac, Guelfes et Gibelins (en particulier en
Italie), parti
solaire et parti lunaire, quarte et quinte, rose rouge et rose blanche,
Beaucéant et Oriflamme, paroisse et château,
Ménestrels de Murcie et Ménestrels
de Morvan. Pour Grasset
d'Orcet, le titre original Hypnerotomachia
Poliphili est à décrypter par l'art du Grimoire.
L'érudit le décompose en
une phrase de moyen français, où combat
(troisième personne de l’indicatif
présent du verbe combattre) se dit il poing : Grec – amour
songe il poing Il n’en garde
que les consonnes, en éliminant le
C de grec (qui ne se prononçait pas à l’époque) et
le G muet de poing. La
phrase se résume alors à cette structure
consonantique : G R M R S N G
L P N Et le
résultat est, après réintroduction de
nouvelles voyelles : Grimoire
Saint-Gilpin Quant
à l’autre partie du titre, Poliphili,
Grasset d’Orcet la décline ainsi : Latin –
Poliphile L T N P L PH L L’est Temple affilié Sa conclusion
est que l’auteur du Songe
était membre d’un Ordre du Temple sauvegardé dans l’Ordre
de Malte. Mais la
proposition de Grasset d’Orcet est assez surprenante. Il se contente de
transcrire Poliphili en Poliphile, en transposant
simplement ce
nom propre latin par son équivalent français, sans le traduire
véritablement, alors qu’il traduit le mot Hypnerotomachi.
Poliphile peut
avoir plusieurs sens différents. Phile est un mot grec
signifiant
« qui aime ». Par rapport au texte du livre,
Poliphile est celui
« qui aime Polia ». En grec, poli
signifie « ville,
cité », Poliphile veut donc dire aussi
« qui aime la ville ».
Mais poli est également un mot latin, le pluriel de polus,
pôle.
Si l’on admet ce mélange, Poliphile devient celui
« qui aime les
pôles ». Comme il n’y a que deux pôles, et qu'il
est bien connu que les
deux font la paire, on peut proposer la déclinaison
suivante : Latin – aime
paire pôles L T N M P R P
L L’y tiens homme parpoli Je le tiens
pour un homme parpoli Un homme
parpoli, c’était un maître accompli, à
la fois parfait et poli. La phrase peut, elle aussi, s’appliquer
à l’auteur de
l’œuvre. ET
MAINTENANT, EN ROUTE POUR
VENISE ! Évoquer
la vie d'Aldo Manuzio, son académie, et
son livre le plus connu, n'était pas suffisant. Pour
compléter ce dossier il
était indispensable d'aller découvrir le décor de
cette histoire : Venise.
Il faut bien comprendre que c'est une ville à part, car c'est
une cité posée
sur l'eau. Pas une île, mais un ensemble de bâtiments qui
chacun reposent sur
une forêt de pieux immergés. Venise est divisée en
six quartiers, que l'on
nomme sestiere, chacun étant lui-même
subdivisé îlots séparés par des
canaux. La ville est partagée en deux parties
séparées par le Grand Canal. D'un
côté les quartiers de Santa Croce, San Polo
et Dorsoduro,
de l'autre Cannareggio, San Marco et Castello.
La partie
la plus fréquentée de la ville est évidemment San
Marco, où l'on trouve
la basilique Saint-Marc sur la place du même nom, le Palais des
Doges, le Pont
des Soupirs, le Pont du Rialto, sans oublier les célèbres
gondoles. Le tourisme
de masse se limite à cela. Pourtant le reste de la ville ne
manque ni de charme
ni de beauté.
Plan
schématique de Venise Me voici
donc, un beau matin, sur le quai de la Riva
degli Schiavoni, la Rive des Esclaves. Aujourd'hui seuls les
touristes
débarquent des bateaux de toutes sortes qui y accostent.
Quelques centaines de
mètres à parcourir, et me voici sur la Piazza San
Marco, la Place
Saint-Marc. C'est la seule à porter le nom de piazza
(place) les autres
se nommant campo (champ), ou quand elles sont plus petites campiello
(petit champ), en souvenir du temps où elles n'étaient
que des prés entourant
une église. Je ne fais que traverser la Place Saint-Marc,
prenant ensuite le
passage qui débouche sur le Bacino Orseolo et ses
nombreuses gondoles.
Je m'engage dans un dédale de ruelles aux multiples commerces,
pour déboucher
sur le Grand Canal. Le Pont du Rialto franchi, me voici dans le sestiere
San Polo. Mon objectif est d'atteindre l'ancienne maison
d'Aldo Manuzio
sur le Campo Sant'Agostin. Pour cela je longe à gauche
le Grand Canal
par le Fondamenta del Vin. Dans le dialecte vénitien,
les quais sont
nommés Riva lorsqu'ils sont larges, ou Fondamenta
s'ils sont plus
étroits. Puis je m'enfonce dans un nouveau dédale de
ruelles, encore plus
étroites, entrecoupé de canaux que des petits ponts en
escalier permettent de
franchir. Voici le Campo San Polo, une grande place
bordée par l'église
du même nom. Ici commence la Venise authentique, habitée
par les vrais Vénitiens.
C'est une place joyeuse, où se déroulent de nombreuses
festivités populaires,
et c'est la plus grande place de Venise après la Place
Saint-Marc, sauf que si
plusieurs centaines de personnes se pressent sur la Place Saint-Marc,
ici on
peut les compter sur les doigts de la main. À l'autre bout je
dois emprunter
une ruelle très étroite, entre deux murs de brique. En
France j'hésiterais sans
doute à m'y engager, mais Venise est une ville paisible, et je
ne suis pas le
seul touriste, il y a d'autres amateurs éclairés qui
passent par là. Au
débouché de la ruelle, voici le pont qui jouxte la Ca'
Bernardo. Ca'
est l'abréviation vénitienne de casa, maison. En
fait c'est un palais à
l'architecture sublime, avec sa porte d'eau donnant sur le canal, qui
avec son
accolade et les deux oculi qui l'entourent évoque de
manière un peu subliminale
l'image d'un visage humain, ou d'un masque. Un masque vénitien,
bien sûr.
L'ensemble forme un décor typique, et pourtant le lieu est peu
connu, même si
quelques rares gondoles chargées de touristes viennent glisser
en silence sur
le canal.
La
Ca' Bernardo et sa porte d'eau À
Venise, les immeubles situés en bordure des
canaux – et ce sont généralement les plus beaux –
possèdent une porte d'eau,
qui autrefois était l'entrée principale, et au moins une
porte de terre, jadis
simple porte de service. Les immeubles qui ne donnent pas sur des
canaux
doivent se contenter de portes de terre. Ils se rattrapent avec les
interphones
qui généralement offrent l'aspect d'une tête
humaine ou plutôt d'un masque. Je
m'aperçois qu'en plus dans ce quartier les boutons de sonnettes
simples,
lorsqu'il n'y a pas d'interphone, ont la forme d'une tête de
lion, le poussoir
se trouvant dans la gueule. Bien que le lion soit omniprésent
à Venise,
puisqu'il est l'emblème de l'évangéliste saint
Marc dont les reliques reposent
dans la basilique qui lui est dédié, ces
« lions de la porte » ne
sont pas sans rappeler les trois portes percées dans la falaise
du Songe de
Poliphile. Sur la porte centrale, que choisira le héros,
figure une
inscription en quatre langues : latin, grec, hébreu et
arabe. C'est la
même expression, « mère d'amour »,
qui est donnée par le latin Materamoris
et par le grec Erototrophos. Mais si l'hébreu reprend
cette locution, il
y ajoute des lettres supplémentaires formant les mots
« lions de la
porte ».
Interphone,
et bouton de sonnette en tête de lion Ces
« lions de la porte » m'indiquent
peut-être que je touche au but : l'atelier Manuzio n'est
qu'à deux pas. Et
ce n'est que le début de la piste. Nouvelle ruelle, et me voici
dans une rue
bien plus large, rare à Venise. Son nom suffi à
l'expliquer : Rio Terra
Secondo. C'était jadis un canal (rio), qui fut
asséché et comblé de
terre (terra) pour devenir une rue, secondo parce
qu'elle est
perpendiculaire au Rio Terra Primo. Aux numéros 2309,
2310, 2311 et 2312
se trouve l'ancienne maison d'Aldo Manuzio. Quatre numéros parce
qu'il y a
quatre portes : les deux portes des magasins et les deux portes
d'entrée
de l'immeuble, séparé aujourd'hui en deux
propriétés.
L'ancienne
maison d'Aldo Manuzio Une porte
cochère au milieu a remplacé l'ancienne
entrée, plus étroite et plus basse, qui se devine encore
dans la maçonnerie.
Les deux magasins ont succédé à l'atelier de
l'imprimerie et à sa boutique de
vente. Au-dessus il y a un entresol, peut-être était-ce le
logement des
collaborateurs de Manuzio. Puis l'étage noble, plus haut, aux
fenêtres
trilobées typiquement vénitiennes, avec petit balcon
central, correspond aux
appartements de l'imprimeur. Deux pierres gravées sont incluses
dans la façade
au crépi jaunâtre, elles portent des inscriptions en latin
ou en italien. La
première est au-dessus de l'ancienne porte, elle date de 1828.
Première
inscription sur la maison Manuzio C'est du
latin, même si le mot tipographica
est évidemment un néologisme. Manucia pour
Manuzio, gens pour
« famille », eruditor pour
« instructeur, maître,
savant ». Ensuite cela se complique un peu. En s'inspirant
de la
traduction donnée par Wikipédia, on peut proposer cette
interprétation :
« le célèbre groupe d'érudits
réuni autour de la famille Manuzio a honoré
ce lieu par l'art typographique ». Eruditor serait
donc
l'abréviation du pluriel eruditorum. Mais avec les mots nem(ini)
et ignota, et sans tenir compte des erreurs grammaticales, il
peut
composer l'expression « instructeurs de l'homme
ignorant », ou plus
finement « maîtres du profane ». Il y a une
autre erreur dans cette
phrase, historique celle-là, car on ne peut pas parler de
« famille
Manuzio » dans la mesure où seul Aldo a exercé
son art dans cette maison,
ses fils qui lui ont succédé travaillaient dans l'atelier
du Campo San
Paternian. L'autre
inscription est au niveau de l'étage
noble. Elle se compose de deux parties superposées.
Seconde
inscription sur la maison Manuzio Cette fois
c'est de l'italien, plus facile à
traduire : « dans cette maison qui était celle
d'Aldo Manuzio
l'Académie Aldine se réunissait, et d'ici la
lumière des lettres grecques est
revenue éclairer les peuples civilisés – l'école
des lettres grecques de
l'université de Padoue de l'année 1876-77 a voulu
désigner pour l'avenir cet
endroit célèbre ». Je jette un
coup d'œil au Campo Sant'Agostin
qui n'est qu'à quelques mètres et qui est longé
par le Rio Terra Secondo.
L'église a disparu au XIXe siècle, à sa
place on a construit des
immeubles. Il n'en reste que le souvenir, et quelques gravures
anciennes. De ce
fait la place est beaucoup plus réduite qu'à
l'époque de Manuzio.
L'ancienne
église Sant'Agostin Maintenant je
dois me diriger vers le second lieu
où se réunissait l'Accademia Aldina, le Campo
San Paternian,
devenu Campo Manin. Pour cela je dois à nouveau franchir
le pont du
Rialto, mais je décide d'emprunter un itinéraire
différent de celui suivi à
l'aller. Je prends la ruelle, située quasiment en face de
l'ancienne maison
Manuzio, qui m'emmène directement sur le Campo San Giacomo
dell'Orio.
C'est une place tranquille, bien loin de la foule des touristes,
située au
chevet de l'église qui lui donne son nom. Ici se retrouvaient
les ouvriers du
livre lorsqu'ils avaient fini leur journée de travail. J'imagine
que les
Gilpins y avaient leur loge. La place se prolonge par le Campiello
dei Morti,
qui est un agréable jardin.
L'église
San Giacomo dell'Orio vue depuis le jardin du
Campiello dei Morti Nouveau
dédale de ruelles et de canaux, et je
rejoins le Fondamenta dell'Olio sur la rive du Grand Canal,
j'admire en
face la Ca' d'Oro, l'un des plus beaux palais vénitiens.
Voici le
bâtiment de la Pescheria, le pittoresque marché
aux poissons et fruits
de mer. Il date du début du XXe siècle, mais
il a remplacé un
bâtiment identique plus ancien. Des sculptures de l'artiste local
Cesare
Laurenti ornent les chapiteaux des solides colonnes soutenant la halle.
On y
retrouve des poissons, des hippocampes, des barques, des têtes
humaines, très
belles, et une étoile, sûrement celle du matin puisque le
marché aux poissons
fonctionne seulement de l'aube à midi. La gastronomie
vénitienne faisant la
part belle aux poissons et fruits de mer, il y a foule chaque matin. Le
marché
traditionnel du Rialto fait suite à la halle des poissonniers,
on peut y
acheter fruits, légumes et fleurs. Le pont du
Rialto franchi, je ne veux pas rater
l'occasion d'aller voir l'église Santa Maria dei Miracoli
où Aldo
Manuzio s'est marié. Bien qu'elle ne soit pas loin, il faut
changer de
quartier, et passer dans le Cannareggio. On sent tout de suite
la
différence au nombre de touristes : pressés en masse
compacte sur le pont
du Rialto, ils se font beaucoup plus rares dans le Cannaregio.
Voici
l'église nuptiale, mais ensuite je me perds un peu dans les
ruelles toutes
semblables pour tenter de rejoindre le Campo Manin. À
vrai dire on ne se
perd jamais vraiment à Venise, d'abord parce les directions des
points
principaux comme la Place Saint-Marc sont toujours indiquées,
ensuite parce que
s'égarer est le meilleur moyen de découvrir ce qui ne
figure pas dans les
guides touristiques. C'est ainsi
qu'après avoir emprunté un sottoportego,
l'équivalent vénitien de la traboule lyonnaise, ma bonne
étoile m'amène devant
une maison dont la façade s'orne d'un médaillon
sculpté en bas-relief, et
représentant un lièvre, ou un lapin, terrassé par
un aigle. Drôle de symbole...
Puis je réalise que aigle-lapin, par le jeu des consonnes
sonores GLPN, cela
donne Gilpin. Et cette maison n'est pas anodine, elle fut celle de
Marco Polo,
le célèbre navigateur vénitien qui vécut
à la charnière des XIIIe et
XIVe siècles.
Médaillon
aigle et lapin en façade de la maison de Marco
Polo Me dirigeant
au jugé vers le sud-ouest, je finis
par me retrouver sur le Campo San Luca, dans le quartier San
Marco.
Un côté de la place est occupé par l'immeuble de la
Caisse d'Épargne, dont la
façade opposée donne sur le Campo Manin. C'est un
immeuble moderne
construit dans les années 70, qui paraît bien incongru au
milieu des bâtiments
classiques qui l'entourent. Il est d'ailleurs très
critiqué. Qu'importe, ce qui
m'intéresse c'est que ce vaste bâtiment la Caisse
d'Épargne a remplacé
l'ancienne maison des Torresani, où les Manuzio avaient leur
atelier, et où se
réunissait l'Accademia Aldina. Il ne reste rien
évidemment de la maison
des imprimeurs, mais lors de la construction de la première
Caisse d'Épargne en
1881 une plaque avait été apposée à
l'emplacement de l'atelier. Elle est
toujours là heureusement, préservée dans
l'immeuble moderne.
Plaque
commémorative des Manuzio L'inscription
est en italien, facile à
traduire : « Aldo Pio – Paolo – Aldo II Manuzio,
princes de l'art de
l'imprimerie au seizième siècle, avec les livres
classiques répandirent depuis
cet endroit une nouvelle lumière de la sagesse civile – Caisse
d'Épargne
1881 ». Aldo Pio, c'est l'ancien, l'imprimeur de l'Hypnetoromachia
Poliphili, Paolo son fils, Aldo II dit le Jeune son petit-fils. Par
la
ruelle qui longe la Caisse d'Épargne, je débouche sur le
grand Campo Manin.
Vue
du Campo Manin – au fond le bâtiment de la Caisse
d'Épargne La
démolition de l'église et des immeubles
voisins a considérablement agrandi la place. En son centre, en
bordure du
piétement entourant la statue, au sol une discrète dalle
gravée reproduit le
plan des lieux dans son ancienne configuration. On y voit le Campo
San
Paternian de l'époque, bordé par son canal,
l'église éponyme avec son
campanile pentagonal, la maison-atelier des Torresani et Manuzio, avec,
à
l'angle, la mention « Accademia Aldina ».
Dalle
commémorative de l'ancien Campo San Paternian On ne peut
pas passer par le Campo Manin
sans aller admirer le magnifique escalier du Palazzo Contarini del
Bovolo,
à quelques dizaines de mètres seulement de la place. Bien
que typiquement
vénitien, ce palais est peu connu car il est situé au
fond d'une cour
accessible par une suite de ruelles sombres et étroites, peu
engageantes il est
vrai. Néanmoins il ne faut pas hésiter, justement,
à s'y engager. L'escalier en
colimaçon est à l'intérieur d'une tour
accolée à la façade du palais, auquel
elle permet d'accéder par des galeries couvertes. Avec ses
colonnades, ses
rambardes ciselées, cette petite merveille architecturale vaut
le détour.
Le
Palazzo Contarini del Bovolo et sa tour-escalier Retour sur le
Campo Manin. Et maintenant,
où aller ? J'ai vu ce que je voulais voir, et même
plus, mais je sens que
d'autres surprises m'attendent. Alors je me laisse guider par ma bonne
étoile... Au fond de la place je franchis le canal par le
pont-escalier.
Nouvelle ruelle, puis un panneau directionnel m'apprend que la venelle
à gauche
conduit à la Fenice, le célèbre
théâtre. Un autre canal à franchir, et
j'ai la confirmation que mon étoile était la bonne, car
voici un nouveau clin
d'œil des Gilpins, toujours le médaillon de l'aigle et du lapin,
en façade
d'une maison dont la porte d'eau est ornée d'une tête
magnifique. Il y a
d'autres têtes, humaines et plus ou moins grotesques, tout autour
du théâtre,
dont on peut faire le tour par un jeu de ruelles, de galeries, de ponts
et de
quais.
Médaillon
de l'aigle et du lapin – têtes de toutes sortes
autour de la Fenice Depuis
l'église Santa Marie dei Miracoli,
j'ai suivi un itinéraire orienté grosso-modo du nord-est
au sud-ouest, l'axe de
Vénus, l'étoile du matin, lorsqu'elle
précède le soleil autour de la Saint-Jean
d'été. Je poursuis dans cette direction. Par une
succession de rues et de
places, bordées de palais tous plus admirables les uns que les
autres, me voici
vers l'église San Vidal, construite en 1084 et
rénovée à la fin du XIIe
siècle. Saint Vidal est l'équivalent italien de saint
Vital de Ravenne,
considéré comme le père des saints Gervais et
Protais, que les Vénitiens
amalgament en un seul saint nommé Trovaso, et dont
l'église qui n'est pas très
loin semble marquer la fin de mon axe stellaire. Une sculpture en
bas-relief
au-dessus d'une porte représente un personnage barbu et
nimbé, dans doute saint
Vital, jouant avec une colombe, qui semble lui obéir. Il doit
sûrement parler
la Langue des Oiseaux...
Sculpture
en façade de l'église San Vidal Le pont de
l'Académie est tout près. De l'autre
côté c'est le bâtiment de l'Académie des
Beaux-Arts, le musée où sont conservés
d'immortels chefs-d’œuvre de la peinture vénitienne, des
Véronèse, des
Tintoret, des Titien, des Canaletto, etc. Le pont franchi, je poursuis
en
m'enfonçant dans les ruelles du Sestiere Dorsoduro.
Là aussi on
sent la différence en terme de fréquentation touristique.
Si le pont de
l'Académie attire les touristes à cause de la vue digne
d'une carte postale
qu'il offre sur le Grand Canal, les palais qui le bordent, et
l'église de la Salute,
il n'en est pas de même pour le quartier du Dorsoduro. Je
longe le Rio
de San Trovaso, par le fondamenta qui le borde, et
où je suis
quasiment tout seul. Voici un immeuble au crépi ocre jaune, avec
une grosse
cheminée vénitienne typique. La hantise des
Vénitiens, à l'époque où beaucoup
de bois entrait dans la construction des maisons, en particulier pour
les
toits, c'était l'incendie. Pour l'éviter, les
cheminées étaient plaquées
extérieurement en façade, et leur partie
supérieure très évasée était
conçue
pour éviter les projections d'escarbilles.
Immeuble
au bord du Rio de San Trovaso Les deux
façades perpendiculaires sont ornées de
médaillons et de bas-reliefs. J'y retrouve sans surprise l'aigle
et le lapin,
et bien d'autres symboles qui me paraissent plus ou moins alchimiques,
des
animaux affrontés, et un homme sauvage armée d'une massue
faite d'une branche
d'arbre. Balthazar de Villars, qui succédera à Nicolas de
Lange à la tête de la
Société Angélique, prendra comme emblème
pour son ex-libris une figure très
semblable, remplaçant seulement la massue rustique par une masse
d'arme étoilée
que l'on nomme « étoile du matin », et qui
deviendra le symbole le
plus secret de la Société Angélique.
L'étoile du matin, Vénus, à qui Venise
doit son nom. Tout est lié, rien n'est hasard, et la filiation
est limpide.
Médaillon
de l'aigle et du lapin
– homme sauvage La base de la
gaine extérieure de la cheminée est
ornée d'un bas-relief représentant un forgeron au
travail, frappant du marteau
sur une enclume. Derrière lui, à droite, on voit le
foyer, d'où s'échappent des
flammes, surmonté d'une hotte. À gauche un petit
personnage, paraissant être
Cupidon, brandit une flèche, tirée de son carquois, en
direction de l'enclume.
Au-dessus de lui une sorte de nuée composée de cercles
concentriques semble
abriter des étoiles.
Le
bas-relief de la cheminée Toute la
partie gauche du bas-relief n'est pas
sans offrir une certaine ressemblance avec
une scène du Songe de Poliphile, où
l'on voit Cupidon, devant un
parterre de spectateurs médusés, décocher des
flèches en direction de la voûte
céleste, ou percer d'une flèche une nuée,
d'où s'échappent des gouttes de
pluie. Cela ne serait pas si étonnant : si la Venise
touristique ignore
tout du Songe de Poliphile (essayez donc d'en parler à
l'un des
multiples marchands de souvenirs made in China !), il
n'en
est pas de même pour les vrais Vénitiens, qui
considèrent Aldo Manuzio comme
l'un des plus célèbres d'entre eux.
Gravure
du Songe de Poliphile mettant en scène Cupîdon Juste sous le
bas-relief, une tête humaine
grotesque orne la façade au-dessus de la porte. Il y a souvent
des têtes –
humaines ou animales – au-dessus des portes vénitiennes, que ce
soient des
portes d'eau ou des portes de terre. Celle-ci paraît rivaliser de
laideur avec
une autre tête grotesque située à quelques
mètres, au-dessus de la porte du
campanile de l'église San Trovaso voisine.
Les
deux têtes grotesques, à gauche celle de l'église, Incroyable !
L'église San Trovaso a
deux façades perpendiculaires rigoureusement identiques,
à quelques infimes
détails près. Quelle obscure raison a poussé
l'architecte à produire cette
curiosité ? L'église remonte au XIe
siècle et est dédiée aux
saints Gervais et Protais, amalgamés en dialecte vénitien
en Trovaso,
mais les deux façades paraissent dater de la Renaissance. Elles
sont d'ailleurs
assez typiques de l'architecture vénitienne, et offrent un air
de famille
certain avec l'église Sant'Agostin, près de
laquelle Aldo Manuzio avait
installé son atelier. L'imprimeur du Songe de Poliphile
n'est décidément
jamais bien loin. La raison de ces deux façades identiques est
simple en
vérité. Jadis Venise était partagée en deux
factions rivales, les Castellani et
les Niccolotti, devant leur nom aux quartiers dont ils était
issus : le
quartier de Castello pour les premiers, la paroisse
Saint-Nicolas pour
les seconds. Dignes héritiers des Guelfes et des Gibelins, les
Castellani et
les Niccolotti s'affrontaient en combats épiques, et la
république de Venise
entretenait soigneusement leur rivalité, car cela lui assurait
en permanence
une réserve d'hommes solides et formés au combat,
toujours utiles en cas de
menace. L'église San Trovaso marquait la limite entre leurs deux
territoires,
aussi chacun des deux clans y avait son entrée, et pour ne pas
créer de
jalousie supplémentaire on avait eu l'idée de doter
l'église de deux façades
identiques.
Les
deux façades de l'église San Trovaso Aujourd'hui
les Castellani et les Niccolotti ont
disparu, même si le « pont des poings » sur
lequel ils s'affrontaient
est resté une curiosité touristique. Le dernier souvenir
des deux factions
rivales persiste dans les deux castes de gondoliers, qui se distinguent
par les
couleurs des rayures de leur maillot et le ruban de leur
canotier : rouge
pour les uns, noir pour les autres. « Gondola signor ? »
me lance un gondolier « rouge ». Je
décline poliment l'invitation,
qui n'a rien de désintéressée. À moins
d'être fortuné, la marche à pied reste
le meilleur moyen de parcourir Venise... |
 |