
 |
|
 Un Inconnu nommé Jean Jourde
|
Seconde
et dernière Partie
|
 Par
notre Ami Franck Daffos
|
Mai
2009 - Rubrique Rennes-les-Bains
|
 |
 |
 |
Nous
retrouvons
comme promis la suite du passionnant récit de Franck Daffos.
Plus
que jamais, et selon la formule consacrée, « calez-vous
bien
dans votre meilleur fauteuil », car les révélations
ont
de quoi en surprendre plus d’un…
|
Si vous
souhaitez
auparavant découvrir ou relire < la
première
partie > consacrée à Jean Jourde
|
|
Entre 1903 et
1906,
le père Jean Jourde, retranché tout seul à N-D de
Marceille
où il résistait contre les lois de séparation de
l’Église
et de l’État, ravitaillé par de bonnes âmes de
Limoux,
tissait donc la toile de son codage. C’est qu’il ne fallait pas,
à
cause de toutes ces lois iniques, que tout se perde. La confiscation
des
églises pouvant entraîner la destruction du message de
celle
de Rennes-le-Château, il fallait revenir à la solution
d’un
livre. Cent fois, mille fois, Jean Jourde remit son cœur sur l’ouvrage,
et
le travail, extraordinaire, démesuré lorsqu’on comprend
la
somme d’intelligence, d’ingéniosité et de connaissances
qu’il
nécessita, se fit. La Bible lui fournit la matière de ses
parchemins
; ancien élève de Fulcran Vigouroux, il fut pour cela
à
la bonne école. C’est ainsi, entre autres, que l’édition
1899
du Dictionnaire de la Bible, à travers la première
reproduction
à l’identique d’une texte très ancien et retrouvé
depuis
peu à Cambridge, le Codex Bezae, qu’il connaissait depuis le
temps
de son séminaire, lui fournit matière à exercer
son
talent : il recopia tout simplement ce texte en le modifiant
adroitement
pour faire passer son message (il est donc totalement erroné de
penser
que c’est le Codex Bezae qui est à la base codé). Il nous
est
ainsi parvenu sous le vocable de Petit Parchemin.
|
Il n’est
dès
lors pas très compliqué de se rendre compte que cette
communication
de la SESA ne fut qu’une habile manipulation pour valider dans le
cimetière
de Rennes-le-Château la pseudo stèle mortuaire d’une
certaine
marquise de Blanquefort. La caution apparente de la SESA garantissait
au
vrai initiateur de cette mystification « l’historicité
»
d’une dalle pourtant fabriquée de toute pièce, et qui n’a
pourtant
jamais existé que sur le papier. Chacun le sait, la chose
imprimée
fait loi. Pour preuve, certains esprits peu éclairés
refusent
catégoriquement, même encore de nos jours, de la mettre en
doute.
« Il se retira à Figueras, d’où il continua à rayonner tant en France qu’en Espagne »  Photo réalisée par François Pous |
|
Les
années
passent et justement l’heure de la retraite sonne pour Henri Boudet.
Après
42 années de sacerdoce ininterrompu dans la petite station
thermale
de la haute vallée de l’Aude, le 30 avril 1914, à
l’âge
de 77 ans, il choisit de se retirer dans la famille de son frère
le
notaire à Axat.
Comme par hasard, Jourde est de retour, relisez son homélie : Le couvent de
Montolieu
tire son origine de la nuit des temps puisque fondé en l’an 800
par
Charlemagne, grand bâtisseur de monastères qui en
construisit
huit dans l’Aude : Saint-Paul en 768, Saint-Hilaire en 778, Lagrasse en
779,
Saint-Polycarpe en 780, Caunes en 791, Montolieu donc en 800, Alet en
813
et Cubières enfin en 817. Durant plus de plus de dix
siècles
et jusqu’à la Révolution, les Bénédictins,
à
qui Charlemagne avait concédé le lieu, occuperont cette
abbaye.
Il ne reste que peu de choses des œuvres architecturales datant de
l’occupation
bénédictine : quelques belles salles
voûtées,
dont le réfectoire et le cloître, et surtout le grand
escalier
datant de 1777 et construit sans pilier de soutien par l’architecte
Paul
Vidal de Carcassonne. Confisqué comme bien national à la
Révolution,
il sera ensuite racheté en 1826 par les Lazaristes qui y tinrent
un
florissant collège. L’ensemble conventuel sera ensuite
cédé
aux Filles de la Charité en 1869. Elles ne l’ont jamais
quitté
ensuite. Depuis 1986, le couvent de Montolieu est une des plus
importantes
maisons de soins et de retraite pour les sœurs de la famille
vincentienne.
Basé
donc
à Montolieu, d’abord comme aumônier puis comme
supérieur,
il en sera le 6ème, en 1917 (et non en 1926 comme indiqué
par
erreur dans sa notice nécrologique), Jourde continuera en
dernière
sentinelle à gérer le trésor de Rennes.
Prétextant
quelques rhumatismes, il se rendra fréquemment à
Rennes-les-Bains,
station thermale réputée pour ses vertus en rhumatologie.
« Les rhumatismes dont il a plus ou moins
souffert
l’obligeant chaque année à aller demander aux eaux
thermales
un peu de soulagement, il fuyait les stations tapageuses et se
contentait
d’Ax-les-Thermes et même ensuite de Rennes-les-Bains près
d’Alet,
où il ne se rendait qu’à contre-cœur et pour le moins de
temps
possible. Au bout de dix à douze jours, il regagnait par la voie
la
plus directe sa chère solitude de Montolieu. »
|
|
Ces
fréquents
séjours (un ou deux par an dans les premières
années)
vont lui permettre sur place de terminer son entreprise de codage. Tout
cela
durera en fait jusqu’en 1928, date où sa véritable
maladie,
car ce ne sont certes pas quelques rhumatismes qui l’ont tué, le
confinera
définitivement aux limites du domaine de Montolieu. De ces
années-là
datent curieusement les toutes dernières pièces
rapportées
sur l’énigme qui nous passionne : ce sera par exemple dans les
années
1920 la transformation du tombeau des Pontils - comme par hasard - en
copie
conforme de celui peint par Poussin sur sa célèbre
deuxième
version des Bergers d’Arcadie : certains messages avaient
décidément
besoin d’être précisés. La première mouture
du
tombeau des Pontils datait en effet de 1903, c’est à dire au
plus
fort de la crise des lois de séparation. On peut penser qu’elle
fut
alors réalisée dans l’urgence et qu’il y avait donc
matière
à la réviser pour y donner sa forme définitive.
Entre
temps les propriétaires du lieu avaient changé, et il a
fallu
le temps de les convaincre. Encore plus étrange, il y aura la
découverte
soi-disant inopinée de la dalle dite de Coumesourde par un
érudit
local, justement en 1928 : il était temps ! Il est à
remarquer
qu’après 1928, nous n’avons ensuite strictement plus rien comme
apport
de nouvel élément concernant cette affaire.
Après
le
décès de Saunière, il en profitera même pour
pousser
l’excursion jusqu’à Rennes-le-Château : il pouvait ainsi
tranquillement
apprécier son œuvre. Hélas le luxe ostentatoire de la
villa
ranimera sa colère et le nom rajouté sur la tour le
désolera.
Inutile de chercher plus loin la compréhension des premiers mots
de
la 11ème strophe du Serpent Rouge : « Maudissant les
profanateurs
dans leurs cendres … » Il faut se souvenir que Saunière
profana
d’abord, sous son église, la crypte des anciens seigneurs de son
village,
puis certaines tombes de son cimetière pour on ne sait quelles
recherches.
Mais Jourde n’était pas rancunier, et il savait qu’il avait
jeté
là les bases d’une fabuleuse épopée. C’est
sûrement
à cette période, dans les années 1920, qu’il
signera
lui même les quelques ajouts peints sur certaines stations du
Chemin
de Croix et sur le bas relief de l’autel de la petite église du
village
de RLC. Il ne pouvait s’empêcher de préciser son message,
dernier
clin d’œil au pèlerin qu’il espérait tant. Il est amusant
de
constater que certains chercheurs peu inspirés s’entêtent
toujours
à vouloir accuser Henri Buthion, qui racheta le domaine à
Noël
Corbu, d’avoir repeint certains détails, ce qu’il ne fit bien
entendu
jamais, alors qu’ils n’ont pas été capables de
déceler
les ajouts véritablement greffés sur ce Chemin de Croix.
Mais
encore pour ce faire faut-il connaître ailleurs un original (et
donc
non retouché) de la même série de chez Giscard…
La maladie
hélas
le crucifiera lentement mais sûrement à partir de 1928, le
confinant
définitivement aux limites du luxuriant domaine de Montolieu.
Mais
sa tâche semble pleinement accomplie et il semblerait que Jourde
ait
été alors l’objet de l’attention discrète de bien
de
gens d’Eglise : ainsi le nouvel évêque de Carcassonne, Mgr
Lacoste,
fait le déplacement à Montolieu le 15 mars 1928 pour
longuement
s’entretenir en privé avec lui. Officiellement, lorsqu’on
consulte
l’historique du couvent, il était venu célébrer la
fête
de Sainte Louise de Marillac (1591-1660) qui, après avoir
été
une proche de Saint François de Salles (1567-1622), se mit au
service
de Saint Vincent de Paul (1581-1660) avec qui elle fonda les Filles de
la
Charité en 1633. Mais on peut difficilement se satisfaire d’un
tel
prétexte puisque il est d’abord assez peu dans les habitudes du
clergé
séculier (celui qui vit dans le siècle : curés,
chanoines,
évêques, cardinaux etc.) de se mêler des
commémorations
du clergé régulier (celui qui est astreint à une
règle,
soit dans un couvent, un monastère ou une abbaye, soit dans une
Congrégation
ou autre), et de plus il paraît extraordinaire que Mgr Lacoste
soit
venu célébrer en 1928 la fête d’une sainte qui ne
l’était
alors pas encore puisqu’elle ne sera canonisée que 6 ans plus
tard
le 11 mars 1934 par Sa Sainteté Pie XI (la cause en
béatification
de Louise de Marillac fut introduite sous Léon XIII le 18 juin
1896,
et elle fut béatifiée par Benoît XV le 9 mai 1920).
|
 |
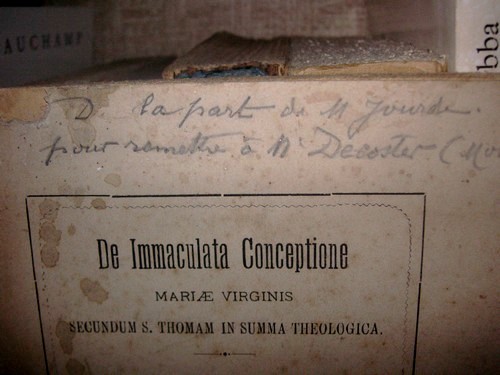 |
|
Mais tout le
monde
semble dès lors se soucier du Père Jean Jourde : ainsi on
décide,
eu égard à son état de santé, de lui
alléger
sa charge en nommant à ses côtés un collaborateur
dévoué,
le R.P. Eugène Vidal (1863-1935) qui bientôt le remplacera
au
poste de Supérieur. Cette décision du Supérieur
Général
de la Congrégation des Prêtres de la Mission (voir sa
notice
nécrologique) prouve que les plus hautes instances de la Famille
Vincentienne
se sont, à partir de 1928, souciées de Jean Jourde. Elle
est
d’autant plus étonnante qu’elle était en fait normalement
du
ressort du Provincial de région, et que ce type de
décision
dans un tel contexte est rarissime puisque la tradition
ecclésiastique
impose de laisser à Dieu la décision ultime de rappeler
à
lui son serviteur, signifiant ainsi la fin de son mandat. Nous en avons
eu
une parfaite démonstration avec la fin du pontificat de
Jean-Paul
II, qui n’a jamais, malgré la maladie,
démissionné.
Miné par une terrible maladie, Jean Jourde succombera le 17 mai
1930,
à l’âge de 78 ans. Ironie du sort, le garde
champêtre
envoyé par le maire de Montolieu, Pierre Artigue, pour constater
le
décès, répondait au nom de Romain… Gasc !
Les Enfants de St Vincent sont connus pour n’avoir jamais pratiqué le culte de la personnalité. Ainsi bien des prédécesseurs prestigieux de Jourde à Montolieu avaient été amenés en terre sans tambour ni trompette : il en est ainsi en 1880 du premier Supérieur, M. Gabriel Perboyre , cousin du bienheureux que nous retrouvons statufié dans N-D de Marceille (Saint Jean-Gabriel Perboyre, 1802-1840, Lazariste béatifié par le pape Léon XIII en 1889, et canonisé le 2 juin 1996 à Rome par le pape Jean-Paul II), et qui, suite à son martyre en Chine, est devenu l’orgueil des Lazaristes ; il en est ainsi également en 1890, d’Antoine Nicolle, fondateur alors qu’il était Supérieur de N-D de Valfleury de l’Archiconfrérie, puis des sœurs de la Sainte Agonie dont les membres se comptaient dans le monde à plus d’un million au début des années 1900 (A. Berjat, Notre-Dame de Valfleury, op. cité page 46). |
|
S’il n’avait
pu
les voir, c’est que les travaux n’étaient pas terminés du
temps
de son vivant. Il fallait donc que Jean Jourde ait tout à coup
pris
une importance sans précédent dans sa Congrégation
pour
avoir droit, même à titre posthume, à autant de
sollicitude.
|
|
La cache de
Rennes
n’ayant ensuite été découverte qu’en juin 1885 par
Boudet,
Vannier et Jourde, on voit mal, dans ces années troublées
par
les lois de séparations de L’Eglise et de l’Etat, la divulgation
d’un
secret engageant justement l’Eglise. De crainte que tout ne soit
détruit,
on préféra donc à nouveau attendre. Mais la
nécessité
d’un nouveau codage se faisait donc sentir : on ne savait ce qu’il
allait
advenir et il fallait que rien ne se perde. Ainsi s’expliquent d’abord
le
livre de Boudet puis l’église de Saunière puis plus tard
son
domaine et enfin le dernier travail de Jourde (parchemins, dalles etc.).
Mais je reste
convaincu
que pendant toutes ces années s’opposait en fait à la
révélation
de ce secret un obstacle majeur : l’impossibilité
matérielle
de le soustraire à sa cachette. En effet tout nous indique que
le
berger Paris ne put s’introduire dans la cache de Rennes que par une
faille
naturelle trop étroite et dangereuse, peut-être
creusée
au fil des siècles, peut être existante quoique inconnue
depuis
toujours, qui n’a jamais été l’entrée principale
du
dépôt obturée définitivement lors de sa
constitution,
fort probablement à la fin du Moyen Age. Ainsi s’explique la
présence
d’une trentaine de squelettes : on n’a voulu laisser à
l’époque
aucun témoin.
N’ayant donc
aucune
possibilité technique de transférer ailleurs la partie
spirituelle
du trésor, tous ceux qui savaient depuis le 17ème
siècle
se sont tout simplement retrouvés obliger de gérer cette
connaissance
au mieux de leurs intérêts, ce qui, faute de mieux, a
entraîné,
pour que rien ne se perde, leurs codages successifs.
Le 20 mai
1930,
Jean Jourde était inhumé dans le petit cimetière
des
Filles de la Charité, au fond du superbe parc de l’ancienne
abbaye
Saint-Jean de Valsiger à Montolieu dans l’Aude. Si les
chevaliers
Templiers nous ont laissé sur leur sceau la vision de les voir
voyager,
par vœu de pauvreté, à deux sur le même cheval, les
Lazaristes,
suivant l’humilité qui sied à leur Ordre, ont pour
tradition
d’ensevelir leurs chers disparus à deux dans la même
sépulture
: Jourde fut donc enseveli dans la même tombe que M. Gardat,
ancien
aumônier du lieu. Ceux qui jetèrent alors sur son cercueil
les
dernières pelletées de terre étaient loin de se
douter
qu’ils mettaient un point final définitif à l’une des
plus
extraordinaires énigmes de tous les temps.
|
 Nous
remercions
notre Ami Franck pour ce brillant Dossier.
Vous pouvez < retrouver l'entretien > qu'il nous a accordé voici 2 mois ; Une bonne occasion de mieux connaître ce personnage. |
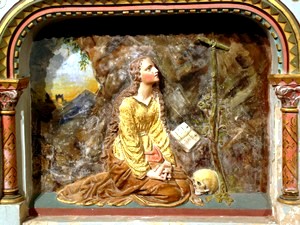 |
 |
|
|
 |
|