
PILAT ET LIENS Mars 2025
|

|
Michel Barbot
|
De Péluse à Pélussin : une voie pérenne de la Clé
de l’Égypte ?
Dans le n° 35 de la revue KOUNTRASS
(juillet – août 1992), nous pouvons découvrir une longue et intrigante étude du
Rav Hillel Roiter : La traversée de la Mer Rouge et le mystère de la
Grande Pyramide. Le Rav évoque l’expression biblique Yam Souf souvent
traduite par « Mer Rouge » mais signifiant « Mer des
Joncs » ou « Mer des Papyrus » ou suivant le contexte,
« Mer des Algues » : « S’il n’y avait déjà une mer de ce
nom dans les Bermudes, on aurait bien pu dire ‘’la Mer des Sargasses’’ !
Or, s’il est une mer caractérisée par une profusion d’algues, c’est bien la Mer
Rouge ! » Le Rav cite l’hébraïste et orientaliste chrétien Allemand
Wilhelm Gesenius (1786-1842) qui dans son Lexicon, dictionnaire
d’hébreu et de chaldéen, indiquait : ‘’Yam souf signifie donc ‘’la
mer des algues’’ ; il s’agit du Golfe Arabique’’ (N.d.T. : le Golfe
de Suez) où les algues abondent. En égyptien [coptique] on le nomme aussi ‘’Mer
des Algues’’. »
Le Rav Roiter s’arrête ensuite sur le
verset 37 du chapitre 12 du Livre de l’Exode, où il est écrit :
« Les Enfants d’Israël partirent de Ramsès, en direction de
Soukkot… » Je ne résiste pas, à partager ici le commentaire du Rabbi Rashi
de Troyes : « De Ra‘amsés vers Soukoth Soit une distance de cent
vingt milles, qu’ils ont franchie en une heure, comme il est écrit :
‘’je vous ai portés sur des ailes d’aigles’’ (infra 19, 4). » Le
développement fait par le rabbi médiéval au ch. 19, v. 4, plutôt surprenant quant
à la période où vivait Moïse, a été interprété par certains commentateurs de
façon prophétique, en référence aux oiseaux ou avions (latin avis,
« oiseau ») du XXe siècle… Le Rav Roiter indique :
« La ville de Ramsès (ou territoire nommé d’après cette ville) est
mentionné cinq fois dans le *‘Houmache. Elle apparaît pour la première
fois dans Beréchit/Genèse 47, v. 11 : ‘’ Joseph établit son père et ses
frères… dans le pays d'Égypte, dans le meilleur territoire, celui de
Ramsès...’’ » *Le ‘Houmache, nom hébreu du Pentateuque, de « Hamech
(masc.) / Hamicha (fém.) » signifiant « cinq », nomme les livres
constitutifs du Pentateuque. Le nombre cinq dans l’histoire biblique de Joseph
fils de Jacob symbolise l’Égypte.
Ramsès, point de départ des Enfants
d’Israël, est différemment nommée dans le texte du Targoum de Jonathan.
Le mot araméen Targoum, « traduction » s’applique au texte
araméen de la Bible hébraïque. Voici ce que le Rav
Roiter nous apprend sur cet autre nom : « Dans tous ces versets, sans
exception, Ramsès est traduit, dans le Targoum de Yonathan ben
‘Ouziel, par le mot Filoussine (ou Pelousin), en d’autres
terme PELUSIUM. Pelusium, en bon français ‘’Péluse’’,
était une ville de l’Egypte ancienne, son point le plus extrême-oriental,
surnommée la ‘’clé de l’Egypte’’. Si c’est bien là le Ramsès
biblique on comprend que les Israélites en aient fait leur première étape sur
la Route de l’Exode. »
Migdol – Joseph – Baal-Tsephon
Le Rav Hillel Roiter reconnaît à juste
titre dans la cité de Migdol traversée par les Israélites au commencement de
leur Exode : « le mot migdal, une tour, un donjon, un château-fort,
une citadelle. » Il s’appuie ensuite sur un passage de la Mekhilta
ou Règles de Rabbi Shimon (étude exégétique sur le Livre de l’Exode),
dans laquelle Migdol est ainsi évoquée :
« …là était la grandeur de l’Egypte
[N.d.T. : l’étymologie de Migdal et de Migdol est gadol :
grand], là était leur splendeur, leur haut lieu ; c’est là que Yossef/Joseph
entassa l’or et l’argent, ainsi qu’il est écrit (Beréchit/Genèse 47, v.
14) : ‘’Joseph recueillit tout l’argent qui se trouvait dans le pays
d’Égypte et dans celui de Canaan, en échange du blé qu’ils achetaient, et il
déposa cet argent dans la demeure du Pharaon’’.
« Joseph ayant enrichi l’Égypte et
son souverain le Pharaon, grâce à sa judicieuse politique économico-financière,
déposa consciencieusement ses biens et profits dans la forteresse de Migdol,
citadelle appartenant au Pharaon. Le
château-fort était aussi un coffre-fort !
Le ‘’Fort-Knox’’ de l’époque… bien gardé par une garnison en armes,
comme il se doit. Par contre, selon le *Yalqout
Mé’am Lo’èz, c’est à Baal-Tsephon que la fortune de l’Egypte
aurait été entassée. *Anthologie biblique du Rabbi Yaacov Couli publiée en
1730. Cet auteur dans son commentaire appliqué à Baal-Tsephon affirmait que
c’était le dieu de la richesse, car « l’or vient du Nord » (Livre
de Job, 37-22). Tsephon signifie en effet, en hébreu,
« Nord ».
Le Mossad ha-Rav Kook, fondation de
recherche religieuse et maison d’édition à Jérusalem, dans le commentaire Da’at
Miqra (‘’Connaissance de l’Ecriture’’), développe une intéressante
lecture : « Il se peut que le mot Baal-Tsephon complète le mot
Migdol, et que le nom complet de l’endroit soit Migdol Baal-Tsephon,
c’est-à-dire : ‘’La forteresse abritant le sanctuaire consacré à l’Idole
du Nord’’, le verset étant construit sur les règles de la symétrie
poétique… »
Le Livre de l’Exode, 12-35 et 36
révèle que les Enfants d’Israël quittèrent l’Égypte en emportant « des
vases d'argent, des vases d'or et des vêtements et le Seigneur avait inspiré
pour ce peuple de la bienveillance aux Égyptiens, qui lui prêtèrent, de sorte
qu'il dépouilla les Égyptiens ». Le commentateur Rashi insiste sur la
traduction en araméen du Targoum Onqelos : « ils
vidèrent ». Le Rav Roiter n’hésite pas à écrire : « Il s’agit
vraiment d’un nettoyage par le vide : ils ‘’dépouillèrent’’ les Égyptiens
une première fois en sortant d’Égypte la nuit de Pessa’h […] pour finir ils
allèrent ‘’nettoyer’’ les trésors de Migdol/Baal-Tsephon ». Ces trésors du
verset 36, autres que ceux du verset 35, correspondaient de tradition à la
grande quantité d’or et d’argent gagnée par Joseph en vendant du blé.
Ces commentaires peuvent-ils être
reconnus comme vérité ? Joseph, l’un des 12 fils de Jacob, vendu par ses
frères, prisonnier dans les geôles de Pharaon, puis devenu par sa Sagesse,
vice-roi d’Égypte, a-t-il réellement existé ? Certains archéologues
acceptent son existence au travers de l’inscription de la Stèle de la Famine,
découverte en 1889 par l’égyptologue Charles Edwin Wilbour, dans l'île de Sehel
sur le Nil près d'Assouan. Elle évoque une période de sept ans de famine durant
le règne de Djéser entre 2691 et 2625 av. J.-C. (IIIe dynastie). Datée du règne
de Ptolémée V Épiphane (204 et 180 av. J.-C.), l’inscription de la stèle,
authentifiée par les uns comme un fait historique, voire comme une fiction
d’époque, est aussi reconnue par les autres comme un faux commis à cette époque
par le clergé de Khnoum. Elle n’en est pas moins reconnue comme porteuse
d’informations précieuses relatives au Pharaon Djéser.
Voir https://theonoptie.org/2018/01/15/les-sept-annees-de-famine-annoncees-par-joseph/
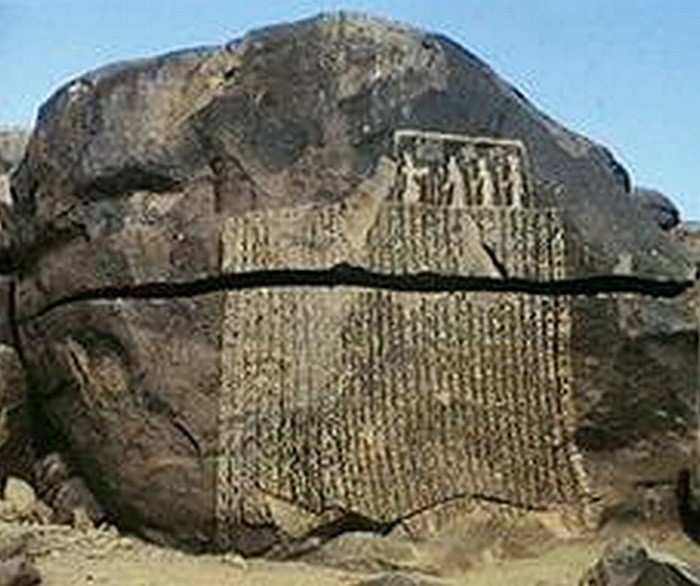
Stèle
de la Famine
Le Rav Roiter, textes exégétiques à
l’appui, avance sa théorie suivant laquelle Migdol, Baal-Tsephon et
Pi-ha’Hirot (importante dans les propos du rav) existeraient toujours. Pour lui
ce « complexe IMPOSANT de bâtiments considérés dans l’Antiquité (et encore
aujourd’hui peut-être) comme la ‘’grandeur et la splendeur de l’Égypte’’, une
tour ou une forteresse ou toute autre construction élevée, accompagnée d’un
IDOLE consacrée au dieu du NORD ?... » pourrait « être le
complexe des Pyramides de Gizeh, près du Caire, et plus particulièrement la
Grande Pyramide de Chéops, et le Sphinx. »
Baal-Tsephon, l’Idole du Nord,
monte la garde devant Migdal, la Grande Pyramide qui indique le Nord vrai
avec une exactitude stupéfiante. Face à cette impression de « gigantisme,
d’immensité, de puissance, en résumé : de GRANDEUR », le Rav
poursuit :
« Ce n’est pas pour rien qu’on la
surnomme la GRANDE Pyramide. Or, rappelons-nous ce que les Sages d’Israël
disent de Migdol :
« ‘’… La
puissante citadelle (ou ‘’tour’’, ou n’importe quelle construction élevée
méritant le nom de migdal, dont l’étymologie, rappelons-le est gadol,
GRAND) de l’Égypte…’’ (*Malbim) *Le
Malbim : grand commentateur juif Ukrainien de la Bible (1809-1879).
« ‘’… Là était la GRANDEUR, la puissance de l’Égypte, là était leur
splendeur, leur haut-lieu…’’ (Mekhilta, Yalqout Chimo’ni) »
Le Sphinx (Sphinge jusqu’au XVIe
siècle) serait pour le Rav Roiter étymologiquement apparenté à l’hébreu Tsaphon
dont l’initiale est un Tsadé : « En effet, en hébreu le tsadé
se lit non pas ts comme il est retranscrit généralement, mais un son
très proche de ss, et il est encore prononcé ainsi dans certaines
communautés. Donc ‘’Tsaphon’’ doit se transcrire ‘’S-PH-N’’, consonnes que l’on
retrouve exactement dans ‘’S-PHiNg’’ (Sphinx). Il est clair à présent que
‘’Sphinx’’ est probablement une hellénisation de ‘’(Baal)-Tsephon’’, étymologie
très ancienne qui a fini par tomber dans l’oubli. »

Le
Sphinx et la pyramide de Gizeh © Dmtriy /Adobe Stock
Migdol
– Baal-Tsephon : Migdal la Grande Pyramide et Baal-Tsephon le
Sphinx ?
L’hypothèse du Rav Hillel Roiter, appuyée
par les commentaires exégétiques des Sages du Judaïsme, présentant la Grande
Pyramide de Gizeh comme le « prosaïque coffre-fort » dans
lequel Joseph, vice-roi d’Égypte aurait entassé l’or de l’Égypte, ne semble pas
irrecevable. Nous savons que la pyramide de Chéops ne renferma jamais le corps
du Pharaon dont elle porte le nom. Nous pouvons admettre que les Enfants
d’Israël après la traversée de Yam Souf aient effectués un premier crochet qui
les mena sur le plateau de Gizeh où ils vidèrent sous la conduite de Moïse, le coffre-fort
de l’Égypte.
La « Clef
de l’Égypte » a-t-elle quitté la Terre d’Égypte pour le Royaume de France ?
Marc-Alain Ouaknin dans l’ouvrage Le
Livre des prénoms bibliques et hébraïques, co-écrit avec Dory Rotnemer,
évoque longuement : « Moïse l’homme aux dix noms » ! En
effet : « Le Talmud insiste beaucoup sur la polynomie de Moïse – il aurait
eu neuf noms ». Et M.-A. Ouaknin d’insister : « Neuf noms
explicités et un nom caché, secret, en
langue égyptienne, qui ne nous est parvenu que sous sa traduction hébraïque,
Moché. » S’il n’est pas certain que Moché (Moïse) soit la traduction
précise du nom secret égyptien du Protecteur des Enfants d’Israël, il semble
néanmoins exister une confirmation, bien que souvent ignorée par les
commentateurs, du Passage de la Mer Rouge. Il s’agit de l’inscription du
sarcophage d’El-Arish découvert en 1857 dans la région du Sinaï par Francis
Frith (1822-1898) qui l’évoqua en 1863
dans son livre : Sinaï, Palestine, Nil. Ce sarcophage en granite noir
comportant des inscriptions hiéroglyphiques sur toute la surface, était utilisé
par les Arabes pour abreuver leurs troupeaux. Un récit sur ce sarcophage et une
traduction partielle du texte furent publiés en 1890 (F.L. Griffith, The
Antiquies of Tell el Yahudiyeh and Miscellaneous Work in Lower Egypt during the
Years 1887-1888). La pierre fut transportée au Musée d'Ismailia et une
nouvelle tentative de traduction fut entreprise. (Georges Goyon, Les travaux
de Chou et les tribulations de Geb d’après le Naos 2248 d’Ismailia – Kêmi,
revue de philologie et d’archéologie égyptiennes et coptes VI (1936), 1-42).
Pour la photo du sarcophage voir : https://promenade-egypte.photosegypte.com/ismailia/ismailia.php
L’inscription indique : « Sa
majesté ... se trouva à l’endroit appelé Pi-Kharoti » lieu correspondant
au Pi-Hahiroth biblique. Le Pharaon « fut jeté par une grande force. Il
fut jeté en l’air par le tourbillon ... Il ne fut plus en vie. » Le nom du
pharaon qui périt dans le tourbillon était Thom ou Thoum que l’on a reconnu
dans Pi-Thom, « l’habitation de Thom“.
https://jesus.forumgratuit.org/t1466-traversee-de-la-mer-rouge-localisee
Problématique sur cette inscription (une
des raison pour laquelle elle reste méconnue), la traversée de la Mer Rouge se
serait déroulée non plus dans Golfe de Suez mais dans le Golfe d’Aqaba.
Le Kabbaliste Virya (Georges Lahy) est
l’auteur d’un intéressant roman historique, Aboulâfia La quête du kabbaliste
(Éditions Lahy) relatant la vie du grand Kabbaliste Abraham Aoulâfia (1240
Saragosse – 1292 ? Patras). En 4e de couverture, nous pouvons
lire : « Grand voyageur, il fut également un témoin de son temps. Il
a, bien évidemment, côtoyé les maîtres de la Kabbale médiévale de sa
génération, mais aussi des hermétistes, des alchimistes, des compagnons bâtisseurs,
des pèlerins, des templiers, des soufis et des mystiques chrétiens. Condamné au
bûcher par un pape, il fut protégé par un autre. »
Un Templier avec qui il voyageait sur le
Rhône, l’interrogea sur la figure de Joseph d’Arimathie et sur le Graal. Voici
ce qu’il aurait répondu : « Il se nomme Yosseph Harmati en hébreu.
C’est-à-dire qu’il vient d’un lieu élevé. On connaît ce lieu, car il s’agit
d’un village qui surplombe la Vallée de Galaâd, là ou Jacob et Laban se sont
réconciliés. ‘’Galaâd’’ peut se lire ‘’Gal âd’’ : onde éternelle. Il y a
quelque chose du domaine de l’éternité. »
Le Templier précise « qu’il s’agit
du nom du chevalier qui est arrivé au bout de la quête et a pu regarder à
l’intérieur du Graâl. D’après toi, où pourrait-il se trouver ? »
Abraham Aboulâfia estime que le Templier lui en demande beaucoup, mais si la
coupe n’a pas été conservée dans la Vallée de Galaâd (nom de
l’arrière-petit-fils de Joseph…) : « alors, je suivrais la piste des
caravanes qui descendent en Égypte. » Le Chancelier également du voyage
lui demande pourquoi. Voici la réponse du Kabbaliste : « – Parce que c’est
la route des épices et surtout celle d’un baume qui avait la vertu de tout
guérir. Au chapitre 37, le Livre de la Genèse mentionne ceci : ‘’et
voici, une caravane d’Ismaélites venait de Galaâd. Leurs chameaux portaient des
épices, du baume et de la myrrhe, qu’ils allaient porter en Égypte.’’ Il
faudrait alors suivre cette route, qui ne s’arrête pas en Égypte. Elle traverse
cette mer que nous rejoignons, pour accoster soit à Lunel, soit à Marseille,
mais aussi à l’endroit où nous nous rendons en ce moment. » Les
Saintes-Maries de Ratis (de la Mer).
Cet épisode biblique évoqué par
Aboulâfia, renseigne sur l’identité des caravaniers qui achetèrent Joseph vendu
par ses frères et le descendirent en Égypte. Ces paroles prononcées par le
Kabbaliste nous intéressent au premier chef. Le voyage de
Joseph s’est achevé en Égypte, il n’a pas navigué sur la Méditerranée jusque
dans ce pays qui un jour sera la France. Mais nous pourrions penser que son
« trésor » qui était aussi celui de Pharaon aurait pu suivre la route
avancée par Aboulâfia.
Le moment est venu pour nous de retrouver
la « clé de l’Égypte ». Georges Lahy dans son livre évoque la cité de
Montpellier visitée par Aboulâfia. Les Juifs lui ont attribué le nom hébreu de Ir
Har Gaâsh. « Ce qui signifie ‘’ville du volcan’’ ou ‘’ville du mont
tremblant’’. […] Le nom Har Gaâsh
apparaît dans le Livre de Josué, chapitre, 24 verset 20. On y apprend
que le tombeau de *Josué se trouve au nord du Mont Gaâsh. » *Josué fut le
successeur de Moïse.
Aboulâfia rappelle « que le nom
romain de Montpellier était Mons Pessulus le ‘’Mont Verrouillé’’ »,
soit en hébreu « Har Naoûl, qui signifie ‘’Mont Verrouillé’’
ou Mont occulte. Allusion à un lieu qui protège un mystère scellé, en relation
avec les anciens cultes du féminin sacré. »
Placée sous l’égide de l’archevêque de
Maguelone, Mons Pessulus de par son nom semblerait tout désigné
pour accueillir la « clef de l’Égypte », de Péluse mais
n’oublions pas la proche cité de Lunel qui aurait pu suivant le Kabbaliste
Aboulâfia accueillir le Graal. La cité de la Lune, dans les anciens textes
hébreux ainsi que l’indique Madeleine Ribot-Vinas (Lunel le Kabbale et
l’Étoile – Éditions Lahy), porte les noms de « Migdal
Yériho », la Tour de Jéricho ou encore « beqâth
Yériho », la Vallée de Jéricho (Deutéronome 34:3). La Yériho
biblique était la cité de la Lune : Yaréah en hébreu. Des textes
médiévaux citeront Lunel sous le seul nom de Yaréah. Dans cette
cité médiévale où naît la Kabbale, « Yarhi […] fut le surnom des
maîtres juifs de Lunel qui portaient toujours l’appellation Yarhi à la
fin de leur nom… »
La cité de Lunel était intimement liée à
Maguelone, l’ancienne île portuaire où mouillaient les marchands Phéniciens et
Grecs. D’aucuns ont vu dans Maguelone un lieu où aurait vécu
Marie-Madeleine. M. Ribot-Vinas au sujet de Maguelone écrit « migdal
en hébreu : prend le sens de ‘’tour, veilleur, gardien, sentinelle’’…
Peut-être que la tour de Maguelone a-t-elle jadis servie d’avant-poste,
sentinelle avancée au milieu des flots pour garder la lagune ? »
Pour les Juifs la Camargue était un lieu
« secret », « verrouillé » un lieu qui détient ou qui a
détenu une clef. Cette clef ouvre un chemin placé sous le signe de la Migdal.
M. Ribot-Vinas fait échos d’une tradition remontant à l’année 70, suivant
laquelle des Juifs fuyant Titus et ses Romains, venus peut-être de Jéricho, se
seraient installés à Lunel, cœur de la Petite Camargue. Ils auraient
traversés la Camargue tout comme leurs ancêtres ont traversé Yam Souf. Le
souvenir du Passage biblique se retrouve en Arles, Porte de la Camargue,
au Musée de l'Arles et de la Provence antiques, avec le sarcophage
paléochrétien de la Mer Rouge de la fin du IVe siècle. Il se
retrouve aussi, toujours dans cette cité, dans cet autre exemplaire de
sarcophage pareillement nommé, dans l'ancienne cathédrale Saint-Trophime.
La « Clef de l’Égypte » a-t-elle
quitté la Camargue pour le Forez ?
Si les Yarhi ou Beneï Yarhi,
les Fils de la Lune ont marqué de leur emprunte cette région, il en va de même
de ces autres Fils de la Lune, les
Roussillon natifs du Roussillon. Pour notre ami Patrick Berlier, les
Roussillon du Pilat étaient membres de cette antique famille qui donna de très
mystérieux Rois du Pilat : LES ROIS DE L’AXE DU MONDE. La Société
Angélique T. I.
Ainsi que le rappelait le Rav Hillel
Roiter, la cité égyptienne de Pelussium (en bon français Péluse), « clé de
l’Égypte » fut la première étape des Israélites sur la Route de
l’Exode ». L’hypothèse suivie dans cette présente étude serait que les
Israélites du premier siècle après J.-C. ayant accosté dans le Roussillon ou
peut-être plus précisément leurs descendants, aient pu ensuite remonter jusque
dans les Monts du Pilat précisément à Pélussin, la médiévale Pulcin ou Pélucin.
L’abbé Batia dans ses Recherches
Historiques sur le FOREZ VIENNOIS publiées en 1921, évoque non pas l’exode
mais la fuite de chrétiens Lyonnais disciples de saint Pothin, après la
persécution de l’an 177 :
« Or, la fuite était facile dans la
direction de Lyon à Vienne et de Vienne à Pélussin. Il y avait le Rhône, ‘’voie
commode et toujours ouverte, très fréquentée par le commerce de Lyon’’.
(Steyert, Hist. de Lyon, T. I.) Il y avait une grande voie romaine de
Lyon à Vienne par Saint-Symphorien (Ottavum), enfin, sur la rive droite, la
Voie Narbonnaise ou, si elle n’était pas encore construite, des tronçons de
routes qui desservaient les environs de Vienne et se prolongeaient sur Ampuis,
Condrieu, Cabanacum et l’Ager Masclatis, toutes localités qui faisaient partie
du Pagus Viennensis. »
Dans sa narration de la fuite des
chrétiens de Lyon vers les montagnes du Pilat, l’abbé Batia juge nécessaire
d’évoquer la Voie Narbonnaise. Cet itinéraire, suivant Strabon,
serait l’œuvre d’Agrippa (– 20 av. J.-C.) qui traça depuis Lyon, un réseau
portant son nom, composé de 4 voies
principales. La Voie Narbonnaise, ancien itinéraire celtique, prenait naissance
dans la continuité du Cardo urbain de la cité lyonnaise pour se diriger au sud
jusqu’à Marseille ou Narbonne.

Tête
d'Agrippa (sculpture romaine, collection privée, Lyon) Photo Patrick Berlier
Les chrétiens Lyonnais, écrit l’abbé,
« seraient venus chercher un asile dans les montagnes du Pilat, à
Pélussin, où ils auraient élevé un autel à une image ou statue de la Mère de
Dieu qu’ils avaient apportée avec eux pour être leur consolatrice dans leur
exil. Une petite communauté chrétienne se serait groupée autour de la Sainte
Image et aurait, plus tard, érigé sur le même emplacement, la crypte de
Notre-Dame-sous-Terre. »
L’abbé Batia pour évoquer la fuite des Frères
de Lyon vers les montagnes du Pilat oriente le lecteur sur la Voie
Narbonnaise. Cette orientation, pourrait-elle révéler de façon
subliminale, la fuite suggérée ci-dessus ayant transitée à Lyon
mais initiée depuis la région Narbonnaise ?
Les princes juifs de la cité de Narbonne
transposèrent son nom sous la forme hébraïque de « Ner binah » soit
« Lumière de l'intelligence », voir : « Phare de
l’intelligence ». À la fin du VIIIe siècle l’exilarque de
Narbonne Makhir David fils de Habibaï David, membre de la diaspora juive de
Babylone et descendant du roi David, fut suivant des textes anciens, le premier
souverain du Royaume de Septimanie. Les récits le font naître à Bagdag en 720
et mourir à Narbonne en 793 (Toulouse est aussi mentionnée). Des livres de
langue anglaise évoquent l’aura quasi messianique de ce Prince de la MAISON
ROYALE de DAVID.
https://gw.geneanet.org/gratienne?lang=fr&n=ha+david&oc=0&p=aka+makhir+ben+habibai
https://gw.geneanet.org/achopart11?lang=fr&n=ha+david&oc=0&p=makhir+ben+habibai


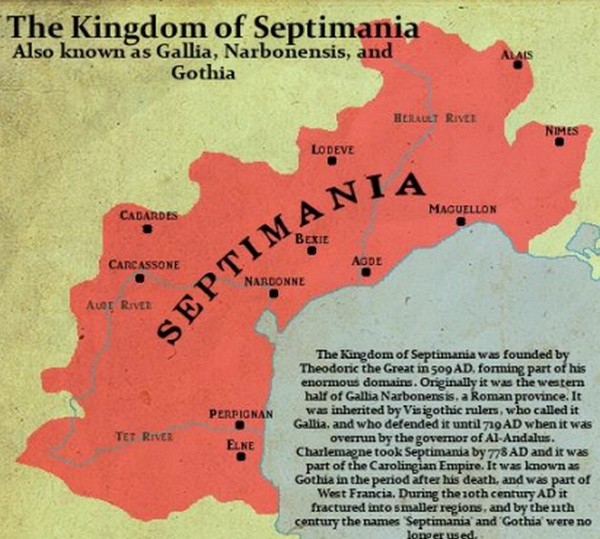
Royaume
de Septimanie
https://acjp.fr/uploads/articles/bba31ad3e51a5d5d368a9c17a8ffba38.pdf
Le site TERRE PROMISE apporte de précieux
renseignements sur les Exilarcats de Babylone et de Narbonne en
reprenant divers articles. Dans l’article Le « roi juif » de
Narbonne rédigé par Aryeh Graboïs (revue des Annales du Midi 1997), nous
découvrons que Makhir David fut richement doté de propriétés à Narbonne
« ce qui sous-entendait que les biens fonciers de la famille étaient
d’origine carolingienne et que leur possession donnait à leurs propriétaires le
droit d’être assimilés aux seigneurs ». Le nom de Charlemagne est très
souvent mis en avant bien qu’il s’emble plus probable qu’il s’agisse de Pépin
le Bref. Charles Martel est aussi évoqué. « La légende de Charlemagne
dans le Languedoc au XIIe siècle » fut principalement
développée dans « l’abbaye de Lagrasse près de Carcassonne » elle
« avait recueilli entre autres matières les échos de la légende juive de
Narbonne ».
L’auteur de cet article au sujet de cette
abbaye, écrit : « L’œuvre en occitan du Pseudo-Philomène, consacrée
aux gestes de Charlemagne dans la province, contient la version retenue par la
population chrétienne du Languedoc, qui comporte des éléments différents de
ceux qui avaient été retenus par l’auteur de la légende hébraïque de Narbonne
». Philomène évoque la délégation juive présentée auprès de l’empereur
pour négocier une capitulation. « L’argument avancé par Philomène comporte
un intérêt particulier, parce qu’il fait expliquer par le chef de la délégation
que son arrivée dans le camp carolingien ne doit pas être taxée de trahison,
étant donné que les ‘’Sarrasins’’ savent parfaitement que les juifs jouissent
de droits propres à Narbonne puisqu’ils sont gouvernés par ‘’leur roi’’. »
Le Royaume Juif de Septimanie dura 140
ans mais ainsi que l’indique Arieh Graboïs : « le Nassi continuait
d’être appelé ‘’le roi juif’’ par la population chrétienne de la région, ce qui
laissa intact son prestige. »
Le titre de « roi juif » se
transmettra de manière héréditaire plusieurs siècles durant au sein de la
dynastie makhirite des Nessiim de Narbonne jusqu’en 1306, année où le roi Philippe le Bel,
expulse tous les Juifs de son royaume et se proclame détenteur de leurs biens. https://terrepromise.fr/le-roi-juif-de-narbonne/
Pour Patric Choffrut : « Il
semblerait que Pépin reçut Makhir dans la noblesse franque et l'adouba avec le
nom distinctif de Théodoric ». Le Royaume juif de Septimanie, mythe ou
réalité ? https://acjp.fr/uploads/articles/bba31ad3e51a5d5d368a9c17a8ffba38.pdf
Ce titre de « Roi du peuple »
ou Théodoric fut été attribué à Makhir « Celui qui sait », par le roi des Francs Pépin le Bref, suite à
l'aide des juifs de Narbonne pour repousser jusqu'à la mer les sarrasins de la
dynastie omeyyade en 759. En 791, Charlemagne confirme les statuts du Royaume
juif de Narbonne en créant le titre permanent de Nassi :
« prince »… le terme Nazir dans le sens de « patriarche »
est aussi reconnu.
Les descendants du Nassi Makhir David
de Narbonne dans le Forez
Julien David de St Etienne né vers 1175 apparaît comme un descendant de l’exilarque de Narbonne Makhir
David. Il est reconnu comme le premier représentant de la famille David
possessionné dans le Forez. Patrick Berlier m’informe que « L'Armorial
Général du Forez voit les David originaires de Saint-Rambert, et possessionnés
à Marclopt et Pravieux. » Au XVIe
siècle la famille lyonnaise de Gadagne tient le fief de Pravieux. Nous
connaissons les curieuses connexions établies entre cette famille d’origine
florentine et le trésor des Maisons juives de Lyon. Les quelques articles du
Net traduits très approximativement de l’anglais, présentent de façon
imprécise, Julien David comme natif, soit de de Lyon, soit de Saint-Étienne.
Pour ajouter à l’ambiguïté ces deux villes sont associés à l’Ardèche. Julien
David, marié à Jeanne Perrine Guiffault et décédé en 1540 vers l’âge de 65 ans,
est le père de Julien Etienne David dit aussi Julien de St Etienne David
seigneur de Pravieux marié à Julienne Matel, né et décédé à Saint-Étienne (env.
1212 - 1280). Les auteurs pensent qu’il fut baptisé enfant par son père, et que
de lui naquît la lignée chrétienne de la famille David. Le blason de cette
famille était : « d'azur à une harpe d'argent, au chef cousu de
gueules chargé de trois étoiles d'or ».
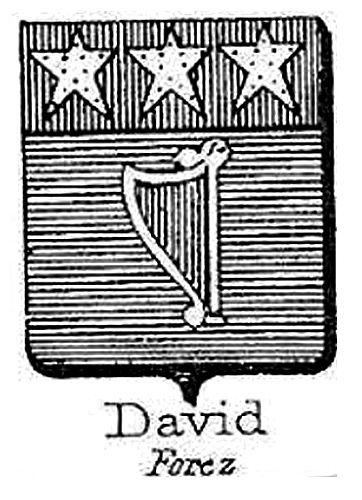
Blason
de la famille David – notons les trois étoiles
Le chef ou ciel de gueules (rouge)
caractérise la zone rougeâtre du coucher de soleil. Bientôt vont apparaître les
trois étoiles d’or ou étoiles moyennes qui indiquent le début et la fin du
Shabbat chez les Juifs. La harpe de David sur champ d’azur évoque la musique
des sphères. Dans la symbolique religieuse la harpe de David est
l’instrument qui accompagnait le roi David dans ses chants et dans ses danses.

Le roi David jouant du
violon (portail roman de Bourg-Argental) Photo Patrick Berlier
Les artistes médiévaux
ont souvent remplacé la harpe de David par un violon, sans doute plus facile à
représenter.
Musicien de grand talent, il composa
suivant la Bible, plusieurs mélodies. Au Moyen-Âge les représentations du roi
David le montrent « tenant dans une main un attribut du pouvoir (l’orbe ou le
sceptre) et dans l’autre, posée sur la poitrine, la harpe ou la lyre […] David est l’archétype du roi chrétien sage et
puissant, pieux et juste, garant de l’harmonie au sein de son royaume. »
Ces propos sont tirés de l’étude de Dominique Vinay, Le symbolisme politique
de David à la harpe dans le Penser du Royal Mémoire de Guillaume Michel (1518)
Albineana, Cahiers d'Aubigné Année
2005 17
pp. 123-151. Pour cette docteure en Littérature française de
l’Université de Tours, la harpe, insigne du pouvoir, a une valeur politique. Le
récit de Guillaume Michel en 1518 adressé au vainqueur de Marignan (1515), lui
rappelle quelle route il doit suivre. Le roi David offre au roi François Ier
sa harpe, ce qui permet à Dominique Vinay de présenter un roi David-François Ier :
« Lorsque David fait don de sa harpe à François, le sens prêté au
transfert d’ornement ne pose aucune ambiguïté : ‘’La harpe d’ung roy est sa
dignité royalle’’. […] La harpe fait du souverain le successeur de David,
elle est le signe des racines divines de sa royauté très-chrétienne, de la
souveraineté de François Ier sur la France et de ses droits sur
Jérusalem ; on peut affirmer qu’elle est l’équivalent symbolique et religieux
de la couronne, voire ici son substitut ».
La harpe du roi David porte en hébreu le
nom de Kinnor. Ce mot « vient du syr. kenara, ce qui signifie ‘’lotus’’.
Le bois de lotus ne pourrît pas et pouvait donc avoir été adapté à de tels
instruments. Le Lac de Génésareth (Kinneret) tient son nom de cet
instrument ».
Sur la rive occidentale de ce lac ou mer
de Kinnereth (dite aussi mer de Galilée) traversée par le Jourdain, se trouvait
la cité de Magdala d’où était originaire Marie-Madeleine ou Marie-de-Magdala,
dont l’ombre ou la lumière plane assurément sur de cette étude. Les trois
étoiles du chef de l’écu des David peuvent évoquer les Tres Marias, les trois
étoiles de la constellations d’Orion (le Baudrier d’Orion) associées dans la
tradition chrétienne aux trois femmes ayant visité le tombeau de Jésus lors de
la résurrection : Marie (mère de Jésus), Marie (femme de Cléophas) et,
précisément, Marie de Magdala. Ces trois étoiles, aussi appelées les
Rois Mages (Gaspard, Melchior, Balthazar), se projettent, il convient de le
rappeler, sur les trois pyramides de Gizeh. En 1830, un Français d’origine
forézienne, descendant de Julien David, retrouve un temps les Français du
Canada puis longe le lac Michigan et s’installe dans l’état de l’Illinois aux
États-Unis sur le territoire des Indiens Potowatomie. François Bourbonnais, tel
est son nom, devient trappeur de fourrures, chasseur et agent de l'American Fur
Company. Bientôt rejoint par d’autres colons, une petite cité verra le jour et
prendra le nom de Bourbonnais Grove : le « Bosquet
Bourbonnais ».
Nous découvrons sur le Net une page d’un
article publié dans Le Journal du Village, de l’Historical Society de
Bourbonnais Grove. Le titre de cet article rédigé par un certain Vic Johnson,
est : A Long Footnote ‘’Borbonnais Royalty’’ ? Fact of
Fiction ? (Une longue note de bas de page sur ‘’la Royauté
Bourbonnais ?’’ Fait de fiction ?). https://www.wikitree.com/photo.php/2/29/David-927-1.jpg
L’auteur, dans cet article hélas
incomplet, s’appuie sur les recherches effectuées par Denise Bourbonnais
Edinger, descendante du fondateur de Bourbonnais Grove. Ses recherches qu’elle
évoqua, été 2009, dans Le Journal du Village, confirmèrent l’ascendance
des Bourbonnais, en la personne de Julien David de St Etienne. Dans cet
article, elle faisait remonter cet ancêtre médiéval au premier roi de
Septimanie : Makhir David, mais ne parvint pas à « relier la
famille à la maison royale des Bourbons » bien que le titre de l’article
de Vic Johnson permette de penser qu’une telle tradition pouvait perdurer dans
la famille Bourbonnais.
V. Johnson rappelle que le roi Philippe
II Auguste (1180-1223) proposa d’expulser les Juifs de France avant la « fête
de Saint Jean-Baptiste (24 juin) 1182 ». « Leurs biens seraient confisqués
et réservés au roi et à ses successeurs. Certains Juifs, plutôt que de se voir
confisquer leurs biens, se sont convertis au catholicisme. ‘’Le Roi, par
respect pour la religion chrétienne, leur restitua toutes leurs possessions
dans leur intégralité et leur donna une liberté perpétuelle.’’ Il semblerait
que si les preuves généalogiques sont exactes, les lointains ancêtres de la
famille Brunet-Bourbonnais faisaient peut-être partie de ces Juifs
christianisés dont la propriété fut restituée. »
V. Johnson, reprenant semble-t-il les
recherches de la descendante du fondateur de Bourbonnais Grove, démontre que la
cité de Saint-Étienne d’où était natif Julien Etienne David, était
Saint-Étienne de Furan, sise à 40 miles au sud-ouest de Lyon ce qui
correspondrait bien aux 64 km séparant les deux cités par l’ancienne route,
ainsi que me l’indique notre ami Stéphanois, Patrick Berlier.
Saint-Étienne-de-Furan, ainsi que rappelé dans l’article, c’est
« développé grâce à l'abbaye cistercienne de Valbenoîte, fondée en
1222. » Patrick ajoute : « Saint-Étienne-de-Furan est bien le
nom le plus ancien de la cité, ainsi nommée pour la première fois dans un acte
de 1258, soit peu après la fondation de l'abbaye de Valbenoîte en effet. »
V. Johnson a placé au centre de la page
que l’on peut lire depuis le lien indiqué ci-dessus, une représentation d’un
personnage ainsi légendée : Saint Julien-Molin-Molette. Nous
retrouvons bien sûr le prénom des deux premiers David connus dans la région du
Forez. L’auteur n’explique aucunement la légende, peut-être le fait-il sur la
page suivante hélas absente. Saint-Julien-Molin-Molette n’est pas le nom d’un
homme mais celui d’une commune qui nous rapproche, via la commune de Maclas, de
la cité de Pélussin. L’illustration ainsi que sa légende, apparaissent en fait
comme un signe de piste. Après recherche il s’avère que l’illustration apparaît
sur la page Wikipédia consacrée à saint Julien l’Hospitalier. https://fr.wikipedia.org/wiki/Julien_l'Hospitalier
Après avoir cliqué sur l’image
représentant saint Julien tenant de la main droite une épée, nous découvrons
sur la nouvelle page, un autre lien placé sous l’image. Ce lien permet de
découvrir la fresque dans sa totalité. Elle représente le thème de la « Sainte
Conversation ». Cette œuvre du peintre Domenico Ghirlandaio visible dans
l'église Sant'Andrea a Brozzi (1473) près de Florence, représente la Madone en
majesté et l’Enfant Jésus, assise sur un trône de marbre et conversant avec
saint Sébastien et saint Julien.
Le choix de saint Julien l’Hospitalier en
le légendant Saint Julien-Molin-Molette ne semble guère logique. En effet,
l’église de cette commune, construite en 1555, est bien consacrée à saint
Julien, mais Julien de Brioude, soldat romain de Vienne, devenu chrétien, et
qui alla lui-même se livrer à l'épée du bourreau à Brioude, un martyr régional
honoré entre la vallée du Rhône et l'Auvergne, ainsi que me le rappelle Patrick
Berlier.
L’énigme
suggérée par les 3 étoiles des David (Julien David pour les deux
premiers seigneurs) présentes dans leur chef armorial au-dessus de la harpe de
David, ne devait pas être étrangère aux Jullien de Pommerol qui ont possédé le
château de Virieu jusqu’à une période récente. Non bien entendu, les Julien
David n’ont aucun lien de parenté avec les Jullien. S’il existe un lien,
au-delà de l’étymologie latine de leur nom, il convient pouvons-nous le penser,
de le chercher dans la symbolique lunaire julienne... Un célèbre
romancier Américain, auteur prolifique de récits d’aventure, de science-fiction
ou d’héroic fantasy connaissait cette symbolique. Il s’agit d’Edgar Rice
Burroughs (1875-1950) le père littéraire de Tarzan. Également connu pour les
cycles de Pellucidar (la Terre creuse), de Mars ou de Vénus, il est aussi
l’auteur d’un cycle de la Lune. Ce cycle conte les aventures des empereurs de
la Lune, d’origine terrestre, qui formèrent la dynastie des Julian (Julien).
Antonin Chavas dans le livre PÉLUSSIN
hier ses origines et son histoire, écrit : « D’après un légende,
les Jullien seraient originaires de Perse, venus en France vers 1234, suite à
la croisade de saint Louis. » Suivant cet historien de Pélussin ce fut
Messire Benoît Jullien, écuyer bourgeois de Lyons qui Le 8 avril 1749,
acquiert « les biens de la famille des mouliniers Benäy possessionnés à
Virieu, Pélussin, Chavanay ». Son fils « Roch Jullien commande la
garde nationale de Pélussin ». Il fut tout à la fois le premier maire de
Pélussin et le premier des Jullien qui occupèrent le siège de premier magistrat
de la cité. Dans cette liste nous trouvons Alexandre Jullien né en 1823. Son
mariage avec Hélène Battant de Pommerol en 1849 permettra à ses descendants de
se nommer Jullien de Pommerol. Deux fois maires de Pélussin de 1852 à 1875 il
participera à la création du blason de la cité en proposant trois étoiles.
Antonin Chavas explique : « Il est vrai que plusieurs familles de
notables ont déjà trois étoiles d’or ou d’argent sur leur blason : Les
Barbier, les de Villars, les Dervieux, etc. » Les Barbier, grande famille
forézienne notariale gravitant autour du seigneur de Virieu,
blasonnaient : « D’or au chevron de gueules. En pointe un
croissant au chef de même, chargé de trois étoiles d’or ». Les
notaires, il est bien connu, reçoivent et transmettent les secrets… Alexandre
Jullien désirait peut-être doter la cité de Pélussin de cette troisième étoile
absente de son blason ?

Blason
d'Alexandre Jullien. Devise : SPES MEA IN DOMINO (Mon Espoir est dans le
Seigneur)
D'azur
à la fasce d'or accompagnée en chef de deux étoiles d'argent et en pointe d’un
croissant de même.
La devise paraît prendre appui sur la
première partie du verset 2 du Psaume 40 (39 dans la Vulgate) du roi
David : « J’ai mis mon espoir dans le Seigneur… ». La devise
latine des Jullien se démarque de la traduction de la Vulgate latine de saint
Jérôme qui traduisait ainsi le texte hébreu : « expectans expectavi
Dominum… » : « J’ai attendu patiemment le Seigneur… »
Le texte hébreu se lit
phonétiquement : « Kavoh Kivyty ‘Adonaï… » Adonaï,
« Seigneur » remplace le nom de Dieu imprononçable : IHVH
ou Yahvé présent dans le texte hébraïque.
Le choix de la devise par les Jullien,
fut-il motivé par son commentaire rabbinique ? Les deux premiers mots
hébreux, « Kavoh Kivyty », apparaissent comme un superlatif qui ne
transparaît pas dans toutes les traductions du verset. « Espérer,
espérer » ou bien « espérer avec espoir » que la devise, à
l’instar de certaines traductions, synthétise dans les mots « mon
espoir ». Il est habituel
d’interroger Rashi de Troyes pour le commentaire biblique. Le célèbre rabbi
médiéval commentait : « J'ai
beaucoup espéré le Seigneur en Égypte, et ce psaume
s'adresse à tout Israël. » Ainsi donc, au travers de cette devise, nous
retrouverions l’Égypte. Le verset commence par un appel, celui des Enfants
d’Israël vers le Seigneur pour qu’il les délivre et se termine par la réponse
favorable de Dieu. Le verset suivant est ainsi traduit dans la Bible du
Rabbinat Français de Zadoc Kahn : « Il m’a retiré d’un gouffre
tumultueux, d’un bourbier fangeux; il a posé mes pieds sur le roc et affermi
mes pas. »
Rashi commente ainsi : « hors de la
fosse rugissante De l'emprisonnement de l'Égypte et du rugissement de leur
tumulte. De la boue épaisse De la mer… est une expression
(caractérisant) la boue, *fanyas en (vieux) français ».
*« fange » en français moderne. Rashi prolonge ainsi : « Oui
Il a établi Il a préparé mes pas. », en l’occurrence sur Sèla, mot
hébreu traduit par « roc » ou « rocher ».
Sur le site http://www.cyber-contact.com/tehil40.html nous découvrons pour les versets 3 et pour le verset 4 évoquant un
« chant nouveau », ce commentaire appuyé sur les propos de
Rashi : « (3) Dans ce verset, David compare l’esclavage d’Egypte à
une ‘’fosse turbulente’’ et la mer Rouge, qui fut ensuite traversée par les
enfants d’Israël, à ‘’une fange boueuse’’ (Rachi). (4) Ce ‘’chant nouveau’’ est
le Cantique de la mer Rouge (Rashi). »
Dans la Bible annotée de Neuchâtel nous
trouvons cet intéressant commentaire : « De
la fosse meurtrière. On a traduit aussi : d'un puits qui menait un grand bruit.
Mais le mot hébreu que l'on traduit par bruit signifie aussi
destruction, et ce dernier sens est mieux à sa place dans ce passage. L'image
employée ici fait penser au traitement infligé à Joseph (Genèse 37.24) et à
Jérémie (Jérémie 38.6). « Le roc élevé et solide forme le contraste le plus
complet avec la fosse fangeuse, où l'on ne peut prendre pied. »
Ainsi donc dans un même passage
biblique, nous pouvons reconnaître tout à la fois, par la structure du texte,
le puits où Joseph fut descendu par ses frères mais aussi la traversée de la
mer Rouge qui va symboliser le retour de Joseph – ici synonyme de d’Israël –
dans la terre de Canaan.
Quant à ce roc ou rocher (hébreu
Séla) sur lequel après la traversée de la mer Rouge les Enfants d’Israël vont
se dresser, où se lever, il est associé par le commentateur Malbim à une
forteresse, « un endroit où mes ennemis ne pourront pas atteindre ».
Les ennemis sont bien sûr les Égyptiens et sur ce rocher, ils ne pourront pas
(ou plus) les atteindre. Nous avons pris connaissance plus haut dans cet
article de ce que Malbim écrivait sur le Migdol d’Égypte : « La puissante citadelle (ou ‘’tour’’, ou n’importe
quelle construction élevée méritant le nom de migdal, dont l’étymologie,
rappelons-le est gadol, GRAND) de l’Egypte ».
Pour le Rav Hillel Roiter,
Pi-ha-Hirot, Migdol et Baal-Tsephon ne formeraient qu’une seul entité, un seul
et unique lieu, celui de Gizeh avec les trois pyramides et le sphinx. La
signification de Pi-ha-Hirot est complexe, je l’avais en partie évoquée dans
cet ancien article : LA FOREST DE TOUPHON ET LA
PIERRE HORI. Le Rav Roiter retient l’idée
d’un rocher auquel les érosions de sable et de l’eau auraient prêté une
forme évocatrice d’un lion à buste d’homme. Il reprend en fait les propos
que l’on peut lire dans le n° 892 de Science et Vie – janvier 1992. Le
Sphinx que le Rav retrouve dans le nom de Baal-Tsephon (le Baal du Nord) serait
devenu synonyme de Liberté pour les Enfants d’Israël qui symboliquement se
dressèrent sur le Rocher (Séla) que Malbim associe à la forteresse, soit la Migdol
ou Grande Pyramide où aurait été entreposé l’or récolté par Joseph pour le
Pharaon. Le mot utilisé par Malbim est
Mibtsar, « forteresse » ou « tour ».
Bien qu’Alexandre Jullien souhaitait doter les
armoiries de Pélussin de trois étoiles, il n’en fut rien, ainsi que l’explique
Antonin Chavas : « Curieusement la nouvelle mairie porte un blason
avec trois sapins au lieu des trois étoiles prévues par la municipalité
Jullien. » Les sapins seraient-ils « plus expressifs et
représentatifs de Pélussin que les étoiles… » ainsi que l’avance A.
Chavas ?
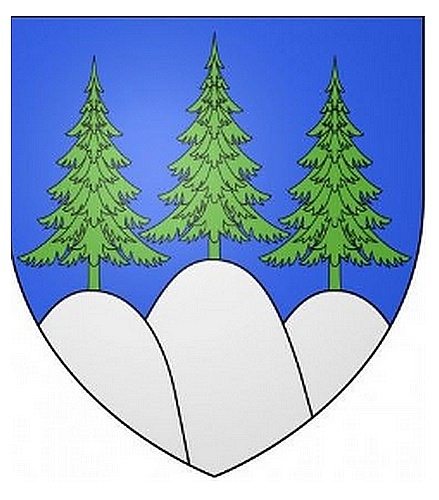
Blason de Pélussin
https://www.armorialdefrance.fr/page_blason.php?ville=8892 Site Internet de la commune,
2012.
Le blason de Pélussin se lit : « D’azur
à trois coupeaux d’argent rangés en fasce, chacun surmonté d’un sapin de
sinople. »
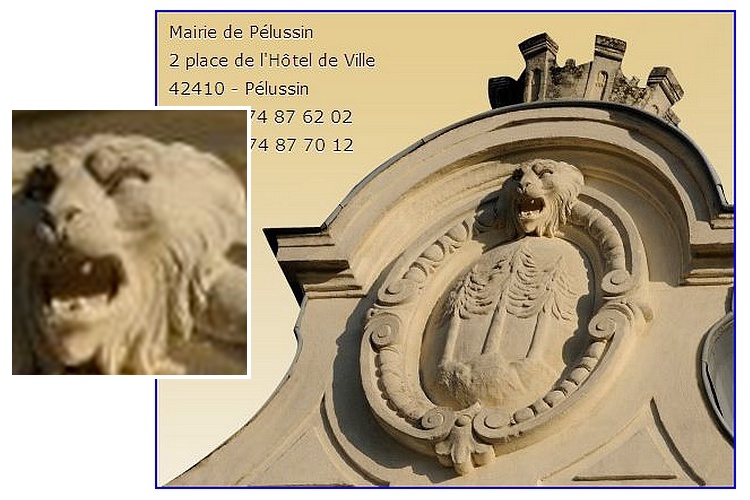
Blason
de Pélussin en façade de la mairie – en médaillon : détail du cimier
Ce blason sculpté, placé en fronton sur
la façade de la mairie, paraît saisissant. Retenons tout d’abord, en cimier, la
tête menaçante semblant faire corps avec
l’écu prenant la forme d’un tronc humain. La bouche grande ouverte ne montrant
que peu de dents mais assurément toujours capable de mordre ! Elle semble
veiller sur un secret tel le Sphinx Gardien du Secret. Le Rav Hillel Roiter
présente le Sphinx sous les traits de Baal-Tsephon le Baal du Nord (du Secret),
divinité antique. Sur la page internet de QUIZ PESSAH 5780 dans
lequel nous retrouvons de façon résumé quelques propos du Rav Hillel Roiter,
nous pouvons lire dans la question 637 : « Selon le Midrach, Baal
Tsefon ressemblait à un grand chien assis. D'après Rav Hillel Roiter il s'agit
du Sphynx (notez la similarité linguistique avec "Tséfon") dont le
rôle était de veiller sur Migdal, qui, toujours selon Rav Roiter, est la grande
pyramide de Gizeh adjacente au Sphynx, dans laquelle étaient entreposés les
trésors de Pharaon. »
https://www.torah-box.com/docs-hizouk/quizz-pessah.pdf
La tête du blason semble veiller tel le
Sphinx. Mais que garde-t-il ? Baal-Tsephon correspond aussi à Baal-Seepa,
le Seigneur à la Sombre Face. Arthur Conan Doyle dans son roman ésotérique La
Ville du Gouffre, en fait le maître de l’Atlantide. Guy Tarade dans ses
livres rappelle que certains chercheurs reconnaissent dans les lettres B.S. de
l’église Rennes-le-Château, Baal-Seepa, le seigneur à la face noire.
L’hébreu Tsephon ou Tsaphon, est connu en
langue hébraïque pour avoir une guématrie de 226 en tenant compte du fait que
chaque lettre est aussi un nombre. Le mot s’écrit avec un Tsadé (90), un Phé
(80), un Vav (6), un Noun (50) soit une longueur d’onde de 226. Or,
cette guématrie est aussi celle du nom de ville égyptienne de Pélussim (la Clé
de l’Égypte) : Pé (80), Lamed (30), Vav (6), Samekh (60), Yod (10), Mem
(40), soit un total de 226 !
Le blason apparaît très parlant avec ses
trois sapins. L’écu de forme ovale symbolise l’œuf. Aux XVIIe et
XVIIIe siècles, il fut utilisé comme cartouche, notamment pour la
figuration des armes de France, (sous le Roi-Soleil, précisément en référence à
ce nom…). Les trois sapins sont représentés de telle façon qu’ils se pénètrent
l’un l’autre de telle façon que l’arbre central semble cacher la forêt. Cette
représentation – trois sapins sur trois coupeaux – se démarque en fait d’une
figure héraldique nommée « forêt », représentée mouvante d’une
« motte ».
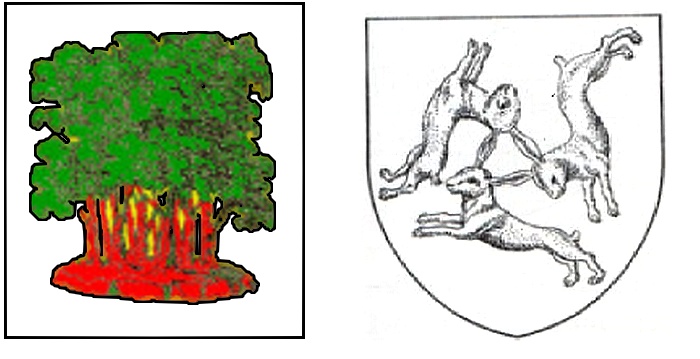
La
forêt héraldique – les trois lapins unis par les oreilles
Les trois sapins réunis par leurs
branches, le sont à la façon des lapins ou lièvres présents dans l’héraldique.
Ils tournoient semblant courir l’un après l’autre et joints ensemble par trois
oreilles disposées en triangle. Ce symbole était déjà connu dans l’Antiquité à
Babylone et en Égypte. L’oreille trinitaire qui relie les lapins/lièvres, relie
également les trois sapins. En effet, en vieux français, l’oreille (oraille ou
euralle) désigne aussi la lisière, l’orée de la forêt… une frontière entre la forêt
secrète (le triangle) et la campagne environnante où évolue l’homme au
quotidien. À noter, sur la commune de
Saint-Appolinard, localité la plus méridionale du canton de Pélussin, se trouve
le toponyme de l’Oreille.
https://www.amisdesparcs.fr/IMG/pdf/lieux_dits_canton_de_pelussin_maj_2016-2.pdf
Le Dictionnaire Godefroy à titre
d’exemple, mentionne dans la forêt de Benon (1273, Reg. Du Parl., Arch.
D26.) le : « droit de chasse aux lievres en l’oraille
… »
Les trois SaPiNs
reliés ensemble comme le sont les trois lapins ou lièvres, nous entraînent dans
un passage entre les langues. Les Phéniciens qui possédaient des
comptoirs sur la côte atlantique, reconnurent dans la Péninsule Ibérique, une
terre de lapins, aussi la nommèrent-ils SEPANA (hébreu
Shapan), lapin en langue phénicienne… d’où le nom du pays : ESPANA. Le nom
hébreu SEFINA ou SPINA, « navire », a aussi été avancé pour
l’Espagne. La racine de ce mot, SEFEN ou
SEPEN signifie « mystère », « secret », « caché ».
L’hébreu biblique Shapan, « daman » ou « lapin », a pour
racine « Sapan » : « caché », « trésor ».
Dans le triangle auriculaire se cache le trésor…
Bien que les trois sapins supplantent les
trois étoiles, ils ne les ont pas supprimées de la mémoire collective, bien au
contraire ! Les trois coupeaux d’argent, support des trois sapins,
devaient initialement soutenir les trois étoiles. Elles sont
symboliquement identiques aux trois pyramides de Gizeh reflet sur la terre des
trois étoiles du Baudrier d’Orion évoquées précédemment. Les trois pyramides et
peut-être plus spécifiquement la Grande Pyramide, qui nous accompagne depuis le
début de cette étude. Dans cette pyramide se trouve l’or de Joseph.
Antonin Chavas évoque ce qu’il nomme les CURIOSITÉS
ET MYSTÈRES DE PÉLUSSIN. Le premier mystère évoqué concerne le nombre trois
dont il constate la présence répétée dans le cirque montagneux où se niche
Pélussin : « – Le massif des TROIS dents. – Le Calvaire des
TROIS Croix… – Les TROIS Sapins – Les TROIS madones – La chapelle Sainte
Antoine dite des TROIS cochons, etc… Il
enchaîne ensuite sur un second mystère : l’année 881 gravée sur un mur de la
crypte de Notre Dame, signalée pour la première fois en 1893. L’actuelle église
fut terminée dans les années 1880, ainsi que le rappelle notre ami Thierry
Rollat dans son article La guerre des clochers. Antonin Chavas dans la
perspective de cette année 881 écrit : « Curieusement, dans
l’inauguration des travaux réalisés à la crypte Notre Dame et du nouveau
clocher de l’église en septembre 1881 ; cette similitude de date est
étonnante ». L’historien Pélussinois s’interroge sur une possible
confusion, voire une mauvaise lecture.
Nous pouvons
aussi y reconnaître une volonté de vouloir marquer le millénaire de la crypte.
Le clocher – la pyramide ou migdal – en cette année 1881 vient couronner ce
millénaire, initié dans le secret de la crypte où fut placée la Vierge noire.
Lorsque j’ai rédigé le conte de Noël Le dernier des VOYAGES EXTRAORDINAIRES
de Jules Verne, j’étais encore loin d’avoir commencé cet article, or il
apparaît que j’y évoquais ce nombre 881 en rappelant que les rabbins
l’associaient à la descente de Joseph fils de Jacob dans le puits d’où les
Ismaélites le retirèrent pour le vendre en Égypte. L’histoire de Joseph était
en route…
L’abbé Batia
rattache le millésime 881 au roi de Bourgogne et de Provence, Bozon siégeant à
Vienne. En 779 les rois Francs contestent cette royauté et mettent le siège
autour de Vienne. La reine Ermengarde dirigea la défense de la cité pendant que
le roi Bozon, suivant Batia, « tenait la campagne pour ravitailler Vienne
et harceler les assiégeants. La ville succomba en 881, après deux ans de
siège ; mais la nouvelle royauté de Bozon fut reconnue par Charles le
Chauve. » L’abbé Batia pense que le roi Bozon, s’en vint « dans ses
marches autour de Vienne […] dans la région Pélussinoise pour y cherchez des
vivres… ». Remarquons que les Frères de Lyon lorsqu’ils ont fui à
Pélussin, s’en venaient pareillement de Vienne, renseignés par les Frères de
Vienne suivant l’abbé Batia. L’abbé avance l’hypothèse suivant laquelle le roi
Bozon aurait inscrit ce millésime 881 suite à « quelque vœu ou promesse à
Notre-Dame-soubs-Terre ou quelque pieuse fondation faite par Bozon en
reconnaissance de l’heureuse issue de cette campagne qui aurait pu être
désastreuse pour lui ? ». La présence possible de Bozon à Pélussin,
venu chercher des vivres, rappelle quelque peu celle des frères de Joseph venus
avec leur père Jacob chercher du blé… un blé au final synonyme d’or…
Patrick
Berlier dans le livre LE PILAT MYSTÉRIEUX (chapitre NOTRE-DAME-SOUBS-TERRE,
LA VIERGE NOIRE DU PILAT), évoque de
façon bien intrigante « la plus curieuse figuration allégorique de la
Vierge, sous la forme d’une tour en marbre, haute de 1,50 m environ, avec
créneaux et mâchicoulis comme une tour médiévale. Elle repose sur un socle
hémisphérique autour duquel s’enroule un serpent. Cette tour n’est pas autre
chose qu’un tronc en réalité. » Patrick poursuit : « En haut, on lit ,une inscription en
latin : TVRRIS DAVIDICA ? LA Tour de David, qui est l’une des appellations de
Marie dans les Litanies de la Vierge. » Information d’importance et
bienvenue, rappelée par le Stéphanois : « Tour se dit migdal
en hébreu, et ce mot a donné Magdala, nom de la ville de Marie la Magdaléenne,
il y a donc par ce biais analogie entre Turris Davidica et sainte
Marie-Madeleine. » Et Patrick de conclure ainsi : « Cette œuvre
étonnante a été donnée par la famille Jullien de Pommerol au XIXe
siècle, à l’époque où elle faisait construire le château de Virieu en l’ornant
d’une tour néogothique assez semblable. »
Famille
Jullien de Pommerol ! Quelque part, nous pourrions dire : la boucle
est bouclée ! Le donateur, serait-il, le deux fois maire, Alexandre
Jullien, pierre majeure de la pyramide dans l’œuvre julienne
pélussinoise ? Une des pierres majeures fut assurément Roch Jullien. L’ami
Thierry m’écrit : « j'aime beaucoup le fait que les Pélussinois
puissent avoir sauvé la vie de Roch Jullien à La Révolution ».
Le mystère
de la Grande Pyramide, avancé par le Rav Hillel Roiter, marqué par la cité
égyptienne de Péluse, « clé de l’Égypte », a-t-il pérégriné jusque
dans la cité pilatoise de Pélussin ? L’idée d’une pyramide dans le Forez a été
déjà pensée mais de façon romanesque dans un
passé récent. Le penseur en question n’est autre que l’ami Patrick
Berlier. C’est ainsi que l’idée se profile quelque peu en 2006 dans l’article LA
PYRAMIDE DU BESSAT, LA CROIX DE CHAUBOURET ET LA CROIX DES FOSSES. Cette
idée sera développée trois années plus tard de belle façon dans le conte de
Noël, LE SECRET DE LA GRANDE PYRAMIDE UN CONTE D’UN AUTRE MONDE. Le
conte comporte assurément une vérité. Patrick projette la Grande Pyramide de
Gizeh sur le Pilat avec un Saint des Saints marqué par... une certaine croix...
Pélussin est extérieur à cette géographie sacrée formulée par Patrick mais
j’invite le lecteur intéressé par ce récit à le (re)découvrir. http://regardsdupilat.free.fr/bonneanneetrois.html
La pyramide pélussinoise,
si tant est qu’elle puisse être acceptée, fut assurément connue des Chevaliers
de Pulcin récemment évoqués par Thierry Rollat dans son très intéressant
article Les châteaux de Pélussin. Derrière ces chevaliers évoqués par
l’abbé Batia, plane l’ombre des Templiers dont on reconnaîtrait sur le
territoire de Pélussin ici et là quelques pierres de réemploi. Signe de piste
en direction de cette pyramide, apparaît semble-t-il la croix énigmatique de La
Valette au dos de laquelle se reconnaît le soleil et la lune… les Roussillon ne
sont pas loin… Admirons les photos de cette croix que Patrick nous présente
dans cet article consacré à la visite de CHRISTIAN DOUMERGUE RETOUR DANS LE
PILAT.
http://regardsdupilat.free.fr/chateauxdepelussin.html
http://regardsdupilat.free.fr/christianetkeida.html
Il y a
quelques années Thierry Rollat me donna le privilège de découvrir les
« signes venus d’ailleurs ». visibles au-dessus d’une cheminée dans
un environnement géographique semblant indéniablement templier... Je me
souviens avoir émis l’hypothèse suivant laquelle ces signes templiers
n’étaient pas étrangers au thème de la pyramide que l’on peut reconnaître par
deux fois (après retournement), coiffée de son pyramidion. http://regardsdupilat.free.fr/dessignesvenusd%27ailleurs.html
Le nombre 3
si présent à Pélussin, important chez les Druides mais aussi chez les
Templiers, m’a incité à dresser une pyramide mathématique à trois étages dont
la base serait marquée par le nombre clé 881.
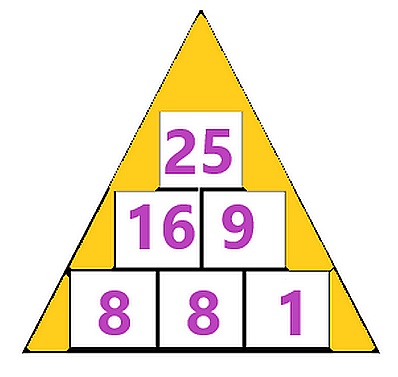
Pyramide mathématique de Pélussin
Le résultat
paraît résumer ce voyage autour de la « clé de l’Égypte » :
Bien sûr le nombre 881 dans la crypte
devait être inscrit en chiffres romains DCCCLXXXI mais nous pouvons tout à fait
l’étudier avec nos chiffres arabes connus déjà des Templiers. L’addition des
trois chiffres donne le nombre 17 et ce nombre a pour valeur secrète 153
(1+2+3+…+17). Le second étage de la pyramide mathématique ou additive se créé
après l’addition des deux cases de gauche, puis ensuite avec les deux cases de
droite… la seconde étant utilisée pour les deux additions. La même opération
sera effectuée avec le second étage pour découvrir le troisième. Évagre le
Pontique (346-399) moine ayant vécu dans le désert d’Égypte, a considéré que
153 représentait une harmonie de contrastes, puisque 153 = 100 + 28 + 25, avec
100 nous avons un carré, avec 28 un triangle et avec 25 un cercle. 153 = 100
(10*10, nombre carré) + 28 (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, nombre triangulaire,
sommation, pyramide) + 25 (=5*5, nombre automorphe, ou sphérique, dont les
chiffres du carré se terminent par le nombre lui-même, comme 76^2 = 5776), donc
réunion de 3 ordres.
La Grande Galerie de la Grande Pyramide
de Gizeh mesure environ 153 pieds de long. Georges Barbarin dans son
livre Le secret de la Grande Pyramide, utilisait ce nombre de pieds
mesurant dans sa longueur la Grande Galerie, comme un étalon permettant de
découvrir des événements relevant de la prophétie. Cette méthode fonctionne
pour certains événements mais beaucoup moins pour d’autres. Il n’en reste pas
moins que ce nombre 153 se retrouverait plusieurs fois dans ce monument. Le
nombre 25 couronnant la pyramide, se retrouve dans la lecture du nombre 153
faite par ce moine d’Égypte. Ce nombre est égal à 5 puissance 2. Le nombre 5
apparaît dans l’histoire de Joseph fils de Jacob, comme le nombre
caractéristique de l’Égypte pharaonique. Le nombre 16 de la case de gauche du
second étage de la pyramide mathématique, apparaît comme la guématrie ou valeur
numérique de Yo (Yod 10 – Vav 6), diminutif hébraïque de Yoseph ou Joseph. Le nombre 9 qui associé au 16 de Yo (Joseph :
« il ajoutera ») donnera le 25 du sommet de la pyramide, s’écrit en
hébreu avec la lettre Teth. Ainsi que l’indiquent Josy Eisenberg et Adin
Steinsaltz (L’Alphabet sacré – Éditions Fayard), cette lettre a la forme
de la grossesse. Elle symbolise en ce sens « les neuf mois de la
prégnance », temps de plénitude mais dont il faut sortir pour entrer dans
la vie.
Les hermétistes connaissent bien le signe
de la Grosse S. Cette grosse lettre apparaît d’étrange façon dans les graffiti
templiers de Chinon dans lesquels certains chercheurs ont voulu reconnaître le
Testament des Chevaliers de l’Ordre du Temple. Cette Grosse S apparaît comme
une Annonciation prédite par les Templiers. Encore une fois cette Grosse S peut
se trouver dans la vie de Joseph, au travers de ce que le peintre et rabbin
Israëlien Itzhak Besançon (Yosseph – Éditions du Chant Nouveau), nomme l’épisode de l’œuf… « Va te faire
cuire une œuf » ou la non grossesse en l’occurrence, mais qui
permit à Joseph suivant le commentaire de Rashi de Troyes, par son maintien du
« Pacte de Pureté », « de déchiffrer les signes qui sont enfouis
jusque dans les hiéroglyphes de l’impure Égypte » et ainsi, de faire face
aux années de famine en amassant le blé nécessaire pour survivre et ainsi
renforcer le « trésor » de Pharaon.
Cette Grosse S est représentée mais de
façon autre que celle de Chinon (qui évoque un cygne et son œuf) dans les « signes venus
d’ailleurs » évoqués ci-dessus. D’autres signes apparaissent communs à
ceux visibles dans cette maison du Pilat proche d’un ancien lieu templier et à
ceux visibles dans la tour de Coudray à Chinon. Notons le rapprochement esquissé
par Thierry Rollat entre ces signes représentés au-dessus d’une cheminée et le
puits à l’extérieur « de la maison aux signes ». Il invite le lecteur
à jeter « un œil averti vers et dans le puits qui parait lui aussi d’un
autre temps. »
Notre long
voyage, effectué grâce à la « clé de l’Égypte » qui nous a ouvert les
portes, s’arrêtera ici. Il conviendra à chacun de l’interpréter selon son
propre discernement.